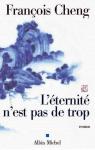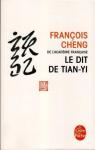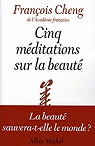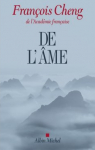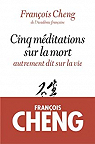Critiques de François Cheng (462)
Un livre sur la beauté
Le culte du beau, dans l’air du temps, n’est certes pas nouveau ; à la cour des rois de France, au Louvre ou à Versailles, le respect de « l’étiquette », l’adoption de la magnificence du dispendieux apparat, pour tenir son rang, étaient les contreparties des largesses de la monarchie absolue.
Mais aujourd’hui, l’omni présence de l’image, l’efficacité des outils médiatiques de masse donnent un hyper pouvoir universel de tous les instants aux standards de la mode et de la beauté.
Il faut plaire, séduire son futur employeur, le client, l’électeur... Il y a aussi ces « speed dating » où il faut emporter l’affaire en 5 mns pendant lesquelles une veste non griffée à la bonne marque, des rides imparfaitement masquées peuvent être fatales… « game over »..
L’apparence règne en maitre absolu et fait notamment le bonheur du scalpel esthétique. L’enveloppe charnelle est réputée refléter l’intérieur, un esprit sain dans un corps sain. ..
Cette connexion beauté plastique/perfection morale n’est pas non plus nouvelle. Dans la Grêce antique, la statue d’Hermès sur le site d’Olympie de Praxitèle, par exemple, ou les œuvres de Phidias sont présumées avoir arrêté à cet égard les normes esthétiques. Platon, dans son pétillant Banquet, considère que l’amour physique de deux corps, parfaits d’un point de vue plastique, constitue la première étape vers la perfection spirituelle. On relèvera accessoirement que cet idéal fonctionne dans le cadre de l’homosexualité masculine et la contradiction pour le moins paradoxale avec le cas Socrate, le maitre de Platon et dont Alcibiade chante les louanges dans ce Banquet ; Socrate était, parait-il, très laid. Enfin passons...
Beaucoup plus tard, mais dans le même esprit normatif Kant affirme pour sa part « est beau ce qui plait universellement sans concept ».
En réalité, et en faisant encore référence à Platon, tout se passe comme si nous étions de nouveau enfermés dans sa fameuse caverne où les seules images accessibles, en dépit de leur plasticité parfaite en surface, seraient des ombres d’idoles en 2D incertaines, déformées.., ces simulacres de la complexité de la richesse de la beauté.
La beauté disparait derrière le déluge du numérique, les extravagances d’une Lady Gaga et il n’y a (presque) plus de place pour l’émotion d’un visage comme celui d’Aung San Suu Kyi. C’est Cyrano que l’on assassine lâchement une seconde fois, les honneurs sont inaccessibles sans des traits sur papier glacé.
Et l’appel d’André Breton, « la beauté sera convulsive ou ne sera pas » semble nous parvenir comme la lumière fossile du big bang.
Nous nous sommes éloignés du livre, pas tant que cela, car l’intérêt de cet essai « œil ouvert et cœur battant » est encore plus marqué en ayant rappelé ce contexte si prégnant. François Cheng nous offre des clés pour s’ouvrir à une autre beauté, la redécouvrir, sans pour autant rompre complètement avec certains standards rappelés.
Ce livre est un vrai bonheur, d’abord au niveau formel. Il s’agit de discours prononcés à l’Académie française et au Collège des Bernardins retranscrits qui n’ont rien… d’académique.
L’auteur parle avec sa sensibilité, dans un style très personnel, bercé de lyrisme. La mise en page est bien faite, les discours dans leur présentation sont fractionnés dans des feuilles aérées qui rendent leur lecture et relecture par séquences plus confortable, un appel sinon à la méditation au moins à la réflexion. De plus, quelques très belles illustrations de peinture chinoise accompagnent le propos.
François Cheng développe une analyse qui constitue, sous un certain angle, un renversement des principes platoniciens ou de l’aphorisme martial du philosophe prussien évoqués précédemment.
Le sage part de l’intériorité de l’être en chantant son unicité, chaque être étant toutefois connecté en un immense réseau par lequel ne cesse de vibrer le souffle de l’infini. C’est cette unicité fondamentale qui est fondatrice de beauté ; chaque être vivant est unique, chaque être humain dispose d’une capacité à la beauté et éprouve un désir de beauté. A cet égard, il n’y a pas une universalité abstraite qui s’imposerait à tous, un quasi impératif esthétique, fort heureusement, serait-on tenté d’ajouter. Il ne s‘agit pas de tomber dans un subjectivisme, simplement d’affirmer que la beauté est une émotion permise par l’unicité, une révélation intérieure. La révélation de la beauté donne sens à la vie, tout particulièrement lorsque l’existence devient harmonie, communion, amour.
Cette beauté permet de transcender les conditions souvent tragiques de l’existence humaine ; à cet effet l’homme doit se mettre dans une position d’accueil pour être à même de rencontrer la beauté.
François Cheng distingue et hiérarchise les différentes beautés. La beauté du non vivant, le minéral naturel et les objets créés par l’homme, est formelle, tandis que celle des êtres vivants est physique.
Au-dessus de ces beautés faciales, la beauté de l’âme constitue l’expression la plus pure de la beauté.
Cette dernière catégorie est réservée aux hommes touchés par un éveil spirituel.
Cet éveil donne aux êtres touchés par cette transcendance une beauté encore plus singulière, plus émouvante, plus durable. C’est cette même beauté qui accompagne les amoureux, la présence de l’être aimé(e) exaltant les capacités à la beauté et à la bonté.
L’artiste à travers sa création permet aussi, comme le vit le sage, d’offrir une lumière et une beauté suprêmes, rencontre du monde sensible appréhendé par la sensibilité de l’artiste et de son propre univers, y compris ses pulsions les plus sombres. L’oeuvre d’art est beauté charnelle et spirituelle. L’âme de l’artiste est à la base de la création au delà de la technicité et du talent. L’auteur ne les cite pas, mais on pourrait évoquer ces fresques souterraines de Lascaux ou des grottes Cosquer et Chauvet qui semblent particulièrement en résonnance avec le propos. Même si les significations de ces œuvres sont à jamais scellées, la rencontre de la virtuosité artistique absolue et de l’élan spirituel anime à l’évidence ces créations.
Œil ouvert et cœur battant, c’est l’âme du petit personnage dans cette peinture chinoise. Il ne s’impose pas au premier plan comme dans les tableaux classiques de la tradition occidentale mais il accueille le souffle de la voie, reçoit la beauté qui transporte à son tour l’observateur attentif.
En conclusion, même si le lecteur n’est pas obligé d’adhérer au postulat de l’auteur, pour lequel, fondamentalement, l’univers n’est que beauté et que tout ceci n’est pas le fruit du hasard, cette oeuvre est un magnifique hymne à la beauté, à la croisée de l’occident et de la sagesse d’extrême orient, qui prolonge admirablement les très belles « cinq méditations sur la beauté » du même auteur.
Le culte du beau, dans l’air du temps, n’est certes pas nouveau ; à la cour des rois de France, au Louvre ou à Versailles, le respect de « l’étiquette », l’adoption de la magnificence du dispendieux apparat, pour tenir son rang, étaient les contreparties des largesses de la monarchie absolue.
Mais aujourd’hui, l’omni présence de l’image, l’efficacité des outils médiatiques de masse donnent un hyper pouvoir universel de tous les instants aux standards de la mode et de la beauté.
Il faut plaire, séduire son futur employeur, le client, l’électeur... Il y a aussi ces « speed dating » où il faut emporter l’affaire en 5 mns pendant lesquelles une veste non griffée à la bonne marque, des rides imparfaitement masquées peuvent être fatales… « game over »..
L’apparence règne en maitre absolu et fait notamment le bonheur du scalpel esthétique. L’enveloppe charnelle est réputée refléter l’intérieur, un esprit sain dans un corps sain. ..
Cette connexion beauté plastique/perfection morale n’est pas non plus nouvelle. Dans la Grêce antique, la statue d’Hermès sur le site d’Olympie de Praxitèle, par exemple, ou les œuvres de Phidias sont présumées avoir arrêté à cet égard les normes esthétiques. Platon, dans son pétillant Banquet, considère que l’amour physique de deux corps, parfaits d’un point de vue plastique, constitue la première étape vers la perfection spirituelle. On relèvera accessoirement que cet idéal fonctionne dans le cadre de l’homosexualité masculine et la contradiction pour le moins paradoxale avec le cas Socrate, le maitre de Platon et dont Alcibiade chante les louanges dans ce Banquet ; Socrate était, parait-il, très laid. Enfin passons...
Beaucoup plus tard, mais dans le même esprit normatif Kant affirme pour sa part « est beau ce qui plait universellement sans concept ».
En réalité, et en faisant encore référence à Platon, tout se passe comme si nous étions de nouveau enfermés dans sa fameuse caverne où les seules images accessibles, en dépit de leur plasticité parfaite en surface, seraient des ombres d’idoles en 2D incertaines, déformées.., ces simulacres de la complexité de la richesse de la beauté.
La beauté disparait derrière le déluge du numérique, les extravagances d’une Lady Gaga et il n’y a (presque) plus de place pour l’émotion d’un visage comme celui d’Aung San Suu Kyi. C’est Cyrano que l’on assassine lâchement une seconde fois, les honneurs sont inaccessibles sans des traits sur papier glacé.
Et l’appel d’André Breton, « la beauté sera convulsive ou ne sera pas » semble nous parvenir comme la lumière fossile du big bang.
Nous nous sommes éloignés du livre, pas tant que cela, car l’intérêt de cet essai « œil ouvert et cœur battant » est encore plus marqué en ayant rappelé ce contexte si prégnant. François Cheng nous offre des clés pour s’ouvrir à une autre beauté, la redécouvrir, sans pour autant rompre complètement avec certains standards rappelés.
Ce livre est un vrai bonheur, d’abord au niveau formel. Il s’agit de discours prononcés à l’Académie française et au Collège des Bernardins retranscrits qui n’ont rien… d’académique.
L’auteur parle avec sa sensibilité, dans un style très personnel, bercé de lyrisme. La mise en page est bien faite, les discours dans leur présentation sont fractionnés dans des feuilles aérées qui rendent leur lecture et relecture par séquences plus confortable, un appel sinon à la méditation au moins à la réflexion. De plus, quelques très belles illustrations de peinture chinoise accompagnent le propos.
François Cheng développe une analyse qui constitue, sous un certain angle, un renversement des principes platoniciens ou de l’aphorisme martial du philosophe prussien évoqués précédemment.
Le sage part de l’intériorité de l’être en chantant son unicité, chaque être étant toutefois connecté en un immense réseau par lequel ne cesse de vibrer le souffle de l’infini. C’est cette unicité fondamentale qui est fondatrice de beauté ; chaque être vivant est unique, chaque être humain dispose d’une capacité à la beauté et éprouve un désir de beauté. A cet égard, il n’y a pas une universalité abstraite qui s’imposerait à tous, un quasi impératif esthétique, fort heureusement, serait-on tenté d’ajouter. Il ne s‘agit pas de tomber dans un subjectivisme, simplement d’affirmer que la beauté est une émotion permise par l’unicité, une révélation intérieure. La révélation de la beauté donne sens à la vie, tout particulièrement lorsque l’existence devient harmonie, communion, amour.
Cette beauté permet de transcender les conditions souvent tragiques de l’existence humaine ; à cet effet l’homme doit se mettre dans une position d’accueil pour être à même de rencontrer la beauté.
François Cheng distingue et hiérarchise les différentes beautés. La beauté du non vivant, le minéral naturel et les objets créés par l’homme, est formelle, tandis que celle des êtres vivants est physique.
Au-dessus de ces beautés faciales, la beauté de l’âme constitue l’expression la plus pure de la beauté.
Cette dernière catégorie est réservée aux hommes touchés par un éveil spirituel.
Cet éveil donne aux êtres touchés par cette transcendance une beauté encore plus singulière, plus émouvante, plus durable. C’est cette même beauté qui accompagne les amoureux, la présence de l’être aimé(e) exaltant les capacités à la beauté et à la bonté.
L’artiste à travers sa création permet aussi, comme le vit le sage, d’offrir une lumière et une beauté suprêmes, rencontre du monde sensible appréhendé par la sensibilité de l’artiste et de son propre univers, y compris ses pulsions les plus sombres. L’oeuvre d’art est beauté charnelle et spirituelle. L’âme de l’artiste est à la base de la création au delà de la technicité et du talent. L’auteur ne les cite pas, mais on pourrait évoquer ces fresques souterraines de Lascaux ou des grottes Cosquer et Chauvet qui semblent particulièrement en résonnance avec le propos. Même si les significations de ces œuvres sont à jamais scellées, la rencontre de la virtuosité artistique absolue et de l’élan spirituel anime à l’évidence ces créations.
Œil ouvert et cœur battant, c’est l’âme du petit personnage dans cette peinture chinoise. Il ne s’impose pas au premier plan comme dans les tableaux classiques de la tradition occidentale mais il accueille le souffle de la voie, reçoit la beauté qui transporte à son tour l’observateur attentif.
En conclusion, même si le lecteur n’est pas obligé d’adhérer au postulat de l’auteur, pour lequel, fondamentalement, l’univers n’est que beauté et que tout ceci n’est pas le fruit du hasard, cette oeuvre est un magnifique hymne à la beauté, à la croisée de l’occident et de la sagesse d’extrême orient, qui prolonge admirablement les très belles « cinq méditations sur la beauté » du même auteur.
François Cheng nous fait entendre le langage de la peinture chinoise et tente de nous faire comprendre la syntaxe de ses signes.
Qu'est ce qu'un langage sinon la communication de l'expression d'une pensée au moyen de signes ?
La peinture chinoise est donc une « pensée en action », et plus encore un art de vivre, une philosophie, « la somme de leur conceptions de la vie », « En Chine, de tous les arts, la peinture occupe la place suprême ». Suprême parce que sacrée, parce que révélatrice, parce que re-création.
« En chine, l'art et l'art de la vie sont indissociables ». Dans ce « lieu médiumnique », le peintre se transporte, rejoint, atteint.
La tradition picturale chinoise remonte au début du premier millénaire. Successions de dynasties, unifications, divisions, invasions n'eurent de cesse de se succéder. À travers les siècles la peinture n'a cessé de se développer. Depuis la grande dynastie des Chin (3e-5e siècles) jusqu'à celle des Ts'ing (17e–19e siècles), les noms de ces grands peintres ont tracé chaque épisode de son illustre histoire.
Cheng s'attache ici à l'exploration du langage picturale profane, délaissant le courant religieux. Profane mais empli de spiritualité.
L'art du trait, voilà la base de cet art. Le trait. Immanquablement il nous revient en mémoire l'étude du point et ligne sur plan de Kandinsky. Ce point qui commençant à vivre, en devenant ligne, évoluant en « nécessité intérieure ». « Voilà le monde de la peinture » disait Kandinsky. Il y a là extraordinaire résonance. « Une ligne unit autant qu'elle divise » écrit Brusatin dans Histoire de la ligne. Et il ajoute « Un point génère le monde, deux points génèrent une vie qui est une ligne... ». Le « Peindre » est donc acte universel. « Poser un point, c'est semer un grain ; celui-ci doit pousser et devenir... » Huang Pin-Hung.
Le Trait donc. Ce trait de l'Esprit qui prononce l'état de l'âme. « Un et Multiple ». Le Trait d'Union entre l'homme et le surnaturel. Surnaturel puisqu'il devient « aussi vrai que la Nature elle-même ».
Voyages vers des espaces intérieurs infinis, le paysage n'est jamais figuratif. Pour entrer dans ce lieu, il faut comprendre l'aspiration du peintre. « Le regard du peintre est tourné vers le dedans ».
S'il est une particularité propre à ces peintures, c'est la place qu'elles offrent au Vide.
Tout ne se remplit pas. Tout ne se recouvre pas. Rien n'est lié. Tout est relié. Pleins, déliés, vagues, nuages, brumes, tendent par leur multiplicité à l'unité.
Et c'est par ce Vide, ces souffles vitaux que l'unicité de l'oeuvre peut apparaître. « tout est là dans le cœur ».
Le Vide est agissant, dynamique, l'espace nécessaire aux transformations, le lieu où le Plein peut se réaliser, le vide, ce non-avoir, ce Rien, cet élément central de l'école taoïste, l'école de la Voie. La Vallée qui mène à la Plénitude.
« La Grande Vallée est le lieu où l'on verse sans jamais remplir et où l'on puise sans jamais épuiser » - Chuang - Tzu.
L'Eau devient Montagne, la Montagne peut être Eau.
Voici leur Devenir réciproque, « cet universel écoulement, cet universel embrassement ».
Le Vide est le lieu du passage, le lieu des Mutations. Car les choses se reflètent les unes dans les autres. Il n'y a pas de dissociations, il y a basculement, embrassement. Tout n'existe qu'à la condition du Rien. « Toute chose réalise son même et son autre et par là atteint sa totalité ». La peinture chinoise est « une philosophie de vie en action ».
Il s'y passe quelque chose, quelque ici se réalise, aussi bien pour le peintre que pour le spectateur.
Le peintre prend vie dans son acte. La peinture chinoise ne copie pas, ne reproduit pas, ne mime pas, n'interprète pas, ne filtre pas, elle vit l'intériorité de l'être.
Le Vide, lieu d'émanation de l'Un, le Souffle primordial qui donne naissance au deux souffles vitaux : la force active le Yang et la douceur réceptive le Yin. Par leurs continuelles interactions ils animent les dix mille êtres du Monde.
Et pour que ces interactions se réalisent il faut l'action du vide médian qui entraîne les souffles vitaux dans un devenir réciproque.
Il est en somme le maître du ballet harmonique de l'équilibre du monde.
Et c'est ce vide médian résidant en toute chose qui permet à celle-ci d'être en relation avec le Vide suprême.
Deux axes régissent la cosmologie de cet univers. « un axe vertical qui représente le va-et-vient entre le Vide et le Plein, le Plein provenant du Vide et le Vide continuant à agir sur le Plein ; un axe horizontal qui représente l'interaction, au sein du Plein, des deux pôles complémentaires Yin et Yang dont procèdent les Dix mille êtres, y compris l'Homme, microcosme par excellence ». « Le Vide est la vêture du Yang et le Plein cœur du Yin ». Ting Kao.
Le devenir de l'Homme, troisième génie de l'Univers, avec le Ciel et la Terre, réunit en lui leurs vertus et il doit les mener à l'harmonie.
Voilà son voyage initiatique. « c'est ce qu'on appelle la nature innée. Qui perfectionne sa nature fait retour à sa vertu originelle. Qui atteint à sa vertu originelle s'identifie avec l'Origine de l'univers et par elle avec le Vide. »
Dans le cœur de l'Homme doit ainsi devenir le miroir du monde et voir apparaître en lui images et formes et maîtrisant l'Espace et le temps, il maîtrise la loi de la Transformation.
Ainsi est il possible, en suivant la Voie du Tao, de devenir miroir du monde et de soi-même, là s'inscrit la possibilité de vivre.
Rapport, harmonie, équilibre, rythme, mouvement, réciprocité, sont les points majuscules de la pensée et donc de la peinture chinoise, illustrant le Cycle infini du Tao.
Infini et non éternité, voici la grande spécificité de cet espace.
Dérouler une peinture c'est Dénouer le Temps. C'est rejoindre l'Esprit du Monde. Atteindre le Retour, cette « reprise en charge de toute la vie remémorée ou rêvée, sans cesse jaillissante », c'est entrer dans le mouvement circulaire de la Création. Par la « conscience du blanc et a contenance du Noir » accéder au Mystère, à la vision Suprême.
Le Trait, par l'encre et le pinceau, par l'esprit et la main, par le Souffle, par le cœur, par la structure de l'esprit, par l'harmonie de tout équilibre, par le rythme de l'écoulement de chaque chose en toute chose, est devenu un Art.
Pour citer Brusatin, il faut comprendre « comment se construit celui qui construit », ceci afin de parfaitement saisir la vérité de ce qui se construit.
C'est ce que François Cheng par « le Vide et le Plein, Le langage pictural chinois », a parfaitement réalisé.
Astrid Shriqui Garain
Qu'est ce qu'un langage sinon la communication de l'expression d'une pensée au moyen de signes ?
La peinture chinoise est donc une « pensée en action », et plus encore un art de vivre, une philosophie, « la somme de leur conceptions de la vie », « En Chine, de tous les arts, la peinture occupe la place suprême ». Suprême parce que sacrée, parce que révélatrice, parce que re-création.
« En chine, l'art et l'art de la vie sont indissociables ». Dans ce « lieu médiumnique », le peintre se transporte, rejoint, atteint.
La tradition picturale chinoise remonte au début du premier millénaire. Successions de dynasties, unifications, divisions, invasions n'eurent de cesse de se succéder. À travers les siècles la peinture n'a cessé de se développer. Depuis la grande dynastie des Chin (3e-5e siècles) jusqu'à celle des Ts'ing (17e–19e siècles), les noms de ces grands peintres ont tracé chaque épisode de son illustre histoire.
Cheng s'attache ici à l'exploration du langage picturale profane, délaissant le courant religieux. Profane mais empli de spiritualité.
L'art du trait, voilà la base de cet art. Le trait. Immanquablement il nous revient en mémoire l'étude du point et ligne sur plan de Kandinsky. Ce point qui commençant à vivre, en devenant ligne, évoluant en « nécessité intérieure ». « Voilà le monde de la peinture » disait Kandinsky. Il y a là extraordinaire résonance. « Une ligne unit autant qu'elle divise » écrit Brusatin dans Histoire de la ligne. Et il ajoute « Un point génère le monde, deux points génèrent une vie qui est une ligne... ». Le « Peindre » est donc acte universel. « Poser un point, c'est semer un grain ; celui-ci doit pousser et devenir... » Huang Pin-Hung.
Le Trait donc. Ce trait de l'Esprit qui prononce l'état de l'âme. « Un et Multiple ». Le Trait d'Union entre l'homme et le surnaturel. Surnaturel puisqu'il devient « aussi vrai que la Nature elle-même ».
Voyages vers des espaces intérieurs infinis, le paysage n'est jamais figuratif. Pour entrer dans ce lieu, il faut comprendre l'aspiration du peintre. « Le regard du peintre est tourné vers le dedans ».
S'il est une particularité propre à ces peintures, c'est la place qu'elles offrent au Vide.
Tout ne se remplit pas. Tout ne se recouvre pas. Rien n'est lié. Tout est relié. Pleins, déliés, vagues, nuages, brumes, tendent par leur multiplicité à l'unité.
Et c'est par ce Vide, ces souffles vitaux que l'unicité de l'oeuvre peut apparaître. « tout est là dans le cœur ».
Le Vide est agissant, dynamique, l'espace nécessaire aux transformations, le lieu où le Plein peut se réaliser, le vide, ce non-avoir, ce Rien, cet élément central de l'école taoïste, l'école de la Voie. La Vallée qui mène à la Plénitude.
« La Grande Vallée est le lieu où l'on verse sans jamais remplir et où l'on puise sans jamais épuiser » - Chuang - Tzu.
L'Eau devient Montagne, la Montagne peut être Eau.
Voici leur Devenir réciproque, « cet universel écoulement, cet universel embrassement ».
Le Vide est le lieu du passage, le lieu des Mutations. Car les choses se reflètent les unes dans les autres. Il n'y a pas de dissociations, il y a basculement, embrassement. Tout n'existe qu'à la condition du Rien. « Toute chose réalise son même et son autre et par là atteint sa totalité ». La peinture chinoise est « une philosophie de vie en action ».
Il s'y passe quelque chose, quelque ici se réalise, aussi bien pour le peintre que pour le spectateur.
Le peintre prend vie dans son acte. La peinture chinoise ne copie pas, ne reproduit pas, ne mime pas, n'interprète pas, ne filtre pas, elle vit l'intériorité de l'être.
Le Vide, lieu d'émanation de l'Un, le Souffle primordial qui donne naissance au deux souffles vitaux : la force active le Yang et la douceur réceptive le Yin. Par leurs continuelles interactions ils animent les dix mille êtres du Monde.
Et pour que ces interactions se réalisent il faut l'action du vide médian qui entraîne les souffles vitaux dans un devenir réciproque.
Il est en somme le maître du ballet harmonique de l'équilibre du monde.
Et c'est ce vide médian résidant en toute chose qui permet à celle-ci d'être en relation avec le Vide suprême.
Deux axes régissent la cosmologie de cet univers. « un axe vertical qui représente le va-et-vient entre le Vide et le Plein, le Plein provenant du Vide et le Vide continuant à agir sur le Plein ; un axe horizontal qui représente l'interaction, au sein du Plein, des deux pôles complémentaires Yin et Yang dont procèdent les Dix mille êtres, y compris l'Homme, microcosme par excellence ». « Le Vide est la vêture du Yang et le Plein cœur du Yin ». Ting Kao.
Le devenir de l'Homme, troisième génie de l'Univers, avec le Ciel et la Terre, réunit en lui leurs vertus et il doit les mener à l'harmonie.
Voilà son voyage initiatique. « c'est ce qu'on appelle la nature innée. Qui perfectionne sa nature fait retour à sa vertu originelle. Qui atteint à sa vertu originelle s'identifie avec l'Origine de l'univers et par elle avec le Vide. »
Dans le cœur de l'Homme doit ainsi devenir le miroir du monde et voir apparaître en lui images et formes et maîtrisant l'Espace et le temps, il maîtrise la loi de la Transformation.
Ainsi est il possible, en suivant la Voie du Tao, de devenir miroir du monde et de soi-même, là s'inscrit la possibilité de vivre.
Rapport, harmonie, équilibre, rythme, mouvement, réciprocité, sont les points majuscules de la pensée et donc de la peinture chinoise, illustrant le Cycle infini du Tao.
Infini et non éternité, voici la grande spécificité de cet espace.
Dérouler une peinture c'est Dénouer le Temps. C'est rejoindre l'Esprit du Monde. Atteindre le Retour, cette « reprise en charge de toute la vie remémorée ou rêvée, sans cesse jaillissante », c'est entrer dans le mouvement circulaire de la Création. Par la « conscience du blanc et a contenance du Noir » accéder au Mystère, à la vision Suprême.
Le Trait, par l'encre et le pinceau, par l'esprit et la main, par le Souffle, par le cœur, par la structure de l'esprit, par l'harmonie de tout équilibre, par le rythme de l'écoulement de chaque chose en toute chose, est devenu un Art.
Pour citer Brusatin, il faut comprendre « comment se construit celui qui construit », ceci afin de parfaitement saisir la vérité de ce qui se construit.
C'est ce que François Cheng par « le Vide et le Plein, Le langage pictural chinois », a parfaitement réalisé.
Astrid Shriqui Garain
Un roman peut-il être un livre de sagesse ? Les à priori ne le suggèrent apparemment pas ou alors que très peu. Cela semble pourtant être le cas pour "L'éternité n'est pas de trop" de François Cheng.
Nous sommes dans la seconde moitié du XVIIème siècle soit peu de temps après la chute du dernier empereur de la dynastie Ming. Voici Dao sheng. Il a passé de nombreuses années dans un monastère taoïste dans lequel il a acquis l'art de guérir et celui de la divination. Esprit indépendant, il a refusé de prononcer ses vœux et a choisi de prendre la route. Il porte en lui un précieux secret : le souvenir de l'amour qu'il porta à une jeune femme nommée Lan-ying.
Après plusieurs jours de marche, Dao sheng arrive dans une petite ville, chef-lieu d'un district qu'il connaît. Il se présente au monastère de l'endroit pour y obtenir l'hospitalité et y offrir ses services de guérisseur. Un jour, se déplaçant dans les rues de la cité et passant devant le domaine de la famille Zhao, lignée de seigneurs locaux, son attention est étrangement retenue par une présence : à un groupe de nécessiteux rassemblés, une femme à l'allure délicate et raffinée, un peu vieillie, distribue à manger. Intrigué, Dao sheng scrute lentement les traits du visage. L'émotion le saisit tout à coup : Se peut-il que...? Il vient de reconnaître Lan-ying.
Voilà tout le beau prétexte qu'a utilisé François Cheng pour imaginer et écrire "L'éternité n'est pas de trop", un roman qui fut, pour moi, une des plus belles lectures qui soient.
L'auteur magnifie l'amour dans une prose toute en retenue, une esthétique et une poétique qui m'ont séduit jusqu'aux dernières lignes du livre. Anciens amants, le passé de Dao sheng et de Lan-ying affleure le présent, suggère l'attente, le désir de l'autre sans jamais le révéler ou le remettre en cause dans l'absence de l'être aimé.
Juste un très très beau roman.
Nous sommes dans la seconde moitié du XVIIème siècle soit peu de temps après la chute du dernier empereur de la dynastie Ming. Voici Dao sheng. Il a passé de nombreuses années dans un monastère taoïste dans lequel il a acquis l'art de guérir et celui de la divination. Esprit indépendant, il a refusé de prononcer ses vœux et a choisi de prendre la route. Il porte en lui un précieux secret : le souvenir de l'amour qu'il porta à une jeune femme nommée Lan-ying.
Après plusieurs jours de marche, Dao sheng arrive dans une petite ville, chef-lieu d'un district qu'il connaît. Il se présente au monastère de l'endroit pour y obtenir l'hospitalité et y offrir ses services de guérisseur. Un jour, se déplaçant dans les rues de la cité et passant devant le domaine de la famille Zhao, lignée de seigneurs locaux, son attention est étrangement retenue par une présence : à un groupe de nécessiteux rassemblés, une femme à l'allure délicate et raffinée, un peu vieillie, distribue à manger. Intrigué, Dao sheng scrute lentement les traits du visage. L'émotion le saisit tout à coup : Se peut-il que...? Il vient de reconnaître Lan-ying.
Voilà tout le beau prétexte qu'a utilisé François Cheng pour imaginer et écrire "L'éternité n'est pas de trop", un roman qui fut, pour moi, une des plus belles lectures qui soient.
L'auteur magnifie l'amour dans une prose toute en retenue, une esthétique et une poétique qui m'ont séduit jusqu'aux dernières lignes du livre. Anciens amants, le passé de Dao sheng et de Lan-ying affleure le présent, suggère l'attente, le désir de l'autre sans jamais le révéler ou le remettre en cause dans l'absence de l'être aimé.
Juste un très très beau roman.
Sublime et bouleversant! Je n'aurai pas les mots pour rendre compte de la beauté de ce texte : un hymne à l'amour et à la féminité. Quelle profondeur, quelle sensibilité.
Merci Monsieur Cheng. Je n'arrive pas à modifier le nombre d'étoiles mais sans conteste C'est 5 étoiles !
Merci Monsieur Cheng. Je n'arrive pas à modifier le nombre d'étoiles mais sans conteste C'est 5 étoiles !
N°326– Février 2009
Le dit de Tianyi – François Cheng – Éditions Albin Michel [Prix Fémina 1998].
C'est une récit poignant par sa simplicité et surtout par son authenticité que nous offre François Cheng. C'est, la relation d'une vie tourmentée, celle de Tianyi [peintre né en 1925], ingrate, pauvre, visitée par la maladie et la mort. La Chine traditionnelle du début du XX° siècle est très attachée à la famille. La sienne est évoquée, avec ces éléments valeureux, qui marquent un enfant, et ceux qui le sont beaucoup moins. Il évoque son père, instituteur devenu écrivain public et calligraphe et qui mourra quand le narrateur a dix ans. Ce que je retiens plus volontiers, au lieu des images d'hommes, son grand-père et ses oncles dissemblables ou attachants, ce sont les figures féminines, sa jeune sœur morte tôt, sa mère, illettrée, dévouée et charitable qui « pratiquait les vertus d'humilité et de compassion » du bouddhisme, ses tantes dont l'une d'elles était demeurée célibataire parce que la vie avait étouffée chez elle cette espièglerie naturelle, une autre qui ne faisait que de courtes apparitions et qui avait vécu un temps en France, une autre enfin qui se pendit pour ne pas avoir connu sur terre et pendant son mariage le bonheur auquel elle estimait avoir droit. Ce qui retient cependant mon attention, c'est le personnage fulgurant de Yumei, que le narrateur retient sous le nom de « l'Amante » et qui l'impressionne par sa grande beauté et son sens de la liberté. L'adolescent qu'il est à l'époque ne peut rester insensible à son charme et il s'éprend d'elle en secret. Son amour ira grandissant avec le temps et l'absence et il finira par regarder la femme comme inaccessible. Cet attachement à la femme se vérifiera également dans la personne de Véronique, musicienne française rencontrée à Paris, torturée comme lui par la vie.
La seconde présence de ce roman est celle d'Haolang, l'ami d'enfance, communiste convaincu, le troisième élément du trio que le narrateur forme avec Yumei. Cette entente amicale à trois ne durera pas et, déçu par des gestes d'intimité qu'il surprend entre eux. Il en est bouleversé et déçu. A la faveur d'une bourse, il part pour la France où il mène une existence précaire, mais il trouve dans la peinture un baume à sa blessure mal fermée. Par Yumei, il apprend qu'Haolang est mort et décide de revenir en Chine, apprend que son amie s'est suicidée mais retrouve son camarade dans un camp de travail où il achève sa vie et lui confie ses écrits.
Drame de l'amour et de l'amitié sur fond de guerre sino-japonaise et de révolution culturelle chinoise, choc de deux civilisations entre l'occident qui ne pense qu'aux richesses et la Chine qui fait une grande place à la philosophie et à la religion, à l'équilibre du monde. La figure du moine taoïste qui apparaît dans la première partie du roman symbolise ces valeurs. Dans l'évocation de la Chine de Mao, qui forme en quelque sorte son pendant révolutionnaire, cette approche change pour laisser la place à la souffrance et à la mort. C'est donc un itinéraire intérieur et personnel, dans une trame historique, que nous livre l'auteur.
C'est aussi une quête impossible de la femme à travers les portraits esquissés de Yumei et de Véronique. Il oppose à sa propre vision du personnage féminin, magnifié à travers sa beauté, tissée notamment à travers la vision fugace de Yumei pendant ses ablutions, ces photos de femmes violées et cruellement humiliées pendant la guerre.
C'est également le mythe du retour qui est évoqué ici, retour douloureux vers cette Chine défigurée par le communisme avec, en filigranes la quête de Yumei qui se révélera vaine. En cela l'auteur semble nous dire que la femme est à la fois idéalisée et inaccessible. Sa recherche est promise à l'échec parce que le destin de l'homme lui-même débouche sur une impasse.
Pour autant, le narrateur enrichit son propos de développements passionnants notamment sur la peinture et la littérature occidentales. Il trouvera dans l'écriture, entendue à la fois comme une création et un acte de témoignage une manière de consolation à son mal-être intérieur.
L'écriture en est limpide, agréable à lire, poétique et nostalgique à la fois, attachante, par l'émotion que suscite ce récit. François Cheng, en spécialiste de la culture, communique à son lecteur attentif, au-delà même du récit, sa passion pour la connaissance, la profondeur de ses réflexions notamment sur le destin de l'homme, ce qui en fait un œuvre profonde et d'une grande richesse, au confluent de l'orient et de l'occident. Il semble dire que la valeur de l'homme, la seule peut-être, réside dans l'art, dans cette extraordinaire faculté qu'il possède à la fois de porter témoignage de son vécu et donc de la condition humaine de le transcender pour en faire une œuvre universelle et unique.
Hervé GAUTIER – Février 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
Lien : http://hervegautier.e-monsit..
Le dit de Tianyi – François Cheng – Éditions Albin Michel [Prix Fémina 1998].
C'est une récit poignant par sa simplicité et surtout par son authenticité que nous offre François Cheng. C'est, la relation d'une vie tourmentée, celle de Tianyi [peintre né en 1925], ingrate, pauvre, visitée par la maladie et la mort. La Chine traditionnelle du début du XX° siècle est très attachée à la famille. La sienne est évoquée, avec ces éléments valeureux, qui marquent un enfant, et ceux qui le sont beaucoup moins. Il évoque son père, instituteur devenu écrivain public et calligraphe et qui mourra quand le narrateur a dix ans. Ce que je retiens plus volontiers, au lieu des images d'hommes, son grand-père et ses oncles dissemblables ou attachants, ce sont les figures féminines, sa jeune sœur morte tôt, sa mère, illettrée, dévouée et charitable qui « pratiquait les vertus d'humilité et de compassion » du bouddhisme, ses tantes dont l'une d'elles était demeurée célibataire parce que la vie avait étouffée chez elle cette espièglerie naturelle, une autre qui ne faisait que de courtes apparitions et qui avait vécu un temps en France, une autre enfin qui se pendit pour ne pas avoir connu sur terre et pendant son mariage le bonheur auquel elle estimait avoir droit. Ce qui retient cependant mon attention, c'est le personnage fulgurant de Yumei, que le narrateur retient sous le nom de « l'Amante » et qui l'impressionne par sa grande beauté et son sens de la liberté. L'adolescent qu'il est à l'époque ne peut rester insensible à son charme et il s'éprend d'elle en secret. Son amour ira grandissant avec le temps et l'absence et il finira par regarder la femme comme inaccessible. Cet attachement à la femme se vérifiera également dans la personne de Véronique, musicienne française rencontrée à Paris, torturée comme lui par la vie.
La seconde présence de ce roman est celle d'Haolang, l'ami d'enfance, communiste convaincu, le troisième élément du trio que le narrateur forme avec Yumei. Cette entente amicale à trois ne durera pas et, déçu par des gestes d'intimité qu'il surprend entre eux. Il en est bouleversé et déçu. A la faveur d'une bourse, il part pour la France où il mène une existence précaire, mais il trouve dans la peinture un baume à sa blessure mal fermée. Par Yumei, il apprend qu'Haolang est mort et décide de revenir en Chine, apprend que son amie s'est suicidée mais retrouve son camarade dans un camp de travail où il achève sa vie et lui confie ses écrits.
Drame de l'amour et de l'amitié sur fond de guerre sino-japonaise et de révolution culturelle chinoise, choc de deux civilisations entre l'occident qui ne pense qu'aux richesses et la Chine qui fait une grande place à la philosophie et à la religion, à l'équilibre du monde. La figure du moine taoïste qui apparaît dans la première partie du roman symbolise ces valeurs. Dans l'évocation de la Chine de Mao, qui forme en quelque sorte son pendant révolutionnaire, cette approche change pour laisser la place à la souffrance et à la mort. C'est donc un itinéraire intérieur et personnel, dans une trame historique, que nous livre l'auteur.
C'est aussi une quête impossible de la femme à travers les portraits esquissés de Yumei et de Véronique. Il oppose à sa propre vision du personnage féminin, magnifié à travers sa beauté, tissée notamment à travers la vision fugace de Yumei pendant ses ablutions, ces photos de femmes violées et cruellement humiliées pendant la guerre.
C'est également le mythe du retour qui est évoqué ici, retour douloureux vers cette Chine défigurée par le communisme avec, en filigranes la quête de Yumei qui se révélera vaine. En cela l'auteur semble nous dire que la femme est à la fois idéalisée et inaccessible. Sa recherche est promise à l'échec parce que le destin de l'homme lui-même débouche sur une impasse.
Pour autant, le narrateur enrichit son propos de développements passionnants notamment sur la peinture et la littérature occidentales. Il trouvera dans l'écriture, entendue à la fois comme une création et un acte de témoignage une manière de consolation à son mal-être intérieur.
L'écriture en est limpide, agréable à lire, poétique et nostalgique à la fois, attachante, par l'émotion que suscite ce récit. François Cheng, en spécialiste de la culture, communique à son lecteur attentif, au-delà même du récit, sa passion pour la connaissance, la profondeur de ses réflexions notamment sur le destin de l'homme, ce qui en fait un œuvre profonde et d'une grande richesse, au confluent de l'orient et de l'occident. Il semble dire que la valeur de l'homme, la seule peut-être, réside dans l'art, dans cette extraordinaire faculté qu'il possède à la fois de porter témoignage de son vécu et donc de la condition humaine de le transcender pour en faire une œuvre universelle et unique.
Hervé GAUTIER – Février 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
Lien : http://hervegautier.e-monsit..
L'action de Quand reviennent les âmes errantes se passe en Chine approximativement en 230 av. J.-C. et s'inspire de faits réels. Cette période agitée a marqué la chute des Royaumes combattants. La période féodale a pris fin et l'empire de Chine est né.
François Cheng nous présente une version romanesque de cette période. Il a découpé son récit en 5 actes, qui s'ouvrent par un "Chœur" nous présentant le contexte. Puis 3 personnages se succèdent et prennent la parole sous la forme d'un monologue.
Chun-niang est une jeune femme d'une grande beauté. Après avoir été vendue par ses parents à cause d'un épisode de famine, elle est devenue serveuse dans une auberge.
Jing Ko est un mercenaire au grand cœur toujours prompt à défendre les causes justes. C'est une sorte de Robin des bois chinois.
Gao Jian-li est un musicien talentueux.
Entre eux va naître une relation profonde entre amour et amitié. Une relation plus forte que la jalousie. Une relation plus forte que la mort.
« Noble amitié, noble amour. Celui-ci instruit de la passion qui engage corps et âme ; celle-là enseigne l'infini respect, l'infini désintéressement. N'y a-t-il pas un ordre supérieur où le vrai trois est réalisable, corps à corps, âme à âme ? »
La forme originale de Quand reviennent les âmes errantes m'a de suite séduit. Cette narration, entre théâtre et tragédie antique, permet de vivre les événements selon le point de vue de nos trois protagonistes. Nous n'avons pas qu'une seule vision des événements. On nous montre les sentiments et les non dits. La relation à trois qui les unit nous apparaît alors dans toute sa profondeur.
Les premiers actes se succèdent. Le récit est doux et plaisant. Les personnages attachants. Puis, sans vraiment m'en apercevoir, j'ai commencé à sortir de l'histoire. Le récit a continué mais je n’étais plus qu'un spectateur détaché.
Ça reste agréable mais ce n'est plus passionnant. L'histoire d'amour à trois est belle et tendre. Elle est omniprésente. Probablement trop, l'équilibre que l'on avait entre le récit proprement dit et cette relation à plusieurs s’effondre dans la deuxième partie. L'histoire stagne dans des interrogations existentielles qui sont trop souvent répétitives. Dommage.
Reste alors un questionnement profond sur l'élévation des âmes par l'amour et l'amitié. Et ses dangereux ennemis qui pervertissent l'être humain : l’orgueil, la jalousie, la passion, l'ambition...
L'histoire comme la narration m'ont fait penser à l’excellent film de Zhang Yimou, Hero (2002). Je vous recommande vivement de le voir. Le questionnement y est très proche mais avec un souffle épique en plus.
Pour conclure, j'ai trouvé la deuxième partie de Quand reviennent les âmes errantes décevante. Toutefois, le livre reste agréable et il n'aurait pas fallu grand chose pour que celui-ci me charme.
Note : 6,5/10
Lien : http://www.les-mondes-imagin..
François Cheng nous présente une version romanesque de cette période. Il a découpé son récit en 5 actes, qui s'ouvrent par un "Chœur" nous présentant le contexte. Puis 3 personnages se succèdent et prennent la parole sous la forme d'un monologue.
Chun-niang est une jeune femme d'une grande beauté. Après avoir été vendue par ses parents à cause d'un épisode de famine, elle est devenue serveuse dans une auberge.
Jing Ko est un mercenaire au grand cœur toujours prompt à défendre les causes justes. C'est une sorte de Robin des bois chinois.
Gao Jian-li est un musicien talentueux.
Entre eux va naître une relation profonde entre amour et amitié. Une relation plus forte que la jalousie. Une relation plus forte que la mort.
« Noble amitié, noble amour. Celui-ci instruit de la passion qui engage corps et âme ; celle-là enseigne l'infini respect, l'infini désintéressement. N'y a-t-il pas un ordre supérieur où le vrai trois est réalisable, corps à corps, âme à âme ? »
La forme originale de Quand reviennent les âmes errantes m'a de suite séduit. Cette narration, entre théâtre et tragédie antique, permet de vivre les événements selon le point de vue de nos trois protagonistes. Nous n'avons pas qu'une seule vision des événements. On nous montre les sentiments et les non dits. La relation à trois qui les unit nous apparaît alors dans toute sa profondeur.
Les premiers actes se succèdent. Le récit est doux et plaisant. Les personnages attachants. Puis, sans vraiment m'en apercevoir, j'ai commencé à sortir de l'histoire. Le récit a continué mais je n’étais plus qu'un spectateur détaché.
Ça reste agréable mais ce n'est plus passionnant. L'histoire d'amour à trois est belle et tendre. Elle est omniprésente. Probablement trop, l'équilibre que l'on avait entre le récit proprement dit et cette relation à plusieurs s’effondre dans la deuxième partie. L'histoire stagne dans des interrogations existentielles qui sont trop souvent répétitives. Dommage.
Reste alors un questionnement profond sur l'élévation des âmes par l'amour et l'amitié. Et ses dangereux ennemis qui pervertissent l'être humain : l’orgueil, la jalousie, la passion, l'ambition...
L'histoire comme la narration m'ont fait penser à l’excellent film de Zhang Yimou, Hero (2002). Je vous recommande vivement de le voir. Le questionnement y est très proche mais avec un souffle épique en plus.
Pour conclure, j'ai trouvé la deuxième partie de Quand reviennent les âmes errantes décevante. Toutefois, le livre reste agréable et il n'aurait pas fallu grand chose pour que celui-ci me charme.
Note : 6,5/10
Lien : http://www.les-mondes-imagin..
Lu sur le conseil d'une amie et je l'en remercie.
Magnifique!
L'histoire, en soi un peu banale: une histoire d'amour impossible à l'époque Ming en Chine, mais magnifiée par la langue, les réflexions philosophiques, les personnages....
Les personnages sont conçus dans un réseau d'oppositions: celui qui aide/ celui qui maltraite, pauvre mais libre / riche mais enfermé(e) dans un monde d'interdits et de conventions, amour véritable/ pure pulsion, finesse et droiture / vulgarité et manipulation.....
N'hésitez pas un instant si vous ne l'avez pas encore lu!
Magnifique!
L'histoire, en soi un peu banale: une histoire d'amour impossible à l'époque Ming en Chine, mais magnifiée par la langue, les réflexions philosophiques, les personnages....
Les personnages sont conçus dans un réseau d'oppositions: celui qui aide/ celui qui maltraite, pauvre mais libre / riche mais enfermé(e) dans un monde d'interdits et de conventions, amour véritable/ pure pulsion, finesse et droiture / vulgarité et manipulation.....
N'hésitez pas un instant si vous ne l'avez pas encore lu!
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux
Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul
Puisqu'ils sont si nombreux
Même la morale parle pour eux
J'aimerais quand même te dire
Tout ce que j'ai pu écrire
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux
Francis Cabrel. L'encre de tes yeux.
Magnifique roman d'un amour empêché. Dao-Sheng est un moine taoiste et Lang-Ying, la femme du seigneur dans la Chine du XVII° siècle. Autant dire que les choses ne vont pas être simples, d'autant que ledit seigneur a déjà envoyé au bagne Dao-Sheng trente ans plus tôt pour avoir adressé un sourire à sa promise.
Éloge de la femme, de la beauté, de la poésie, de l'amour évidemment, ce roman est absolument magnifique et la plume de François Cheng, tout simplement magique pour capter l'instant d'une rencontre éphémère entre nos deux amoureux par-delà les conventions d'un pays et d'une époque.
Elle n'aimait pas mon deux pièces séjour
Mais toi qui voyages si tu la croises un jour
Reviens me dire
Reviens me dire
Dis-lui que pour elle je donnerais
Mon dernier souffle et même celui d'après
Celui d'après même
Celui d'après.
Francis Cabrel. Si tu la croises un jour.
Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul
Puisqu'ils sont si nombreux
Même la morale parle pour eux
J'aimerais quand même te dire
Tout ce que j'ai pu écrire
Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux
Francis Cabrel. L'encre de tes yeux.
Magnifique roman d'un amour empêché. Dao-Sheng est un moine taoiste et Lang-Ying, la femme du seigneur dans la Chine du XVII° siècle. Autant dire que les choses ne vont pas être simples, d'autant que ledit seigneur a déjà envoyé au bagne Dao-Sheng trente ans plus tôt pour avoir adressé un sourire à sa promise.
Éloge de la femme, de la beauté, de la poésie, de l'amour évidemment, ce roman est absolument magnifique et la plume de François Cheng, tout simplement magique pour capter l'instant d'une rencontre éphémère entre nos deux amoureux par-delà les conventions d'un pays et d'une époque.
Elle n'aimait pas mon deux pièces séjour
Mais toi qui voyages si tu la croises un jour
Reviens me dire
Reviens me dire
Dis-lui que pour elle je donnerais
Mon dernier souffle et même celui d'après
Celui d'après même
Celui d'après.
Francis Cabrel. Si tu la croises un jour.
« Point de retour sans aller
Point d'aller sans retour ».
« Tu entends enfin ton chant
qui lui même est appel
à tous les vents venant vers toi,
à tous les vols partant de toi,
à la terre explosée en fleurs… »
« À la source du Long Fleuve », « Austères glaciers »,« Tendre filet d'eau… »
« Voici que le fleuve retourne à sa source,
Que nous terminons notre grand périple. »
« Tant de jours à longer le fleuve millénaire,
Toujours à contre-courant, à contretemps »
« À sillonner l'aride haut-plateau,
Creusé de ravins, menacé de vautours,
À traquer chairs crues et fruits sauvages,
À dormir à même les herbes virginales,
À traverser le lac aux étoiles, poussant plus loin
Nos corps tatoués de gelures, de brûlures,
Minuscule caravane à bout d'endurance,
En ce point de l'ultime rendez-vous,
Austères glaciers, tendre filet d'eau,
Où toute fin est commencement. »
« Proche est le lointain,
Durable l'instant.
Quand le feu s'enfouit,
Quand se tait l'oiseau,
Tout tend vers son libre
Ou vers son repos. »
Stupéfiant silence...
Ici commence la rencontre , la joie de notre reconnaissance,
L'instant de l'échange.
« un oeil justifie la création
parce que l'oeil est regard et que le regard donne signe de vie »
« cendres-semences » , la « brume va monter de la vallée l'in-fini cet inachevé «
« Tout est signe » , alors « nous comprenons alors que nous aurons
à refaire le chemin parcouru »
« Le monde recommence »
Écoute !
« La nuit prépare le festin des jours »
Regarde !
« cette lumière tremblotante
sur le rebord de la coupe »
« Nous avons trop vécu pour ne plus être »
« Encore un jour de gloire
Pour ceux d'ici qui voient.
Gloire des corps, gloire des fruits.
Mystère même des étoiles.
Pour ceux qui voient et louent,
Nulle possession, nulle proie.
Sol nu buvant la source,
Rien d'autre que cri de joie.
Encore un jour de gloire
En-deçà, au-delà. »
« avant la tempête annoncée,
Il y a ce coin d'hiver,
ce coin perdu de l'univers,
où s'attarde un reste de soleil …. »
Lueur émise, flamme meneuse d'âmes,
« en cet instant de l'éternelle donation,
Ici retourné par un regard étonné
en perpétuelle offrande ».
Ô
« que toujours nos instants se fassent accueil »
« Mais ce qui a été vécu
sera rêvé ;
Et ce qui a été rêvé
Revécu. »
transmutation de toutes « douleurs bues » en leur renaissante tendresse.
« car tout est à revoir, tous les rires, tous les pleurs, toute la gloire »
maintenir la flamme allumée, veilleuse éternelle , pour toutes nos âmes errantes
« au royaume de l'infini, la moindre lueur est diamant. »
La vrai gloire est bien ici, dans le vide médian que libère le souffle de la Poésie.
« Vers son libre
vers son repos »…
source du renouveau.
Astrid Shriqui Garain
Lien : https://dutremblementdesarch..
Point d'aller sans retour ».
« Tu entends enfin ton chant
qui lui même est appel
à tous les vents venant vers toi,
à tous les vols partant de toi,
à la terre explosée en fleurs… »
« À la source du Long Fleuve », « Austères glaciers »,« Tendre filet d'eau… »
« Voici que le fleuve retourne à sa source,
Que nous terminons notre grand périple. »
« Tant de jours à longer le fleuve millénaire,
Toujours à contre-courant, à contretemps »
« À sillonner l'aride haut-plateau,
Creusé de ravins, menacé de vautours,
À traquer chairs crues et fruits sauvages,
À dormir à même les herbes virginales,
À traverser le lac aux étoiles, poussant plus loin
Nos corps tatoués de gelures, de brûlures,
Minuscule caravane à bout d'endurance,
En ce point de l'ultime rendez-vous,
Austères glaciers, tendre filet d'eau,
Où toute fin est commencement. »
« Proche est le lointain,
Durable l'instant.
Quand le feu s'enfouit,
Quand se tait l'oiseau,
Tout tend vers son libre
Ou vers son repos. »
Stupéfiant silence...
Ici commence la rencontre , la joie de notre reconnaissance,
L'instant de l'échange.
« un oeil justifie la création
parce que l'oeil est regard et que le regard donne signe de vie »
« cendres-semences » , la « brume va monter de la vallée l'in-fini cet inachevé «
« Tout est signe » , alors « nous comprenons alors que nous aurons
à refaire le chemin parcouru »
« Le monde recommence »
Écoute !
« La nuit prépare le festin des jours »
Regarde !
« cette lumière tremblotante
sur le rebord de la coupe »
« Nous avons trop vécu pour ne plus être »
« Encore un jour de gloire
Pour ceux d'ici qui voient.
Gloire des corps, gloire des fruits.
Mystère même des étoiles.
Pour ceux qui voient et louent,
Nulle possession, nulle proie.
Sol nu buvant la source,
Rien d'autre que cri de joie.
Encore un jour de gloire
En-deçà, au-delà. »
« avant la tempête annoncée,
Il y a ce coin d'hiver,
ce coin perdu de l'univers,
où s'attarde un reste de soleil …. »
Lueur émise, flamme meneuse d'âmes,
« en cet instant de l'éternelle donation,
Ici retourné par un regard étonné
en perpétuelle offrande ».
Ô
« que toujours nos instants se fassent accueil »
« Mais ce qui a été vécu
sera rêvé ;
Et ce qui a été rêvé
Revécu. »
transmutation de toutes « douleurs bues » en leur renaissante tendresse.
« car tout est à revoir, tous les rires, tous les pleurs, toute la gloire »
maintenir la flamme allumée, veilleuse éternelle , pour toutes nos âmes errantes
« au royaume de l'infini, la moindre lueur est diamant. »
La vrai gloire est bien ici, dans le vide médian que libère le souffle de la Poésie.
« Vers son libre
vers son repos »…
source du renouveau.
Astrid Shriqui Garain
Lien : https://dutremblementdesarch..
L'histoire de Dao-Sheng, médecin guérisseur, se situe en Chine au XVIIe siècle. Après 30 ans, il se décide à partir à la recherche d'un amour absolu, celui qu'il a ressenti pour une jeune fille avec laquelle il n'a pourtant échangé qu'un regard.
C'est avec beaucoup de poésie et une grande finesse que l'auteur nous transporte dans cette époque de la fin de la dynastie Ming où règne une réelle dureté d'existence pour de nombreux Chinois.
On retrouve également au fil de cette lecture la spiritualité et la sagesse des Moines Taoïstes.
L'essence même du livre reste cependant l'amour et la pureté des sentiments.
J'ai beaucoup aimé ce livre et je remercie lecteur84 pour ses conseils.
C'est avec beaucoup de poésie et une grande finesse que l'auteur nous transporte dans cette époque de la fin de la dynastie Ming où règne une réelle dureté d'existence pour de nombreux Chinois.
On retrouve également au fil de cette lecture la spiritualité et la sagesse des Moines Taoïstes.
L'essence même du livre reste cependant l'amour et la pureté des sentiments.
J'ai beaucoup aimé ce livre et je remercie lecteur84 pour ses conseils.
Tout jeune, c’est avec cet ouvrage que j’ai découvert François Cheng et la pensée sous-jacente à la peinture chinoise. Cet essai m’avait profondément marqué et c’est avec lui que je m’étais exercé pour la première fois au Shan shui, littéralement « montagne et eau », un style de peinture traditionnelle chinoise alliant expression littéraire et picturale au travers de la représentation d’un paysage naturel.
Comme le rappelle l’auteur, « en Chine, de tous les arts, la peinture occupe la place suprême. » C’est sans doute parce que nulle autre expression artistique ne possède une telle dimension syncrétique. Au travers de cet essai, François Cheng nous présente les éléments essentiels de la pensée philosophique et esthétique chinoise, mettant l’emphase sur une notion centrale, celle du Vide, avant de l’illustrer à partir de l’œuvre du célèbre Shitao, plus connu en France sous le nom de Moine Citrouille Amère, artiste peintre, poète et calligraphe de la dynastie Qing. Cette seconde partie m’avait parue à l’époque un peu plus cryptique, et ce n’est que bien plus tard, grâce à l’influence de Fabienne Verdier, que j’ai redécouvert Citrouille-Amère avec la traduction de ses propos et les commentaires de Pierre Ryckmans.
Après des préliminaires brossant rapidement l’évolution de l’art pictural au travers des dynasties chinoises, c’est donc au Vide que François Cheng consacre l’essentiel de son essai. Le Vide est un pivot autour duquel s’articulent toutes les formes artistiques (peinture, poésie, musique, théâtre) et même notre quotidien. Que serait la musique sans les silences entre les notes ? A quoi servirait une cruche sans le vide qui caractérise son usage ? De même, le vide structure la peinture et permet aussi de comprendre la philosophie et la cosmogonie chinoises. Cheng décortique les dualités (Pinceau-Encre, Yin-Yang, Montagne-Eau, Homme-Ciel), cite Lao-Tzu et Confucius, mais aussi Matisse et Ryckmans, nous emmène en voyage guidé dans les paysages peints et les poèmes qui les accompagnent, ne manquant pas d’offrir de nombreuses images pour accompagner ses propos.
Un essai érudit et lumineux, relu avec grand plaisir.
Comme le rappelle l’auteur, « en Chine, de tous les arts, la peinture occupe la place suprême. » C’est sans doute parce que nulle autre expression artistique ne possède une telle dimension syncrétique. Au travers de cet essai, François Cheng nous présente les éléments essentiels de la pensée philosophique et esthétique chinoise, mettant l’emphase sur une notion centrale, celle du Vide, avant de l’illustrer à partir de l’œuvre du célèbre Shitao, plus connu en France sous le nom de Moine Citrouille Amère, artiste peintre, poète et calligraphe de la dynastie Qing. Cette seconde partie m’avait parue à l’époque un peu plus cryptique, et ce n’est que bien plus tard, grâce à l’influence de Fabienne Verdier, que j’ai redécouvert Citrouille-Amère avec la traduction de ses propos et les commentaires de Pierre Ryckmans.
Après des préliminaires brossant rapidement l’évolution de l’art pictural au travers des dynasties chinoises, c’est donc au Vide que François Cheng consacre l’essentiel de son essai. Le Vide est un pivot autour duquel s’articulent toutes les formes artistiques (peinture, poésie, musique, théâtre) et même notre quotidien. Que serait la musique sans les silences entre les notes ? A quoi servirait une cruche sans le vide qui caractérise son usage ? De même, le vide structure la peinture et permet aussi de comprendre la philosophie et la cosmogonie chinoises. Cheng décortique les dualités (Pinceau-Encre, Yin-Yang, Montagne-Eau, Homme-Ciel), cite Lao-Tzu et Confucius, mais aussi Matisse et Ryckmans, nous emmène en voyage guidé dans les paysages peints et les poèmes qui les accompagnent, ne manquant pas d’offrir de nombreuses images pour accompagner ses propos.
Un essai érudit et lumineux, relu avec grand plaisir.
J'aime. Purs et scintillants comme des joyaux, les mots courent et coulent comme les eaux tempétueux d'un torrent de montagne. Lecture rafraichissante et une histoire où l'Amour cherche sa voie dans un dédale de codes anciens. La poésie toujours présente, rappelle les contes d'autrefois. Un petit trésor à conserver précieusement.
Je suis surpris moi-même. Est-ce l’effet du confinement ? Est-ce parce qu’en ce moment je n’ai pas le cœur à lire ? Est-ce parce que je me pose beaucoup de question sur l’instant dans l’univers qu’est notre vie ? Est-ce parce que j’ai 58 ans en 2020 ? Qu’on est au mois de Mai ?
Je ne sais pas ?
Mais ce roman m’a laisser de marbre, froid, aucune empathie avec les personnages ? Est-ce parce que cela me semble être l’élite de ceux qui ont tout compris ?
C’est superbement écrit. C’est d’une belle fluidité, c’est très évocateur comme un dépliant touristique de Venise écrit par Thomas Mann ? Virtuose par moment.
Mais je n’en retire aucune citation, aucune profondeur qui me corresponde. Je suis resté sur le pas de la porte. J’ai peur qu’avec les mois j’oublie même l’histoire, et peut-être même que je l’ai lu. Peut-être qu’un jour j’y reviendrais, mais ce n’est pas le moment pour moi. Je retourne aux dialogues avec l’ange et je commence L’effort d’être spectateur de Pierre Notte.
Je suis surpris moi-même.
Lien : https://tsuvadra.blog/2020/0..
Je ne sais pas ?
Mais ce roman m’a laisser de marbre, froid, aucune empathie avec les personnages ? Est-ce parce que cela me semble être l’élite de ceux qui ont tout compris ?
C’est superbement écrit. C’est d’une belle fluidité, c’est très évocateur comme un dépliant touristique de Venise écrit par Thomas Mann ? Virtuose par moment.
Mais je n’en retire aucune citation, aucune profondeur qui me corresponde. Je suis resté sur le pas de la porte. J’ai peur qu’avec les mois j’oublie même l’histoire, et peut-être même que je l’ai lu. Peut-être qu’un jour j’y reviendrais, mais ce n’est pas le moment pour moi. Je retourne aux dialogues avec l’ange et je commence L’effort d’être spectateur de Pierre Notte.
Je suis surpris moi-même.
Lien : https://tsuvadra.blog/2020/0..
Après la découverte des Cinq méditations sur la mort que j'avais trouvé très intéressantes, j'avais vraiment hâte de découvrir ces Cinq méditations sur la beauté.
Dans ces cinq méditations, François Cheng fait appel à des références classiques occidentales comme orientales qu'elles soient littéraires, artistiques, religieuses ou philosophiques pour mieux éclairer cette notion quelque peu énigmatique.
S'il est vrai que la lecture de cet essai était intéressante, celle-ci me fut plus difficile que l'autre ouvrage de François Cheng à cause des trop nombreuses digressions qui donnent une impression de construction bancales et perdent le lecteur. À l'issue de cette lecture, on a certes quelques pistes, mais on est pas très sûr de savoir où l'auteur à voulu en venir.
De plus certains aspects de la question m'ont paru trop développées (compte tenu de ce qu'elles amenaient au développement) alors qu'à l'inverse, certains arguments que je trouvais très intéressants ont été trop vite expédiés à mon goût.
Dans ces cinq méditations, François Cheng fait appel à des références classiques occidentales comme orientales qu'elles soient littéraires, artistiques, religieuses ou philosophiques pour mieux éclairer cette notion quelque peu énigmatique.
S'il est vrai que la lecture de cet essai était intéressante, celle-ci me fut plus difficile que l'autre ouvrage de François Cheng à cause des trop nombreuses digressions qui donnent une impression de construction bancales et perdent le lecteur. À l'issue de cette lecture, on a certes quelques pistes, mais on est pas très sûr de savoir où l'auteur à voulu en venir.
De plus certains aspects de la question m'ont paru trop développées (compte tenu de ce qu'elles amenaient au développement) alors qu'à l'inverse, certains arguments que je trouvais très intéressants ont été trop vite expédiés à mon goût.
Bon. Au risque de ne pas faire très "intello", je dirai que c'est un livre que je vais devoir relire pour tout saisir, si possible... Ce questionnement n'est pas pour me déplaire, loin s'en faut. L'âme. .. cette part de nous qui demeure un profond mystère , et qui cependant semble , de la triade" âme corps esprit" , être la seule à porter en elle une promesse d'éternité, de plus d'amour envers les autres et soi même. .. Monsieur F. Cheng est assurément très érudit, mais ses écrits s'adressent au "tout public ", aux citoyens lambdas dont je fais partie. Je regrette une chose. C'est qu' il ne se soit pas suffisamment mis à ma portée . Il ne s'agit pas bien entendu de faire au plus simple car je ne suis pas tout à fait stupide. Il s'agit de se souvenir, quand on s'adresse aux lecteurs, que nous ne sommes pas tous philosophes et académiciens. Tout le monde semble avoir tout compris. Eh bien moi non. Je sors plutôt frustrée de cette lecture. Dommage.
Un essai philosophique, très dense, sur la beauté, découpé en cinq méditations, et dont la lecture n'est pas toujours aisée, du moins ne l'a pas toujours été pour moi. De très beaux passages, et d'autres plus ardus, relus plusieurs fois et dont la compréhension m'a parfois échappé.
J'ai beaucoup aimé les passages évoquant la beauté artistique dans la peinture, "tout tableau chinois, relevant d'une peinture non naturaliste mais spiritualiste, est à contempler comme un paysage de l'âme", dans la poésie, ou encore la beauté du monde, de la nature qui justifie finalement notre existence sur terre.
«De tout temps en Chine, poètes et peintres sont avec la nature dans cette relation de connivence et de révélation mutuelle. La beauté du monde est un appel, au sens le plus concret du mot, et l'homme, cet être de langage, y répond de toute son âme. Tout se passe comme si l'univers, se pensant, attendait l'homme pour être dit.»
«Je ne tarde pas à découvrir la chose magique qu'est l'art. Les yeux écarquillés je commence à regarder plus attentivement la peinture chinoise qui recrée si merveilleusement les scènes brumeuses de la montagne. Et découverte parmi les découvertes ; un autre type de peinture. [...] Nouveau choc devant le corps nu des femmes si charnellement et si idéalement montré : Vénus grecques , modèles de Botticelli, du Titien, et surtout, plus proches de nous, de Chassériau, d'Ingres. La Source d'Ingres, emblématique, pénètre l'imaginaire de l'enfant, lui tire des larmes, lui remue le sang.»
L'auteur évoque et détaille parfois scrupuleusement certains tableaux ou paysages, et permet à l'esprit de s'évader, suscite le questionnement, la méditation ... un cheminement vers la spiritualité.
«La terre est une vallée où poussent les âmes.» Keats
«En tant que présence, chaque être est virtuellement habité par la capacité à la beauté, et surtout par le « désir de beauté »
«La beauté nous paraît presque toujours tragique, hantés que nous sommes par la conscience que toute beauté est éphémère.»
Un essai de qualité, que je lirai de nouveau, très certainement, pour en saisir toute la grandeur.
Lien : https://seriallectrice.blogs..
J'ai beaucoup aimé les passages évoquant la beauté artistique dans la peinture, "tout tableau chinois, relevant d'une peinture non naturaliste mais spiritualiste, est à contempler comme un paysage de l'âme", dans la poésie, ou encore la beauté du monde, de la nature qui justifie finalement notre existence sur terre.
«De tout temps en Chine, poètes et peintres sont avec la nature dans cette relation de connivence et de révélation mutuelle. La beauté du monde est un appel, au sens le plus concret du mot, et l'homme, cet être de langage, y répond de toute son âme. Tout se passe comme si l'univers, se pensant, attendait l'homme pour être dit.»
«Je ne tarde pas à découvrir la chose magique qu'est l'art. Les yeux écarquillés je commence à regarder plus attentivement la peinture chinoise qui recrée si merveilleusement les scènes brumeuses de la montagne. Et découverte parmi les découvertes ; un autre type de peinture. [...] Nouveau choc devant le corps nu des femmes si charnellement et si idéalement montré : Vénus grecques , modèles de Botticelli, du Titien, et surtout, plus proches de nous, de Chassériau, d'Ingres. La Source d'Ingres, emblématique, pénètre l'imaginaire de l'enfant, lui tire des larmes, lui remue le sang.»
L'auteur évoque et détaille parfois scrupuleusement certains tableaux ou paysages, et permet à l'esprit de s'évader, suscite le questionnement, la méditation ... un cheminement vers la spiritualité.
«La terre est une vallée où poussent les âmes.» Keats
«En tant que présence, chaque être est virtuellement habité par la capacité à la beauté, et surtout par le « désir de beauté »
«La beauté nous paraît presque toujours tragique, hantés que nous sommes par la conscience que toute beauté est éphémère.»
Un essai de qualité, que je lirai de nouveau, très certainement, pour en saisir toute la grandeur.
Lien : https://seriallectrice.blogs..
« Enfin le royaume »… Comme un lieu situé au bout d'un long chemin, d'un long périple, comme un point de destination longtemps recherché, enfin atteint.
Le titre de ce recueil de François Cheng, plus qu'un lieu géographique, une contrée localisée, évoque plus un état intérieur de l'être, une disposition du moi porté vers l'écoute, le silence et le recueillement.
Un chemin qui part de soi et qui, par un long détour, revient à soi. Ce royaume, c'est ce pays qui s'ouvre au regard qui se porte vers les choses simples, sur le don inépuisable de la nature, vers cette « vaste réserve, inépuisable, que contient pourtant ce coeur nôtre ».
Au travers de tous les quatrains qui composent « Enfin le royaume », il est aisé de reconnaître l'influence du taoïsme, ce courant de pensée de la Chine du IIIème siècle avant notre ère, très préoccupé de l'individu, de sa conscience et de sa vie spirituelle, en quête incessante d'une harmonie avec la nature et l'univers.
Cette influence imprègne toute l'écriture de François Cheng et tout particulièrement ce recueil. le corps du sujet n'est ici jamais évoqué ou dépeint. le sujet est pleine conscience de l'instant et du rapport qu'il entretient avec la nature, avec son environnement. Seule la pensée structure son être.
Dans chaque poème du livre, les mots fertilisent la pensée de l'auteur, l'éveillent dans un haut degré de perfection. Chaque texte éveille, suscite ensuite chez le lecteur une émotion, une révélation qu'il faut prendre le temps d'accueillir en soi pour qu'elle trouve sa pleine expression, à des degrés divers.
Ici l'intime contient le tout. Il s'incarne jusque dans la matière, dans le rythme fluctuant des mots. Souvent à la lecture des courts poèmes, les images affluent, dont la précision du trait et la naïveté du thème ressemblent à des estampes, à des représentations venues d'un lointain imaginaire.
Plus peut-être que d'autres recueils de François Cheng, j'ai particulièrement apprécié la lecture d'« Enfin le royaume ». Une écriture détachée mais tout entière dévouée à ce qui fait sens et créé du lien, une écriture « où tout demeure en soi et se change en son autre ».
Héritière d'une pensée et d'une tradition anciennes, l'écriture de François Cheng ne cesse d'instruire dans un temps qui nous appartient mais qui, aussi, va au-devant de nous, malgré nous.
« Le vrai toujours
Est ce qui tremble
Entre frayeur et appel,
Entre regard et silence »
Le titre de ce recueil de François Cheng, plus qu'un lieu géographique, une contrée localisée, évoque plus un état intérieur de l'être, une disposition du moi porté vers l'écoute, le silence et le recueillement.
Un chemin qui part de soi et qui, par un long détour, revient à soi. Ce royaume, c'est ce pays qui s'ouvre au regard qui se porte vers les choses simples, sur le don inépuisable de la nature, vers cette « vaste réserve, inépuisable, que contient pourtant ce coeur nôtre ».
Au travers de tous les quatrains qui composent « Enfin le royaume », il est aisé de reconnaître l'influence du taoïsme, ce courant de pensée de la Chine du IIIème siècle avant notre ère, très préoccupé de l'individu, de sa conscience et de sa vie spirituelle, en quête incessante d'une harmonie avec la nature et l'univers.
Cette influence imprègne toute l'écriture de François Cheng et tout particulièrement ce recueil. le corps du sujet n'est ici jamais évoqué ou dépeint. le sujet est pleine conscience de l'instant et du rapport qu'il entretient avec la nature, avec son environnement. Seule la pensée structure son être.
Dans chaque poème du livre, les mots fertilisent la pensée de l'auteur, l'éveillent dans un haut degré de perfection. Chaque texte éveille, suscite ensuite chez le lecteur une émotion, une révélation qu'il faut prendre le temps d'accueillir en soi pour qu'elle trouve sa pleine expression, à des degrés divers.
Ici l'intime contient le tout. Il s'incarne jusque dans la matière, dans le rythme fluctuant des mots. Souvent à la lecture des courts poèmes, les images affluent, dont la précision du trait et la naïveté du thème ressemblent à des estampes, à des représentations venues d'un lointain imaginaire.
Plus peut-être que d'autres recueils de François Cheng, j'ai particulièrement apprécié la lecture d'« Enfin le royaume ». Une écriture détachée mais tout entière dévouée à ce qui fait sens et créé du lien, une écriture « où tout demeure en soi et se change en son autre ».
Héritière d'une pensée et d'une tradition anciennes, l'écriture de François Cheng ne cesse d'instruire dans un temps qui nous appartient mais qui, aussi, va au-devant de nous, malgré nous.
« Le vrai toujours
Est ce qui tremble
Entre frayeur et appel,
Entre regard et silence »
Élu immortel parmi les immortels en 2002, François Cheng signe avec cet ouvrage un élégant recueil de textes et calligraphies dont le souffle poétique est empreint de philosophie asiatique aux influences taoïstes, zen ou shintô. Entre citations de poètes chinois fameux et réflexions sur l'art délicat de la calligraphie, l'auteur se prête à des confidences personnelles sur le moment créateur ou certains passages de sa vie qui l'ont profondément affecté, inspiré et transformé. le souvenir insuffle alors la vie aux idéogrammes, les nourrit et les anime.
Poèmes, aphorismes ou simples combinaisons de caractères aux profondes racines sémantiques s'enchaînent en pleins et déliés d'encre noire sur ombres grises, où les spontanés et inattendus « blancs volants » de l'encre raréfiée réjouissent le calligraphe en permettant « la circulation du souffle dans le trait même ». Les signes tracés par le pinceau de François Cheng sont puissants mais racés, pénétrés par une fulgurance de la pensée et du geste tous deux animés par un souffle intime. L'espace est colonisé avec un équilibre remarquable, traversé par des obliques téméraires ou ployé dans des courbes serpentines. François Cheng se nourrit de la tradition sans hésiter à la bousculer tout en se bousculant lui-même.
J'ai aimé tracer du doigt dans le vide ces signes à l'âme vive, afin de retrouver le geste de l'artiste, ses mouvements de pinceaux, ses élans et ses retenues. Mon seul regret est que la transcription en pinyin des poèmes et idéogrammes ne soit pas proposée. Car pour celui qui ne maîtrise pas la langue, il manque le son au signe, toute une dimension alors inaccessible au profane.
Un bel ouvrage sur la magie de la calligraphie chinoise, probablement le plus personnel de François Cheng. le portrait de son âme à l'encre de Chine.
Poèmes, aphorismes ou simples combinaisons de caractères aux profondes racines sémantiques s'enchaînent en pleins et déliés d'encre noire sur ombres grises, où les spontanés et inattendus « blancs volants » de l'encre raréfiée réjouissent le calligraphe en permettant « la circulation du souffle dans le trait même ». Les signes tracés par le pinceau de François Cheng sont puissants mais racés, pénétrés par une fulgurance de la pensée et du geste tous deux animés par un souffle intime. L'espace est colonisé avec un équilibre remarquable, traversé par des obliques téméraires ou ployé dans des courbes serpentines. François Cheng se nourrit de la tradition sans hésiter à la bousculer tout en se bousculant lui-même.
J'ai aimé tracer du doigt dans le vide ces signes à l'âme vive, afin de retrouver le geste de l'artiste, ses mouvements de pinceaux, ses élans et ses retenues. Mon seul regret est que la transcription en pinyin des poèmes et idéogrammes ne soit pas proposée. Car pour celui qui ne maîtrise pas la langue, il manque le son au signe, toute une dimension alors inaccessible au profane.
Un bel ouvrage sur la magie de la calligraphie chinoise, probablement le plus personnel de François Cheng. le portrait de son âme à l'encre de Chine.
« Le livre d’une vie » annonce le bandeau en couverture.
Et c’est parfaitement résumé.
C’est en tout cas certainement l’un des livres majeurs de François Cheng, livre dans lequel il revient sur sa vie et le parcours qui l’a amené à vivre en France et à « s’unir au chant français » (ce sont ses mots) par sa passion pour la littérature et la poésie.
François Cheng est depuis longtemps une voie précieuse, véritable passeur entre deux cultures (chinoise et française).
C’est un écrivain qui transmet à merveille sa sagesse, ses passions et son regard poétique sur la vie.
Une lecture lumineuse et qui grandit.
Et c’est parfaitement résumé.
C’est en tout cas certainement l’un des livres majeurs de François Cheng, livre dans lequel il revient sur sa vie et le parcours qui l’a amené à vivre en France et à « s’unir au chant français » (ce sont ses mots) par sa passion pour la littérature et la poésie.
François Cheng est depuis longtemps une voie précieuse, véritable passeur entre deux cultures (chinoise et française).
C’est un écrivain qui transmet à merveille sa sagesse, ses passions et son regard poétique sur la vie.
Une lecture lumineuse et qui grandit.
Une fois de plus, c’est grâce à l’émission La Grande Librairie que j’ai découvert cet auteur et sa manière de parler, sans précipitation, avec réflexion et de manière très profonde, m’a donné envie de le découvrir par la lecture.
Rappelez-moi, un jour, de coller un procès à l’animateur, François Busnel, pour toutes les super découvertes littéraires que j’ai faites en regardant son émission (ça me ruine le portefeuille tout en enrichissant mon âme. Les banquiers se foutent de mon âme).
Sa manière de nous expliquer que pour éprouver du bonheur, il fallait avoir souffert, que sans les malheurs, souffrances, bref, toutes ces merdes, nous ne pourrions pas jouir et reconnaître le bonheur quand il se présente à votre porte.
Ben oui, je ne suis jamais si contente d’être en bonne santé qu’après avoir été malade… Et lorsque je suis malade, je regrette les jours de pleine santé que je n’ai pas accueilli avec joie.
Anybref, parlons de ce petit livre qui se lit avec lenteur aussi car là, on n’est pas dans un roman léger mais dans du lourd. Mon cerveau en fume encore.
Rassurez-vous, lire un essai qui parle de méditations sur le mort ne plombe en aucun cas l’ambiance ou votre moral. J’en suis sortie plus sereine, plus zen, plus apaisée aussi.
En fait, ce qu’il dit rejoint ce qu’une connaissance m’avait dite un jour et qui m’avait fait l’effet d’un uppercut car je ne l’avais jamais vue sous cet angle, l’idée de la mort : sans la mort, il n’y a pas de vie ! Si la vie est précieuse, c’est parce qu’elle n’est pas éternelle et qu’il y a la mort. Mais surtout, s’il n’y avait pas la mort, il n’y aurait pas la vie.
Ceci n’est qu’un résumé succin de ce que je viens de lire et que mon cerveau tente encore de mettre en ordre. De toute façon, je n’ai pas le talent, ni la prose, ni l’érudition de François Cheng pour vous parler de cette lecture qui m’a plongée ailleurs que sur Terre. Et ça, en plein confinement, c’est du tonnerre de Dieu !
Dieu, oui, il en parle mais à la manière d’un qui se questionne… Car si le hasard fait souvent bien les choses, ma question est la même que la sienne : comment le hasard a-t-il pu ordonnancer parfaitement la Terre, l’Univers, la Vie ?
Parce que bordel de dieu, c’est quand même bien fichu, bien pensé, pour un coup de hasard. Mais ne dit-on pas que le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito ? Je n’ai toujours pas la réponse à ma question, lui non plus, mais au moins, on a le mérite de les poser (lui plus que moi).
Sans vouloir être plus catholique que le pape, ce que je ne suis pas, il parle du sujet Dieu avec justesse et de celui de jésus d’une manière qui, déjà, dans l’émission, m’avait fait monter la boule dans la gorge car une fois de plus, il en parlait bien, sans virer grenouille de bénitier, sans choquer non plus les croyants, ni remettre en question les athées et les agnostiques. Ah si on m’avait parlé ainsi lorsque j’étais jeune !
Ce petit roman de méditations, c’est de la poésie, au sens propre comme au figuré, c’est de la justesse, ce sont des mots réfléchis, des réunions avec ses amis afin de partager avec eux ses méditations, c’est aussi de la philosophie, la beauté des mots, le fait que tout ce qu’il dit s’imbrique l’un dans l’autre.
Et en plus, c’est accessible à moi ! What’else ?
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Rappelez-moi, un jour, de coller un procès à l’animateur, François Busnel, pour toutes les super découvertes littéraires que j’ai faites en regardant son émission (ça me ruine le portefeuille tout en enrichissant mon âme. Les banquiers se foutent de mon âme).
Sa manière de nous expliquer que pour éprouver du bonheur, il fallait avoir souffert, que sans les malheurs, souffrances, bref, toutes ces merdes, nous ne pourrions pas jouir et reconnaître le bonheur quand il se présente à votre porte.
Ben oui, je ne suis jamais si contente d’être en bonne santé qu’après avoir été malade… Et lorsque je suis malade, je regrette les jours de pleine santé que je n’ai pas accueilli avec joie.
Anybref, parlons de ce petit livre qui se lit avec lenteur aussi car là, on n’est pas dans un roman léger mais dans du lourd. Mon cerveau en fume encore.
Rassurez-vous, lire un essai qui parle de méditations sur le mort ne plombe en aucun cas l’ambiance ou votre moral. J’en suis sortie plus sereine, plus zen, plus apaisée aussi.
En fait, ce qu’il dit rejoint ce qu’une connaissance m’avait dite un jour et qui m’avait fait l’effet d’un uppercut car je ne l’avais jamais vue sous cet angle, l’idée de la mort : sans la mort, il n’y a pas de vie ! Si la vie est précieuse, c’est parce qu’elle n’est pas éternelle et qu’il y a la mort. Mais surtout, s’il n’y avait pas la mort, il n’y aurait pas la vie.
Ceci n’est qu’un résumé succin de ce que je viens de lire et que mon cerveau tente encore de mettre en ordre. De toute façon, je n’ai pas le talent, ni la prose, ni l’érudition de François Cheng pour vous parler de cette lecture qui m’a plongée ailleurs que sur Terre. Et ça, en plein confinement, c’est du tonnerre de Dieu !
Dieu, oui, il en parle mais à la manière d’un qui se questionne… Car si le hasard fait souvent bien les choses, ma question est la même que la sienne : comment le hasard a-t-il pu ordonnancer parfaitement la Terre, l’Univers, la Vie ?
Parce que bordel de dieu, c’est quand même bien fichu, bien pensé, pour un coup de hasard. Mais ne dit-on pas que le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito ? Je n’ai toujours pas la réponse à ma question, lui non plus, mais au moins, on a le mérite de les poser (lui plus que moi).
Sans vouloir être plus catholique que le pape, ce que je ne suis pas, il parle du sujet Dieu avec justesse et de celui de jésus d’une manière qui, déjà, dans l’émission, m’avait fait monter la boule dans la gorge car une fois de plus, il en parlait bien, sans virer grenouille de bénitier, sans choquer non plus les croyants, ni remettre en question les athées et les agnostiques. Ah si on m’avait parlé ainsi lorsque j’étais jeune !
Ce petit roman de méditations, c’est de la poésie, au sens propre comme au figuré, c’est de la justesse, ce sont des mots réfléchis, des réunions avec ses amis afin de partager avec eux ses méditations, c’est aussi de la philosophie, la beauté des mots, le fait que tout ce qu’il dit s’imbrique l’un dans l’autre.
Et en plus, c’est accessible à moi ! What’else ?
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de François Cheng
Lecteurs de François Cheng Voir plus
Quiz
Voir plus
Un titre = un auteur
Si je vous dis "Histoires extraordinaires"
Edgar Allan Poe
Honoré de Balzac
Agatha Christie
7 questions
11333 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur11333 lecteurs ont répondu