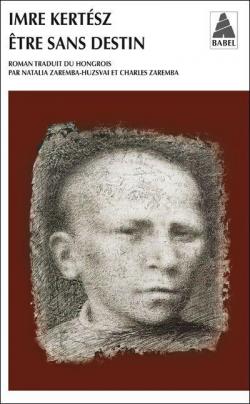Critiques filtrées sur 5 étoiles
Je voudrais pouvoir employer les mots les plus délicats possibles pour porter à votre regard cet être qui a failli ne plus être ni rien ni personne, ce jeune garçon qu'il aurait fallu prendre délicatement et bercer de ce qu'il a vu et vécu.
Je voudrais pourvoir trouver les phrases justes aussi pour ne pas trahir la parole d'Imre Kertész sur cette expérience inhumaine qu'ont été les camps de concentration et d'extermination.
Son narrateur, un jeune adolescent juif hongrois de 15 ans, peu conscient de la montée du nazisme et de l'antisémitisme, est un matin pris dans une rafle. Les premiers jours, où lui et ses compagnons sont amenés à pied puis en train d'un lieu de détention à un autre, il ne peut tout simplement pas saisir ce qui lui arrive, le vivant comme une aventure, puis une mésaventure, acceptant les conditions de plus en plus inhumaines des transports avec la confiance, la docilité d'un enfant et le détachement de celui qui pense tout cela provisoire.
C'est pas à pas, et surtout en découvrant le camp d'Auschwitz, les femmes rasées et les cheminées des chambres à gaz, que l'absurdité de sa situation, lui qui n'est coupable de rien, se révèle dans sa froide réalité. Autour de lui, les jeunes garçons se regardent encore en riant, gênés de leur corps rasés, mais les adultes tournent les yeux de tout côté, incrédules. Comment accepter l'inacceptable?
Hommes et femmes perdent leur nom, remplacé par un numéro, leur visage, après avoir été tondus, leur libre-arbitre, jusqu'à ne plus être qu'un corps parmi d'autres battus, affamés, transportés, jetés, déshabillés, voire soumis à expérimentations, vivants ou morts.
La question a sans aucun doute été: comment raconter l'innommable sans se trahir? Justifier sa vie par la suite? Car il faut bien vivre, puisqu'on est vivant. C'est cette question de l'écriture et surtout du point de vue choisi que j'ai trouvée si terrible, si puissante, le regard du narrateur sur l'impossible réalité de ce qu'il vit et la manière dont il s'adapte jusqu'au point où son âme n'est plus, à un moment, qu'une faible lueur à l'intérieur de son corps émacié, prête à s'éteindre. Comment il est arrivé à perdre, presque, son humanité, à ne plus être rien. Puis à ressusciter, grâce à quelque chose d'aussi trivial qu'à l'odeur de la soupe du camp.
C'est ce pas à pas, dira -t-il, qui lui aura permis de s'adapter, survivre. Sans cela, la tête et le coeur n'auraient pas pu supporter.
J'ai lu de nombreux livres sur ces camps, celui-ci m'a plongée dans le même état chaotique émotionnel que Si c'est un homme de Primo Levi, face à l'incompréhensible, l'impossible, l'insoutenable réalité de ces camps. Sans doute faut-il l'écrire, encore et encore, pour se battre contre l'ignorance, le refus de croire.
Je voudrais pourvoir trouver les phrases justes aussi pour ne pas trahir la parole d'Imre Kertész sur cette expérience inhumaine qu'ont été les camps de concentration et d'extermination.
Son narrateur, un jeune adolescent juif hongrois de 15 ans, peu conscient de la montée du nazisme et de l'antisémitisme, est un matin pris dans une rafle. Les premiers jours, où lui et ses compagnons sont amenés à pied puis en train d'un lieu de détention à un autre, il ne peut tout simplement pas saisir ce qui lui arrive, le vivant comme une aventure, puis une mésaventure, acceptant les conditions de plus en plus inhumaines des transports avec la confiance, la docilité d'un enfant et le détachement de celui qui pense tout cela provisoire.
C'est pas à pas, et surtout en découvrant le camp d'Auschwitz, les femmes rasées et les cheminées des chambres à gaz, que l'absurdité de sa situation, lui qui n'est coupable de rien, se révèle dans sa froide réalité. Autour de lui, les jeunes garçons se regardent encore en riant, gênés de leur corps rasés, mais les adultes tournent les yeux de tout côté, incrédules. Comment accepter l'inacceptable?
Hommes et femmes perdent leur nom, remplacé par un numéro, leur visage, après avoir été tondus, leur libre-arbitre, jusqu'à ne plus être qu'un corps parmi d'autres battus, affamés, transportés, jetés, déshabillés, voire soumis à expérimentations, vivants ou morts.
La question a sans aucun doute été: comment raconter l'innommable sans se trahir? Justifier sa vie par la suite? Car il faut bien vivre, puisqu'on est vivant. C'est cette question de l'écriture et surtout du point de vue choisi que j'ai trouvée si terrible, si puissante, le regard du narrateur sur l'impossible réalité de ce qu'il vit et la manière dont il s'adapte jusqu'au point où son âme n'est plus, à un moment, qu'une faible lueur à l'intérieur de son corps émacié, prête à s'éteindre. Comment il est arrivé à perdre, presque, son humanité, à ne plus être rien. Puis à ressusciter, grâce à quelque chose d'aussi trivial qu'à l'odeur de la soupe du camp.
C'est ce pas à pas, dira -t-il, qui lui aura permis de s'adapter, survivre. Sans cela, la tête et le coeur n'auraient pas pu supporter.
J'ai lu de nombreux livres sur ces camps, celui-ci m'a plongée dans le même état chaotique émotionnel que Si c'est un homme de Primo Levi, face à l'incompréhensible, l'impossible, l'insoutenable réalité de ces camps. Sans doute faut-il l'écrire, encore et encore, pour se battre contre l'ignorance, le refus de croire.
Être sans destin
Imre Kertesz (1929-2016)
Prix Nobel 2002.
Nous sommes en 1944 à Budapest. le narrateur, un jeune garçon d'une quinzaine d'années est pris dans une rafle, entassé dans un wagon à bestiaux et emmené vers l'inconnu. Une étoile jaune sur la veste, il sait sans en comprendre les raisons qu'il fait partie de ces parias que sont les Juifs. Il va alors enregistrer de façon quasi clinique, minutieuse et ingénue tout ce qui lui arrive.
Avec une distanciation étonnante et un détachement singulier, il imagine qu'il va découvrir le monde et vivre une aventure hors du commun.
Au lever du jour, il découvre Auschwitz. Il n'a pas l'étoffe d'un héros ; il va cependant tout faire pour survivre, pas à pas, avec l'espoir comme arme principale.
Peu à peu se fait jour en lui la vérité : file de gauche la vie, file de droite la mort. Il est surpris et presque admiratif devant l'efficacité des soldats allemands :
« Je remarquai que là, dehors, derrière eux, des soldats allemands en casquette verte, en col vert, le bras montrant le chemin d'un geste éloquent, avaient les yeux sur tout : j'étais un peu soulagé à leur vue, parce que, pimpants et bien soignés au milieu de ce tohu-bohu, eux seuls étaient solides et respiraient la sérénité. J'entendais beaucoup d'adultes parmi nous dire, et j'étais d'accord avec eux, qu'il fallait s'efforcer de se rendre utile, d'abréger les questions et les adieux, d'être raisonnable, pour ne pas donner aux Allemands l'image d'un troupeau désordonné...Je ne pouvais qu'admirer la rapidité, la précision régulière avec lesquelles tout se déroulait. »
Il est assez déconcertant de voir la passivité de tous ces détenus qui semblent résignés : c'est du moins le sentiment que l'on éprouve à la lecture du témoignage du narrateur.
« Je ne l'aurais jamais cru, mais le fait est là : à l'évidence, un mode de vie ordonné, une certaine exemplarité, je dirais même une certaine vertu, ne sont nulle part aussi importants qu'en détention, justement. »
Ce qui étonne aussi c'est qu'une forme d'ennui guette le détenu :
« C'est ainsi que j'ai compris que, même à Auschwitz, on pouvait s'ennuyer, à condition d'être un privilégié. Nous attendions que rien ne se passe ! Cet ennui, avec cette étrange attente : je crois que c'est cette impression-là, à peu près, oui, qui en réalité caractérise vraiment Auschwitz, à mes yeux en tout cas. »
Toutefois, « les murs étroits des prisons ne peuvent pas tracer de limite aux ailes de notre imagination. »
le narrateur va survivre c'est évident puis qu'il témoigne : mais il va falloir affronter l'après ! Aux proches retrouvés qui lui disent qu'il va falloir oublier, il ne peut que « faire comprendre qu'on ne peut jamais commencer une nouvelle vie, on ne peut que poursuivre l'ancienne. »
Ce récit est très déstabilisant. La candeur du garçon pendant une bonne partie du livre fait place lors du retour en Hongrie à la haine, une haine à l'encontre de tous ces gens qui lui parlent déjà d'avenir, un avenir qui ne peut paraître qu'absurde à ce gamin qui a vécu un an dans les camps. Comme l'ont dit nombre d'exégètes, une barrière infranchissable nous sépare à jamais des survivants des camps.
Un livre admirable, bouleversant dont la fin laisse songeur.
Imre Kertesz (1929-2016)
Prix Nobel 2002.
Nous sommes en 1944 à Budapest. le narrateur, un jeune garçon d'une quinzaine d'années est pris dans une rafle, entassé dans un wagon à bestiaux et emmené vers l'inconnu. Une étoile jaune sur la veste, il sait sans en comprendre les raisons qu'il fait partie de ces parias que sont les Juifs. Il va alors enregistrer de façon quasi clinique, minutieuse et ingénue tout ce qui lui arrive.
Avec une distanciation étonnante et un détachement singulier, il imagine qu'il va découvrir le monde et vivre une aventure hors du commun.
Au lever du jour, il découvre Auschwitz. Il n'a pas l'étoffe d'un héros ; il va cependant tout faire pour survivre, pas à pas, avec l'espoir comme arme principale.
Peu à peu se fait jour en lui la vérité : file de gauche la vie, file de droite la mort. Il est surpris et presque admiratif devant l'efficacité des soldats allemands :
« Je remarquai que là, dehors, derrière eux, des soldats allemands en casquette verte, en col vert, le bras montrant le chemin d'un geste éloquent, avaient les yeux sur tout : j'étais un peu soulagé à leur vue, parce que, pimpants et bien soignés au milieu de ce tohu-bohu, eux seuls étaient solides et respiraient la sérénité. J'entendais beaucoup d'adultes parmi nous dire, et j'étais d'accord avec eux, qu'il fallait s'efforcer de se rendre utile, d'abréger les questions et les adieux, d'être raisonnable, pour ne pas donner aux Allemands l'image d'un troupeau désordonné...Je ne pouvais qu'admirer la rapidité, la précision régulière avec lesquelles tout se déroulait. »
Il est assez déconcertant de voir la passivité de tous ces détenus qui semblent résignés : c'est du moins le sentiment que l'on éprouve à la lecture du témoignage du narrateur.
« Je ne l'aurais jamais cru, mais le fait est là : à l'évidence, un mode de vie ordonné, une certaine exemplarité, je dirais même une certaine vertu, ne sont nulle part aussi importants qu'en détention, justement. »
Ce qui étonne aussi c'est qu'une forme d'ennui guette le détenu :
« C'est ainsi que j'ai compris que, même à Auschwitz, on pouvait s'ennuyer, à condition d'être un privilégié. Nous attendions que rien ne se passe ! Cet ennui, avec cette étrange attente : je crois que c'est cette impression-là, à peu près, oui, qui en réalité caractérise vraiment Auschwitz, à mes yeux en tout cas. »
Toutefois, « les murs étroits des prisons ne peuvent pas tracer de limite aux ailes de notre imagination. »
le narrateur va survivre c'est évident puis qu'il témoigne : mais il va falloir affronter l'après ! Aux proches retrouvés qui lui disent qu'il va falloir oublier, il ne peut que « faire comprendre qu'on ne peut jamais commencer une nouvelle vie, on ne peut que poursuivre l'ancienne. »
Ce récit est très déstabilisant. La candeur du garçon pendant une bonne partie du livre fait place lors du retour en Hongrie à la haine, une haine à l'encontre de tous ces gens qui lui parlent déjà d'avenir, un avenir qui ne peut paraître qu'absurde à ce gamin qui a vécu un an dans les camps. Comme l'ont dit nombre d'exégètes, une barrière infranchissable nous sépare à jamais des survivants des camps.
Un livre admirable, bouleversant dont la fin laisse songeur.
"Etre sans destin" est au premier rang des livres les plus puissants sur le nazisme (et ses avatars), la déportation, l'expérience concentrationnaire. "Aujourd'hui, je ne suis pas allé au lycée." C'est l'incipit de cette grande oeuvre, récit d'adolescence, roman de formation, qui pourrait être assez classique si ce n'est que le sentiment d'étrangeté ressenti par l'ado tient à celui d'être juif, et que les épreuves traversées sont un cauchemar. Mais somme toute le narrateur, emporté comme un fétu de paille dans l'incendie, candide en enfer, peut malgré tout dire, lui aussi, "avoir avancé pas à pas". Rescapé il écrit : "Je les suppliais presque d'essayer d'admettre que je ne pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir n'être rien qu'innocent."
La première fois que je t'ai lu, je n'ai pas su si je pouvais t'aimer ou si je devais te détester. Ce devait être en 2002, il y a donc près de vingt ans et moi j'en avais un peu plus de quarante, parce que c'est l'année où Imre Kertesz a reçu le prix Nobel et qu'il a dû me tomber sous les yeux suffisamment d'articles te signalant comme « son chef d'oeuvre » pour m'inciter à aller te flairer dans une librairie et repartir avec toi. Je ne connaissais pas l'auteur et j'ai difficilement surmonté l'idée que son Nobel était une récompense de sa déportation et, à ce compte là, pensai-je, pourquoi le prix n'avait-il pas été donné à Primo Levi - sans compter qu'il s'était suicidé, naturellement. Ton sujet, le témoignage d'un survivant des camps, ne me rebutait pas, au contraire. Je n'avais rien perdu du visionnage et des débats sur Shoah de Claude Lanzmann, de la série Holocauste, des films le choix de Sophie, La liste de Schindler et La vie est belle, et si j'avais raté le livre d'Hannah Arendt sur le procès d'Eichman à Jérusalem (ce qui est étonnant puisque je venais justement de travailler un an avec Rony Brauman et Eyal Syvan qui en avaient tiré un documentaire), j'avais lu bien sûr Si c'est un homme et Les naufragés et les rescapés de Primo Levi ainsi que Quel beau dimanche ! de Jorge Semprun.
Je pensais donc savoir à peu près tout ce qu'on pouvait savoir sur les camps et, de ce point de vue, j'avais raison, tu ne m'as pas révélé la zone grise que préfère ignorer le devoir de mémoire. Pour la raison que tu te situes au-delà de cette zone grise où toutes les victimes ne sont pas innocentes.
Je t'ai lu rapidement, pressé sans doute d'échapper au malaise que ta lecture me causait. Quel est donc ce malaise qui émane de toi que bien des lecteurs ont dû comme moi ressentir – même si la critique, française tout du moins car j'ai lu depuis qu'il n'en était pas de même en Allemagne, l'ignore superbement ? C'est un dérangement lié à la posture du héros-narrateur qui, contrairement à ceux de Levi, Semprun, Wiesel et des autres, s'exprime avec une déroutante désinvolture exempte de pathos, de recul sur les événements qu'il vit, de compassion, de culpabilité et de honte. Je dirais que ton humanité n'est pas humanitaire. Elle est palpable, et même exceptionnellement palpable, mais elle est étrangère à toutes les valeurs réconfortantes de l'humanisme. de sorte qu'en tant que lecteur, j'étais captivé par ton héros mais désarçonné par ton narrateur. Je te ressentais comme de la bonne, de la très bonne littérature puisque tu débordais d'humanité vraie, mais je ne t'aimais pas vraiment, et j'en arrivais même parfois à te détester d'être le porte-voix d'un sauvageon, certes innocent dans ses actes mais non pas exemplaire dans ses pensées. Oui, je me souviens que m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises l'idée que tu pouvais être un livre malsain. Aujourd'hui, je ne suis pas fier de devoir admettre que les reproches que je t'adressais n'étaient pas très éloignés du registre des censeurs staliniens bornés qui refusèrent ta publication, ainsi que ton auteur le raconte dans le refus, au motif que « si le roman ne devient pas pour le lecteur une expérience bouleversante, c'est en premier lieu à cause des réactions pour le moins bizarre du héros ».
Pendant les années qui suivirent, je n'ai pas eu l'idée de te relire pour éclaircir le malaise que tu me causais. Ce n'est pas que je ne voulais pas parler de toi, c'était que je ne voulais pas que tu me parles, je ne voulais pas t'entendre me parler. Alors, lorsqu'il arrivait qu'on parle de toi, je me faisais un devoir de faire ton éloge littéraire, non sans te qualifier de « dérangeant ». Je situais confusément ce dérangement dans un passage qui me restait à l'esprit : le déroulement de la sélection de ton convoi de déportés au bout du quai de la gare d'Auschwitz.
La scène de la sélection est un classique des récits écrits, racontés ou filmés sur les « camps de la mort », comme on dit, avant justement que la sélection opère une distinction entre le camp d'extermination et le camp de concentration: à gauche, Birkenau ; à droite, Auschwitz. Il ne peut pas y avoir de récit de survivant de Birkenau puisque Birkenau est le nom de la mort quasi instantanée, une mort qui ne laisse aucune miette de vie, ces miettes dont on fait des récits.
Dans cette scène de la sélection telle que tu la racontes, je me souvenais que le héros se comportait comme un adolescent plus habité par l'égoïsme et la malignité que par l'innocence et la compassion. Voici les extraits les plus significatifs de ce passage que tu déroules sur trois pages (c'est moi qui écrit en italiques certains mots, ceux qui me paraissaient dérangeants)
- « Soudain, j'ai vu deux groupes séparés, là-bas devant. le plus important, à droite, se composait de personnes diverses, et à gauche le plus petit et en quelque sorte le plus plaisant comprenait entres autres des garçons de notre groupe. A première vue, ces derniers, du moins à mes yeux, avaient été déclarés aptes.
- « Juste devant moi, il y avait Moskovics – lui, le docteur lui a immédiatement montré l'autre direction. Je l'ai encore entendu essayer d'expliquer…. Quant à moi, je le voyais bien, le médecin me regarda plus soigneusement, me pesant d'un regard grave et attentif. Je bombais le torse pour lui montrer ma cage thoracique et – je m'en souviens – j'ai même souri un peu, là, comparé à Moskovics.
- « Je sentais que je luis plaisais bien…il m'a envoyé parmi les aptes. Les gars m'ont fait un triomphe, ils riaient de joie. Et à la vue des ces visages rayonnants, j'ai compris la différence qui séparait notre groupe de ceux d'en face : la réussite, si je ne m'abusais.
- « J'ai vite compris le travail du docteur. Un vieil homme arrive, il l'envoie de l'autre côté, c'est clair. Un jeune, ici, avec nous. Un autre, ventru, sauf qu'il bombe le torse de toutes ses forces : en vain – mais non, le médecin l'a quand même envoyé ici, et je n'étais pas très satisfait parce que, pour ma part je le trouvais plutôt âgé.
C'était difficile à avouer, mais certains sentiments fort peu nobles qui étaient écrits ici, je ne pouvais que trop les lire en moi-même adolescent ou jeune homme. Je me serais bien passé d'une telle identification, mais force était de reconnaître que ton récit de ta sélection me prenait au piège du souvenir des « petites sélections » auxquelles la vie m'avait convoquées, que ca me plaise ou pas. Honte à moi ! En te lisant, je lisais les actes de mon procès au tribunal de l'humanisme qui m'avait tant de fois fait défaut. Ces choses là sont tellement honteuses qu'on est bien content de ne jamaisen parler, alors que toi, tu viens nous le mettre sous le nez !
Pas de trace de la culpabilité du survivant dans ce passage, comme dans toutes tes autres pages (sauf une, celle de l'infirmerie). Mais pas de trace non plus de cette honte plus universelle qui concerne presque autant les témoins réels des camps que les témoins virtuels que nous sommes tous devenus en étant habités par la mémoire des camps.
Cette honte est décrite par Primo Levi dans les premières pages de la Trêve, un matin où apparaissent les premiers libérateurs de son camps (Bergen), quatre soldats russes à cheval d'allure peu fringante : « Ils ne nous saluaient pas, ne nous souriaient pas ; à leur pitié semblait s'ajouter un sentiment confus de gène qui les oppressait, les rendait muets enchainait leur regard à ce spectacle funèbre (ndlr : celui des monceaux de cadavres, et des survivants décharnés). C'était la même honte que nous connaissions bien, celle qui nous accablait après les sélections et chaque fois que nous devions assister ou nous soumettre à un outrage : la honte que les Allemands ignorèrent, celle que le juste éprouve devant la faute commise par autrui, tenaillé par l'idée qu'elle existe, qu'elle ait été introduite irrévocablement dans l'univers des choses existantes et que sa bonne volonté se soit montrée nulle ou insuffisante et totalement inefficace. »
Tout n'est encore pas dit de cette honte, nous en reparlerons plus loin.
En 2010, je suis tombé par hasard chez un bouquiniste sur Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, un autre livre de Kertesz, dont le ton de supplication et le phrasé répété à la Thomas Bernhard m'ont suffisamment séduit pour rehausser encore l'idée que je me faisais de Kertesz comme écrivain, mais pas assez pour être pris de l'envie de lire ses autres livres ni de te relire toi, qui m'avait laissé dans un dérangeant malaise que je ne songeais pas à dissiper plus avant, puisqu'il est compréhensible que l'exploration d'un malaise ne se présente pas à celui qui l'éprouve comme une partie de plaisir, et que c'est pour cette raison que les malaises s'épanouissent sans risque d'être dissipés chez la plupart des individus et en particulier chez les névrosés bien marqués – ce qui est mon état, évidemment.
Mais voici qu'un beau jour, à l'automne 2018 je m'en souviens bien, j'écoute à la radio un entretien avec Yasmina Reza et je l'entends faire un éloge appuyé de Kertesz en tant qu'écrivain assez courageux pour oser explorer et mettre au jour nos contrées les plus troubles dit-elle en substance, en citant à l'appui l'aveu inouï d'une « nostalgie du camp » qu'il écrit avoir éprouvée. La nostalgie du camp ! Quelle chose a priori impensable ! Mais non, à moi cette chose n'apparaît pas incompréhensible et presque familière dans la littérature en général et sans doute dans ton souvenir inconscient en particulier.
Cette fois-ci j'ai décidé de m'intéresser à Kertesz, mais en te tenant bizarrement d'abord, toi, à l'écart car je ne me souvenais pas que dans tes pages, il soit question de cette nostalgie du camp. J'ai lu le refusoù il est beaucoup question de la difficulté de ta rédaction et de ta réception. de même dans Journal de galère.
Et puis, enfin, je t'ai relu.
Ton altérité gênante s'est transformée en fraternité bienfaisante. Tu es une prouesse, tu es un prodige. Kertesz a réussi le difficile exploit de s'arracher à l'adulte qu'il était devenu pour redevenir l'adolescent qu'il était resté. Il va pas à pas et le narrateur n'est jamais en avance sur le héros. Ainsi se réalise en toi la magie de la littérature.
Lisons ta quatrième de couverture (collection 10/18) « - de son arrestation à Budapest, à la libération du camp, un adolescent a vécu le cauchemar d'un temps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreur concentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui fit composer avec l'inacceptable. Parole inaudible avant que ce livre ne vienne la proférer dans toute sa force et ne pose la question de savoir ce qu'il advient de l'humanité de l'homme quand il est privé de son destin. Cette oeuvre dont l'élaboration a requis un inimaginable travail de distanciation et de mémoire dérangera tout autant ceux qui refusent encore de voir en face le fonctionnement du totalitarisme que ceux qui entretiennent le mythe d'un univers concentrationnaire manichéen. Un livre à placer à côté du Si c'est un homme de Primo Lévi. Enfin reconnu, Imre Kertesz a reçu le prix Nobel de littérature pour son « oeuvre qui dresse l'expérience fragile de l'individu contre l'arbitraire barbare de l'histoire.»
Ce texte commence par une erreur factuelle: « de son arrestation, à la libération du camp,… ». Il manque ici la mention du retour du jeune héros à Budapest, épisode qui occupe les trente dernières pages du livre qui ne sont pas anodines. Ensuite, l'indication du « cauchemar d'un temps arrêté et répétitif » ne rend pas compte, selon moi, de la teneur aventureuse du récit. Mais le plus important vient maintenant : « victime tant de l'horreur concentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui fit composer avec l'inacceptable.»
Cette notation accusatrice d'un « instinct de survie qui lui fit composer avec l'inacceptable » va décidément trop vite en besogne. de quelle composition, pour ne pas dire compromission, mot qui rime à la lettre et dans le sens, est-il fait allusion ? Puisque le héros ne se rend coupable d'aucune vilenie, c'est difficile à comprendre, à moins qu'il s'agisse encore et toujours de la même chose: la bizarrerie des réactions du héros, bizarrerie qui se confond avec l'absence complète de pathos, de compassion, de culpabilité, de honte. Et c'est bien cela qui fait la force du livre sans qu'il soit besoin d'ajouter ce morceau de phrase inutile qui fait semblant d'être intelligent en jouant avec le titre mais qui ne dit absolument rien de son intelligibilité pour moi qui ait renoncé à comprendre la signification de ce titre : Etre sans destin. A cet égard, je me sens comme ces deux vieux juifs voisins d'immeuble du narrateur à qui il essaie d'expliquer ce qui lui apparaît comme une révélation: « S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible; si au contraire, (…) la liberté existe, alors il n'y a plus de destin, c'est à dire qu'alors nous sommes nous-mêmes le destin. »
Pour en revenir à cette idée d'une « composition avec l'inacceptable » qui rendrait en quelque sorte la victime coupable, coupable de quelque chose qui justifierait la honte, la culpabilité du survivant, je laisse la parole à l'auteur dans Son journal de galère :
« Je regarde à la loupe la photo des arrivants (au camp d'Auschwitz). Sourire, sérénité, assurance. Oui, dans le fond, tenir à la vie même dans les conditions du totalitarisme contribue au maintien de ce dernier : c'est une technique d'organisation élémentaire. Il faut en prendre conscience pour que disparaisse le sentiment aliéné qu'on éprouve pour le totalitarisme. Cette prise de conscience et la revendication de celle-ci sont des actes de liberté; pourtant, cet acte de liberté, cette illumination - qui revient à assumer sa complicité – se heurte toujours aux protestations des survivants. C'est ainsi que se forme un destin sans destin, qu'on passe d'une aliénation à une autre, c'est ainsi que rien ne finit jamais : même les morts sont menacés de résurrection. »
Cette réflexion très forte sur « cette prise de conscience et sa revendication qui revient à assumer sa complicité » est contrebalancée par cette autre, justement tirée de l'ouvrage Un autre :
« En passant par la place Vermezo, à côté de la statue de Bela Kun barbouillée d'étoiles jaunes, j'ai soudain compris que ce que je prenais dans ma jeunesse pour de la lâcheté, de l'aveuglement et - en fait - une variante inconcevablement tragicomique du suicide était en réalité une sorte d'impuissance qui se transforme en dignité. Il y a quelque chose de digne à exécuter un ordre de meurtre et à subir avec un certain sang-froid le fait d'être désigné et massacré. le confort – celui de la victime – a quelque chose de grandiose. En ce qui me concerne : je soupçonne déjà que je ne bougerai pas d'un poil, tout au plus mon dégoût va-t-il s'accroitre. »
En définitive, pour ma part, j'en reste sur ce sujet de la culpabilité du survivant à cette idée forte, formulée aussi par Kertesz dans Un autre :
« Ce que je dois de toute façon noter : la trahison que le vivant commet à tous les instants, l'humiliation bien connue et insurmontable de la survie. Tôt ou tard, on se trouve dans une situation où on lutte pour une survie que le chaos du mourant menace d'engloutir. D'abord, on apprend la maladie mortelle d'un proche, ensuite on en accepte, puis on s'y résigne et on le remet aux mains des spécialistes. En un certain sens, on devient un assassin et peu de gens peuvent éviter ce sort, sauf peut-être les solitaires, les personnes seules. »
Suite du texte de couverture : « - Un livre à placer à côté de Si c'est un homme de Primo Lévi.» Effectivement, les récits des deux livres sont proches, et leur parenté va presque de soi. Pourtant, c'est à une autre parenté à laquelle j'ai parfois eu l'idée en te lisant, celle d'avec L'attrape coeur de Salinger, à cause de la primauté donnée à la voix singulière d'un héros adolescent.
Ce héros ne compose pas avec l'inacceptable, il s'adapte et tout ce qu'il cherche à expliquer c'est que cette adaptation se fait pas à pas, qu'elle est une découverte de tous les jours et que c'est à cause de cette progressivité du temps et des événements qui passent qu'il lui a été possible, comme à tous les autres, de s'adapter à un sort qui, si il lui était tombé d'un coup sur la tête l'aurait sans doute entraîné au désespoir absolu. Quant à l'instinct de survie, il se confond avec cette idée que l'avenir n'est pas connu d'avance, que chaque jour, chaque heure, chaque minute, est une découverte qui se fait pas à pas et c'est paradoxalement d'ailleurs quand l'instinct de survie s'éteignait chez le héros-narrateur, qu'il se sentait devenir comme un « musulman », affaibli par un abcès au genou qui risquait de le condamner, que les circonstances vont le sauver, transformant le mauvais augure de cet abcès au genou en une possibilité inespérée de survie à l'infirmerie du camp.
Et c'est aussi à ce moment du récit où apparaît un court passage où il est question de « la culpabilité du survivant », celle du « un contre un pour la survie ». En effet, alors que le héros est
Il est bien jeune et bien naïf, le narrateur, au début de ce récit.
Son père est embarqué au STO, mais il envoie des nouvelles rassurantes : pas d'inquiétude, donc.
Le narrateur, à 14 ans, est envoyé travailler en usine ; on lui délivre pour cela des papiers d'identité permettant de quitter la ville, et il s'en réjouit.
Lorsque son autobus est arrêté et qu'on en fait descendre les Juifs, il retrouve ses camarades, et avec eux rit de cette surprise.
D'ailleurs, être juif ce n'est pas fondamental, pour lui qui ne parle ni hébreu ni yiddish, lui qui a récité la prière "en play-back" lors du départ de son père…
Sauf que lui et ses camarades, c'est vers Auschwitz qu'ils sont emmenés.
Le transport en wagon à bestiaux, le manque d'eau, le seau hygiénique posé dans un coin pour 60 personnes : il ne semble pas s'en offusquer, tant qu'il peut échanger des blagues avec ses amis.
L'arrivée au camp, les détenus qui leur enjoignent de se vieillir lors du tri : c'est "une évidence", c'est "bien naturel".
Déni ? Instinct de survie ? Distance salvatrice ? C'est avec un certain détachement que le narrateur découvre les chambres à gaz, les crématoires.
Et puis, peu à peu, l'horizon se rétrécit : le temps, le temps interminable, une journée après l'autre…
"Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd, qui s'était faufilée en moi, comme honteuse d'être si insensée, et pourtant de plus en plus obstinée : je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration."
Expédié à Buchenwald, puis à Zeitz, puis de nouveau à Buchenwald, il ne pense plus qu'à survivre. Survivre une journée de plus. Puis survivre jusqu'au prochain repas…
S'évader par l'imagination en reconstituant minutieusement, dans sa tête, une journée "d'avant", une journée parfaite, une journée ordinaire...
Au fil de son récit, le narrateur décrit la descente aux enfers, à l'enfer concentrationnaire : le corps qui lâche, les maladies, la "vermine" avec laquelle il doit cohabiter, l'obsession de la faim.
De cette déshumanisation émergent – et le sauvent – quelques instants de compassion, quelques personnages, tels que l'infirmier Pietka, qui ramènent un semblant d'humanité.
Avec la libération du camp, le retour à Budapest, Kertész redevient un être pensant, et agissant, et parlant, et termine le livre par ses réflexions de plus en plus âpres au fur et à mesure qu'il découvre l'immensité de la perte.
Ce n'est pas qu'un témoignage (celui d'un adolescent, rédigé 30 ans après), c'est un tour de force littéraire, qui ne peut laisser personne indifférent.
Traduction parfaitement fluide de Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba.
Challenge Nobel
Son père est embarqué au STO, mais il envoie des nouvelles rassurantes : pas d'inquiétude, donc.
Le narrateur, à 14 ans, est envoyé travailler en usine ; on lui délivre pour cela des papiers d'identité permettant de quitter la ville, et il s'en réjouit.
Lorsque son autobus est arrêté et qu'on en fait descendre les Juifs, il retrouve ses camarades, et avec eux rit de cette surprise.
D'ailleurs, être juif ce n'est pas fondamental, pour lui qui ne parle ni hébreu ni yiddish, lui qui a récité la prière "en play-back" lors du départ de son père…
Sauf que lui et ses camarades, c'est vers Auschwitz qu'ils sont emmenés.
Le transport en wagon à bestiaux, le manque d'eau, le seau hygiénique posé dans un coin pour 60 personnes : il ne semble pas s'en offusquer, tant qu'il peut échanger des blagues avec ses amis.
L'arrivée au camp, les détenus qui leur enjoignent de se vieillir lors du tri : c'est "une évidence", c'est "bien naturel".
Déni ? Instinct de survie ? Distance salvatrice ? C'est avec un certain détachement que le narrateur découvre les chambres à gaz, les crématoires.
Et puis, peu à peu, l'horizon se rétrécit : le temps, le temps interminable, une journée après l'autre…
"Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd, qui s'était faufilée en moi, comme honteuse d'être si insensée, et pourtant de plus en plus obstinée : je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration."
Expédié à Buchenwald, puis à Zeitz, puis de nouveau à Buchenwald, il ne pense plus qu'à survivre. Survivre une journée de plus. Puis survivre jusqu'au prochain repas…
S'évader par l'imagination en reconstituant minutieusement, dans sa tête, une journée "d'avant", une journée parfaite, une journée ordinaire...
Au fil de son récit, le narrateur décrit la descente aux enfers, à l'enfer concentrationnaire : le corps qui lâche, les maladies, la "vermine" avec laquelle il doit cohabiter, l'obsession de la faim.
De cette déshumanisation émergent – et le sauvent – quelques instants de compassion, quelques personnages, tels que l'infirmier Pietka, qui ramènent un semblant d'humanité.
Avec la libération du camp, le retour à Budapest, Kertész redevient un être pensant, et agissant, et parlant, et termine le livre par ses réflexions de plus en plus âpres au fur et à mesure qu'il découvre l'immensité de la perte.
Ce n'est pas qu'un témoignage (celui d'un adolescent, rédigé 30 ans après), c'est un tour de force littéraire, qui ne peut laisser personne indifférent.
Traduction parfaitement fluide de Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba.
Challenge Nobel
En 1944, Gyurka a quatorze ans. Il vit à Budapest avec son père et sa belle-mère jusqu'à ce que son père reçoive une convocation pour le travail obligatoire. La première partie nous montre donc un être jeune, en pleine formation, qui n'a encore de repères fixes sur le monde et n'éprouve pas nécessairement les émotions attendues. Dans la seconde partie, l'adolescent est lui-même soumis au travail obligatoire puis est arrêté. Suivent alors les descriptions de l'attente, de la déportation et de l'arrivée dans un camp de concentration. Dans la suite du livre, Gyurka raconte son passage à Auschwitz, son transfert à Buchenwald puis dans un petit camp annexe. Il fait alors l'expérience de la survie, comprend ce qui se passe mais ne juge pas, s'accrochant à la vie. Tombé malade, le jeune prisonnier connaît le calvaire de ces êtres livrés à des bouchers et il mourrait si le camp n'était libéré par les forces alliés. de retour à Budapest, le rescapé comprend qu'on ne veut pas de gens comme lui parce que la guerre est finie et parce que le discours qu'il tient n'est pas celui qui est attendu.
Être sans destin est pour moi un livre extraordinaire. C'est la troisième fois que je le lis et je reste impressionnée par sa grandeur. Tous les clichés sur la barbarie, la figure de la victime et l'innocence sont renvoyés dos à dos. Imre Kertész qui a lui-même été déporté à l'âge de quatorze ans, livre là une oeuvre extrêmement cohérente et puissante où la figure du jeune homme renvoie par ses apparentes neutralité et indifférence au Josef K du Procès et au Meursault de l'Etranger. Un très grand livre qui doit hanter la mémoire de bien des lecteurs...
Être sans destin est pour moi un livre extraordinaire. C'est la troisième fois que je le lis et je reste impressionnée par sa grandeur. Tous les clichés sur la barbarie, la figure de la victime et l'innocence sont renvoyés dos à dos. Imre Kertész qui a lui-même été déporté à l'âge de quatorze ans, livre là une oeuvre extrêmement cohérente et puissante où la figure du jeune homme renvoie par ses apparentes neutralité et indifférence au Josef K du Procès et au Meursault de l'Etranger. Un très grand livre qui doit hanter la mémoire de bien des lecteurs...
« Je peux dire peut-être que, cinquante ans après, j'ai donné forme à l'horreur que l'Allemagne a déversée sur le monde (…), que je l'ai rendue aux Allemands sous forme d'art. » (L'holocauste comme culture)
Avec Etre sans destin, l'immense auteur hongrois Imre Kertész, nobélisé en 2002 pour « une écriture qui soutient la fragile expérience de l'individu contre l'arbitraire barbare de l'histoire », a véritablement transmué l'horreur et l'innommable en art. Et c'est ce qui, à mes yeux, fait de ce livre un objet unique qui, plus que tout autre livre sur la Shoah, répare et apaise. Car Imre Kertész ne se contente pas de témoigner, il ne tente pas d'analyser, encore moins de dénoncer, il crée, il recrée plus exactement un monde, celui des camps d'extermination nazis. Et c'est cette re-création, servie par une langue inouïe qui entre dans notre chair de lecteur, qui, paradoxalement, nous permet de sortir de l'hébétude dans laquelle l'horreur nous a initialement plongés, nous invitant à abandonner des réactions érigées comme autant de barrières défensives — indignation, rébellion, dégoût, déni, évitement…— pour nous conduire sur la seule voie possible, celle de l'acceptation.
« Je vais continuer à vivre ma vie invivable (…), il n'y a aucune absurdité qu'on ne puisse vivre tout naturellement, et sur la route, je le sais déjà, me guette, comme un piège incontournable, le bonheur. »
Pour Imre Kertész, déporté à l'âge de quinze ans parce que né juif, la confrontation avec l'absurdité de notre monde a lieu très tôt. D'autant que cette expérience primordiale se verra prolongée, approfondie, enrichie par plus de quatre décennies passées derrière le rideau de fer sous un régime au mode de gouvernement arbitraire et paranoïaque. Imre Kertesz se disait d'ailleurs convaincu qu'il n'aurait pas pu écrire son expérience dans les camps nazis s'il avait vécu sous un régime démocratique et libre. J'ignore s'il faut prendre ses paroles au pied de la lettre. Disons qu'il n'aurait probablement pas écrit l'oeuvre qu'il a écrite, imprégnée de la conviction qu'aucune destinée ne préside à nos existences, que celles-ci sont tout entières vouées à la contingence et à l'absurde, ce qui, pour lui, revient à dire qu'elles sont absolument libres. Imre Kertesz rejoint en cela Camus, dont la lecture, à l'âge de vingt-cinq ans, l'a, dit-il, profondément marqué, précisant qu'en hongrois, L'Etranger était traduit par « L'indifférent ». « Indifférent au sens de détaché du monde, de lui-même. Mais aussi au sens d'affranchi, c'est-à-dire d'homme libre. »
L'homme libre, l'homme affranchi pour Imre Kertesz, c'est l'homme sans destin : « S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible; si, au contraire, ai-je poursuivi de plus en plus surpris et me piquant au jeu, si la liberté existe, alors il n'y a pas de destin, c'est-à-dire — je me suis interrompu, mais juste le temps de reprendre mon souffle — c'est-à-dire qu'alors nous sommes nous-mêmes le destin. »
Dès lors, il est inconcevable, absurde de se percevoir comme une victime. Car être victime, c'est devenir l'objet de quelqu'un ou de quelque chose; être victime, c'est subir. Or, on n'est victime de rien ni de personne, on vit juste des choses plus ou moins désagréables. Quand la vermine s'installe dans sa plaie à la hanche, notre héros est d'abord horrifié et s'acharne à la chasser, exercice parfaitement vain :
« Au bout d'un certain temps, je renonçai et me contentais de contempler cette voracité, ce grouillement, cette avidité, cet appétit, ce bonheur sans fard : d'une certaine façon, il me semblait les connaître un peu. C'est alors que je me rendis compte que je pouvais peu ou prou les comprendre, à bien y réfléchir. Finalement, j'en fus presque soulagé, les démangeaisons cessèrent presque. Mais je ne me réjouis pas pour autant, je restai un peu aigri - et je pense que c'est compréhensible, en fin de compte - mais dans l'ensemble, sans colère, juste un peu à cause des lois de la nature, pour ainsi dire. »
Et c'est cette même attitude, mélange unique d'apparente désinvolture, de fausse candeur et d'humour impitoyable, qu'il adopte à l'égard des Allemands, assimilés à une gigantesque machine anonyme et dépersonnalisée. Les Allemands réifient les Juifs? Il réifie les Allemands, faisant mine de reprendre à son compte l'argumentaire nazi selon lequel juifs et allemands n'appartiendraient pas à la même espèce :
« Et j'avais beau voir, par exemple, leur visage, leurs yeux ou la couleur de leurs cheveux, l'un ou l'autre trait particulier voire défaut, un bouton sur leur peau, j'étais totalement incapable de m'accrocher à quelque chose, j'étais à deux doigts de douter, effectivement, si ceux qui marchaient à côté de nous étaient en dépit de tout nos semblables, si, en définitive, ils étaient faits de la même substance que nous, au fond. Mais il me vint à l'esprit que ma façon de voir pouvait être erronée, puisque c'est moi qui n'étais pas de la même substance, naturellement. »
En retournant comme un gant l'horreur, en transformant le plomb en or, Imre Kertesz nous offre une lecture jubilatoire en même temps qu'une leçon de vie qui nous aide, ainsi que je l'écrivais en préambule, à accepter l'humaine condition pour ce qu'elle est : le plus souvent misérable, parfois admirable et surtout, jamais inéluctable. Au moment ultime où tout semble perdu, voici que se produit l'impensable, l'inexplicable, et le moribond se croyant acheminé vers les chambres à gaz, se retrouve à l'infirmerie où, pour la première fois depuis longtemps, il rencontre des détenus (médecins et infirmiers) qui ressemblent à des hommes, non à des squelettes dépenaillés. C'est aussi en ce lieu qu'il retrouve cette chose fragile et néanmoins tenace, déjà rencontrée depuis son arrivée au camp, une forme de résistance sourde et têtue qui anime certains hommes, comme cet infirmier qui, atterré par son extrême maigreur, lui apporte clandestinement deux fois par semaine de la viande en conserve et un morceau de pain.
« C'est alors que je compris, je crois, ces hommes. Car en recoupant toutes mes expériences, en assemblant tous les maillons de la chaîne, oui, il ne me restait aucun doute, c'était bien cela, même si je le connaissais sous une autre forme : en dernière analyse, ce n'était toujours que le même moyen, à savoir l'obstination - même si, je le voyais bien, c'était une forme très élaborée d'obstination, la plus efficace de toutes celles que je connaissais, et puis surtout, cela va sans dire, la plus utile pour moi, je ne pouvais pas le nier. »
L'acceptation n'implique pas la résignation, bien au contraire, elle implique de s'adapter aux circonstances, et de ne jamais oublier que chaque minute, chaque seconde à venir contient en elle un monde de possibles. Est-ce le fait de se concevoir comme un être absolument libre qui a sauvé Imre Kertész ? Est-ce le fait d'avoir transformé en art l'effroyable entreprise d'extermination de tout un peuple? Il a survécu. Et par deux fois : une première fois durant une année entière à Buchenwald-Auschwitz, une deuxième fois durant le reste de sa « vie invivable », lui qui dans un entretien à Florence Noiville, rappelait :
« Vous remarquerez que je ne me suis pas suicidé. Tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, Celan, Améry, Borowski, Primo Levi… ont préféré la mort. »
Avec Etre sans destin, l'immense auteur hongrois Imre Kertész, nobélisé en 2002 pour « une écriture qui soutient la fragile expérience de l'individu contre l'arbitraire barbare de l'histoire », a véritablement transmué l'horreur et l'innommable en art. Et c'est ce qui, à mes yeux, fait de ce livre un objet unique qui, plus que tout autre livre sur la Shoah, répare et apaise. Car Imre Kertész ne se contente pas de témoigner, il ne tente pas d'analyser, encore moins de dénoncer, il crée, il recrée plus exactement un monde, celui des camps d'extermination nazis. Et c'est cette re-création, servie par une langue inouïe qui entre dans notre chair de lecteur, qui, paradoxalement, nous permet de sortir de l'hébétude dans laquelle l'horreur nous a initialement plongés, nous invitant à abandonner des réactions érigées comme autant de barrières défensives — indignation, rébellion, dégoût, déni, évitement…— pour nous conduire sur la seule voie possible, celle de l'acceptation.
« Je vais continuer à vivre ma vie invivable (…), il n'y a aucune absurdité qu'on ne puisse vivre tout naturellement, et sur la route, je le sais déjà, me guette, comme un piège incontournable, le bonheur. »
Pour Imre Kertész, déporté à l'âge de quinze ans parce que né juif, la confrontation avec l'absurdité de notre monde a lieu très tôt. D'autant que cette expérience primordiale se verra prolongée, approfondie, enrichie par plus de quatre décennies passées derrière le rideau de fer sous un régime au mode de gouvernement arbitraire et paranoïaque. Imre Kertesz se disait d'ailleurs convaincu qu'il n'aurait pas pu écrire son expérience dans les camps nazis s'il avait vécu sous un régime démocratique et libre. J'ignore s'il faut prendre ses paroles au pied de la lettre. Disons qu'il n'aurait probablement pas écrit l'oeuvre qu'il a écrite, imprégnée de la conviction qu'aucune destinée ne préside à nos existences, que celles-ci sont tout entières vouées à la contingence et à l'absurde, ce qui, pour lui, revient à dire qu'elles sont absolument libres. Imre Kertesz rejoint en cela Camus, dont la lecture, à l'âge de vingt-cinq ans, l'a, dit-il, profondément marqué, précisant qu'en hongrois, L'Etranger était traduit par « L'indifférent ». « Indifférent au sens de détaché du monde, de lui-même. Mais aussi au sens d'affranchi, c'est-à-dire d'homme libre. »
L'homme libre, l'homme affranchi pour Imre Kertesz, c'est l'homme sans destin : « S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible; si, au contraire, ai-je poursuivi de plus en plus surpris et me piquant au jeu, si la liberté existe, alors il n'y a pas de destin, c'est-à-dire — je me suis interrompu, mais juste le temps de reprendre mon souffle — c'est-à-dire qu'alors nous sommes nous-mêmes le destin. »
Dès lors, il est inconcevable, absurde de se percevoir comme une victime. Car être victime, c'est devenir l'objet de quelqu'un ou de quelque chose; être victime, c'est subir. Or, on n'est victime de rien ni de personne, on vit juste des choses plus ou moins désagréables. Quand la vermine s'installe dans sa plaie à la hanche, notre héros est d'abord horrifié et s'acharne à la chasser, exercice parfaitement vain :
« Au bout d'un certain temps, je renonçai et me contentais de contempler cette voracité, ce grouillement, cette avidité, cet appétit, ce bonheur sans fard : d'une certaine façon, il me semblait les connaître un peu. C'est alors que je me rendis compte que je pouvais peu ou prou les comprendre, à bien y réfléchir. Finalement, j'en fus presque soulagé, les démangeaisons cessèrent presque. Mais je ne me réjouis pas pour autant, je restai un peu aigri - et je pense que c'est compréhensible, en fin de compte - mais dans l'ensemble, sans colère, juste un peu à cause des lois de la nature, pour ainsi dire. »
Et c'est cette même attitude, mélange unique d'apparente désinvolture, de fausse candeur et d'humour impitoyable, qu'il adopte à l'égard des Allemands, assimilés à une gigantesque machine anonyme et dépersonnalisée. Les Allemands réifient les Juifs? Il réifie les Allemands, faisant mine de reprendre à son compte l'argumentaire nazi selon lequel juifs et allemands n'appartiendraient pas à la même espèce :
« Et j'avais beau voir, par exemple, leur visage, leurs yeux ou la couleur de leurs cheveux, l'un ou l'autre trait particulier voire défaut, un bouton sur leur peau, j'étais totalement incapable de m'accrocher à quelque chose, j'étais à deux doigts de douter, effectivement, si ceux qui marchaient à côté de nous étaient en dépit de tout nos semblables, si, en définitive, ils étaient faits de la même substance que nous, au fond. Mais il me vint à l'esprit que ma façon de voir pouvait être erronée, puisque c'est moi qui n'étais pas de la même substance, naturellement. »
En retournant comme un gant l'horreur, en transformant le plomb en or, Imre Kertesz nous offre une lecture jubilatoire en même temps qu'une leçon de vie qui nous aide, ainsi que je l'écrivais en préambule, à accepter l'humaine condition pour ce qu'elle est : le plus souvent misérable, parfois admirable et surtout, jamais inéluctable. Au moment ultime où tout semble perdu, voici que se produit l'impensable, l'inexplicable, et le moribond se croyant acheminé vers les chambres à gaz, se retrouve à l'infirmerie où, pour la première fois depuis longtemps, il rencontre des détenus (médecins et infirmiers) qui ressemblent à des hommes, non à des squelettes dépenaillés. C'est aussi en ce lieu qu'il retrouve cette chose fragile et néanmoins tenace, déjà rencontrée depuis son arrivée au camp, une forme de résistance sourde et têtue qui anime certains hommes, comme cet infirmier qui, atterré par son extrême maigreur, lui apporte clandestinement deux fois par semaine de la viande en conserve et un morceau de pain.
« C'est alors que je compris, je crois, ces hommes. Car en recoupant toutes mes expériences, en assemblant tous les maillons de la chaîne, oui, il ne me restait aucun doute, c'était bien cela, même si je le connaissais sous une autre forme : en dernière analyse, ce n'était toujours que le même moyen, à savoir l'obstination - même si, je le voyais bien, c'était une forme très élaborée d'obstination, la plus efficace de toutes celles que je connaissais, et puis surtout, cela va sans dire, la plus utile pour moi, je ne pouvais pas le nier. »
L'acceptation n'implique pas la résignation, bien au contraire, elle implique de s'adapter aux circonstances, et de ne jamais oublier que chaque minute, chaque seconde à venir contient en elle un monde de possibles. Est-ce le fait de se concevoir comme un être absolument libre qui a sauvé Imre Kertész ? Est-ce le fait d'avoir transformé en art l'effroyable entreprise d'extermination de tout un peuple? Il a survécu. Et par deux fois : une première fois durant une année entière à Buchenwald-Auschwitz, une deuxième fois durant le reste de sa « vie invivable », lui qui dans un entretien à Florence Noiville, rappelait :
« Vous remarquerez que je ne me suis pas suicidé. Tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, Celan, Améry, Borowski, Primo Levi… ont préféré la mort. »
Je poursuis ma découverte enchantée de cet auteur hongrois, rescapé des camps de la mort. Avec Être sans destin, Imre Kertész prend le parti de rendre compte de l'expérience concentrationnaire d'une façon particulièrement propre à en faire ressortir toute l'horreur, dans une langue simple et dépouillée. Gyurka est un jeune adolescent de presque quinze ans. C'est d'abord son père qui est « réquisitionné » pour le « service du travail obligatoire » (p.18), et il accompagne ce dernier, avec sa belle-mère, faire des « emplettes » pour s'y préparer : sac à dos, canif, gamelle… Lui-même raflé sur la route le menant à l'usine où il est envoyé pour travailler – le chapitre commence par « le lendemain, il m'est arrivé quelque chose d'un peu étrange » (p. 57) -, envoyé dans un camp de transit puis de là transporté à Auschwitz dans les tristement célèbres wagons à bestiaux, totalement ignorant de ce qui l'attend, il ne se départit jamais du regard naïf et décalé qui est le sien, étranger à sa propre expérience, alors que le lecteur a forcément une représentation plus intégrée des choses, ce qui s'avère particulièrement efficace pour mettre en lumière l'entreprise de destruction nazie, ses mécanismes, ses stratagèmes. Un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a fait comprendre davantage l'incommunicabilité d'une telle expérience.
Je n'ai plus ce livre entre les mains. Une impression étrange de coeur serré, lourd et tous les synonymes possibles.
"Continuer à vivre la vie invivable".
" Survivre après avoir survecu"
Quelles phrases.
Pris Nobel de littérature hongrois. On l'a rapproché de Primo Levy pour leurs descriptions calmes,froides de leurs vies dans les camps.
"Continuer à vivre la vie invivable".
" Survivre après avoir survecu"
Quelles phrases.
Pris Nobel de littérature hongrois. On l'a rapproché de Primo Levy pour leurs descriptions calmes,froides de leurs vies dans les camps.
Récit majeur d'Imre Kertesz, écrit dans les années 60, découvert très tardivement en Europe occidentale (édité en 1992 en anglais, en 1997 en français), ignoré superbement dans la Hongrie socialiste où il avait été édité en 1975. C'est un récit (j'emploie volontairement ce mot car ce n'est pas vraiment un roman ni tout à fait, par la forme, un témoignage) très déroutant et très perturbant pour le lecteur qui ne comprend le parti pris de l'auteur que dans les dernières pages. L'auteur ne nous livre pas un témoignage en racontant ce qu'il a vécu, mais en se mettant dans la peau de l'adolescent qu'il a été et qui partage au jour le jour ce qu'il a vécu, comme il l'a vécu. D'où l'emploi du présent, déjà un tout petit peu perturbant pour un tel récit si on y réfléchit. Imre Kertesz a cherché à éliminer tout ce qui, dans son regard d'adulte, dans le recul pris avec le temps, pouvait modifier la perception de son vécu dans les camps. La violence est quasi absente, mais le lecteur ne peut s'empêcher de la deviner entre les lignes, et de réagir avec ses propres émotions. Ce choix explique le ton du narrateur, relativement froid (plutôt distant d'ailleurs), détaché des événements. le lecteur ne peut que le trouver terriblement passif, candide, naïf jusqu'à l'absurde. Cette distanciation nous paraît paradoxale, mais c'est une manière de supporter ce qui lui arrive, en suivant quelques préceptes simples, au jour le jour, en prenant soin de lui-même aussi longtemps qu'il peut. le narrateur est arrêté à 15 ans, sur le chemin de l'usine, placé en camp de transit puis déporté à Auschwitz où il ne restera que trois jours, suffisant pour qu'il comprenne que les personnes non sélectionnées sont gazés, ensuite il sera transféré à Buchenwald. Pour donner une petite idée de ce qui est perturbant dans ce texte : pour le narrateur Buchenwald apparaît presque comme un paradis ! du décalage entre ce que sait le narrateur et ce que sait le lecteur naît un sentiment d'absurdité et le non-sens profond de la persécution des Juifs. Il survivra, rentrera, sans rien avoir vu des combats de libération car cloué au lit à l'infirmerie pendant toute cette période (alors qu'il était dans le seul camp où les prisonniers ont pris les armes : Buchenwald). A son retour il a la haine, ses voisins juifs non déportés lui disent d'oublier, de passer à autre chose, il ne peut partager son vécu : « j'ai essayé de lui expliquer à quel point c'était différent, par exemple, d'arriver dans une gare pas nécessairement luxueuse mais tout à fait acceptable, jolie, proprette, où on découvre tout petit à petit, chaque chose en son temps, étape par étape, le temps de passer une étape, de l'avoir derrière soi, et déjà arrive la suivante. Ensuite, le temps de tout apprendre, on a déjà tout compris. Et pendant qu'on comprend tout, on ne reste pas inactif ; on effectue déjà sa nouvelle tâche, on agit, on bouge, on réalise les nouvelles exigences de chaque nouvelle étape. Si les choses ne se passaient pas dans cet ordre, si toute la connaissance nous tombait immédiatement dessus..., sur place, il est possible qu'alors ni notre tête ni notre coeur ne pourraient le supporter » Un livre très fort, marquant, à lire absolument !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Imre Kertész (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1721 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1721 lecteurs ont répondu