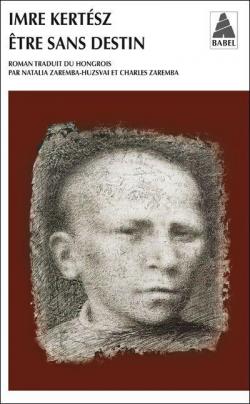Critiques filtrées sur 5 étoiles
Longtemps après avoir refermé le « si c'est un homme » je suis toujours hanté par ce livre. En ouvrant cet « être sans destin » je pensais me retrouver en terrain connu, éprouver les mêmes sensations qu'à la lecture de Primo Levi. du coup j'ai été très déstabilisé par la candeur, la passivité d'Imre Kertész. d'ailleurs j'ai longtemps pensé attribuer une note inférieure à ce livre, jusqu'à cette dernière partie, ces 30 dernières pages relatant son retour en Hongrie, un chapitre bouleversant, qui fait froid dans le dos, qui m'a mis K.O., que je relis en boucle depuis plusieurs jours. En effet, ici sont livrées les clés qui expliquent son comportement, son ressenti et là, je me suis senti aussi « coupable » que ses anciens voisins, heureux de le voir revenir vivant mais incapables désormais de le comprendre. Quand on lui demande ce qu'il ressent en retrouvant sa ville il répond « de la haine... envers tout le monde », envers ces gens qui ont vécu ou survécu pendant qu'il était à Buchenwald, envers ces gens qui lui parlent de son avenir, envers ces gens qui lui conseillent d'oublier ces atrocités sans se rendre compte de l'absurdité de leurs paroles.
« … je commence tout doucement à voir qu'il y a une ou deux choses dont on ne peut visiblement jamais discuter avec des étrangers, des ignorants, dans un certain sens des enfants... »
J'ai lu dans la critique d'IreneAdler : « Ce texte confirme une autre chose : quelque soit le nombre de témoignages lus, quelque soit le nombre de point de vue abordé, nous resterons toujours de l'autre côté des barbelés. » . C'est exactement ça, une barrière infranchissable nous sépare à jamais de ces survivants.
« Moi aussi, j'ai vécu un destin donné. Ce n'était pas mon destin, mais c'est moi qui l'ai vécu jusqu'au bout, et j' étais incapable de comprendre que cela ne leur rentre pas dans la tête : que désormais je devais en faire quelque chose, maintenant, je pouvais ne pas m'accommoder de l'idée que ce n'était qu'une erreur, un accident, une espèce de dérapage, ou que peut-être rien ne s'était passé. Je voyais, je voyais très bien qu'ils ne comprenaient pas trop, mes paroles n'étaient pas vraiment à leur goût, l'une ou l'autre semblait même les irriter. »
…
« On ne peut pas – il fallait qu'ils essaient de comprendre cela – on ne peut pas tout me prendre, il m'est impossible de n'être ni vainqueur ni vaincu, de ne pas pouvoir avoir raison et de n'avoir pas pu me tromper, de n'être ni la cause ni la conséquence de rien ; je les suppliais presque d'essayer d'admettre que je en pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir n'être rien qu'innocent. Mais je voyais qu'ils ne voulaient rien admettre, et ainsi, prenant mon sac et ma casquette, après quelques gestes embarrassés, mouvements inachevés, au milieu d'une phrase inachevée, je suis parti. »
Une lecture bouleversante loin du sensationnalisme, de tout misérabilisme, très déroutante mais assurément indispensable.
« … je commence tout doucement à voir qu'il y a une ou deux choses dont on ne peut visiblement jamais discuter avec des étrangers, des ignorants, dans un certain sens des enfants... »
J'ai lu dans la critique d'IreneAdler : « Ce texte confirme une autre chose : quelque soit le nombre de témoignages lus, quelque soit le nombre de point de vue abordé, nous resterons toujours de l'autre côté des barbelés. » . C'est exactement ça, une barrière infranchissable nous sépare à jamais de ces survivants.
« Moi aussi, j'ai vécu un destin donné. Ce n'était pas mon destin, mais c'est moi qui l'ai vécu jusqu'au bout, et j' étais incapable de comprendre que cela ne leur rentre pas dans la tête : que désormais je devais en faire quelque chose, maintenant, je pouvais ne pas m'accommoder de l'idée que ce n'était qu'une erreur, un accident, une espèce de dérapage, ou que peut-être rien ne s'était passé. Je voyais, je voyais très bien qu'ils ne comprenaient pas trop, mes paroles n'étaient pas vraiment à leur goût, l'une ou l'autre semblait même les irriter. »
…
« On ne peut pas – il fallait qu'ils essaient de comprendre cela – on ne peut pas tout me prendre, il m'est impossible de n'être ni vainqueur ni vaincu, de ne pas pouvoir avoir raison et de n'avoir pas pu me tromper, de n'être ni la cause ni la conséquence de rien ; je les suppliais presque d'essayer d'admettre que je en pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir n'être rien qu'innocent. Mais je voyais qu'ils ne voulaient rien admettre, et ainsi, prenant mon sac et ma casquette, après quelques gestes embarrassés, mouvements inachevés, au milieu d'une phrase inachevée, je suis parti. »
Une lecture bouleversante loin du sensationnalisme, de tout misérabilisme, très déroutante mais assurément indispensable.
« Je peux dire peut-être que, cinquante ans après, j'ai donné forme à l'horreur que l'Allemagne a déversée sur le monde (…), que je l'ai rendue aux Allemands sous forme d'art. » (L'holocauste comme culture)
Avec Etre sans destin, l'immense auteur hongrois Imre Kertész, nobélisé en 2002 pour « une écriture qui soutient la fragile expérience de l'individu contre l'arbitraire barbare de l'histoire », a véritablement transmué l'horreur et l'innommable en art. Et c'est ce qui, à mes yeux, fait de ce livre un objet unique qui, plus que tout autre livre sur la Shoah, répare et apaise. Car Imre Kertész ne se contente pas de témoigner, il ne tente pas d'analyser, encore moins de dénoncer, il crée, il recrée plus exactement un monde, celui des camps d'extermination nazis. Et c'est cette re-création, servie par une langue inouïe qui entre dans notre chair de lecteur, qui, paradoxalement, nous permet de sortir de l'hébétude dans laquelle l'horreur nous a initialement plongés, nous invitant à abandonner des réactions érigées comme autant de barrières défensives — indignation, rébellion, dégoût, déni, évitement…— pour nous conduire sur la seule voie possible, celle de l'acceptation.
« Je vais continuer à vivre ma vie invivable (…), il n'y a aucune absurdité qu'on ne puisse vivre tout naturellement, et sur la route, je le sais déjà, me guette, comme un piège incontournable, le bonheur. »
Pour Imre Kertész, déporté à l'âge de quinze ans parce que né juif, la confrontation avec l'absurdité de notre monde a lieu très tôt. D'autant que cette expérience primordiale se verra prolongée, approfondie, enrichie par plus de quatre décennies passées derrière le rideau de fer sous un régime au mode de gouvernement arbitraire et paranoïaque. Imre Kertesz se disait d'ailleurs convaincu qu'il n'aurait pas pu écrire son expérience dans les camps nazis s'il avait vécu sous un régime démocratique et libre. J'ignore s'il faut prendre ses paroles au pied de la lettre. Disons qu'il n'aurait probablement pas écrit l'oeuvre qu'il a écrite, imprégnée de la conviction qu'aucune destinée ne préside à nos existences, que celles-ci sont tout entières vouées à la contingence et à l'absurde, ce qui, pour lui, revient à dire qu'elles sont absolument libres. Imre Kertesz rejoint en cela Camus, dont la lecture, à l'âge de vingt-cinq ans, l'a, dit-il, profondément marqué, précisant qu'en hongrois, L'Etranger était traduit par « L'indifférent ». « Indifférent au sens de détaché du monde, de lui-même. Mais aussi au sens d'affranchi, c'est-à-dire d'homme libre. »
L'homme libre, l'homme affranchi pour Imre Kertesz, c'est l'homme sans destin : « S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible; si, au contraire, ai-je poursuivi de plus en plus surpris et me piquant au jeu, si la liberté existe, alors il n'y a pas de destin, c'est-à-dire — je me suis interrompu, mais juste le temps de reprendre mon souffle — c'est-à-dire qu'alors nous sommes nous-mêmes le destin. »
Dès lors, il est inconcevable, absurde de se percevoir comme une victime. Car être victime, c'est devenir l'objet de quelqu'un ou de quelque chose; être victime, c'est subir. Or, on n'est victime de rien ni de personne, on vit juste des choses plus ou moins désagréables. Quand la vermine s'installe dans sa plaie à la hanche, notre héros est d'abord horrifié et s'acharne à la chasser, exercice parfaitement vain :
« Au bout d'un certain temps, je renonçai et me contentais de contempler cette voracité, ce grouillement, cette avidité, cet appétit, ce bonheur sans fard : d'une certaine façon, il me semblait les connaître un peu. C'est alors que je me rendis compte que je pouvais peu ou prou les comprendre, à bien y réfléchir. Finalement, j'en fus presque soulagé, les démangeaisons cessèrent presque. Mais je ne me réjouis pas pour autant, je restai un peu aigri - et je pense que c'est compréhensible, en fin de compte - mais dans l'ensemble, sans colère, juste un peu à cause des lois de la nature, pour ainsi dire. »
Et c'est cette même attitude, mélange unique d'apparente désinvolture, de fausse candeur et d'humour impitoyable, qu'il adopte à l'égard des Allemands, assimilés à une gigantesque machine anonyme et dépersonnalisée. Les Allemands réifient les Juifs? Il réifie les Allemands, faisant mine de reprendre à son compte l'argumentaire nazi selon lequel juifs et allemands n'appartiendraient pas à la même espèce :
« Et j'avais beau voir, par exemple, leur visage, leurs yeux ou la couleur de leurs cheveux, l'un ou l'autre trait particulier voire défaut, un bouton sur leur peau, j'étais totalement incapable de m'accrocher à quelque chose, j'étais à deux doigts de douter, effectivement, si ceux qui marchaient à côté de nous étaient en dépit de tout nos semblables, si, en définitive, ils étaient faits de la même substance que nous, au fond. Mais il me vint à l'esprit que ma façon de voir pouvait être erronée, puisque c'est moi qui n'étais pas de la même substance, naturellement. »
En retournant comme un gant l'horreur, en transformant le plomb en or, Imre Kertesz nous offre une lecture jubilatoire en même temps qu'une leçon de vie qui nous aide, ainsi que je l'écrivais en préambule, à accepter l'humaine condition pour ce qu'elle est : le plus souvent misérable, parfois admirable et surtout, jamais inéluctable. Au moment ultime où tout semble perdu, voici que se produit l'impensable, l'inexplicable, et le moribond se croyant acheminé vers les chambres à gaz, se retrouve à l'infirmerie où, pour la première fois depuis longtemps, il rencontre des détenus (médecins et infirmiers) qui ressemblent à des hommes, non à des squelettes dépenaillés. C'est aussi en ce lieu qu'il retrouve cette chose fragile et néanmoins tenace, déjà rencontrée depuis son arrivée au camp, une forme de résistance sourde et têtue qui anime certains hommes, comme cet infirmier qui, atterré par son extrême maigreur, lui apporte clandestinement deux fois par semaine de la viande en conserve et un morceau de pain.
« C'est alors que je compris, je crois, ces hommes. Car en recoupant toutes mes expériences, en assemblant tous les maillons de la chaîne, oui, il ne me restait aucun doute, c'était bien cela, même si je le connaissais sous une autre forme : en dernière analyse, ce n'était toujours que le même moyen, à savoir l'obstination - même si, je le voyais bien, c'était une forme très élaborée d'obstination, la plus efficace de toutes celles que je connaissais, et puis surtout, cela va sans dire, la plus utile pour moi, je ne pouvais pas le nier. »
L'acceptation n'implique pas la résignation, bien au contraire, elle implique de s'adapter aux circonstances, et de ne jamais oublier que chaque minute, chaque seconde à venir contient en elle un monde de possibles. Est-ce le fait de se concevoir comme un être absolument libre qui a sauvé Imre Kertész ? Est-ce le fait d'avoir transformé en art l'effroyable entreprise d'extermination de tout un peuple? Il a survécu. Et par deux fois : une première fois durant une année entière à Buchenwald-Auschwitz, une deuxième fois durant le reste de sa « vie invivable », lui qui dans un entretien à Florence Noiville, rappelait :
« Vous remarquerez que je ne me suis pas suicidé. Tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, Celan, Améry, Borowski, Primo Levi… ont préféré la mort. »
Avec Etre sans destin, l'immense auteur hongrois Imre Kertész, nobélisé en 2002 pour « une écriture qui soutient la fragile expérience de l'individu contre l'arbitraire barbare de l'histoire », a véritablement transmué l'horreur et l'innommable en art. Et c'est ce qui, à mes yeux, fait de ce livre un objet unique qui, plus que tout autre livre sur la Shoah, répare et apaise. Car Imre Kertész ne se contente pas de témoigner, il ne tente pas d'analyser, encore moins de dénoncer, il crée, il recrée plus exactement un monde, celui des camps d'extermination nazis. Et c'est cette re-création, servie par une langue inouïe qui entre dans notre chair de lecteur, qui, paradoxalement, nous permet de sortir de l'hébétude dans laquelle l'horreur nous a initialement plongés, nous invitant à abandonner des réactions érigées comme autant de barrières défensives — indignation, rébellion, dégoût, déni, évitement…— pour nous conduire sur la seule voie possible, celle de l'acceptation.
« Je vais continuer à vivre ma vie invivable (…), il n'y a aucune absurdité qu'on ne puisse vivre tout naturellement, et sur la route, je le sais déjà, me guette, comme un piège incontournable, le bonheur. »
Pour Imre Kertész, déporté à l'âge de quinze ans parce que né juif, la confrontation avec l'absurdité de notre monde a lieu très tôt. D'autant que cette expérience primordiale se verra prolongée, approfondie, enrichie par plus de quatre décennies passées derrière le rideau de fer sous un régime au mode de gouvernement arbitraire et paranoïaque. Imre Kertesz se disait d'ailleurs convaincu qu'il n'aurait pas pu écrire son expérience dans les camps nazis s'il avait vécu sous un régime démocratique et libre. J'ignore s'il faut prendre ses paroles au pied de la lettre. Disons qu'il n'aurait probablement pas écrit l'oeuvre qu'il a écrite, imprégnée de la conviction qu'aucune destinée ne préside à nos existences, que celles-ci sont tout entières vouées à la contingence et à l'absurde, ce qui, pour lui, revient à dire qu'elles sont absolument libres. Imre Kertesz rejoint en cela Camus, dont la lecture, à l'âge de vingt-cinq ans, l'a, dit-il, profondément marqué, précisant qu'en hongrois, L'Etranger était traduit par « L'indifférent ». « Indifférent au sens de détaché du monde, de lui-même. Mais aussi au sens d'affranchi, c'est-à-dire d'homme libre. »
L'homme libre, l'homme affranchi pour Imre Kertesz, c'est l'homme sans destin : « S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible; si, au contraire, ai-je poursuivi de plus en plus surpris et me piquant au jeu, si la liberté existe, alors il n'y a pas de destin, c'est-à-dire — je me suis interrompu, mais juste le temps de reprendre mon souffle — c'est-à-dire qu'alors nous sommes nous-mêmes le destin. »
Dès lors, il est inconcevable, absurde de se percevoir comme une victime. Car être victime, c'est devenir l'objet de quelqu'un ou de quelque chose; être victime, c'est subir. Or, on n'est victime de rien ni de personne, on vit juste des choses plus ou moins désagréables. Quand la vermine s'installe dans sa plaie à la hanche, notre héros est d'abord horrifié et s'acharne à la chasser, exercice parfaitement vain :
« Au bout d'un certain temps, je renonçai et me contentais de contempler cette voracité, ce grouillement, cette avidité, cet appétit, ce bonheur sans fard : d'une certaine façon, il me semblait les connaître un peu. C'est alors que je me rendis compte que je pouvais peu ou prou les comprendre, à bien y réfléchir. Finalement, j'en fus presque soulagé, les démangeaisons cessèrent presque. Mais je ne me réjouis pas pour autant, je restai un peu aigri - et je pense que c'est compréhensible, en fin de compte - mais dans l'ensemble, sans colère, juste un peu à cause des lois de la nature, pour ainsi dire. »
Et c'est cette même attitude, mélange unique d'apparente désinvolture, de fausse candeur et d'humour impitoyable, qu'il adopte à l'égard des Allemands, assimilés à une gigantesque machine anonyme et dépersonnalisée. Les Allemands réifient les Juifs? Il réifie les Allemands, faisant mine de reprendre à son compte l'argumentaire nazi selon lequel juifs et allemands n'appartiendraient pas à la même espèce :
« Et j'avais beau voir, par exemple, leur visage, leurs yeux ou la couleur de leurs cheveux, l'un ou l'autre trait particulier voire défaut, un bouton sur leur peau, j'étais totalement incapable de m'accrocher à quelque chose, j'étais à deux doigts de douter, effectivement, si ceux qui marchaient à côté de nous étaient en dépit de tout nos semblables, si, en définitive, ils étaient faits de la même substance que nous, au fond. Mais il me vint à l'esprit que ma façon de voir pouvait être erronée, puisque c'est moi qui n'étais pas de la même substance, naturellement. »
En retournant comme un gant l'horreur, en transformant le plomb en or, Imre Kertesz nous offre une lecture jubilatoire en même temps qu'une leçon de vie qui nous aide, ainsi que je l'écrivais en préambule, à accepter l'humaine condition pour ce qu'elle est : le plus souvent misérable, parfois admirable et surtout, jamais inéluctable. Au moment ultime où tout semble perdu, voici que se produit l'impensable, l'inexplicable, et le moribond se croyant acheminé vers les chambres à gaz, se retrouve à l'infirmerie où, pour la première fois depuis longtemps, il rencontre des détenus (médecins et infirmiers) qui ressemblent à des hommes, non à des squelettes dépenaillés. C'est aussi en ce lieu qu'il retrouve cette chose fragile et néanmoins tenace, déjà rencontrée depuis son arrivée au camp, une forme de résistance sourde et têtue qui anime certains hommes, comme cet infirmier qui, atterré par son extrême maigreur, lui apporte clandestinement deux fois par semaine de la viande en conserve et un morceau de pain.
« C'est alors que je compris, je crois, ces hommes. Car en recoupant toutes mes expériences, en assemblant tous les maillons de la chaîne, oui, il ne me restait aucun doute, c'était bien cela, même si je le connaissais sous une autre forme : en dernière analyse, ce n'était toujours que le même moyen, à savoir l'obstination - même si, je le voyais bien, c'était une forme très élaborée d'obstination, la plus efficace de toutes celles que je connaissais, et puis surtout, cela va sans dire, la plus utile pour moi, je ne pouvais pas le nier. »
L'acceptation n'implique pas la résignation, bien au contraire, elle implique de s'adapter aux circonstances, et de ne jamais oublier que chaque minute, chaque seconde à venir contient en elle un monde de possibles. Est-ce le fait de se concevoir comme un être absolument libre qui a sauvé Imre Kertész ? Est-ce le fait d'avoir transformé en art l'effroyable entreprise d'extermination de tout un peuple? Il a survécu. Et par deux fois : une première fois durant une année entière à Buchenwald-Auschwitz, une deuxième fois durant le reste de sa « vie invivable », lui qui dans un entretien à Florence Noiville, rappelait :
« Vous remarquerez que je ne me suis pas suicidé. Tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, Celan, Améry, Borowski, Primo Levi… ont préféré la mort. »
Bien sur, il existe une multitude de récits et de témoignages sur la Déportation et les camps pendant la Seconde Guerre Mondiale mais celui-ci a quelque chose de différent, d'unique.
Différent, parce qu'il faut, avant de commencer la lecture, essayer d'oublier tout ce que vous savez sur ce sujet, vous ne savez rien, vous n'avez jamais entendu parler de ce qui s'est passé dans les camps.
Unique, parce que vous allez être dans le corps, le cerveau, l'esprit d'un gamin de 15 ans, raflé dans un bus, jeté dans une prison puis dans un train qui le conduira, seul, sans même avoir revu sa famille, au bout d'un long voyage, dans un camp : celui d'Auschwitz.
Le tri sur le quai, le coiffeur, la douche ( la vraie avec de l'eau pour lui ), la désinfection, le repas si l'on peut appeler cela un repas, les kapos, les odeurs , les rumeurs qui font que dès le premier jour, on apprend ce que signifie ces fumées qui sortent sans discontinuer des cheminées. Tout cela à 15 ans alors que l'on était sensé venir juste travailler en Allemagne.
Trois jours plus tard, nouveau train, nouveau camp ( Buchenwald ) puis envoi en kommando extérieur pour travailler dans une usine.
C'est le récit de la vie quotidienne avec la faim pour principale compagne mais aussi le manque d'hygiène , les poux , la promiscuité, la peur, les maladies et enfin le Revier ( infirmerie ).
Il n'y a pas d'horreur, pas de description de scènes insoutenables seulement
si je puis dire, la survie dans cet univers au quotidien.
Tout est décrit avec un certain détachement qui peut dérouter au début mais qui s'avère terriblement efficace pour nous faire comprendre la découverte et l'appréhension de l'inimaginable et de l'insoutenable.
Après la libération et le difficile retour au pays, l'auteur nous expose sa théorie des petits pas. Selon lui, les bourreaux ne sont pas les seuls coupables, chacun en faisant un petit pas de trop, une concession de trop, a permis que tout cela arrive.
C'est évidement un livre bouleversant mais c'est surtout un livre qui propose une tout autre version, un autre regard sur ces horreurs et il vrai que l'on lit rarement sur les camps en pensant que ces pauvres gens ne pouvaient imaginer ce qu'ils allaient découvrir et subir et le choc que cela fut pour eux.
Quant à la théorie de l'auteur "sur les petits pas", il serait bon de l'avoir toujours à l'esprit.
Différent, parce qu'il faut, avant de commencer la lecture, essayer d'oublier tout ce que vous savez sur ce sujet, vous ne savez rien, vous n'avez jamais entendu parler de ce qui s'est passé dans les camps.
Unique, parce que vous allez être dans le corps, le cerveau, l'esprit d'un gamin de 15 ans, raflé dans un bus, jeté dans une prison puis dans un train qui le conduira, seul, sans même avoir revu sa famille, au bout d'un long voyage, dans un camp : celui d'Auschwitz.
Le tri sur le quai, le coiffeur, la douche ( la vraie avec de l'eau pour lui ), la désinfection, le repas si l'on peut appeler cela un repas, les kapos, les odeurs , les rumeurs qui font que dès le premier jour, on apprend ce que signifie ces fumées qui sortent sans discontinuer des cheminées. Tout cela à 15 ans alors que l'on était sensé venir juste travailler en Allemagne.
Trois jours plus tard, nouveau train, nouveau camp ( Buchenwald ) puis envoi en kommando extérieur pour travailler dans une usine.
C'est le récit de la vie quotidienne avec la faim pour principale compagne mais aussi le manque d'hygiène , les poux , la promiscuité, la peur, les maladies et enfin le Revier ( infirmerie ).
Il n'y a pas d'horreur, pas de description de scènes insoutenables seulement
si je puis dire, la survie dans cet univers au quotidien.
Tout est décrit avec un certain détachement qui peut dérouter au début mais qui s'avère terriblement efficace pour nous faire comprendre la découverte et l'appréhension de l'inimaginable et de l'insoutenable.
Après la libération et le difficile retour au pays, l'auteur nous expose sa théorie des petits pas. Selon lui, les bourreaux ne sont pas les seuls coupables, chacun en faisant un petit pas de trop, une concession de trop, a permis que tout cela arrive.
C'est évidement un livre bouleversant mais c'est surtout un livre qui propose une tout autre version, un autre regard sur ces horreurs et il vrai que l'on lit rarement sur les camps en pensant que ces pauvres gens ne pouvaient imaginer ce qu'ils allaient découvrir et subir et le choc que cela fut pour eux.
Quant à la théorie de l'auteur "sur les petits pas", il serait bon de l'avoir toujours à l'esprit.
À travers le regard d'un adolescent, un témoignage différent sur les camps de concentration, un récit autobiographique du prix Nobel de littérature 2002.
À Budapest, un garçon de quinze ans vit avec son père et sa belle-mère. Il ne comprend pas très bien pourquoi, mais son père doit partir pour un camp de travail. Arrêté lui-même plus tard, il échappe aux fours d'Auschwitz pour être envoyé à Buchenwald. Il y travaille et y dépérit, mais il a la chance que dans ce camp, on soigne les malades. Il pourra rentrer chez lui après un an de détention.
Ce garçon n'a pas l'étoffe d'un héros. Ce n'est pas un homme fort ni un rebelle qui s'échappe du camp. Ce n'est pas un leader ni un rusé négociateur pour se procurer des avantages. C'est seulement un jeune homme, étonné de ce qu'il voit, soucieux d'apprendre les règles pour « bien faire » comme pour tout ce qu'on fait dans la vie, apprendre donc les règles pour être un bon détenu. Un homme qui continue d'avancer avec le temps, de faire un pas de plus.
Dans ce livre, ce ne sont pas les atrocités ou les tortures sadiques qui sont décrites, mais plutôt la psychologie de ces gens ordinaires qui sont embarqués, trompés et qui espèrent toujours. Des gens qui continuent simplement d'appliquer leurs valeurs ordinaires : respecter l'autorité, suivre la foule, bien se comporter en société. Des gens dont la survie dépend de leur obstination plutôt que de leur héroïsme.
Un ouvrage à lire absolument pour voir autrement et peut-être comprendre les mécanismes de la machine sociale dont on fait partie.
À Budapest, un garçon de quinze ans vit avec son père et sa belle-mère. Il ne comprend pas très bien pourquoi, mais son père doit partir pour un camp de travail. Arrêté lui-même plus tard, il échappe aux fours d'Auschwitz pour être envoyé à Buchenwald. Il y travaille et y dépérit, mais il a la chance que dans ce camp, on soigne les malades. Il pourra rentrer chez lui après un an de détention.
Ce garçon n'a pas l'étoffe d'un héros. Ce n'est pas un homme fort ni un rebelle qui s'échappe du camp. Ce n'est pas un leader ni un rusé négociateur pour se procurer des avantages. C'est seulement un jeune homme, étonné de ce qu'il voit, soucieux d'apprendre les règles pour « bien faire » comme pour tout ce qu'on fait dans la vie, apprendre donc les règles pour être un bon détenu. Un homme qui continue d'avancer avec le temps, de faire un pas de plus.
Dans ce livre, ce ne sont pas les atrocités ou les tortures sadiques qui sont décrites, mais plutôt la psychologie de ces gens ordinaires qui sont embarqués, trompés et qui espèrent toujours. Des gens qui continuent simplement d'appliquer leurs valeurs ordinaires : respecter l'autorité, suivre la foule, bien se comporter en société. Des gens dont la survie dépend de leur obstination plutôt que de leur héroïsme.
Un ouvrage à lire absolument pour voir autrement et peut-être comprendre les mécanismes de la machine sociale dont on fait partie.
Je voudrais pouvoir employer les mots les plus délicats possibles pour porter à votre regard cet être qui a failli ne plus être ni rien ni personne, ce jeune garçon qu'il aurait fallu prendre délicatement et bercer de ce qu'il a vu et vécu.
Je voudrais pourvoir trouver les phrases justes aussi pour ne pas trahir la parole d'Imre Kertész sur cette expérience inhumaine qu'ont été les camps de concentration et d'extermination.
Son narrateur, un jeune adolescent juif hongrois de 15 ans, peu conscient de la montée du nazisme et de l'antisémitisme, est un matin pris dans une rafle. Les premiers jours, où lui et ses compagnons sont amenés à pied puis en train d'un lieu de détention à un autre, il ne peut tout simplement pas saisir ce qui lui arrive, le vivant comme une aventure, puis une mésaventure, acceptant les conditions de plus en plus inhumaines des transports avec la confiance, la docilité d'un enfant et le détachement de celui qui pense tout cela provisoire.
C'est pas à pas, et surtout en découvrant le camp d'Auschwitz, les femmes rasées et les cheminées des chambres à gaz, que l'absurdité de sa situation, lui qui n'est coupable de rien, se révèle dans sa froide réalité. Autour de lui, les jeunes garçons se regardent encore en riant, gênés de leur corps rasés, mais les adultes tournent les yeux de tout côté, incrédules. Comment accepter l'inacceptable?
Hommes et femmes perdent leur nom, remplacé par un numéro, leur visage, après avoir été tondus, leur libre-arbitre, jusqu'à ne plus être qu'un corps parmi d'autres battus, affamés, transportés, jetés, déshabillés, voire soumis à expérimentations, vivants ou morts.
La question a sans aucun doute été: comment raconter l'innommable sans se trahir? Justifier sa vie par la suite? Car il faut bien vivre, puisqu'on est vivant. C'est cette question de l'écriture et surtout du point de vue choisi que j'ai trouvée si terrible, si puissante, le regard du narrateur sur l'impossible réalité de ce qu'il vit et la manière dont il s'adapte jusqu'au point où son âme n'est plus, à un moment, qu'une faible lueur à l'intérieur de son corps émacié, prête à s'éteindre. Comment il est arrivé à perdre, presque, son humanité, à ne plus être rien. Puis à ressusciter, grâce à quelque chose d'aussi trivial qu'à l'odeur de la soupe du camp.
C'est ce pas à pas, dira -t-il, qui lui aura permis de s'adapter, survivre. Sans cela, la tête et le coeur n'auraient pas pu supporter.
J'ai lu de nombreux livres sur ces camps, celui-ci m'a plongée dans le même état chaotique émotionnel que Si c'est un homme de Primo Levi, face à l'incompréhensible, l'impossible, l'insoutenable réalité de ces camps. Sans doute faut-il l'écrire, encore et encore, pour se battre contre l'ignorance, le refus de croire.
Je voudrais pourvoir trouver les phrases justes aussi pour ne pas trahir la parole d'Imre Kertész sur cette expérience inhumaine qu'ont été les camps de concentration et d'extermination.
Son narrateur, un jeune adolescent juif hongrois de 15 ans, peu conscient de la montée du nazisme et de l'antisémitisme, est un matin pris dans une rafle. Les premiers jours, où lui et ses compagnons sont amenés à pied puis en train d'un lieu de détention à un autre, il ne peut tout simplement pas saisir ce qui lui arrive, le vivant comme une aventure, puis une mésaventure, acceptant les conditions de plus en plus inhumaines des transports avec la confiance, la docilité d'un enfant et le détachement de celui qui pense tout cela provisoire.
C'est pas à pas, et surtout en découvrant le camp d'Auschwitz, les femmes rasées et les cheminées des chambres à gaz, que l'absurdité de sa situation, lui qui n'est coupable de rien, se révèle dans sa froide réalité. Autour de lui, les jeunes garçons se regardent encore en riant, gênés de leur corps rasés, mais les adultes tournent les yeux de tout côté, incrédules. Comment accepter l'inacceptable?
Hommes et femmes perdent leur nom, remplacé par un numéro, leur visage, après avoir été tondus, leur libre-arbitre, jusqu'à ne plus être qu'un corps parmi d'autres battus, affamés, transportés, jetés, déshabillés, voire soumis à expérimentations, vivants ou morts.
La question a sans aucun doute été: comment raconter l'innommable sans se trahir? Justifier sa vie par la suite? Car il faut bien vivre, puisqu'on est vivant. C'est cette question de l'écriture et surtout du point de vue choisi que j'ai trouvée si terrible, si puissante, le regard du narrateur sur l'impossible réalité de ce qu'il vit et la manière dont il s'adapte jusqu'au point où son âme n'est plus, à un moment, qu'une faible lueur à l'intérieur de son corps émacié, prête à s'éteindre. Comment il est arrivé à perdre, presque, son humanité, à ne plus être rien. Puis à ressusciter, grâce à quelque chose d'aussi trivial qu'à l'odeur de la soupe du camp.
C'est ce pas à pas, dira -t-il, qui lui aura permis de s'adapter, survivre. Sans cela, la tête et le coeur n'auraient pas pu supporter.
J'ai lu de nombreux livres sur ces camps, celui-ci m'a plongée dans le même état chaotique émotionnel que Si c'est un homme de Primo Levi, face à l'incompréhensible, l'impossible, l'insoutenable réalité de ces camps. Sans doute faut-il l'écrire, encore et encore, pour se battre contre l'ignorance, le refus de croire.
Être sans destin c'est être privé de sa liberté, de son humanité, devenir objet et non sujet.
de là on comprend mieux le style de l'auteur, rapportant les faits comme s'il en était détaché, comme si son âme volait au-dessus de son corps, avec naïveté, passivité.
Dés les premières pages, on se rend compte que le jeune adolescent Juif hongrois, ne conçoit pas la haine que les gens ont à l'égard des Juifs, il n'a pas la conscience de cette différence, il en a même un peu honte. Pourquoi le port de l'étoile jaune, si ce n'est pour marquer la différence, qui sans cela ne serait pas visible.
Jeune, innocent et naïf, il s'imagine, au début, être comme un acteur de théâtre, qui ne connaîtrait pas bien le rôle qu'il a à jouer, il est embarrassé, étonné. Comment comprendre ce qui lui arrive? Il avance pas à pas vers l'horreur, il s'y habitue, il finit même par trouver la quiétude , la paix , le soulagement.
Chacun, dans cette histoire, a avancé pas à pas vers son destin, qui n'était peut-être pas le sien , qui aurait pu être autre, si certains avaient oser agir, faire n'importe quoi, mais faire quelque chose.
"S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible ; si au contraire [...] la liberté existe, alors il n'y a pas de destin, c'est-à-dire[...] qu'alors nous sommes nous-même le destin. "
Ce récit est d'autant plus troublant, qu'il est écrit avec détachement, avec une sorte d'acceptation de son sort, comme si tout cela était naturel. Cette rupture est sans doute nécessaire à l'auteur pour révéler les atrocités , l'horreur, pour ne pas s'y perdre complètement , il s'en sert comme d'une sorte de bouclier.
On ressent aussi dans ce récit, la force incroyable de ces hommes face à la barbarie. Ils résistent par les seuls moyens qui leur restent ; l'imagination, l'obsession, l'obstination.
"Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd, qui s'était faufilée en moi, comme honteuse d'être si insensée, et pourtant de plus en plus obstinée : je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration."
Continuer à vivre sa vie invivable, en acceptant tous les arguments, au prix de pouvoir vivre, en cachant au fond de lui, la haine de tous, et se laisser prendre tout naturellement au piège du bonheur.
de là on comprend mieux le style de l'auteur, rapportant les faits comme s'il en était détaché, comme si son âme volait au-dessus de son corps, avec naïveté, passivité.
Dés les premières pages, on se rend compte que le jeune adolescent Juif hongrois, ne conçoit pas la haine que les gens ont à l'égard des Juifs, il n'a pas la conscience de cette différence, il en a même un peu honte. Pourquoi le port de l'étoile jaune, si ce n'est pour marquer la différence, qui sans cela ne serait pas visible.
Jeune, innocent et naïf, il s'imagine, au début, être comme un acteur de théâtre, qui ne connaîtrait pas bien le rôle qu'il a à jouer, il est embarrassé, étonné. Comment comprendre ce qui lui arrive? Il avance pas à pas vers l'horreur, il s'y habitue, il finit même par trouver la quiétude , la paix , le soulagement.
Chacun, dans cette histoire, a avancé pas à pas vers son destin, qui n'était peut-être pas le sien , qui aurait pu être autre, si certains avaient oser agir, faire n'importe quoi, mais faire quelque chose.
"S'il y a un destin, la liberté n'est pas possible ; si au contraire [...] la liberté existe, alors il n'y a pas de destin, c'est-à-dire[...] qu'alors nous sommes nous-même le destin. "
Ce récit est d'autant plus troublant, qu'il est écrit avec détachement, avec une sorte d'acceptation de son sort, comme si tout cela était naturel. Cette rupture est sans doute nécessaire à l'auteur pour révéler les atrocités , l'horreur, pour ne pas s'y perdre complètement , il s'en sert comme d'une sorte de bouclier.
On ressent aussi dans ce récit, la force incroyable de ces hommes face à la barbarie. Ils résistent par les seuls moyens qui leur restent ; l'imagination, l'obsession, l'obstination.
"Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd, qui s'était faufilée en moi, comme honteuse d'être si insensée, et pourtant de plus en plus obstinée : je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration."
Continuer à vivre sa vie invivable, en acceptant tous les arguments, au prix de pouvoir vivre, en cachant au fond de lui, la haine de tous, et se laisser prendre tout naturellement au piège du bonheur.
Je suis né en 1953, soit huit petites années après la fin de la seconde Guerre Mondiale et son cortège d'horreurs, dont certaines inédites dans l'histoire de l'humanité. Mon père, mon parrain et d'autres membres de ma famille ont pris part à ce conflit. Ma famille maternelle, native du Limousin, avait des amis proches à Oradour. Je suis donc né au sein d'une famille que ce terrible bouleversement a bouleversée, et qui par conséquent en parlait de manière récurrente. Mais dans leurs récits, leurs souvenirs, leurs anecdotes ou leurs allusions, il manquait un "mais"... et pas n'importe lequel : l'univers concentrationnaire, la solution finale, la Shoah... !
C'est à partir de l'acquisition du disque de Jean Ferrat - Nuit et Brouillard -en 1964, de ses passages télé et de ses interviews que j'ai commencé à me poser des questions et à en poser.
Était née une passion dévorante et obsessionnelle pour ce qui, à mon sens, est le Marqueur de l'histoire de l'homme et ce qui a structuré définitivement ma pensée et ma vision du monde.
J'ai donc lu beaucoup de "la littérature" (au sens noble du terme) ayant trait au sujet : Primo Levi, Robert Antelme, Charlotte Delbo, Ida Grinspan, Marceline Loridan-Ivens, Rudolf Vrba, Simone Veil, Jorge Semprun, Claude Lanzmann, le très controversé Filip Muller, Elie Wiesel, Jean Cayrol, Viktor Frankl, pour n'en citer que très peu et continue de le faire mais moins fréquemment que naguère.
J'avais, dans les rayons de ma bibliothèque, le livre de I. Kertész qui m'attendait, comme m'attendent beaucoup d'autres encore... que j'aurai peut-être encore le temps de découvrir.
Quelques mots pour qualifier le caractère original, unique de cette oeuvre :
"Être sans destin, du moins au début, c'est Candide dans un Auschwitz dont la fonction première – l'extermination – se dérobe à ses yeux et qui jette sur ce monde qu'il découvre des regards étonnés, impatients parfois mais jamais vraiment angoissés. Grâce à ce procédé, Kertész, le rescapé des camps devenu écrivain, s'efface complètement pour laisser vivre ce jeune narrateur – cet autre lui-même si différent et si lointain – au rythme des épreuves et des illusions qui sont les siennes. Subtil est ce dispositif narratif où l'auteur, dépouillé en quelque sorte de sa toute-puissance puisqu'il renonce à construire une histoire où les faits s'ordonnent et s'éclairent en fonction d'une fin qu'il connaît, se plie aux exigences d'une chronique..."
Chaque déporté, qu'il fut juif ou pas, a voulu témoigner de manière personnelle, authentique, "novatrice" sur ce qu'il a vécu. C'est pour cela que les témoignages d'un Robert Antelme, d'un Primo Levi, d'une Charlotte Delbo ont littérairement parlant, un caractère unique.
Il en va de même pour Kertész, qui a réussi une performance d'écriture inégalée dans le genre : celle de se dépouiller de l'adulte qu'il était devenu au moment de prendre la plume, pour retrouver l'adolescent de quinze ans qu'il était lorsqu'il a fait l'apprentissage de ce qu'était "un être sans destin".
Et le résultat est époustouflant, déroutant, déchirant.
Grâce à cette approche, grâce à cet angle de vue, grâce à cette chronique qu'il revit pas à pas, il nous permet de comprendre ce que fut la soi-disant "passivité" des victimes face à la froide organisation et la grande efficacité des bourreaux qui, en étant "peu nombreux" réussirent à exterminer des millions d'êtres humains.
Comme je l'ai déjà dit, ayant lu beaucoup sur ce thème, si l'émotion reste intacte, il est rare qu'un livre sur l'univers concentrationnaire nazi me surprenne vraiment.
- Être sans destin - m'a surpris.
Je voudrais terminer cette présentation en vous livrant un extrait dans lequel, l'auteur de retour à Budapest ( j'avais oublié... Kertész, prix Nobel de littérature 2002 est un juif hongrois...), rencontre un journaliste qui lui propose un peu d'argent contre le récit de "l'enfer" des camps... et voici ce qu'il lui répond sur ceux qui ne l'ont pas vécu appellent "l'enfer".
-"Alors je me l'imaginerais comme un endroit où on ne peut pas s'ennuyer ; cependant, ai-je ajouté, on pouvait s'ennuyer dans un camp de concentration, même à Auschwitz, sous certaines conditions, bien sûr. Il s'est tu un moment, puis il a demandé, mais déjà presque à contrecoeur, me semblait-il : " Et comment expliques-tu cela ?" , et après une brève réflexion, j'ai trouvé la réponse : "Le temps." " Comment ça, le temps ?" " Je veux dire que le temps, ça aide." " Ça aide... ?" " À quoi ?" " À tout", et j'ai essayé de lui expliquer à quel point c'était différent, par exemple, d'arriver dans une gare pas nécessairement luxueuse mais tout à fait acceptable, jolie, proprette, où on découvre tout petit à petit, chaque chose en son temps, étape par étape, le temps de passer une étape, de l'avoir derrière soi, et déjà arrive la suivante. Ensuite, le temps de tout apprendre, on a déjà tout compris. Et pendant qu'on comprend tout, on ne reste pas inactif ; on effectue déjà sa nouvelle tâche, on agit, on bouge, on réalise les nouvelles exigences de chaque nouvelle étape. Si les choses ne se passaient pas dans cet ordre, si toute la connaissance nous tombait immédiatement dessus..., sur place, il est possible qu'alors ni notre tête ni notre coeur ne pourraient le supporter - essayais-je d'une certaine manière de lui expliquer... Il a dit d'une voix blanche et sourde : " Je comprends." D'autre part, ai-je poursuivi, le problème, le désavantage, dirais-je, était qu'il fallait meubler le temps. J'avais vu par exemple, lui dis-je, des détenus qui vivaient depuis quatre, six ou même douze ans déjà - plus précisément : survivaient - en camp de concentration. Et donc ces quatre, six ou douze années, à savoir dans ce dernier cas, douze fois trois cent soixante-cinq jours, c'est-à-dire douze fois trois cent soixante-cinq fois vingt-quatre heures, et donc douze fois trois cent soixante-cinq fois vingt-quatre fois... et tout cela, à rebours, minute par minute, heure par heure, jour par jour ; c'est-à-dire qu'ils ont dû meubler tout ce temps d'une certaine manière. Mais d'autre part, ai-je ajouté, c'est justement ce qui les aidait, parce que si ces douze fois trois cent soixante-cinq fois,... vingt-quatre fois, soixante fois, et encore soixante fois leur étaient tombées dessus d'un seul coup, alors ils n'auraient sûrement pas pu les supporter comme ils avaient pu le faire - ni avec leur corps, ni avec leur cerveau. Et comme il se taisait, j'ai ajouté encore : " C'est à peu près comme ça qu'il faut se l'imaginer.' Et alors lui... tenant son visage à deux mains... sa voix plus sourde, plus étouffée, il a dit : " Non, c'est inimaginable", et pour ma part j'en convenais. Et je me suis dit que c'était apparemment pour cette raison qu'on préférait dire enfer, sans aucun doute..."
En conclusion, un très grand livre, une oeuvre magistrale, écrite - vous avez pu le voir - sans lyrisme, sans grandiloquence, sans effets... avec des mots vrais justes, forts, qui disent sans jamais porter de jugement(s)... ce qui donne à l'oeuvre une dimension tout à fait exceptionnelle.
C'est à partir de l'acquisition du disque de Jean Ferrat - Nuit et Brouillard -en 1964, de ses passages télé et de ses interviews que j'ai commencé à me poser des questions et à en poser.
Était née une passion dévorante et obsessionnelle pour ce qui, à mon sens, est le Marqueur de l'histoire de l'homme et ce qui a structuré définitivement ma pensée et ma vision du monde.
J'ai donc lu beaucoup de "la littérature" (au sens noble du terme) ayant trait au sujet : Primo Levi, Robert Antelme, Charlotte Delbo, Ida Grinspan, Marceline Loridan-Ivens, Rudolf Vrba, Simone Veil, Jorge Semprun, Claude Lanzmann, le très controversé Filip Muller, Elie Wiesel, Jean Cayrol, Viktor Frankl, pour n'en citer que très peu et continue de le faire mais moins fréquemment que naguère.
J'avais, dans les rayons de ma bibliothèque, le livre de I. Kertész qui m'attendait, comme m'attendent beaucoup d'autres encore... que j'aurai peut-être encore le temps de découvrir.
Quelques mots pour qualifier le caractère original, unique de cette oeuvre :
"Être sans destin, du moins au début, c'est Candide dans un Auschwitz dont la fonction première – l'extermination – se dérobe à ses yeux et qui jette sur ce monde qu'il découvre des regards étonnés, impatients parfois mais jamais vraiment angoissés. Grâce à ce procédé, Kertész, le rescapé des camps devenu écrivain, s'efface complètement pour laisser vivre ce jeune narrateur – cet autre lui-même si différent et si lointain – au rythme des épreuves et des illusions qui sont les siennes. Subtil est ce dispositif narratif où l'auteur, dépouillé en quelque sorte de sa toute-puissance puisqu'il renonce à construire une histoire où les faits s'ordonnent et s'éclairent en fonction d'une fin qu'il connaît, se plie aux exigences d'une chronique..."
Chaque déporté, qu'il fut juif ou pas, a voulu témoigner de manière personnelle, authentique, "novatrice" sur ce qu'il a vécu. C'est pour cela que les témoignages d'un Robert Antelme, d'un Primo Levi, d'une Charlotte Delbo ont littérairement parlant, un caractère unique.
Il en va de même pour Kertész, qui a réussi une performance d'écriture inégalée dans le genre : celle de se dépouiller de l'adulte qu'il était devenu au moment de prendre la plume, pour retrouver l'adolescent de quinze ans qu'il était lorsqu'il a fait l'apprentissage de ce qu'était "un être sans destin".
Et le résultat est époustouflant, déroutant, déchirant.
Grâce à cette approche, grâce à cet angle de vue, grâce à cette chronique qu'il revit pas à pas, il nous permet de comprendre ce que fut la soi-disant "passivité" des victimes face à la froide organisation et la grande efficacité des bourreaux qui, en étant "peu nombreux" réussirent à exterminer des millions d'êtres humains.
Comme je l'ai déjà dit, ayant lu beaucoup sur ce thème, si l'émotion reste intacte, il est rare qu'un livre sur l'univers concentrationnaire nazi me surprenne vraiment.
- Être sans destin - m'a surpris.
Je voudrais terminer cette présentation en vous livrant un extrait dans lequel, l'auteur de retour à Budapest ( j'avais oublié... Kertész, prix Nobel de littérature 2002 est un juif hongrois...), rencontre un journaliste qui lui propose un peu d'argent contre le récit de "l'enfer" des camps... et voici ce qu'il lui répond sur ceux qui ne l'ont pas vécu appellent "l'enfer".
-"Alors je me l'imaginerais comme un endroit où on ne peut pas s'ennuyer ; cependant, ai-je ajouté, on pouvait s'ennuyer dans un camp de concentration, même à Auschwitz, sous certaines conditions, bien sûr. Il s'est tu un moment, puis il a demandé, mais déjà presque à contrecoeur, me semblait-il : " Et comment expliques-tu cela ?" , et après une brève réflexion, j'ai trouvé la réponse : "Le temps." " Comment ça, le temps ?" " Je veux dire que le temps, ça aide." " Ça aide... ?" " À quoi ?" " À tout", et j'ai essayé de lui expliquer à quel point c'était différent, par exemple, d'arriver dans une gare pas nécessairement luxueuse mais tout à fait acceptable, jolie, proprette, où on découvre tout petit à petit, chaque chose en son temps, étape par étape, le temps de passer une étape, de l'avoir derrière soi, et déjà arrive la suivante. Ensuite, le temps de tout apprendre, on a déjà tout compris. Et pendant qu'on comprend tout, on ne reste pas inactif ; on effectue déjà sa nouvelle tâche, on agit, on bouge, on réalise les nouvelles exigences de chaque nouvelle étape. Si les choses ne se passaient pas dans cet ordre, si toute la connaissance nous tombait immédiatement dessus..., sur place, il est possible qu'alors ni notre tête ni notre coeur ne pourraient le supporter - essayais-je d'une certaine manière de lui expliquer... Il a dit d'une voix blanche et sourde : " Je comprends." D'autre part, ai-je poursuivi, le problème, le désavantage, dirais-je, était qu'il fallait meubler le temps. J'avais vu par exemple, lui dis-je, des détenus qui vivaient depuis quatre, six ou même douze ans déjà - plus précisément : survivaient - en camp de concentration. Et donc ces quatre, six ou douze années, à savoir dans ce dernier cas, douze fois trois cent soixante-cinq jours, c'est-à-dire douze fois trois cent soixante-cinq fois vingt-quatre heures, et donc douze fois trois cent soixante-cinq fois vingt-quatre fois... et tout cela, à rebours, minute par minute, heure par heure, jour par jour ; c'est-à-dire qu'ils ont dû meubler tout ce temps d'une certaine manière. Mais d'autre part, ai-je ajouté, c'est justement ce qui les aidait, parce que si ces douze fois trois cent soixante-cinq fois,... vingt-quatre fois, soixante fois, et encore soixante fois leur étaient tombées dessus d'un seul coup, alors ils n'auraient sûrement pas pu les supporter comme ils avaient pu le faire - ni avec leur corps, ni avec leur cerveau. Et comme il se taisait, j'ai ajouté encore : " C'est à peu près comme ça qu'il faut se l'imaginer.' Et alors lui... tenant son visage à deux mains... sa voix plus sourde, plus étouffée, il a dit : " Non, c'est inimaginable", et pour ma part j'en convenais. Et je me suis dit que c'était apparemment pour cette raison qu'on préférait dire enfer, sans aucun doute..."
En conclusion, un très grand livre, une oeuvre magistrale, écrite - vous avez pu le voir - sans lyrisme, sans grandiloquence, sans effets... avec des mots vrais justes, forts, qui disent sans jamais porter de jugement(s)... ce qui donne à l'oeuvre une dimension tout à fait exceptionnelle.
A quinze ans, on a une façon particulière de recevoir la vie : ouverte, avide, sans clés de lecture construites, sans remparts. Aussi, quand la réalité de cette vie est celle de l'expérience des camps de concentration, celle-ci pénètre et détruit tout l'être, sans rémission possible.
Avec cette distanciation dans le regard qui paradoxalement décuple la violence sensorielle avec laquelle le jeune narrateur reçoit la réalité dont il témoigne, ce texte autobiographique est d'une force incomparable. Bouleversante, évidemment, mais surtout propre à lever un peu de ce voile si épais, si impénétrable, qui néantise toute forme de réelle compréhension d'Auschwitz et en particulier cette question qui me taraude depuis toujours: pourquoi la majorité de ceux qui ont survécu n'ont pas parlé. Imre Kertesz parle, et je m'arrêterai là pour ne pas avoir l'indécence de singer cette parole.
Avec cette distanciation dans le regard qui paradoxalement décuple la violence sensorielle avec laquelle le jeune narrateur reçoit la réalité dont il témoigne, ce texte autobiographique est d'une force incomparable. Bouleversante, évidemment, mais surtout propre à lever un peu de ce voile si épais, si impénétrable, qui néantise toute forme de réelle compréhension d'Auschwitz et en particulier cette question qui me taraude depuis toujours: pourquoi la majorité de ceux qui ont survécu n'ont pas parlé. Imre Kertesz parle, et je m'arrêterai là pour ne pas avoir l'indécence de singer cette parole.
Je poursuis ma découverte enchantée de cet auteur hongrois, rescapé des camps de la mort. Avec Être sans destin, Imre Kertész prend le parti de rendre compte de l'expérience concentrationnaire d'une façon particulièrement propre à en faire ressortir toute l'horreur, dans une langue simple et dépouillée. Gyurka est un jeune adolescent de presque quinze ans. C'est d'abord son père qui est « réquisitionné » pour le « service du travail obligatoire » (p.18), et il accompagne ce dernier, avec sa belle-mère, faire des « emplettes » pour s'y préparer : sac à dos, canif, gamelle… Lui-même raflé sur la route le menant à l'usine où il est envoyé pour travailler – le chapitre commence par « le lendemain, il m'est arrivé quelque chose d'un peu étrange » (p. 57) -, envoyé dans un camp de transit puis de là transporté à Auschwitz dans les tristement célèbres wagons à bestiaux, totalement ignorant de ce qui l'attend, il ne se départit jamais du regard naïf et décalé qui est le sien, étranger à sa propre expérience, alors que le lecteur a forcément une représentation plus intégrée des choses, ce qui s'avère particulièrement efficace pour mettre en lumière l'entreprise de destruction nazie, ses mécanismes, ses stratagèmes. Un roman que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a fait comprendre davantage l'incommunicabilité d'une telle expérience.
Certains livres, de par leur thème douloureux, presque autobiographiques, rendent leur critique délicate.
Restituer un avis sur ces textes devient une gageure d'apprenti funambule car, par l'émotion objective qu'ils véhiculent, au sens où l'évocation des enfers humains arrive en monolithe, voire en monument, il est difficile de se focaliser sur leurs qualités proprement littéraires. Récit tragique devant lequel il sera bienvenu s'incliner ou roman qui a une toute autre ambition ?
Je me souviens l'interview d'un Edgar Hilsenrath expliquant que seul son roman "Nact" / "Nuit" était le seul objet littéraire racontant la Shoah, les autres étant des récits et témoignages. La lecture de ce texte en début d'année 2012 a été l'un des grands moments de celle-ci.
C'était avec quelque appréhension que j'ai lu à la suite "Etre sans destin" de Kertesz, comme pour ne pas rester sur cette impression, comme pour essayer encore de me convaincre que certaines expériences restaient rétives à la littérature et devaient se limiter à leur simple transcription...
Après quelques pages, ma première réflexion a été: "tiens, mais c'est un roman kafkaïen !" C'est que Kertesz emporte son lecteur dans son expérience mais la transpose non pas comme s'il en témoignait, mais comme s'il la revivait intégralement. Il ne sait donc pas ce qu'il adviendra de son être, lui ne sait pas encore comme nous l'existence des camps de la mort... Vertigineux paradoxe littéraire temporel...
On comprend que le présent de l'indicatif domine largement son texte. Pire encore, et c'est en cela que Kafka n'aurait peut-être pas renié un tel roman, Kertesz ne se pose jamais la question du "pourquoi", il décrit simplement le "comment", à la manière de Gregor Samsa dans "La Métamorphose".
A titre d'illustration, l'antisémitisme qu'il a à subir de la part de voisins autrefois bienveillants n'est pas vécu comme une surprise ou comme une horreur, mais comme un fait avec lequel il doit désormais composer. Des termes tels que "naturellement" doivent être parmi les mots les plus utilisés au début du roman pour caractériser la situation.
De même, le transport dans les trains vers Auschwitz est presque relaté comme une promenade. Certes, des gens meurent, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas en assez bonne santé, vieux ou enfants, "naturellement".
On n'ose imaginer l'effort réalisé par Kertesz pour manifester ce détachement: sans doute est-cela le talent...
Ensuite, l'arrivée au camp d'Auschwitz-Birkenau peu avant l'aube est peu-être ce que j'ai lu de plus beau de ma vie, la description du lever du jour comme une métaphore de la littérature s'emparant des témoignages indicibles ou indescriptibles, les sculptant, les taillant, les polissant, et en faire oeuvre.
La comparaison qui est faite par la suite entre Auschwitz et Buchenwald achève de déranger et de magnifier le propos: pour un déporté quittant Auschwitz, Buchenwald ressemble presque...au paradis.
Kertesz déploie là une puissance, un dépouillement d'émotion qui fait dignité mais aussi, presque fantastique.
Son expérience de la Shoah a beau être racontée, le lecteur sent/sait qu'il ne pourrait comprendre à moins de la vivre à sa place. A défaut, Kertesz "nous la fait ressentir avec lui".
Quant à l'épilogue, je manque absolument de mots pour vous dire à quel point il est ...
Imre Kertesz a obtenu le prix Nobel de littérature en 2002. "Naturellement".
Restituer un avis sur ces textes devient une gageure d'apprenti funambule car, par l'émotion objective qu'ils véhiculent, au sens où l'évocation des enfers humains arrive en monolithe, voire en monument, il est difficile de se focaliser sur leurs qualités proprement littéraires. Récit tragique devant lequel il sera bienvenu s'incliner ou roman qui a une toute autre ambition ?
Je me souviens l'interview d'un Edgar Hilsenrath expliquant que seul son roman "Nact" / "Nuit" était le seul objet littéraire racontant la Shoah, les autres étant des récits et témoignages. La lecture de ce texte en début d'année 2012 a été l'un des grands moments de celle-ci.
C'était avec quelque appréhension que j'ai lu à la suite "Etre sans destin" de Kertesz, comme pour ne pas rester sur cette impression, comme pour essayer encore de me convaincre que certaines expériences restaient rétives à la littérature et devaient se limiter à leur simple transcription...
Après quelques pages, ma première réflexion a été: "tiens, mais c'est un roman kafkaïen !" C'est que Kertesz emporte son lecteur dans son expérience mais la transpose non pas comme s'il en témoignait, mais comme s'il la revivait intégralement. Il ne sait donc pas ce qu'il adviendra de son être, lui ne sait pas encore comme nous l'existence des camps de la mort... Vertigineux paradoxe littéraire temporel...
On comprend que le présent de l'indicatif domine largement son texte. Pire encore, et c'est en cela que Kafka n'aurait peut-être pas renié un tel roman, Kertesz ne se pose jamais la question du "pourquoi", il décrit simplement le "comment", à la manière de Gregor Samsa dans "La Métamorphose".
A titre d'illustration, l'antisémitisme qu'il a à subir de la part de voisins autrefois bienveillants n'est pas vécu comme une surprise ou comme une horreur, mais comme un fait avec lequel il doit désormais composer. Des termes tels que "naturellement" doivent être parmi les mots les plus utilisés au début du roman pour caractériser la situation.
De même, le transport dans les trains vers Auschwitz est presque relaté comme une promenade. Certes, des gens meurent, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas en assez bonne santé, vieux ou enfants, "naturellement".
On n'ose imaginer l'effort réalisé par Kertesz pour manifester ce détachement: sans doute est-cela le talent...
Ensuite, l'arrivée au camp d'Auschwitz-Birkenau peu avant l'aube est peu-être ce que j'ai lu de plus beau de ma vie, la description du lever du jour comme une métaphore de la littérature s'emparant des témoignages indicibles ou indescriptibles, les sculptant, les taillant, les polissant, et en faire oeuvre.
La comparaison qui est faite par la suite entre Auschwitz et Buchenwald achève de déranger et de magnifier le propos: pour un déporté quittant Auschwitz, Buchenwald ressemble presque...au paradis.
Kertesz déploie là une puissance, un dépouillement d'émotion qui fait dignité mais aussi, presque fantastique.
Son expérience de la Shoah a beau être racontée, le lecteur sent/sait qu'il ne pourrait comprendre à moins de la vivre à sa place. A défaut, Kertesz "nous la fait ressentir avec lui".
Quant à l'épilogue, je manque absolument de mots pour vous dire à quel point il est ...
Imre Kertesz a obtenu le prix Nobel de littérature en 2002. "Naturellement".
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Imre Kertész (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1710 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1710 lecteurs ont répondu