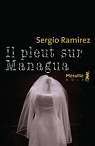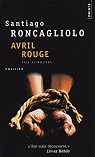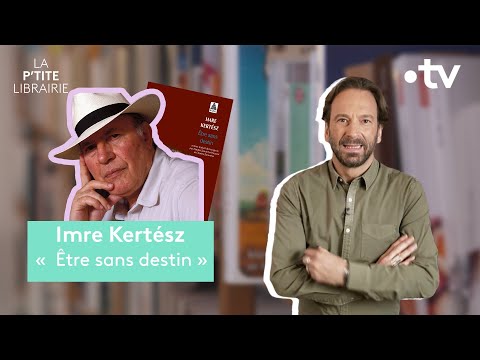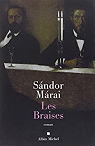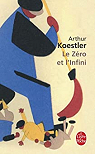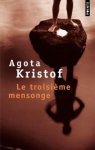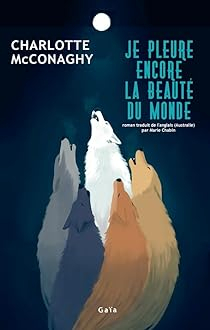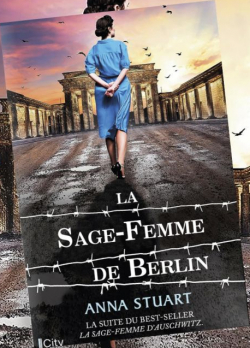Imre Kertész
Natalia Zaremba-Huzsvai (Traducteur)Charles Zaremba (Traducteur)/5 42 notes
Ce court roman, écrit en 1976 par le prix Nobel de littérature, brosse le portrait magistral de trois types de “bourreaux” : le cynique, le tortionnaire et le suiveur. Après la chute d’une obscure dictature, les hommes de main de l’ancien pouvoir sont assignés en justice.
L’un d’eux, Antonio Martens, pour être en paix avec lui-même, confie un manuscrit à son avocat commis d’office: il s’agit du dossier Salinas, le cas tragique d’un ... >Voir plus
Natalia Zaremba-Huzsvai (Traducteur)Charles Zaremba (Traducteur)/5 42 notes
Résumé :
Ce court roman, écrit en 1976 par le prix Nobel de littérature, brosse le portrait magistral de trois types de “bourreaux” : le cynique, le tortionnaire et le suiveur. Après la chute d’une obscure dictature, les hommes de main de l’ancien pouvoir sont assignés en justice.
L’un d’eux, Antonio Martens, pour être en paix avec lui-même, confie un manuscrit à son avocat commis d’office: il s’agit du dossier Salinas, le cas tragique d’un ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Roman policierVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (16)
Voir plus
Ajouter une critique
Funeste méprise par Imre Kertész
L'écrivain magyar, grand ami de László Krasznahorkai, décide de déplacer l'intrigue de “Roman Policier” en Amérique Latine mais, ne nous y trompons pas, l'implacable, l'aveuglement, l'arbitraire et la bêtise des automates de la police politique du régime totalitaire fictif dépeint par le Prix Nobel de Littérature est bien celle de sa Hongrie communiste.
Le Père et le fils Salinas sont a priori bien loin d'être les plus à plaindre dans cette nouvelle dictature, la bourgeoisie est souvent plus épargnée, grâce aux réseaux que son argent lui assure. Une question se pose alors : pourquoi lutter ? La réponse est capitale car “il faut savoir pourquoi on lutte. Sinon ça n'a pas de sens. En général on lutte contre le pouvoir en place pour prendre soi-même le pouvoir. Ou bien parce que le pouvoir en place représente une menace de mort” souligne le père Salinas. Dès les premières pages nous apprenons qu'ils ont fait l'objet d'une enquête policière aux méthodes difficilement soutenables…
“Je déteste la cécité, les faux espoirs, la vie végétative, les esclaves qui soupirent de bonheur pour peu que le fouet les épargne pendant une journée”. Les aspirations romantiques d'une jeunesse perdue coté Enrique Salinas, la duplicité brutale d'un régime qui ne laisse rien au hasard du coté du flic Diaz. Mais, pris dans une course infernale, ce régime pour qui la fin justifie les moyens atteint ce paradoxe ultime où il n'y a même plus de fin…. juste des moyens odieux.
“D'abord le pouvoir, et ensuite seulement la loi." Kertész ne se considérait pas comme un écrivain engagé, et nul n'est besoin d'autre engagement que celui de cette écriture de chair et de sang. Ce n'est pas tant le roman qui est policier c'est l'Etat qu'il dépeint. Dans son ton original, un poil sardonique, et sa construction captivante, ce court ouvrage est à mettre entre les mains de tous les amoureux de la liberté, de la justice et ses garanties qui y trouveront des pages difficiles et révoltantes mais pourtant nécessaires.
Qu'en pensez-vous ?
L'écrivain magyar, grand ami de László Krasznahorkai, décide de déplacer l'intrigue de “Roman Policier” en Amérique Latine mais, ne nous y trompons pas, l'implacable, l'aveuglement, l'arbitraire et la bêtise des automates de la police politique du régime totalitaire fictif dépeint par le Prix Nobel de Littérature est bien celle de sa Hongrie communiste.
Le Père et le fils Salinas sont a priori bien loin d'être les plus à plaindre dans cette nouvelle dictature, la bourgeoisie est souvent plus épargnée, grâce aux réseaux que son argent lui assure. Une question se pose alors : pourquoi lutter ? La réponse est capitale car “il faut savoir pourquoi on lutte. Sinon ça n'a pas de sens. En général on lutte contre le pouvoir en place pour prendre soi-même le pouvoir. Ou bien parce que le pouvoir en place représente une menace de mort” souligne le père Salinas. Dès les premières pages nous apprenons qu'ils ont fait l'objet d'une enquête policière aux méthodes difficilement soutenables…
“Je déteste la cécité, les faux espoirs, la vie végétative, les esclaves qui soupirent de bonheur pour peu que le fouet les épargne pendant une journée”. Les aspirations romantiques d'une jeunesse perdue coté Enrique Salinas, la duplicité brutale d'un régime qui ne laisse rien au hasard du coté du flic Diaz. Mais, pris dans une course infernale, ce régime pour qui la fin justifie les moyens atteint ce paradoxe ultime où il n'y a même plus de fin…. juste des moyens odieux.
“D'abord le pouvoir, et ensuite seulement la loi." Kertész ne se considérait pas comme un écrivain engagé, et nul n'est besoin d'autre engagement que celui de cette écriture de chair et de sang. Ce n'est pas tant le roman qui est policier c'est l'Etat qu'il dépeint. Dans son ton original, un poil sardonique, et sa construction captivante, ce court ouvrage est à mettre entre les mains de tous les amoureux de la liberté, de la justice et ses garanties qui y trouveront des pages difficiles et révoltantes mais pourtant nécessaires.
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci à ASAI, qui par ses critiques enthousiastes, m'a donné envie de découvrir cet auteur hongrois nobellisé.
A mon grand étonnement, j'ai découvert que ma bibliothèque n'avait qu'un seul de ses livres, ce "Roman policier".
Ce livre est glaçant, cynique et tellement vrai.
Imre Kertesz situe son court roman dans un pays d'Amérique du Sud non nommé. On comprend bien que c'est son seul moyen de passer la censure hongroise des années 70. Car le roman est une critique très acerbe d'un régime dictatorial. Ce qu'était son pays à ce moment-là.
L'auteur aborde plusieurs thèmes, le choix, la raison de vivre, l'engagement à travers le personnage d'Enrique qui veut changer de société.
Et la violence, l'oppression, la torture... à travers le personnage du policier Martens.
La fin est d'un cynisme absolu, violent.
L'écriture est magnifique, l'auteur s'interroge et nous interroge en si peu de pages. Un livre qui pousse à la réflexion....
Je sens que je vais faire une commande auprès de ma librairie pour découvrir d'autres textes de cet auteur.
A mon grand étonnement, j'ai découvert que ma bibliothèque n'avait qu'un seul de ses livres, ce "Roman policier".
Ce livre est glaçant, cynique et tellement vrai.
Imre Kertesz situe son court roman dans un pays d'Amérique du Sud non nommé. On comprend bien que c'est son seul moyen de passer la censure hongroise des années 70. Car le roman est une critique très acerbe d'un régime dictatorial. Ce qu'était son pays à ce moment-là.
L'auteur aborde plusieurs thèmes, le choix, la raison de vivre, l'engagement à travers le personnage d'Enrique qui veut changer de société.
Et la violence, l'oppression, la torture... à travers le personnage du policier Martens.
La fin est d'un cynisme absolu, violent.
L'écriture est magnifique, l'auteur s'interroge et nous interroge en si peu de pages. Un livre qui pousse à la réflexion....
Je sens que je vais faire une commande auprès de ma librairie pour découvrir d'autres textes de cet auteur.
Effroyablement efficace.
L'auteur, hongrois, a voulu raconter son pays sous la tyrannie, mais « comment, dans une dictature arrivée au pouvoir par des voies illégales, publier au nez et à la barbe de la censure une histoire qui parle des moyens illégaux de s'emparer du pouvoir ? » Tout simplement en transposant les faits en Amérique du Sud.
Et ces faits, qu'ils soient de n'importe où, d'ailleurs, sont glaçants. Tout l'appareillage du Pouvoir est décrit, sans aucun détail racoleur. C'est cela justement qui donne froid dans le dos : le ton candide du narrateur (un des policiers préposés à la question) qui a d'effroyables migraines lorsqu'il doit interroger les suspects. le narrateur est considéré comme le « bleu » par son chef et par le bourreau. Et il ne se rend pas totalement compte de l'effroyable efficacité de ce petit bureau aux ordres du Colonel.
« C'était une conversation à deux, moi, ils ne me demandaient plus rien. Je restais donc assis à les écouter. J'avais mal à la tête, terriblement mal. Peut-être que ça se voyait.
- Il va se sauver, dit Rodriguez d'un ton soucieux.
- Où ça ? demande Diaz.
- Qu'est-ce que j'en sais ? Ces gens-là ont toujours un endroit où aller, rétorque Rodriguez nerveusement. Il va se sauver au dernier moment. le sale bourgeois.
- Nous ne combattons pas expressément le capitalisme, lui rappelle Diaz.
- Ca m'est égal, dit Rodriguez, les yeux brillants. Bourgeois, juifs, sauveurs du monde, tout ça, c'est pareil. Tout ce qui les intéresse, c'est de semer le trouble.
- Et toi, demande alors Diaz, tu veux quoi, mon brave Rodriguez ?
- L'ordre. Mais mon ordre à moi ! »
Mais c'est ce petit bleu qui va être considéré comme le responsable, qui va porter le chapeau d'une effroyable erreur : le cas « Salinas ». En prison, il va écrire, ou plutôt décomposer le cas « Salinas », du nom d'un jeune homme idéaliste et emprisonné, en s'aidant du journal intime de celui-ci, pour essayer enfin de comprendre…
Ce jeune Salinas, idéaliste, parce qu'il résume à lui tout seul toute l'opposition au Pouvoir, a été exécuté avant même d'avoir commis toute action subversive. Et ce qu'il dit dans son journal est effroyablement juste :
« Plutôt ne pas vivre que vivre de la sorte. Je lui parle de ma nausée, je lui parle de mon dégoût quotidien. Je lui dis que je déteste tout autour de moi, tout. Je déteste leurs policiers, leurs journaux, leurs informations. Je déteste ces regards sournois autour de moi, ces hommes qu'on fête aujourd'hui et qu'on méprisait hier. Je déteste la résignation, l'avidité, cet éternel jeu de cache-cache, de qui est qui, les privilèges et les gens qui s'écrasent…Je déteste la cécité, les faux espoirs, la vie végétative, les esclaves qui soupirent de bonheur pour peu que le fouet les épargne pendant une journée…Et je lui dis aussi que je me déteste moi-même, avant tout, seulement parce que je suis là et que je ne fais rien. Que je sais bien que je suis moi aussi un esclave, du moins pour l'instant, mais que je le serai de plus en plus si je ne fais rien. »
Petit roman qui donne froid dans le dos ! Effroyable. Efficace.
L'auteur, hongrois, a voulu raconter son pays sous la tyrannie, mais « comment, dans une dictature arrivée au pouvoir par des voies illégales, publier au nez et à la barbe de la censure une histoire qui parle des moyens illégaux de s'emparer du pouvoir ? » Tout simplement en transposant les faits en Amérique du Sud.
Et ces faits, qu'ils soient de n'importe où, d'ailleurs, sont glaçants. Tout l'appareillage du Pouvoir est décrit, sans aucun détail racoleur. C'est cela justement qui donne froid dans le dos : le ton candide du narrateur (un des policiers préposés à la question) qui a d'effroyables migraines lorsqu'il doit interroger les suspects. le narrateur est considéré comme le « bleu » par son chef et par le bourreau. Et il ne se rend pas totalement compte de l'effroyable efficacité de ce petit bureau aux ordres du Colonel.
« C'était une conversation à deux, moi, ils ne me demandaient plus rien. Je restais donc assis à les écouter. J'avais mal à la tête, terriblement mal. Peut-être que ça se voyait.
- Il va se sauver, dit Rodriguez d'un ton soucieux.
- Où ça ? demande Diaz.
- Qu'est-ce que j'en sais ? Ces gens-là ont toujours un endroit où aller, rétorque Rodriguez nerveusement. Il va se sauver au dernier moment. le sale bourgeois.
- Nous ne combattons pas expressément le capitalisme, lui rappelle Diaz.
- Ca m'est égal, dit Rodriguez, les yeux brillants. Bourgeois, juifs, sauveurs du monde, tout ça, c'est pareil. Tout ce qui les intéresse, c'est de semer le trouble.
- Et toi, demande alors Diaz, tu veux quoi, mon brave Rodriguez ?
- L'ordre. Mais mon ordre à moi ! »
Mais c'est ce petit bleu qui va être considéré comme le responsable, qui va porter le chapeau d'une effroyable erreur : le cas « Salinas ». En prison, il va écrire, ou plutôt décomposer le cas « Salinas », du nom d'un jeune homme idéaliste et emprisonné, en s'aidant du journal intime de celui-ci, pour essayer enfin de comprendre…
Ce jeune Salinas, idéaliste, parce qu'il résume à lui tout seul toute l'opposition au Pouvoir, a été exécuté avant même d'avoir commis toute action subversive. Et ce qu'il dit dans son journal est effroyablement juste :
« Plutôt ne pas vivre que vivre de la sorte. Je lui parle de ma nausée, je lui parle de mon dégoût quotidien. Je lui dis que je déteste tout autour de moi, tout. Je déteste leurs policiers, leurs journaux, leurs informations. Je déteste ces regards sournois autour de moi, ces hommes qu'on fête aujourd'hui et qu'on méprisait hier. Je déteste la résignation, l'avidité, cet éternel jeu de cache-cache, de qui est qui, les privilèges et les gens qui s'écrasent…Je déteste la cécité, les faux espoirs, la vie végétative, les esclaves qui soupirent de bonheur pour peu que le fouet les épargne pendant une journée…Et je lui dis aussi que je me déteste moi-même, avant tout, seulement parce que je suis là et que je ne fais rien. Que je sais bien que je suis moi aussi un esclave, du moins pour l'instant, mais que je le serai de plus en plus si je ne fais rien. »
Petit roman qui donne froid dans le dos ! Effroyable. Efficace.
Écrit en deux semaines et publié pour la première fois en 1977, ce court roman avait pour but de dénoncer un régime totalitaire parvenu au pouvoir légalement tout en contournant la censure de l'époque en Hongrie.
L'avocat commis d'office d'Antonio Martens nous présente le manuscrit de son client.
Antonio a en effet demandé du fin fond de sa prison de pouvoir relater l'affaire qui l'a mené devant le tribunal du nouveau régime politique : l'affaire Salinas.
Martens raconte son passage de « naif » policier à la criminelle à membre de la Corporation, chargée de faire « descentes, arrestations, interrogatoires, liquidations » des éléments hostiles au gouvernement au pouvoir depuis le jour de la Victoire.
Un jeune homme idéaliste qui rêve de lutter contre le totalitarisme, un père inquiet, une femme qui tente de vivre malgré la dictature, tels sont les principaux protagonistes de ce qui paraît être un complot sur fond de menaces d'attentats.
Antonio Martens se dédouane, se justifie en expliquant qu'il n'était qu'un simple « bleu », qu'il obéissait aux ordres de sa hiérarchie tout en pensant parfois « qu'ils allaient trop loin ». Il est poursuivi par des migraines qui semblent figurées son sentiment de culpabilité. Lorsqu'il achète le journal intime du fils Salinas, les frontières se brouillent plus encore, diluant les notions de bien et de mal.
Le livre présente une réflexion sur les fondements de l'humanité et ses lois trop souvent bafouées : « D'abord, on croit être malin et maîtriser les évènements, mais après on aimerait seulement savoir où diable ils nous entraînent. »
L'avocat commis d'office d'Antonio Martens nous présente le manuscrit de son client.
Antonio a en effet demandé du fin fond de sa prison de pouvoir relater l'affaire qui l'a mené devant le tribunal du nouveau régime politique : l'affaire Salinas.
Martens raconte son passage de « naif » policier à la criminelle à membre de la Corporation, chargée de faire « descentes, arrestations, interrogatoires, liquidations » des éléments hostiles au gouvernement au pouvoir depuis le jour de la Victoire.
Un jeune homme idéaliste qui rêve de lutter contre le totalitarisme, un père inquiet, une femme qui tente de vivre malgré la dictature, tels sont les principaux protagonistes de ce qui paraît être un complot sur fond de menaces d'attentats.
Antonio Martens se dédouane, se justifie en expliquant qu'il n'était qu'un simple « bleu », qu'il obéissait aux ordres de sa hiérarchie tout en pensant parfois « qu'ils allaient trop loin ». Il est poursuivi par des migraines qui semblent figurées son sentiment de culpabilité. Lorsqu'il achète le journal intime du fils Salinas, les frontières se brouillent plus encore, diluant les notions de bien et de mal.
Le livre présente une réflexion sur les fondements de l'humanité et ses lois trop souvent bafouées : « D'abord, on croit être malin et maîtriser les évènements, mais après on aimerait seulement savoir où diable ils nous entraînent. »
Ce court roman a été écrit alors que la Hongrie, pays de l'auteur, faisait encore partie du bloc de l'est. Imre Kertész, a tout intérêt alors à exporter l'action dans un pays d'Amérique latine, fictif, car son livre est une sévère critique d'un régime totalitaire, aux mains de militaires et policiers, faisant régner la terreur et n'hésitant pas à mettre à mort des innocents après des procès arbitraires, des enquêtes à charge et des interrogatoires musclés menés par des sadiques sanguinaires.
Beaucoup de violence dans ce livre... qui provoque un grand malaise. Un livre fort.
Beaucoup de violence dans ce livre... qui provoque un grand malaise. Un livre fort.
Citations et extraits (25)
Voir plus
Ajouter une citation
" Plutôt ne pas vivre que vivre de la sorte. Je lui parle de ma nausée, je lui parle de mon dégoût quotidien. Je lui dis que je déteste tout autour de moi, tout. Je déteste leurs policiers, leurs journaux, leurs informations. Je déteste ces regards sournois autour de moi, ces hommes qu'on fête aujourd'hui et qu'on méprisait hier. Je déteste la résignation, l'avidité, cet éternel jeu de cache-cache, de qui est qui, les privilèges et les gens qui s'écrasent…Je déteste la cécité, les faux espoirs, la vie végétative, les esclaves qui soupirent de bonheur pour peu que le fouet les épargne pendant une journée…"
Enrique a entamé ce journal après la fermeture de l’université. C’est-à-dire après le jour de la Victoire.
Je l’ouvre au hasard :
« Rendre compte de mes journées : impossible. Rendre compte de mes projets : néant. Rendre compte de ma vie : je ne vis pas.
Ils ont détruit mes espoirs, détruit mon avenir, ils ont tout détruit. Les salauds. »
Je feuillette.
« J’existe. Est-ce une vie ? Non, je végète. Après la philosophie de l’existentialisme il ne peut visiblement y avoir qu’une seule philosophie : le non-existentialisme. C’est-à-dire la philosophie de l’existence inexistante. »
(…)
Je feuillette.
« Inexistence. Une société d’inexistants. Hier dans la rue, un homme inexistant m’a écrasé le pied avec son pied inexistant.
Je flânais en ville. Il faisait terriblement chaud. C’était l’habituel tapage du soir. La rue était pleine de couples d’amoureux, de gens qui se pressaient vers les cinémas et les bars. Comme s’il ne s’était rien passé, rien. Ils vivaient leur vie inexistante. Ou bien ce sont eux qui existent et pas moi ?
Dans la rue, un type sur deux semblait avoir perdu quelque chose. A chaque pas, des flics étaient là à écouter, à flairer, en croyant que personne ne s’occupait d’eux. Et ils avaient raison : les gens ne s’occupent pas d’eux. Il a suffi de ces quelques mois, et les gens se sont déjà habitués à leur présence. »
Je l’ouvre au hasard :
« Rendre compte de mes journées : impossible. Rendre compte de mes projets : néant. Rendre compte de ma vie : je ne vis pas.
Ils ont détruit mes espoirs, détruit mon avenir, ils ont tout détruit. Les salauds. »
Je feuillette.
« J’existe. Est-ce une vie ? Non, je végète. Après la philosophie de l’existentialisme il ne peut visiblement y avoir qu’une seule philosophie : le non-existentialisme. C’est-à-dire la philosophie de l’existence inexistante. »
(…)
Je feuillette.
« Inexistence. Une société d’inexistants. Hier dans la rue, un homme inexistant m’a écrasé le pied avec son pied inexistant.
Je flânais en ville. Il faisait terriblement chaud. C’était l’habituel tapage du soir. La rue était pleine de couples d’amoureux, de gens qui se pressaient vers les cinémas et les bars. Comme s’il ne s’était rien passé, rien. Ils vivaient leur vie inexistante. Ou bien ce sont eux qui existent et pas moi ?
Dans la rue, un type sur deux semblait avoir perdu quelque chose. A chaque pas, des flics étaient là à écouter, à flairer, en croyant que personne ne s’occupait d’eux. Et ils avaient raison : les gens ne s’occupent pas d’eux. Il a suffi de ces quelques mois, et les gens se sont déjà habitués à leur présence. »
"- bref, à vrai dire je pensais que nous étions ici au service de la loi.
- Nous sommes au service du pouvoir mon garçon (...)
- Je croyais jusqu'à présent que c'était pareil.
- Si on veut. Mais il ne faut pas oublier les priorités.
- Quelles priorités ?
Et il m'a répondu avec son sourire inimitable:
- D'abord le pouvoir, et ensuite seulement la loi."
- Nous sommes au service du pouvoir mon garçon (...)
- Je croyais jusqu'à présent que c'était pareil.
- Si on veut. Mais il ne faut pas oublier les priorités.
- Quelles priorités ?
Et il m'a répondu avec son sourire inimitable:
- D'abord le pouvoir, et ensuite seulement la loi."
(...) Sais-tu ce qu'est l'incertitude?
Je réfléchis un moment.
- Oui, dis-je enfin.
- Où l'as-tu appris?
- Sur la route. Aujourd'hui. Quand le flic m'a touché avec sa botte. Si je ne m'appelais pas Salinas, je crois qu'ils m'auraient battu jusqu'au sang.
- Oui, acquiesce-t-il. Je ne pouvais pas avancer cet argument et je me réjouis que tu l'aies compris tout seul, Enrique. Est-ce que tu sais que si tu risques ta peau, tu ne le fais pas pour toi-même mais uniquement pour les autres?
Sa question me donne à réfléchir.
- Dans les limites étroites que tu as tracées, je reconnais que c'est le cas, dis-je enfin.
- Les limites sont toujours étroites, dit-il en se penchant vers moi derrière son bureau. Quand on se décide à entamer le combat, il faut savoir pourquoi on lutte. Sinon, ça n'a pas de sens. En général, on lutte contre le pouvoir en place pour prendre soi-même le pouvoir. Ou bien parce que le pouvoir en place représente une menace de mort. Mais reconnais que dans notre cas aucune de ces deux causes n'entre en ligne de compte.
- Oui, j'en conviens.
Je réfléchis un moment.
- Oui, dis-je enfin.
- Où l'as-tu appris?
- Sur la route. Aujourd'hui. Quand le flic m'a touché avec sa botte. Si je ne m'appelais pas Salinas, je crois qu'ils m'auraient battu jusqu'au sang.
- Oui, acquiesce-t-il. Je ne pouvais pas avancer cet argument et je me réjouis que tu l'aies compris tout seul, Enrique. Est-ce que tu sais que si tu risques ta peau, tu ne le fais pas pour toi-même mais uniquement pour les autres?
Sa question me donne à réfléchir.
- Dans les limites étroites que tu as tracées, je reconnais que c'est le cas, dis-je enfin.
- Les limites sont toujours étroites, dit-il en se penchant vers moi derrière son bureau. Quand on se décide à entamer le combat, il faut savoir pourquoi on lutte. Sinon, ça n'a pas de sens. En général, on lutte contre le pouvoir en place pour prendre soi-même le pouvoir. Ou bien parce que le pouvoir en place représente une menace de mort. Mais reconnais que dans notre cas aucune de ces deux causes n'entre en ligne de compte.
- Oui, j'en conviens.
- Quand on se décide à entamer le combat, il faut savoir pourquoi on lutte. Sinon, ça n'a pas de sens. En général, on lutte contre le pouvoir en place pour prendre soi-même le pouvoir. Ou bien parce que le pouvoir en place représente une menace de mort. Mais reconnais que dans notre cas aucune de ces deux causes n'entre en ligne de compte.
(...)
Est-ce que tu sais que tout groupement conscient a besoin d'instruments inconscients? Oui, d'instruments, même si on dit que ce sont des héros et qu'on leur érige parfois des statues dans les parcs, du moins à un petit nombre d'entre eux, toujours un très petit nombre.
(...)
Est-ce que tu sais, Enrique, est-ce que tu sais vraiment ce que tu risques?
- Ma vie.
- Ta vie ! s'écrie-t-il. Tu parles comme un gosse qui jette une poupée de chiffon qu'il a trop vue ! (...) Ta vie, c'est toi-même qui es assis ici, avec ton passé réel, ton avenir possible et tout ce que tu représentes pour ta mère.
Regarde le soir qui tombe, regarde dans la rue, regarde le monde autour de toi, et imagine que cela n'existe plus. Peux-tu te l'imaginer? Sais-tu ce que vivre signifie? Comment le saurais-tu? Tu es encore trop jeune et bien portant pour cela...
(...)
Est-ce que tu sais que tout groupement conscient a besoin d'instruments inconscients? Oui, d'instruments, même si on dit que ce sont des héros et qu'on leur érige parfois des statues dans les parcs, du moins à un petit nombre d'entre eux, toujours un très petit nombre.
(...)
Est-ce que tu sais, Enrique, est-ce que tu sais vraiment ce que tu risques?
- Ma vie.
- Ta vie ! s'écrie-t-il. Tu parles comme un gosse qui jette une poupée de chiffon qu'il a trop vue ! (...) Ta vie, c'est toi-même qui es assis ici, avec ton passé réel, ton avenir possible et tout ce que tu représentes pour ta mère.
Regarde le soir qui tombe, regarde dans la rue, regarde le monde autour de toi, et imagine que cela n'existe plus. Peux-tu te l'imaginer? Sais-tu ce que vivre signifie? Comment le saurais-tu? Tu es encore trop jeune et bien portant pour cela...
Videos de Imre Kertész (10)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Connaissez-vous ce livre qui raconte l'univers concentrationnaire à travers les yeux d'un garçon de quinze ans ? le récit d'un grand écrivain hongrois, prix Nobel de littérature…
« Être sans destin », de Imre Kertész, c'est à lire en poche chez Babel.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Connaissez-vous ce livre qui raconte l'univers concentrationnaire à travers les yeux d'un garçon de quinze ans ? le récit d'un grand écrivain hongrois, prix Nobel de littérature…
« Être sans destin », de Imre Kertész, c'est à lire en poche chez Babel.
Dans la catégorie :
Littérature hongroiseVoir plus
>Littérature des autres langues>Littératures ouralo-altaïque, paléosibériennes, finno-ougriennes (hongroise, finnoise), dravidiennes>Littérature hongroise (84)
autres livres classés : littérature hongroiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

littérature hongroise
ASAI
35 livres

Bleu, bleu, bleu
Moutulus
43 livres
Autres livres de Imre Kertész (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
763 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre763 lecteurs ont répondu