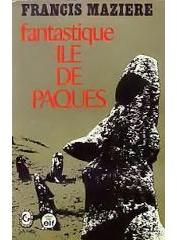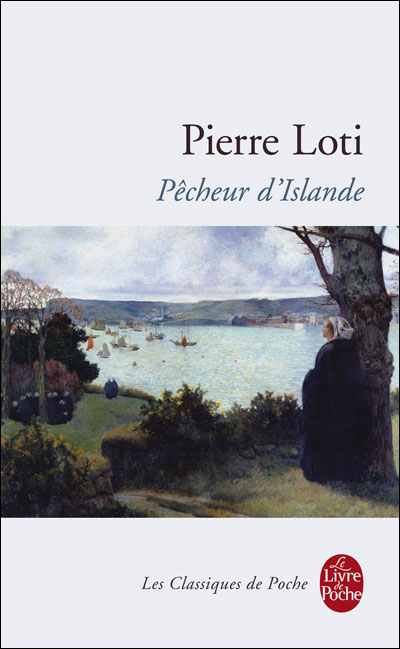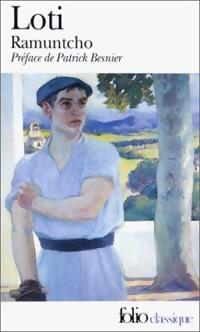En partenariat avec l'Opéra National de Bordeaux, rencontre avec Alain Quella-Villéger autour de l'oeuvre de Pierre Loti. Entretien avec Christophe Lucet.
Retrouvez les livres : https://www.mollat.com/Recherche/Auteur/0-1303180/quella-villeger-alain
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Pierre Loti/5
11 notes
Résumé :
Le 15 mars 1871, le jeune aspirant Julien Viaud embarque à Lorient sur le Vaudreuil, un aviso à hélice pour un long voyage dans les mers du sud. C'est sa première campagne. Il arrive le 11 octobre à Valparaiso qu'il quitte le 19 décembre sur la frégate à voiles La Flore. Il aborde l'Ile de Pâques le 3 janvier suivant pour une escale de quatre jours. C'est là que Julien naît à la littérature, en écrivant ce Journal d'un aspirant de La Flore accompagné de dessins. "Il... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Heureux qui comme... Pierre Loti : Ile de PâquesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
1872 Jeune aspirant de la marine française, Julien Viaud (Pierre Loti) arrive à bord de la frégate "La Flore" sur l'île de Pâques.
Mystérieuse île que l'on connaît pour ses immenses et magnifiques statues.
Pierre Loti tient un journal dans lequel il évoque son voyage et ses découvertes de l'île et de ses habitants. Ainsi il décrit la cheffesse, les tatouages, les costumes, les coiffes, les statues bien sûr, les cases mais aussi l'amitié qui se tisse, le troc avec les habitants.
Un récit dépaysant.
Mystérieuse île que l'on connaît pour ses immenses et magnifiques statues.
Pierre Loti tient un journal dans lequel il évoque son voyage et ses découvertes de l'île et de ses habitants. Ainsi il décrit la cheffesse, les tatouages, les costumes, les coiffes, les statues bien sûr, les cases mais aussi l'amitié qui se tisse, le troc avec les habitants.
Un récit dépaysant.
Pierre Loti, écrivain voyageur s'embarque dans une grande aventure : l'exploration de l'île de Pâques. Il découvre un endroit atypique avec des statues de pierre appelées : « Moaï ». Il confie son malaise dans son journal intime, ses amitiés, etc. Un livre qui a piqué ma curiosité sur l'histoire emblématique de cette île tout ayant une dimension littéraire. Une chouette collection pour les Globe-trotteurs.
Julien Viaud, n'est pas encore Pierre Loti, il est jeune aspirant de la marine française sur la frégate " La Flore " lorsqu'il arrive en vue de L'île de Pâques le 3 janvier 1872. La plus part des textes de ce livre sont issus de son journal intime, car à cette époque il est plus dessinateur que écrivain. Tant par le dessin que par l'écrit, il décrit admirablement les indigènes qu'il découvre, le livre s'ouvre sur un portrait dessiné de Vantaï, la " chefesse ", plus loin c'est son corps, puis le détail des tatouages, et les costumes, les coiffes faites de plumes. Il aborde ensuite la description des cases, de l'organisation des villages, et ses contacts, ses échanges avec cette population. Il a une telle passion d'apprendre, de communiquer, mais également de se faire aimer que rapidement il se lie avec les indigènes, fait du troc d'objets, d'éléments de costumes, d'armes primitives qu'il ramène dans sa cabine (dont on trouve un dessin). Puis il découvre les statues " J'étais perché sur le menton d'un de ces colosses, qui, renversé sur le dos,... ils sont tous là, couchés pêle-mêle, à moitié brisés ". Par le détail, il nous conte l'extraction et le transport de la tête d'une de ces gigantesques statues, plusieurs dessins nous les montrent, une carte de l'île nous en précise l'emplacement. L'association de ses talents de dessinateur et d'écrivain font de lui un grand reporter de l'époque. Il sait tout décrire, les hommes, les visages, les corps, les tatouages, les fétiches, les coutumes, l'organisation de leur société, les habitations, les paysages, les conditions météorologiques. Nous le suivons sur la frégate, faisant l'allée et venue entre le bateau et la terre, sur la baleinière, nous entrons avec lui dans les cases, nous sommes les témoins de ses contacts. Ses dessins ont été publiés dans le journal " L Illustration " en Août 1872. Il y a fort à parier que cela devait passionner les lecteurs.
Jeune aspirant, il embarque à bord d'une goélette qui va l'emmener de Valparaiso à la baie de Cook d'où il débarquera sur Rapa Nui pour 4 jours.
Pierre Loti consigne dans son journal ses impressions, ainsi que des croquis sur sa vision de cette île du bout du monde, nimbée de mystère en raison des immenses statues dressées partout dans l'île. Il y rencontre également ses habitants, les pascuans.
Même si ce récit n'a pas la vocation d'une oeuvre littéraire, il en possède toutes les qualités. D'une extrême concision, les observations de l'aspirant sont très bien retranscrites, et parfaitement imagées. Il s'agit en tout état de cause d'un constat de reporter ; du journalisme avant l'heure ; du très bon journalisme !
Bien entendu, il n'est nullement question ici de recherche scientifique. L'île de Pâques, bien que découverte bien plus tôt n'avait pas encore délivré tous ses secrets. Les expéditions scientifiques seront pour bien plus tard sans pour autant que le voile soit complètement levé sur ses étranges statues.
Pierre Loti laisse aller ses émotions à la découverte de ce petit bout de terre ; de la même façon que plus tard lors d'une escale de quelques heures à Rangoon, il écrira les Pagodes d'or.
A lire donc pour s'imprégner d'un lieu, pour nourrir son imaginaire, pour construire son propre regard à partir de celui de l'autre…
Lien : https://leblogdemimipinson.b..
Pierre Loti consigne dans son journal ses impressions, ainsi que des croquis sur sa vision de cette île du bout du monde, nimbée de mystère en raison des immenses statues dressées partout dans l'île. Il y rencontre également ses habitants, les pascuans.
Même si ce récit n'a pas la vocation d'une oeuvre littéraire, il en possède toutes les qualités. D'une extrême concision, les observations de l'aspirant sont très bien retranscrites, et parfaitement imagées. Il s'agit en tout état de cause d'un constat de reporter ; du journalisme avant l'heure ; du très bon journalisme !
Bien entendu, il n'est nullement question ici de recherche scientifique. L'île de Pâques, bien que découverte bien plus tôt n'avait pas encore délivré tous ses secrets. Les expéditions scientifiques seront pour bien plus tard sans pour autant que le voile soit complètement levé sur ses étranges statues.
Pierre Loti laisse aller ses émotions à la découverte de ce petit bout de terre ; de la même façon que plus tard lors d'une escale de quelques heures à Rangoon, il écrira les Pagodes d'or.
A lire donc pour s'imprégner d'un lieu, pour nourrir son imaginaire, pour construire son propre regard à partir de celui de l'autre…
Lien : https://leblogdemimipinson.b..
Citations et extraits (10)
Voir plus
Ajouter une citation
Les grandes statues, ce soir je ne les oublierai pas comme j’avais fait ce matin. Et, ma sieste méridienne finie, je les demande, dans son propre langage, au premier qui se présente à moi, à Atamou :
— Conduis-moi, je te prie, aux Sépultures.
Et il me comprend à merveille.
J’ai dit : sépultures (en tahitien : maraé, et à l’île de Pâques : maraï) parce que ces colosses de pierre, qui font l’objet de notre voyage, ornent les places où l’on ensevelissait, sous des roches amoncelées en tumulus, les grands chefs tombés dans les batailles. Ce nom de maraï, les indigènes le donnent également aux mille figures de fétiches et d’idoles qui remplissent leurs cases en roseaux et qui, dans leur esprit, sont liées au souvenir des morts.
Donc, nous partons, Atamou et moi, sans cortège par hasard, tous deux seuls, pour visiter le maraï le plus proche. Et c’est ma première course dans l’île inconnue.
En suivant à petite distance le bord de la mer, nous traversons une plaine, que recouvre une herbe rude, d’espèce unique, de couleur triste et comme fanée.
Sur notre chemin, nous trouvons les ruines d’une petite demeure, pareille à celle que le Danois habite. Atamou m’apprend que c’était la maison d’un papa farani (père français, missionnaire), et m’arrête pour me conter à ce sujet, avec une mimique excessive, une histoire sans doute très émouvante, que je ne démêle pas bien ; je vois seulement à ses gestes qu’il y a eu des guet-apens, des hommes cachés derrière des pierres, des coups de fusil et des coups de lance… Que lui ont-ils fait, à ce pauvre prêtre ?… On ne sait jamais à quel degré de férocité soudaine peut atteindre un sauvage, ordinairement doux et câlin, lorsqu’il est poussé par quelqu’une de ses passions d’homme primitif, ou par quelque superstition ténébreuse. Il ne faut pas oublier non plus qu’un instinct de cannibalisme sommeille au plus intime de ces natures polynésiennes, si accueillantes et d’apparence débonnaire : ainsi, là-bas, en Océanie, aux îles de Routouma et d’Hivaoa, des Maoris, d’un aspect charmant, à l’occasion vous mangent encore.
Son histoire contée, Atamou, persuadé que j’ai très bien compris, me prend par la main, et nous continuons notre route.
Devant nous, voici un monticule de pierres brunes, dans le genre des cromlechs gaulois, mais formé de blocs plus énormes ; il domine d’un côté la mer où rien ne passe, de l’autre la plaine déserte et triste, que limitent au loin des cratères éteints. Atamou assure que c’est le maraï, et tous deux nous montons sur ces pierres.
On dirait une estrade cyclopéenne, à demi cachée par un éboulement de grosses colonnes, irrégulières et frustes. Mais je demande les statues, que je n’aperçois nulle part — et alors Atamou. d’un geste recueilli, m’invite à regarder mieux à mes pieds… J’étais perché sur le menton de l’une d’elles, qui renversée sur le dos, me contemplait fixement d’en bas, avec les deux trous qui lui servaient d’yeux. Je ne me l’imaginais pas si grande et informe, aussi n’avais-je pas remarqué sa présence… En effet, elles sont là une dizaine, couchées pêle-mêle et à moitié brisées : quelque dernière secousse des volcans voisins, sans doute, les a culbutées ainsi, et le fracas de ces chutes a dû être lourdement terrible. Leur visage est sculpté avec une inexpérience enfantine ; des rudiments de bras et de mains sont à peine indiqués le long de leur corps tout rond, qui les fait ressembler à des piliers trapus. Mais une épouvante religieuse pouvait se dégager de leur aspect, quand elles se tenaient debout, droites et colossales, en face de cet océan sans bornes et sans navires. Atamou me confirme d’ailleurs qu’il y en a d’autres, dans les lointains de l’île, beaucoup d’autres, toute une peuplade gisante et morte, le long des grèves blanchies par le corail.
Aux pieds du maraï est une petite plage circulaire, entourée de rochers, sur laquelle nous descendons ; l’émiettement, par la mer, des coraux de toute espèce lui a fait un sable d’une blancheur neigeuse, semé de frêles coquilles précieuses et de fins rameaux de corail rose.
Cependant l’alizé, comme hier, souffle avec une violence croissante, à mesure que la journée s’avance. Il apporte à nouveau, du fond des solitudes de la mer Australe, tout un banc de nuages noirs, si noirs que les montagnes, les vieux volcans refroidis, recommencent de se détacher en clair sur le ciel soudainement obscur. Et Atamou, qui voit la pluie prochaine, précipite notre retour.
En effet, à mi-chemin, nous prend une ondée rapide, tandis que le vent furieux couche entièrement les herbes dans toute l’étendue de la plaine ; alors, sous des roches qui surplombent en voûte, nous nous arrêtons à l’abri, — au milieu d’un essaim de libellules rouges… D’où sont-elles venues, celles-là, encore ?… Et les papillons, que nous avons vus courir au-dessus de ces tapis d’herbes pâles, les papillons blancs, les papillons jaunes, qui donc en a apporté la graine, à travers huit cents lieues d’Océan ?…
Très vite ils s’en vont, ces nuages en troupe sombre, continuer leur course sur les déserts de la mer, après avoir arrosé en passant la mystérieuse île. Et, quand nous revenons à la baie où se tient notre frégate, le soleil du soir rayonne.
Les environs de cette baie, où sont groupées les cases de roseaux, ont en ce moment un aspect bien insolite de vie et de joie, car tous les officiers du bord s’y sont promenés durant l’après-midi, chacun escorté d’une petite troupe d’indigènes, et, maintenant que l’heure de rentrer approche, ils attendent l’arrivée des canots, assis là par terre au milieu des grands enfants primitifs qui ont été leurs amis de la journée et qui chantent pour leur faire plus de fête. Je prends place, à mon tour, et aussitôt mes amis particuliers viennent en courant se serrer auprès de moi, Petero, Houga, Marie et la jolie Juaritaï. Notre présence de quelques heures a déjà, hélas ! apporté du ridicule et de la mascarade dans ce pays de l’âpre désolation. Nous avons presque tous échangé, contre des fétiches ou des armes, de vieux vêtements quelconques, dont les hommes aux poitrines tatouées se sont puérilement affublés. Et la plupart des femmes, par convenance ou par pompe, ont mis de pauvres robes sans taille, en indienne décolorée, qui avaient dû jadis être offertes à leurs mères par les prêtres de la mission, et dormaient depuis longtemps sous le chaume des cases.
Ils chantent, les Maoris ; ils chantent tous, en battant des mains comme pour marquer un rythme de danse. Les femmes donnent des notes aussi douces et flutées que des notes d’oiseau. Les hommes, tantôt se font des petites voix de fausset toutes chevrotantes et grêles, tantôt produisent des sons caverneux, comme des rauquements de fauves qui s’ennuient. Leur musique se compose de phrases courtes et saccadées, qu’ils terminent toujours par de lugubres vocalises descendantes, en mode mineur ; on dirait qu’ils expriment l’étonnement de vivre, la tristesse de vivre, et pourtant c’est dans la joie qu’ils chantent, dans l’enfantine joie de nous voir, dans l’amusement des petits objets nouveaux par nous apportés.
Joie d’un jour, joie qui, demain, quand nous serons loin, fera pour longtemps place à la monotonie et au silence. Prisonniers sur leur île sans arbres et sans eau, ils sont, ces chanteurs sauvages, d’une race condamnée, qui, même là-bas en Polynésie, dans les îles mères, va s’éteignant très vite ; ils appartiennent à une humanité finissante et leur singulier destin est de bientôt disparaître…
Pendant que ceux-là battent des mains et s’amusent, mêlés si familièrement à nous, d’autres personnages nous observent dans une immobilité pensive. Sur des roches en amphithéâtre, qui nous dominent et font face à la mer, se tient échelonnée toute une autre partie de la population, plus craintive ou plus ombrageuse, avec qui nous n’avons pu lier connaissance : des hommes très tatoués, farouchement accroupis, les mains jointes sous les genoux ; des femmes assises dans des poses de statue, ayant aux épaules des espèces de manteaux blanchâtres et, sur leurs cheveux noués à l’antique, des couronnes de roseaux. Pas un mouvement, pas une manifestation, pas un bruit ; ils se contentent de nous regarder, d’un peu haut et à distance. Et, quand nous nous éloignons dans nos canots, le soleil couchant, déjà au ras de la mer, leur envoie ses rayons rouges, par une trouée dans de nouveaux nuages, encore soudainement venus ; il n’éclaire que leurs groupes muets et leur rocher, qui se détachent lumineux sur l’obscurité du ciel et des cratères bruns…
— Conduis-moi, je te prie, aux Sépultures.
Et il me comprend à merveille.
J’ai dit : sépultures (en tahitien : maraé, et à l’île de Pâques : maraï) parce que ces colosses de pierre, qui font l’objet de notre voyage, ornent les places où l’on ensevelissait, sous des roches amoncelées en tumulus, les grands chefs tombés dans les batailles. Ce nom de maraï, les indigènes le donnent également aux mille figures de fétiches et d’idoles qui remplissent leurs cases en roseaux et qui, dans leur esprit, sont liées au souvenir des morts.
Donc, nous partons, Atamou et moi, sans cortège par hasard, tous deux seuls, pour visiter le maraï le plus proche. Et c’est ma première course dans l’île inconnue.
En suivant à petite distance le bord de la mer, nous traversons une plaine, que recouvre une herbe rude, d’espèce unique, de couleur triste et comme fanée.
Sur notre chemin, nous trouvons les ruines d’une petite demeure, pareille à celle que le Danois habite. Atamou m’apprend que c’était la maison d’un papa farani (père français, missionnaire), et m’arrête pour me conter à ce sujet, avec une mimique excessive, une histoire sans doute très émouvante, que je ne démêle pas bien ; je vois seulement à ses gestes qu’il y a eu des guet-apens, des hommes cachés derrière des pierres, des coups de fusil et des coups de lance… Que lui ont-ils fait, à ce pauvre prêtre ?… On ne sait jamais à quel degré de férocité soudaine peut atteindre un sauvage, ordinairement doux et câlin, lorsqu’il est poussé par quelqu’une de ses passions d’homme primitif, ou par quelque superstition ténébreuse. Il ne faut pas oublier non plus qu’un instinct de cannibalisme sommeille au plus intime de ces natures polynésiennes, si accueillantes et d’apparence débonnaire : ainsi, là-bas, en Océanie, aux îles de Routouma et d’Hivaoa, des Maoris, d’un aspect charmant, à l’occasion vous mangent encore.
Son histoire contée, Atamou, persuadé que j’ai très bien compris, me prend par la main, et nous continuons notre route.
Devant nous, voici un monticule de pierres brunes, dans le genre des cromlechs gaulois, mais formé de blocs plus énormes ; il domine d’un côté la mer où rien ne passe, de l’autre la plaine déserte et triste, que limitent au loin des cratères éteints. Atamou assure que c’est le maraï, et tous deux nous montons sur ces pierres.
On dirait une estrade cyclopéenne, à demi cachée par un éboulement de grosses colonnes, irrégulières et frustes. Mais je demande les statues, que je n’aperçois nulle part — et alors Atamou. d’un geste recueilli, m’invite à regarder mieux à mes pieds… J’étais perché sur le menton de l’une d’elles, qui renversée sur le dos, me contemplait fixement d’en bas, avec les deux trous qui lui servaient d’yeux. Je ne me l’imaginais pas si grande et informe, aussi n’avais-je pas remarqué sa présence… En effet, elles sont là une dizaine, couchées pêle-mêle et à moitié brisées : quelque dernière secousse des volcans voisins, sans doute, les a culbutées ainsi, et le fracas de ces chutes a dû être lourdement terrible. Leur visage est sculpté avec une inexpérience enfantine ; des rudiments de bras et de mains sont à peine indiqués le long de leur corps tout rond, qui les fait ressembler à des piliers trapus. Mais une épouvante religieuse pouvait se dégager de leur aspect, quand elles se tenaient debout, droites et colossales, en face de cet océan sans bornes et sans navires. Atamou me confirme d’ailleurs qu’il y en a d’autres, dans les lointains de l’île, beaucoup d’autres, toute une peuplade gisante et morte, le long des grèves blanchies par le corail.
Aux pieds du maraï est une petite plage circulaire, entourée de rochers, sur laquelle nous descendons ; l’émiettement, par la mer, des coraux de toute espèce lui a fait un sable d’une blancheur neigeuse, semé de frêles coquilles précieuses et de fins rameaux de corail rose.
Cependant l’alizé, comme hier, souffle avec une violence croissante, à mesure que la journée s’avance. Il apporte à nouveau, du fond des solitudes de la mer Australe, tout un banc de nuages noirs, si noirs que les montagnes, les vieux volcans refroidis, recommencent de se détacher en clair sur le ciel soudainement obscur. Et Atamou, qui voit la pluie prochaine, précipite notre retour.
En effet, à mi-chemin, nous prend une ondée rapide, tandis que le vent furieux couche entièrement les herbes dans toute l’étendue de la plaine ; alors, sous des roches qui surplombent en voûte, nous nous arrêtons à l’abri, — au milieu d’un essaim de libellules rouges… D’où sont-elles venues, celles-là, encore ?… Et les papillons, que nous avons vus courir au-dessus de ces tapis d’herbes pâles, les papillons blancs, les papillons jaunes, qui donc en a apporté la graine, à travers huit cents lieues d’Océan ?…
Très vite ils s’en vont, ces nuages en troupe sombre, continuer leur course sur les déserts de la mer, après avoir arrosé en passant la mystérieuse île. Et, quand nous revenons à la baie où se tient notre frégate, le soleil du soir rayonne.
Les environs de cette baie, où sont groupées les cases de roseaux, ont en ce moment un aspect bien insolite de vie et de joie, car tous les officiers du bord s’y sont promenés durant l’après-midi, chacun escorté d’une petite troupe d’indigènes, et, maintenant que l’heure de rentrer approche, ils attendent l’arrivée des canots, assis là par terre au milieu des grands enfants primitifs qui ont été leurs amis de la journée et qui chantent pour leur faire plus de fête. Je prends place, à mon tour, et aussitôt mes amis particuliers viennent en courant se serrer auprès de moi, Petero, Houga, Marie et la jolie Juaritaï. Notre présence de quelques heures a déjà, hélas ! apporté du ridicule et de la mascarade dans ce pays de l’âpre désolation. Nous avons presque tous échangé, contre des fétiches ou des armes, de vieux vêtements quelconques, dont les hommes aux poitrines tatouées se sont puérilement affublés. Et la plupart des femmes, par convenance ou par pompe, ont mis de pauvres robes sans taille, en indienne décolorée, qui avaient dû jadis être offertes à leurs mères par les prêtres de la mission, et dormaient depuis longtemps sous le chaume des cases.
Ils chantent, les Maoris ; ils chantent tous, en battant des mains comme pour marquer un rythme de danse. Les femmes donnent des notes aussi douces et flutées que des notes d’oiseau. Les hommes, tantôt se font des petites voix de fausset toutes chevrotantes et grêles, tantôt produisent des sons caverneux, comme des rauquements de fauves qui s’ennuient. Leur musique se compose de phrases courtes et saccadées, qu’ils terminent toujours par de lugubres vocalises descendantes, en mode mineur ; on dirait qu’ils expriment l’étonnement de vivre, la tristesse de vivre, et pourtant c’est dans la joie qu’ils chantent, dans l’enfantine joie de nous voir, dans l’amusement des petits objets nouveaux par nous apportés.
Joie d’un jour, joie qui, demain, quand nous serons loin, fera pour longtemps place à la monotonie et au silence. Prisonniers sur leur île sans arbres et sans eau, ils sont, ces chanteurs sauvages, d’une race condamnée, qui, même là-bas en Polynésie, dans les îles mères, va s’éteignant très vite ; ils appartiennent à une humanité finissante et leur singulier destin est de bientôt disparaître…
Pendant que ceux-là battent des mains et s’amusent, mêlés si familièrement à nous, d’autres personnages nous observent dans une immobilité pensive. Sur des roches en amphithéâtre, qui nous dominent et font face à la mer, se tient échelonnée toute une autre partie de la population, plus craintive ou plus ombrageuse, avec qui nous n’avons pu lier connaissance : des hommes très tatoués, farouchement accroupis, les mains jointes sous les genoux ; des femmes assises dans des poses de statue, ayant aux épaules des espèces de manteaux blanchâtres et, sur leurs cheveux noués à l’antique, des couronnes de roseaux. Pas un mouvement, pas une manifestation, pas un bruit ; ils se contentent de nous regarder, d’un peu haut et à distance. Et, quand nous nous éloignons dans nos canots, le soleil couchant, déjà au ras de la mer, leur envoie ses rayons rouges, par une trouée dans de nouveaux nuages, encore soudainement venus ; il n’éclaire que leurs groupes muets et leur rocher, qui se détachent lumineux sur l’obscurité du ciel et des cratères bruns…
4 janvier.
Cinq heures du matin, et le jour commence de poindre sous d’épaisses nuées grises. Vers la rive encore obscure, une baleinière qu’on m’a confiée m’emporte avec deux autres aspirants, mes camarades, pressés comme moi de mettre le pied dans l’île étrange. L’amiral, amusé de notre hâte, nous a donné à chacun des commissions diverses : reconnaître la passe et l’endroit propice au débarquement, chercher les grandes statues — et, pour son déjeuner, lui tuer des lapins !
Il fait froid et sombre. Nous avons vent debout ; un alizé violent nous jette au visage des paquets d’écume salée. L’île, pour nous recevoir, a pris sa plus fantastique apparence ; sur les grisailles foncées du ciel, ses rochers et ses cratères semblent du cuivre pâle. D’ailleurs, pas un arbre nulle part ; une désolation de désert.
Sans trop de peine, nous trouvons la passe au milieu des brisants qui, ce matin, font grand et sinistre tapage. Et, la ceinture de récifs une fois franchie, arrivés en eau calme et moins éventés, nous apercevons Petero, notre ami d’hier au soir, qui s’est perché sur une roche et nous appelle. Ses cris éveillent la peuplade entière et, en un instant, la grève se couvre de sauvages. Il en sort de partout, de creux de rochers où ils dormaient, de huttes si basses qu’elles semblaient incapables de recéler des êtres humains. De loin, nous ne les avions pas remarquées, les huttes de chaume ; elles sont là, nombreuses encore, aplaties sur le sol dont elles ont la couleur.
À l’endroit que Petero nous a désigné, à peine avons-nous débarqué, tous ces hommes nous entourent, agitant devant nous, dans la demi-obscurité matinale, leurs lances à pointe de silex, leurs pagaies et leurs vieilles idoles. Et le vent redouble, bruissant et froid ; les nuages bas semblent traîner sur la terre.
La baleinière qui nous a amenés s’en retourne vers la frégate, suivant les ordres du commandant. Mes deux camarades, qui ont des fusils, s’en vont par la plage, du côté d’un territoire à lapins que le Danois nous a indiqué la veille, — et je reste seul, cerné de plus en plus près par mes nouveaux hôtes : des poitrines et des figures bleuies par les tatouages, de longues chevelures, de singuliers sourires à dents blanches, et des yeux de tristesse dont l’émail est rendu plus blanc encore par les dessins d’un bleu sombre qui le soulignent. Je tremble de froid, sous mes vêtements légers, humides des embruns de la mer, et je trouve que le plein jour tarde bien à venir ce matin, sous le ciel si épais… Leur cercle s’est fermé de tous côtés, et, chacun me présentant sa lance ou son idole, voici qu’ils me chantent, à demi-voix d’abord, une sorte de mélopée plaintive, lugubre, et l’accompagnent d’un balancement de la tête et des reins comme feraient de grands ours, debout… Je les sais inoffensifs, et du reste leurs figures, que les tatouages rendent farouches au premier abord, sont d’une enfantine douceur ; ils ne m’inspirent aucune crainte raisonnée ; mais c’est égal, pour moi qui, la première fois de ma vie, pénètre dans une île du Grand Océan, il y a un frisson de surprise et d’instinctif effroi à sentir si près tous ces yeux et toutes ces haleines, avant jour, sur un rivage désolé et par un temps noir….
Maintenant le rythme de la chanson se précipite, le mouvement des têtes et des reins s’accélère, les voix se font rauques et profondes ; cela devient, dans le vent et dans le bruit de la mer, une grande clameur sauvage menant une danse furieuse.
Et puis, brusquement : cela s’apaise. C’est fini. Le cercle s’ouvre et les danseurs se dispersent… Que me voulaient-ils tous ? Enfantillage quelconque de leur part, ou bien conjuration, ou bien encore souhaits de bienvenue ?… Qui peut savoir ?…
Cinq heures du matin, et le jour commence de poindre sous d’épaisses nuées grises. Vers la rive encore obscure, une baleinière qu’on m’a confiée m’emporte avec deux autres aspirants, mes camarades, pressés comme moi de mettre le pied dans l’île étrange. L’amiral, amusé de notre hâte, nous a donné à chacun des commissions diverses : reconnaître la passe et l’endroit propice au débarquement, chercher les grandes statues — et, pour son déjeuner, lui tuer des lapins !
Il fait froid et sombre. Nous avons vent debout ; un alizé violent nous jette au visage des paquets d’écume salée. L’île, pour nous recevoir, a pris sa plus fantastique apparence ; sur les grisailles foncées du ciel, ses rochers et ses cratères semblent du cuivre pâle. D’ailleurs, pas un arbre nulle part ; une désolation de désert.
Sans trop de peine, nous trouvons la passe au milieu des brisants qui, ce matin, font grand et sinistre tapage. Et, la ceinture de récifs une fois franchie, arrivés en eau calme et moins éventés, nous apercevons Petero, notre ami d’hier au soir, qui s’est perché sur une roche et nous appelle. Ses cris éveillent la peuplade entière et, en un instant, la grève se couvre de sauvages. Il en sort de partout, de creux de rochers où ils dormaient, de huttes si basses qu’elles semblaient incapables de recéler des êtres humains. De loin, nous ne les avions pas remarquées, les huttes de chaume ; elles sont là, nombreuses encore, aplaties sur le sol dont elles ont la couleur.
À l’endroit que Petero nous a désigné, à peine avons-nous débarqué, tous ces hommes nous entourent, agitant devant nous, dans la demi-obscurité matinale, leurs lances à pointe de silex, leurs pagaies et leurs vieilles idoles. Et le vent redouble, bruissant et froid ; les nuages bas semblent traîner sur la terre.
La baleinière qui nous a amenés s’en retourne vers la frégate, suivant les ordres du commandant. Mes deux camarades, qui ont des fusils, s’en vont par la plage, du côté d’un territoire à lapins que le Danois nous a indiqué la veille, — et je reste seul, cerné de plus en plus près par mes nouveaux hôtes : des poitrines et des figures bleuies par les tatouages, de longues chevelures, de singuliers sourires à dents blanches, et des yeux de tristesse dont l’émail est rendu plus blanc encore par les dessins d’un bleu sombre qui le soulignent. Je tremble de froid, sous mes vêtements légers, humides des embruns de la mer, et je trouve que le plein jour tarde bien à venir ce matin, sous le ciel si épais… Leur cercle s’est fermé de tous côtés, et, chacun me présentant sa lance ou son idole, voici qu’ils me chantent, à demi-voix d’abord, une sorte de mélopée plaintive, lugubre, et l’accompagnent d’un balancement de la tête et des reins comme feraient de grands ours, debout… Je les sais inoffensifs, et du reste leurs figures, que les tatouages rendent farouches au premier abord, sont d’une enfantine douceur ; ils ne m’inspirent aucune crainte raisonnée ; mais c’est égal, pour moi qui, la première fois de ma vie, pénètre dans une île du Grand Océan, il y a un frisson de surprise et d’instinctif effroi à sentir si près tous ces yeux et toutes ces haleines, avant jour, sur un rivage désolé et par un temps noir….
Maintenant le rythme de la chanson se précipite, le mouvement des têtes et des reins s’accélère, les voix se font rauques et profondes ; cela devient, dans le vent et dans le bruit de la mer, une grande clameur sauvage menant une danse furieuse.
Et puis, brusquement : cela s’apaise. C’est fini. Le cercle s’ouvre et les danseurs se dispersent… Que me voulaient-ils tous ? Enfantillage quelconque de leur part, ou bien conjuration, ou bien encore souhaits de bienvenue ?… Qui peut savoir ?…
Un vieil homme très tatoué, portant sur la chevelure de longues plumes noires, quelque chef sans doute, me prend par une main ; Petero me prend par l’autre ; tous deux en courant m’emmènent, et la foule nous suit.
Ils m’arrêtent devant une de ces demeures en chaume qui sont là partout, aplaties parmi les roches et le sable, ressemblent à des dos de bête couchée.
Et ils m’invitent à entrer, ce que je suis obligé de faire à quatre pattes, en me faufilant à la manière d’un chat qui passe par une chatière, car la porte, au ras du sol, gardée par deux divinités en granit de sinistre visage, est un trou rond, haut de deux pieds à peine.
Là dedans, on n’y voit pas, surtout à cause de la foule qui se presse et jette de l’ombre alentour ; il est impossible de se tenir debout, bien entendu, et, après les grands souffles vivifiants du dehors, on respire mal, dans une odeur de tanière.
À côté de la cheffesse et de sa fille, on m’invite à m’asseoir sur des nattes ; on n’a rien à m’offrir comme cadeau et je comprends, à certaine mimique éplorée, qu’on s’en excuse. Maintenant mes yeux s’accoutument, et je vois grouiller autour de nous des chats et des lapins.
Il me faut faire dans la matinée beaucoup d’autres visites du même genre, pour contenter les notables de l’île, et je pénètre en rampant au fond de je ne sais combien de gîtes obscurs — où la foule entre derrière moi, m’enserre dans une confusion de poitrines, de cuisses, nues et tatouées ; peu à peu je m’imprègne d’une senteur de fauve et de sauvage.
Tous sont disposés à me donner des idoles, des casse-tête ou des lances, en échange de vêtements ou d’objets qui les amusent. L’argent, naturellement, ne leur dit rien : c’est bon tout au plus pour orner des colliers ; mais les perles de verre sont d’un effet bien plus beau.
Ils m’arrêtent devant une de ces demeures en chaume qui sont là partout, aplaties parmi les roches et le sable, ressemblent à des dos de bête couchée.
Et ils m’invitent à entrer, ce que je suis obligé de faire à quatre pattes, en me faufilant à la manière d’un chat qui passe par une chatière, car la porte, au ras du sol, gardée par deux divinités en granit de sinistre visage, est un trou rond, haut de deux pieds à peine.
Là dedans, on n’y voit pas, surtout à cause de la foule qui se presse et jette de l’ombre alentour ; il est impossible de se tenir debout, bien entendu, et, après les grands souffles vivifiants du dehors, on respire mal, dans une odeur de tanière.
À côté de la cheffesse et de sa fille, on m’invite à m’asseoir sur des nattes ; on n’a rien à m’offrir comme cadeau et je comprends, à certaine mimique éplorée, qu’on s’en excuse. Maintenant mes yeux s’accoutument, et je vois grouiller autour de nous des chats et des lapins.
Il me faut faire dans la matinée beaucoup d’autres visites du même genre, pour contenter les notables de l’île, et je pénètre en rampant au fond de je ne sais combien de gîtes obscurs — où la foule entre derrière moi, m’enserre dans une confusion de poitrines, de cuisses, nues et tatouées ; peu à peu je m’imprègne d’une senteur de fauve et de sauvage.
Tous sont disposés à me donner des idoles, des casse-tête ou des lances, en échange de vêtements ou d’objets qui les amusent. L’argent, naturellement, ne leur dit rien : c’est bon tout au plus pour orner des colliers ; mais les perles de verre sont d’un effet bien plus beau.
À bord, on nous reçoit bien, quand même, et les officiers s’intéressent à toutes les choses que je rapporte.
Mais je ne tiens pas en place et, dès midi, je retourne à terre auprès de mes amis sauvages.
Il vente toujours, et le vent d’ailleurs doit être familier à cette île de Pâques, située dans la région où l’alizé austral souffle le plus fort. Pourtant il ne reste plus au ciel que des lambeaux tourmentés du sombre vélum de ce matin, et le soleil paraît, dans du bleu profond, un brûlant soleil, car nous sommes ici tout près du tropique.
Quand j’arrive à la grève, je m’aperçois que, dans l’île, c’est l’heure de dormir, l’heure de la sieste méridienne, et mes cinq amis, qui sont là par politesse à m’attendre, assis sur des pierres, ont des yeux très somnolents.
Je dormirais bien quelques minutes, moi aussi ; mais où trouver un peu d’ombre pour ma tête, dans ce pays qui n’a pas un arbre pas un buisson vert ?
Après hésitation, je vais demander au vieux chef l’hospitalité d’un moment, et, marchant à quatre pattes, je m’insinue en son logis.
Il y fait très chaud et il y a encombrement de corps étendus. C’est que, sous cette carapace, qui a tout juste la contenance d’un canot renversé, le chef habite avec sa famille : une femme, deux fils, une fille, un gendre, un petit-fils ; plus, des lapins et des poules ; plus, enfin, sept vilains chats, à mine allongée et hauts sur pattes, qui ont plusieurs petits.
On m’installe cependant sur un tapis de joncs tressés et, par déférence, les gens sortent un à un sans bruit pour aller se coucher ailleurs ; je reste sous la garde d’Atamou, qui m’évente avec un chasse-mouches en plumes noires, et je m’endors.
Une demi-heure après, quand je reprends conscience de vivre, je suis complètement seul, au milieu d’un silence où se perçoit le bruit lointain de la mer sur les récifs de corail ; et, de temps à autre, une courte rafale d’alizé agite les roseaux de la toiture. À ce réveil, dans ce pauvre gîte de sauvages, me vient d’abord la notion d’un dépaysement extrême. Je me sens loin, loin comme jamais, et perdu. Et je suis pris aussi de cette angoisse spéciale qui est l’oppression des îles et qu’aucun lieu du monde ne saurait donner aussi intensément que celui-ci ; l’immensité des mers australes autour de moi m’inquiète soudain, d’une façon presque physique.
Par le trou qui sert de porte, un rayon de soleil pénètre, éclatant, vu du recoin obscur où je suis couché ; sur le sol de la case, il dessine l’ombre d’une idole qui en surveille l’entrée — et les ombres saugrenues de deux chats à trop longues oreilles, qui rêvent, assis là sur leur derrière, regardant au dehors… Même cette traînée de lumière et son éclat morne me semblent avoir quelque chose d’étranger, d’extra-lointain, d’infiniment antérieur. Dans cet ensoleillement, dans ce silence, au souffle de ce vent tropical, une tristesse indicible vient m’étreindre au réveil : tristesse des premiers âges humains peut-être, qui serait confusément demeurée dans la terre où je m’appuie, et que surchaufferait à cette heure le toujours même soleil éternel…
Bien entendu, cela passe vite, s’efface comme un caprice d’enfant, dès le plein retour de la vie. Et, sans bouger encore, je m’amuse à examiner les détails de la demeure, tandis que des souris, malgré ces deux chats en sentinelle, font le va-et-vient tranquillement à mes côtés.
La toiture en roseaux qui m’abrite est soutenue par des nervures de palmes ; — mais où donc les ont-ils prises, puisque leur île est sans arbres et ne connaît guère d’autre végétation que celle des herbages ?… Dans, ce réduit, qui n’a pas un mètre et demi de haut sur quatre mètres de long, mille choses sont soigneusement accrochées : des petites idoles de bois noir, qu’emmaillottent des sparteries grossières ; des lances à pointe de silex éclaté, des pagaies à figure humaine, des coiffures en plumes, des ornements de danse ou de combat, et beaucoup d’ustensiles d’aspect inquiétant, d’usage à moi inconnu, qui semblent tous d’une extrême vieillesse. Nos ancêtres des premiers âges, lorsqu’ils se risquèrent à sortir des cavernes, durent construire des huttes de ce genre, ornées d’objets pareils ; on se sent ici au milieu d’une humanité infiniment primitive et, dirait-on, plus jeune que la nôtre de vingt ou trente mille ans.
Mais, quand on y songe, tout ce bois si desséché de leurs massues et de leurs dieux, à quelle époque peut-il remonter et d’où leur est-il venu ?… Et leurs chats, leurs lapins ?… Je veux bien que les missionnaires les leur aient amenés jadis. Mais les souris qui se promènent partout dans les cases, personne, je suppose, ne les a apportées, celles-là !… Alors, d’où arrivent-elles ?… Les moindres choses, dans cette île isolée, soulèvent des interrogations sans réponse ; on s’étonne qu’il puisse y avoir ici une faune et une flore.
Mais je ne tiens pas en place et, dès midi, je retourne à terre auprès de mes amis sauvages.
Il vente toujours, et le vent d’ailleurs doit être familier à cette île de Pâques, située dans la région où l’alizé austral souffle le plus fort. Pourtant il ne reste plus au ciel que des lambeaux tourmentés du sombre vélum de ce matin, et le soleil paraît, dans du bleu profond, un brûlant soleil, car nous sommes ici tout près du tropique.
Quand j’arrive à la grève, je m’aperçois que, dans l’île, c’est l’heure de dormir, l’heure de la sieste méridienne, et mes cinq amis, qui sont là par politesse à m’attendre, assis sur des pierres, ont des yeux très somnolents.
Je dormirais bien quelques minutes, moi aussi ; mais où trouver un peu d’ombre pour ma tête, dans ce pays qui n’a pas un arbre pas un buisson vert ?
Après hésitation, je vais demander au vieux chef l’hospitalité d’un moment, et, marchant à quatre pattes, je m’insinue en son logis.
Il y fait très chaud et il y a encombrement de corps étendus. C’est que, sous cette carapace, qui a tout juste la contenance d’un canot renversé, le chef habite avec sa famille : une femme, deux fils, une fille, un gendre, un petit-fils ; plus, des lapins et des poules ; plus, enfin, sept vilains chats, à mine allongée et hauts sur pattes, qui ont plusieurs petits.
On m’installe cependant sur un tapis de joncs tressés et, par déférence, les gens sortent un à un sans bruit pour aller se coucher ailleurs ; je reste sous la garde d’Atamou, qui m’évente avec un chasse-mouches en plumes noires, et je m’endors.
Une demi-heure après, quand je reprends conscience de vivre, je suis complètement seul, au milieu d’un silence où se perçoit le bruit lointain de la mer sur les récifs de corail ; et, de temps à autre, une courte rafale d’alizé agite les roseaux de la toiture. À ce réveil, dans ce pauvre gîte de sauvages, me vient d’abord la notion d’un dépaysement extrême. Je me sens loin, loin comme jamais, et perdu. Et je suis pris aussi de cette angoisse spéciale qui est l’oppression des îles et qu’aucun lieu du monde ne saurait donner aussi intensément que celui-ci ; l’immensité des mers australes autour de moi m’inquiète soudain, d’une façon presque physique.
Par le trou qui sert de porte, un rayon de soleil pénètre, éclatant, vu du recoin obscur où je suis couché ; sur le sol de la case, il dessine l’ombre d’une idole qui en surveille l’entrée — et les ombres saugrenues de deux chats à trop longues oreilles, qui rêvent, assis là sur leur derrière, regardant au dehors… Même cette traînée de lumière et son éclat morne me semblent avoir quelque chose d’étranger, d’extra-lointain, d’infiniment antérieur. Dans cet ensoleillement, dans ce silence, au souffle de ce vent tropical, une tristesse indicible vient m’étreindre au réveil : tristesse des premiers âges humains peut-être, qui serait confusément demeurée dans la terre où je m’appuie, et que surchaufferait à cette heure le toujours même soleil éternel…
Bien entendu, cela passe vite, s’efface comme un caprice d’enfant, dès le plein retour de la vie. Et, sans bouger encore, je m’amuse à examiner les détails de la demeure, tandis que des souris, malgré ces deux chats en sentinelle, font le va-et-vient tranquillement à mes côtés.
La toiture en roseaux qui m’abrite est soutenue par des nervures de palmes ; — mais où donc les ont-ils prises, puisque leur île est sans arbres et ne connaît guère d’autre végétation que celle des herbages ?… Dans, ce réduit, qui n’a pas un mètre et demi de haut sur quatre mètres de long, mille choses sont soigneusement accrochées : des petites idoles de bois noir, qu’emmaillottent des sparteries grossières ; des lances à pointe de silex éclaté, des pagaies à figure humaine, des coiffures en plumes, des ornements de danse ou de combat, et beaucoup d’ustensiles d’aspect inquiétant, d’usage à moi inconnu, qui semblent tous d’une extrême vieillesse. Nos ancêtres des premiers âges, lorsqu’ils se risquèrent à sortir des cavernes, durent construire des huttes de ce genre, ornées d’objets pareils ; on se sent ici au milieu d’une humanité infiniment primitive et, dirait-on, plus jeune que la nôtre de vingt ou trente mille ans.
Mais, quand on y songe, tout ce bois si desséché de leurs massues et de leurs dieux, à quelle époque peut-il remonter et d’où leur est-il venu ?… Et leurs chats, leurs lapins ?… Je veux bien que les missionnaires les leur aient amenés jadis. Mais les souris qui se promènent partout dans les cases, personne, je suppose, ne les a apportées, celles-là !… Alors, d’où arrivent-elles ?… Les moindres choses, dans cette île isolée, soulèvent des interrogations sans réponse ; on s’étonne qu’il puisse y avoir ici une faune et une flore.
Un vieil homme très tatoué, portant sur la chevelure de longues plumes noires, quelque chef sans doute, me prend par une main ; Petero me prend par l’autre ; tous deux en courant m’emmènent, et la foule nous suit.
Ils m’arrêtent devant une de ces demeures en chaume qui sont là partout, aplaties parmi les roches et le sable, ressemblent à des dos de bête couchée.
Et ils m’invitent à entrer, ce que je suis obligé de faire à quatre pattes, en me faufilant à la manière d’un chat qui passe par une chatière, car la porte, au ras du sol, gardée par deux divinités en granit de sinistre visage, est un trou rond, haut de deux pieds à peine.
Là dedans, on n’y voit pas, surtout à cause de la foule qui se presse et jette de l’ombre alentour ; il est impossible de se tenir debout, bien entendu, et, après les grands souffles vivifiants du dehors, on respire mal, dans une odeur de tanière.
À côté de la cheffesse et de sa fille, on m’invite à m’asseoir sur des nattes ; on n’a rien à m’offrir comme cadeau et je comprends, à certaine mimique éplorée, qu’on s’en excuse. Maintenant mes yeux s’accoutument, et je vois grouiller autour de nous des chats et des lapins.
Il me faut faire dans la matinée beaucoup d’autres visites du même genre, pour contenter les notables de l’île, et je pénètre en rampant au fond de je ne sais combien de gîtes obscurs — où la foule entre derrière moi, m’enserre dans une confusion de poitrines, de cuisses, nues et tatouées ; peu à peu je m’imprègne d’une senteur de fauve et de sauvage.
Tous sont disposés à me donner des idoles, des casse-tête ou des lances, en échange de vêtements ou d’objets qui les amusent. L’argent, naturellement, ne leur dit rien : c’est bon tout au plus pour orner des colliers ; mais les perles de verre sont d’un effet bien plus beau.
Cependant le plein jour est venu et, de tous côtés, le rideau de nuages se déchire. Alors, les aspects changent ; l’île plus éclairée, plus réelle, se fait moins sinistre, et d’ailleurs je m’y habitue.
Déjà, pour faire des marchés, j’ai livré tout ce que contenaient mes poches : mon mouchoir, des allumettes, un carnet et un crayon ; je me résous à livrer encore ma veste d’aspirant pour obtenir une massue extraordinaire que termine une sorte de tête de Janus à double visage humain, — et je continue ma promenade en bras de chemise.
Je suis décidément tombé au milieu d’un peuple d’enfants ; jeunes et vieux ne se lassent pas de me voir, de m’écouter, de me suivre, et portent derrière moi mes acquisitions diverses, mes idoles et mes armes, en chantant toujours des mélopées plaintives. Quand on y songe, en effet, quel événement que notre présence dans leur île isolée, où ils ne voient pas en moyenne tous les dix ans poindre une voile autour d’eux sur l’infini des eaux !
En plus du cortège qui se tient à distance, j’ai aussi conquis des amitiés particulières, au nombre de cinq : Petero, d’abord ; puis deux jeunes garçons, Atamou et Houga ; et deux jeunes filles, Marie et Juaritaï.
Toutes deux sont nues, Marie et Juaritaï, à part une ceinture qui retombe un peu aux places essentielles ; leur corps serait presque blanc, sans le hâle du soleil et de la mer, s’il ne gardait toutefois ce léger reflet de cuivre rouge, qui est le sceau de la race. De longs tatouages bleus, d’une bizarrerie et d’un dessin exquis, courent sur leurs jambes et leurs flancs, sans doute pour en accentuer la sveltesse charmante. Marie, qui fut un enfant baptisé par les missionnaires, — ce nom de Marie, à une fille de l’île de Pâques, déroute beaucoup, — n’a pour elle que sa taille de jeune déesse, sa fraîcheur et ses dents. Mais Juaritaï serait jolie partout et dans tous les pays, avec son petit nez fin et ses grands yeux craintifs ; elle a noué à l’antique sa chevelure, artificiellement rougie, dans laquelle des brins d’herbe sont piqués…
Mon Dieu, comme le temps passe !… Déjà dix heures et demie, l’heure à laquelle nous devons rentrer à bord pour le déjeuner, et j’aperçois là-bas, franchissant les lignes de récifs, la baleinière qui arrive pour nous reprendre. Mes deux camarades aussi reviennent de la chasse, suivis comme moi d’un cortège qui chante. Ils ont tué plusieurs mouettes blanches, qu’ils distribuent aux femmes ; mais de lapins, aucun. Quels mauvais commissionnaires nous sommes, tous les trois !… Et les grandes statues que j’étais chargé d’aller reconnaître, moi qui les ai oubliées !…
Ils m’arrêtent devant une de ces demeures en chaume qui sont là partout, aplaties parmi les roches et le sable, ressemblent à des dos de bête couchée.
Et ils m’invitent à entrer, ce que je suis obligé de faire à quatre pattes, en me faufilant à la manière d’un chat qui passe par une chatière, car la porte, au ras du sol, gardée par deux divinités en granit de sinistre visage, est un trou rond, haut de deux pieds à peine.
Là dedans, on n’y voit pas, surtout à cause de la foule qui se presse et jette de l’ombre alentour ; il est impossible de se tenir debout, bien entendu, et, après les grands souffles vivifiants du dehors, on respire mal, dans une odeur de tanière.
À côté de la cheffesse et de sa fille, on m’invite à m’asseoir sur des nattes ; on n’a rien à m’offrir comme cadeau et je comprends, à certaine mimique éplorée, qu’on s’en excuse. Maintenant mes yeux s’accoutument, et je vois grouiller autour de nous des chats et des lapins.
Il me faut faire dans la matinée beaucoup d’autres visites du même genre, pour contenter les notables de l’île, et je pénètre en rampant au fond de je ne sais combien de gîtes obscurs — où la foule entre derrière moi, m’enserre dans une confusion de poitrines, de cuisses, nues et tatouées ; peu à peu je m’imprègne d’une senteur de fauve et de sauvage.
Tous sont disposés à me donner des idoles, des casse-tête ou des lances, en échange de vêtements ou d’objets qui les amusent. L’argent, naturellement, ne leur dit rien : c’est bon tout au plus pour orner des colliers ; mais les perles de verre sont d’un effet bien plus beau.
Cependant le plein jour est venu et, de tous côtés, le rideau de nuages se déchire. Alors, les aspects changent ; l’île plus éclairée, plus réelle, se fait moins sinistre, et d’ailleurs je m’y habitue.
Déjà, pour faire des marchés, j’ai livré tout ce que contenaient mes poches : mon mouchoir, des allumettes, un carnet et un crayon ; je me résous à livrer encore ma veste d’aspirant pour obtenir une massue extraordinaire que termine une sorte de tête de Janus à double visage humain, — et je continue ma promenade en bras de chemise.
Je suis décidément tombé au milieu d’un peuple d’enfants ; jeunes et vieux ne se lassent pas de me voir, de m’écouter, de me suivre, et portent derrière moi mes acquisitions diverses, mes idoles et mes armes, en chantant toujours des mélopées plaintives. Quand on y songe, en effet, quel événement que notre présence dans leur île isolée, où ils ne voient pas en moyenne tous les dix ans poindre une voile autour d’eux sur l’infini des eaux !
En plus du cortège qui se tient à distance, j’ai aussi conquis des amitiés particulières, au nombre de cinq : Petero, d’abord ; puis deux jeunes garçons, Atamou et Houga ; et deux jeunes filles, Marie et Juaritaï.
Toutes deux sont nues, Marie et Juaritaï, à part une ceinture qui retombe un peu aux places essentielles ; leur corps serait presque blanc, sans le hâle du soleil et de la mer, s’il ne gardait toutefois ce léger reflet de cuivre rouge, qui est le sceau de la race. De longs tatouages bleus, d’une bizarrerie et d’un dessin exquis, courent sur leurs jambes et leurs flancs, sans doute pour en accentuer la sveltesse charmante. Marie, qui fut un enfant baptisé par les missionnaires, — ce nom de Marie, à une fille de l’île de Pâques, déroute beaucoup, — n’a pour elle que sa taille de jeune déesse, sa fraîcheur et ses dents. Mais Juaritaï serait jolie partout et dans tous les pays, avec son petit nez fin et ses grands yeux craintifs ; elle a noué à l’antique sa chevelure, artificiellement rougie, dans laquelle des brins d’herbe sont piqués…
Mon Dieu, comme le temps passe !… Déjà dix heures et demie, l’heure à laquelle nous devons rentrer à bord pour le déjeuner, et j’aperçois là-bas, franchissant les lignes de récifs, la baleinière qui arrive pour nous reprendre. Mes deux camarades aussi reviennent de la chasse, suivis comme moi d’un cortège qui chante. Ils ont tué plusieurs mouettes blanches, qu’ils distribuent aux femmes ; mais de lapins, aucun. Quels mauvais commissionnaires nous sommes, tous les trois !… Et les grandes statues que j’étais chargé d’aller reconnaître, moi qui les ai oubliées !…
Videos de Pierre Loti (18)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : île de pâquesVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Loti (130)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le pays des Lotiphiles
Le vrai nom de Pierre Loti était :
Louis Poirier
Henri Beyle
Julien Viaud
Fréderic Louis Sauser
10 questions
49 lecteurs ont répondu
Thème :
Pierre LotiCréer un quiz sur ce livre49 lecteurs ont répondu