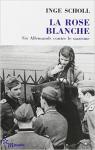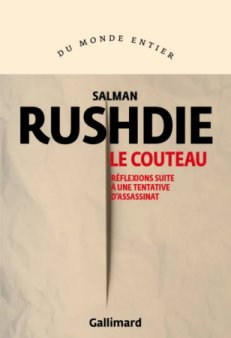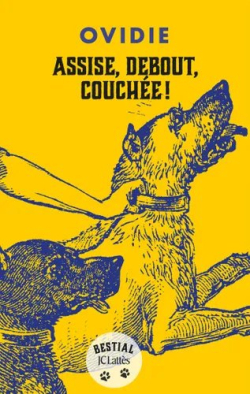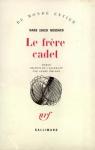Hans Erich Nossack
Silke Hass (Traducteur)Jean-Pierre Boyer (Traducteur)/5 13 notes
Silke Hass (Traducteur)Jean-Pierre Boyer (Traducteur)/5 13 notes
Résumé :
Le 21 juillet 1943, Hans Erich Nossack, écrivain pacifiste de gauche, qui n’a encore pratiquement rien publié, décide d’aller passer quelques jours dans la campagne proche d’Hambourg. Il ne sait pas que dans la nuit du 24 et jusqu’au 3 août aura lieu «l’opération Gomorrhe», menée par les Alliés et qui a pour but la destruction de la ville allemande : 350’000 habitations détruites et près d’un million de civils sans abri. Il assiste à distance au Feuersturm, «la temp... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'effondrementVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
Les Éditions Héros-Limite de Genève ont eu l'excellente idée de publier, en octobre 2021, un témoignage historique important sorti initialement en 1948 à Hambourg ("Der Untergang") d'un des tout premiers auteurs importants allemands d'après-guerre.
Hans Erich Nossack est né en janvier 1901 à Hambourg dans une famille aisée. Après des études d'histoire de l'art et de la littérature à l'université de sa ville natale, il a abandonné des études de droit à l'université de Jéna, est devenu membre du Parti communiste (KPD) et s'est marié en 1925 avec Gabriele Knierer (1896-1987), une employée de banque. En 1933, l'année où Hitler est venu au pouvoir, il a repris l'entreprise florissante d'importation de café et de cacao de son père. Si l'auteur a eu des démêlés fréquents avec la Gestapo, il n'a cependant jamais été arrêté.
Féru de littérature, très tôt Nossack s'est mis à tenir courageusement un journal intime. Une grosse partie de ses journaux a toutefois brûlé lors des bombardements massifs alliés d'Hambourg en 1943. Vingt-cinq années disparues dans les flammes, comme il note.
C'est exactement l'effondrement de sa ville qui constitue le thème de son important témoignage de 1948, écrit en fait déjà en novembre 1943, et traduit en Français par Silke Hass et Jean-Pierre Boyer.
Hans Erich Nossack a vendu son entreprise en 1956 pour dédier sa vie exclusivement aux Lettres jusqu'à sa mort en novembre 1977. Il a laissé des romans, des pièces de théâtre, des recueils de nouvelles et de la poésie, qui ont été récompensés par de nombreux prix littéraires.
Pour en arriver à bout du régime criminel nazi, Hambourg, comme 2e ville et 1er port d'Allemagne, a fait l'objet d'exactement 213 attaques aériennes anglo-américaines en tout au cours de la dernière guerre mondiale. Les bombardements dans le cadre de la fameuse "Opération Gomorrhe" du 25 juillet au 3 août 1943, surnommés l'Hiroshima allemand, ont fait 45.000 morts et 80.000 blessés et détruit 350.000 habitations. le pire s'est produit pendant la nuit du 27 au 28 juillet, lorsque des bombes incendiaires ont provoqué une véritable tempête de feu ("Feuersturm").
Le récit sous rubrique de seulement 77 pages constitue de l'histoire vécue. L'auteur raconte en effet comment il se trouvait avec sa femme en vacances à Maschen dans la lande, 25 km au sud d'Hambourg, lorsque l'immeuble où ils habitaient en plein centre-ville a été complètement anéanti par cette tempête de feu, qu'il a donc vu comme impuissant spectateur à une distance somme toute réduite.
L'objectif des alliées avec leur tapis de bombes sur cette ville hanséatique était essentiellement double : 1) démoraliser le peuple allemand et ainsi le contraindre à la paix et 2) ruiner la production et la distribution d'armes. Sans oublier l'insistance de Staline pour l'ouverture d'un front occidental.
L'ampleur d'une telle agression aérienne qui a frappé principalement des civils reste un sujet fort controversé et est maintenant interdite par le droit international public sur la base entre autres de la Convention de Genève du dix octobre 1980.
Le reportage de ces événements, de cet enfer, par Hans Erich Nossack est tout à la fois instructif, émouvant et très littéraire.
Comme l'a remarqué à juste titre le critique littéraire Walter Boehlich dans une postface : "Au-delà de l'horreur ... il y a {chez Nossack} la compassion".
Comme lectures supplémentaires sur ce sujet, je peux vous recommander de Jean-Dominique Merchet "Bombardement : La leçon de Hambourg" (2007) ; de Stig Dagerman "Automne allemand" (1981) ; de W.G. Sebald "De la destruction comme élément de l'histoire naturelle" (2004) et de Keith Lowe "Inferno : La dévastation de Hambourg, 1943" (2015).
Ce court texte (80 pages) se présente comme un journal intime, écrit dans un style élaboré, alternant descriptions précises et impressions fugaces, parfois hermétique, souvent allusif. Prenant des notes à partir du 21 juillet 1943, Hans Erich Nossack y décrit sa vision des bombardements de Hambourg, en insistant sur les différentes phases par lesquelles passe son état d'esprit – sorte d'autoanalyse rétrospective. le lecteur apprend ainsi qu'il habitait Hambourg et qu'il y demeurait habituellement pendant l'été, contrairement à son amie Misi qui préférait s'évader à la campagne. Mais en ce mois de juillet 1943, il décide de la rejoindre dans une vieille bâtisse à une vingtaine de km au sud de la ville. Ils ont décidé d'y passer, en pleine guerre, des vacances d'été et s'accommodent de l'inconfort de l'habitation.
Bien leur en a pris, car quelques jours plus tard, la première attaque massive sur des civils est décidée par le commandement des armées anglo-américaines. En effet, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet (1943), le narrateur est réveillé par Misi. Elle a entendu retentir au loin les sirènes d'alerte aérienne, ainsi que les grondements si caractéristiques d'une série de bombardements. Cette fois, il lui semble que ces bombardements sont encore plus intenses que ceux auxquels ils étaient habitués à Hambourg.
« C'était le bruit de mille huit cents avions qui, venant du sud, à des hauteurs inimaginables, volaient vers Hambourg. Nous avions déjà vécu deux cents attaques ou plus, dont de très sévères, mais celle-ci était quelque chose de tout à fait nouveau. (…) Ce bruit allait durer une heure et demie, puis se répéter pendant trois nuits la semaine suivante. Il se maintenait uniformément dans l'air. On l'entendait même lorsque le vacarme bien plus fort de la défense s'intensifiait en un feu roulant » (p. 13-14).
Dès lors, le narrateur et sa compagne se cachent dans une cave aménagée sous la maison. Mais même sous terre le bruit incessant des explosions est insupportable. Sorti de nuit dans le jardin, l'auteur note dans son journal le spectacle infernal des incendies – les alliés utilisant des bombes au napalm –, des éclats de bombes, des avions touchés par les batteries de DCA qui chutent en flammes, le dôme de fumées qui s'élève suffisamment haut dans le ciel pour que l'on puisse l'apercevoir à plusieurs dizaines de kilomètres.
« Et soudain, tout fut plongé dans la laiteuse fumée des enfers » (p. 17).
Le texte est parfois étrange, aussi étrange sans doute que les visions que devait avoir toute personne assistant à ce spectacle, se sentant à la fois menacé de mort et fasciné. Hans Erich Nossack, auteur, narrateur, tente de reconstituer l'état de confusion qu'il a vécu lui-même, puisqu'il était présent lors de « l'opération Gomorrhe », nom donné à cette effroyable tempête de feu qui a causé la mort de plus de 40 000 personnes. Nous partageons son désarroi, le désordre mental qui l'assaille, mélange d'effroi, d'hallucinations et de désir d'en finir. Il rend compte également de ce qu'il ressent physiquement, les vibrations qui parcourent son corps.
Ce qui, cependant, fait l'originalité de ce témoignage, c'est la manière dont Hans Erich Nossack analyse les conséquences sociales de ces bombardements d'ampleur exceptionnelle. Les villes et les villages alentour se doivent d'accueillir les survivants s'échappant de Hambourg. Devenus des réfugiés, ils sont plus ou moins à la merci des réactions qu'ils provoquent. Si, les premiers jours, ils sont généralement les bienvenus, progressivement les attitudes se font plus hostiles. Certains les envient, car ils considèrent que ces réfugiés, ces survivants, sont tirés d'affaire, qu'ils en ont fini avec les menaces venues du ciel – personne ne semble imaginer que l'on peut être victimes des bombardements à plusieurs reprises. D'autres peuvent même les jalouser, puisque des survivants reçoivent des aides des pouvoirs publics subsistants. À contrario, certains réfugiés exigent de leurs hôtes qu'ils leur donnent la moitié de ce qu'ils ont. Tôt ou tard, les masques tombent.
« Avidité et peur se montrèrent dans leur nudité éhontée et supplantèrent tout sentiment plus délicat » (p. 25).
Mais ce que ressentaient les réfugiés, d'une part, leurs hôtes, d'autre part, est encore plus compliqué à saisir. La distance entre ceux qui ont survécu et les autres paraît infranchissable. Désabusés, insensibles, perdus dans leurs méditations muettes, les réfugiés semblent avoir migré dans un monde parallèle, où nul ne peut les rejoindre.
« Et qu'attendaient les victimes quand elles semblaient accepter tout le bien qu'on leur faisait presque uniquement par obligeance envers ceux qui donnaient ? (…) Il arrivait ainsi que des gens vivant dans la même maison et s'asseyant autour de la même table respiraient l'air de mondes tout à fait différents. Ils essayaient de se donner la main et ne saisissaient que le vide » (p. 27).
L'auteur et sa compagne retournent à Hambourg pour évaluer l'état de destruction de leur quartier, de leur logement, dans l'idée d'en rapporter ce qui resterait de leurs biens. C'est alors qu'ils réalisent que la déraison qui habitait les survivant les atteint à leur tour. Plus personne dans la ville martyrisée ne semble pouvoir agir de façon logique. Ainsi, traversant des rues rasées, ils remarquent une femme laver les vitres de sa maisons restée miraculeusement intacte. Ou bien, plus loin, des familles assises à leur balcon prennent le café, au milieu des ruines, de la puanteur, des cris, de la poussière montant des décombres.
Réalisant que leur immeuble a, lui aussi, été détruit, ils repartent pour leur maison de vacances. Les voilà rangés dans la catégorie de réfugiés. La logique aussi les quitte. Ils effectuent sans trop savoir pourquoi, plusieurs aller-retours entre Hambourg et la campagne, partageant avec d'autres survivants leur humiliation d'être ainsi déracinés, se plaignant de l'ignominie des élites politiques locales qui s'étaient tous éclipsés et avaient abusé de leurs positions pour « se procurer sans scrupule des véhicules pour emporter leurs biens » (p. 39). Même le fait de tenir à jour son journal ne lui est d'aucun secours.
« Même après des visites répétées, on ne s'habituait pas à ce qu'on voyait. (…) Ce qui nous entourait ne rappelait en aucune manière ce qui était perdu. Ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose d'autre, c'était l'inconnu, c'était à proprement parler le Non-Possible » (p. 43). Suivent des descriptions insupportables et pourtant révélatrices de toute cité atrocement bombardée, comme le sont de nos jours celles d'Ukraine, de Gaza, de Khartoum, entre autres.
Les réflexions de l'auteur ne sont pas toujours faciles à comprendre : est-ce un problème de traduction, de style, ou parce qu'il veut nous faire percevoir l'incommunicabilité qu'engendre la douleur d'avoir tout perdu, à commencer par l'espoir ? Les 20 dernières pages contiennent les situations et les états d'âme par lesquels l'auteur est passé pour survivre malgré tout : les bousculades, les files d'attente, les interrogations, l'impossibilité de croire à ce qu'il fait, le dédoublement permanent qui le caractérise. Les dernières pages semblent assez proches d'un délire.
À en croire l'auteur de la postface, Walter Boehlich, c'est la vision de ce bombardement qui aurait donné le courage à l'auteur de devenir écrivain, lui qui écrivait depuis 25 ans, en secret. Quoi qu'il en soit, au-delà du cas particulier, et emblématique, de « l'opération Gomorrhe », l'un des intérêt de ce témoignage est de nous faire percevoir la palette de sentiments qu'éprouvent les réfugiés fuyant les guerres, les catastrophes et la misère. Tout leur paraît irréel, insaisissable. Projetés dans l'inconnu, vulnérables, inconsolables, ils ont un immense besoin de soutien matériel, certes, mais aussi d'empathie.
Lien : https://www.babelio.com/livr..
Bien leur en a pris, car quelques jours plus tard, la première attaque massive sur des civils est décidée par le commandement des armées anglo-américaines. En effet, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet (1943), le narrateur est réveillé par Misi. Elle a entendu retentir au loin les sirènes d'alerte aérienne, ainsi que les grondements si caractéristiques d'une série de bombardements. Cette fois, il lui semble que ces bombardements sont encore plus intenses que ceux auxquels ils étaient habitués à Hambourg.
« C'était le bruit de mille huit cents avions qui, venant du sud, à des hauteurs inimaginables, volaient vers Hambourg. Nous avions déjà vécu deux cents attaques ou plus, dont de très sévères, mais celle-ci était quelque chose de tout à fait nouveau. (…) Ce bruit allait durer une heure et demie, puis se répéter pendant trois nuits la semaine suivante. Il se maintenait uniformément dans l'air. On l'entendait même lorsque le vacarme bien plus fort de la défense s'intensifiait en un feu roulant » (p. 13-14).
Dès lors, le narrateur et sa compagne se cachent dans une cave aménagée sous la maison. Mais même sous terre le bruit incessant des explosions est insupportable. Sorti de nuit dans le jardin, l'auteur note dans son journal le spectacle infernal des incendies – les alliés utilisant des bombes au napalm –, des éclats de bombes, des avions touchés par les batteries de DCA qui chutent en flammes, le dôme de fumées qui s'élève suffisamment haut dans le ciel pour que l'on puisse l'apercevoir à plusieurs dizaines de kilomètres.
« Et soudain, tout fut plongé dans la laiteuse fumée des enfers » (p. 17).
Le texte est parfois étrange, aussi étrange sans doute que les visions que devait avoir toute personne assistant à ce spectacle, se sentant à la fois menacé de mort et fasciné. Hans Erich Nossack, auteur, narrateur, tente de reconstituer l'état de confusion qu'il a vécu lui-même, puisqu'il était présent lors de « l'opération Gomorrhe », nom donné à cette effroyable tempête de feu qui a causé la mort de plus de 40 000 personnes. Nous partageons son désarroi, le désordre mental qui l'assaille, mélange d'effroi, d'hallucinations et de désir d'en finir. Il rend compte également de ce qu'il ressent physiquement, les vibrations qui parcourent son corps.
Ce qui, cependant, fait l'originalité de ce témoignage, c'est la manière dont Hans Erich Nossack analyse les conséquences sociales de ces bombardements d'ampleur exceptionnelle. Les villes et les villages alentour se doivent d'accueillir les survivants s'échappant de Hambourg. Devenus des réfugiés, ils sont plus ou moins à la merci des réactions qu'ils provoquent. Si, les premiers jours, ils sont généralement les bienvenus, progressivement les attitudes se font plus hostiles. Certains les envient, car ils considèrent que ces réfugiés, ces survivants, sont tirés d'affaire, qu'ils en ont fini avec les menaces venues du ciel – personne ne semble imaginer que l'on peut être victimes des bombardements à plusieurs reprises. D'autres peuvent même les jalouser, puisque des survivants reçoivent des aides des pouvoirs publics subsistants. À contrario, certains réfugiés exigent de leurs hôtes qu'ils leur donnent la moitié de ce qu'ils ont. Tôt ou tard, les masques tombent.
« Avidité et peur se montrèrent dans leur nudité éhontée et supplantèrent tout sentiment plus délicat » (p. 25).
Mais ce que ressentaient les réfugiés, d'une part, leurs hôtes, d'autre part, est encore plus compliqué à saisir. La distance entre ceux qui ont survécu et les autres paraît infranchissable. Désabusés, insensibles, perdus dans leurs méditations muettes, les réfugiés semblent avoir migré dans un monde parallèle, où nul ne peut les rejoindre.
« Et qu'attendaient les victimes quand elles semblaient accepter tout le bien qu'on leur faisait presque uniquement par obligeance envers ceux qui donnaient ? (…) Il arrivait ainsi que des gens vivant dans la même maison et s'asseyant autour de la même table respiraient l'air de mondes tout à fait différents. Ils essayaient de se donner la main et ne saisissaient que le vide » (p. 27).
L'auteur et sa compagne retournent à Hambourg pour évaluer l'état de destruction de leur quartier, de leur logement, dans l'idée d'en rapporter ce qui resterait de leurs biens. C'est alors qu'ils réalisent que la déraison qui habitait les survivant les atteint à leur tour. Plus personne dans la ville martyrisée ne semble pouvoir agir de façon logique. Ainsi, traversant des rues rasées, ils remarquent une femme laver les vitres de sa maisons restée miraculeusement intacte. Ou bien, plus loin, des familles assises à leur balcon prennent le café, au milieu des ruines, de la puanteur, des cris, de la poussière montant des décombres.
Réalisant que leur immeuble a, lui aussi, été détruit, ils repartent pour leur maison de vacances. Les voilà rangés dans la catégorie de réfugiés. La logique aussi les quitte. Ils effectuent sans trop savoir pourquoi, plusieurs aller-retours entre Hambourg et la campagne, partageant avec d'autres survivants leur humiliation d'être ainsi déracinés, se plaignant de l'ignominie des élites politiques locales qui s'étaient tous éclipsés et avaient abusé de leurs positions pour « se procurer sans scrupule des véhicules pour emporter leurs biens » (p. 39). Même le fait de tenir à jour son journal ne lui est d'aucun secours.
« Même après des visites répétées, on ne s'habituait pas à ce qu'on voyait. (…) Ce qui nous entourait ne rappelait en aucune manière ce qui était perdu. Ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose d'autre, c'était l'inconnu, c'était à proprement parler le Non-Possible » (p. 43). Suivent des descriptions insupportables et pourtant révélatrices de toute cité atrocement bombardée, comme le sont de nos jours celles d'Ukraine, de Gaza, de Khartoum, entre autres.
Les réflexions de l'auteur ne sont pas toujours faciles à comprendre : est-ce un problème de traduction, de style, ou parce qu'il veut nous faire percevoir l'incommunicabilité qu'engendre la douleur d'avoir tout perdu, à commencer par l'espoir ? Les 20 dernières pages contiennent les situations et les états d'âme par lesquels l'auteur est passé pour survivre malgré tout : les bousculades, les files d'attente, les interrogations, l'impossibilité de croire à ce qu'il fait, le dédoublement permanent qui le caractérise. Les dernières pages semblent assez proches d'un délire.
À en croire l'auteur de la postface, Walter Boehlich, c'est la vision de ce bombardement qui aurait donné le courage à l'auteur de devenir écrivain, lui qui écrivait depuis 25 ans, en secret. Quoi qu'il en soit, au-delà du cas particulier, et emblématique, de « l'opération Gomorrhe », l'un des intérêt de ce témoignage est de nous faire percevoir la palette de sentiments qu'éprouvent les réfugiés fuyant les guerres, les catastrophes et la misère. Tout leur paraît irréel, insaisissable. Projetés dans l'inconnu, vulnérables, inconsolables, ils ont un immense besoin de soutien matériel, certes, mais aussi d'empathie.
Lien : https://www.babelio.com/livr..
"Eh, che volete, signore: hanno vinto le mosche!". Curzio Malaparte : Kaputt (page finale).
‘'Et que voulez-vous, Monsieur, Ce sont les mouches qui ont gagné''
Entre le 25 juillet et le 3 août 1943 les armées de l'air britannique et américaine
bombardent la Ville de Hambourg. Ce fut l'opération Gomorrah qui aurait tué 45 000 humains.
Hans Erich Nossack naît dans une famille aisée de Hambourg. Employé de banque pour des raisons alimentaires, il écrit des poèmes et des drames. Il finit par prendre la direction de l'entreprise familiale. Il réside à Hambourg. Fin juillet 1943 il est en vacances, à quelques kilomètres de Hambourg « chaque fois que j'avais allumé le feu, je courais dehors me livrer au plaisir de regarder la fumée sortit de notre cheminée. »
Il était, en bas, dessous.
Dès novembre 1943, Nossack rédige ce texte à la fois descriptif et méditatif.
Et soudain « Nous avions déjà vécu deux cents attaques ou plus, dont de très sévères, mais celle-ci était quelque chose de tout à fait nouveau……. c'était la fin. »
La ville entière est devenue, vaste cimetière, horizontale.
Un couple prenant son café tranquillement sur son balcon alors que tout est en ruine autour d'eux.
Les réfugiés, silencieux : la moindre parole aurait fait exploser l'atmosphère dramatique.
Le manque de solidarité, parfois. Dans la perte et dans l'errance, les masques qui tombent
« Tout ce qui peut s'exprimer en chiffres est remplaçable ».
Et les mésanges gazouillent.
La ville est en chaos, et pourtant, sans qu'on ait besoin de lui enseigner ou ordonner quoi que ce soit, la population, calme, s'organise.
Contrairement aux espérances des ennemis et aux craintes des autorités : aucune émeute ni troubles. « L'État tentait-il de se mêler d'organisation les gens râlaient. »
Croyance, erronée, qu'au vue des destructions la guerre allait s'arrêter.
« Et autre chose encore : je n'ai pas entendu une seule personne insulter les ennemis, ni les rendre coupables de la destruction. » Ne pas penser à se venger, mais assumer la vie quotidienne, du moins d'abord.
« Ecrit à la craie sur la porte d'une maison, la première et dernière question : où es-tu, maman ? Donne donc des nouvelles ! Je vis maintenant à tel endroit. »
Une semaine plus tard, la ville anéantie est devenue le royaume des rats, des vers et des mouches, des odeurs.
Il n'y a plus de passé, d'avenir, il n'y a plus de temps que le présent.
La perte aurait pu mettre fin à ses aspirations littéraires ; or, c'est à partir de cette perte-là que Nossack va écrire. « Ce fut comme un accomplissement. »
Voilà, en vrac, la vision, par un « intellectuel » qui a survécu, par hasard, à un bombardement « déluge de fer, de feu, de sang ». Mais je suppose que le réel serait identique pour tout humain.
Ps ; aussi sur un sujet proche : une femme à Berlin : journal : 20 avril/22 juin 1945
Sur une réflexion ; l'oeuvre entière De W.G.Sebald
Et plus particulièrement : « de la destruction comme élément de l'histoire naturelle »
‘'Et que voulez-vous, Monsieur, Ce sont les mouches qui ont gagné''
Entre le 25 juillet et le 3 août 1943 les armées de l'air britannique et américaine
bombardent la Ville de Hambourg. Ce fut l'opération Gomorrah qui aurait tué 45 000 humains.
Hans Erich Nossack naît dans une famille aisée de Hambourg. Employé de banque pour des raisons alimentaires, il écrit des poèmes et des drames. Il finit par prendre la direction de l'entreprise familiale. Il réside à Hambourg. Fin juillet 1943 il est en vacances, à quelques kilomètres de Hambourg « chaque fois que j'avais allumé le feu, je courais dehors me livrer au plaisir de regarder la fumée sortit de notre cheminée. »
Il était, en bas, dessous.
Dès novembre 1943, Nossack rédige ce texte à la fois descriptif et méditatif.
Et soudain « Nous avions déjà vécu deux cents attaques ou plus, dont de très sévères, mais celle-ci était quelque chose de tout à fait nouveau……. c'était la fin. »
La ville entière est devenue, vaste cimetière, horizontale.
Un couple prenant son café tranquillement sur son balcon alors que tout est en ruine autour d'eux.
Les réfugiés, silencieux : la moindre parole aurait fait exploser l'atmosphère dramatique.
Le manque de solidarité, parfois. Dans la perte et dans l'errance, les masques qui tombent
« Tout ce qui peut s'exprimer en chiffres est remplaçable ».
Et les mésanges gazouillent.
La ville est en chaos, et pourtant, sans qu'on ait besoin de lui enseigner ou ordonner quoi que ce soit, la population, calme, s'organise.
Contrairement aux espérances des ennemis et aux craintes des autorités : aucune émeute ni troubles. « L'État tentait-il de se mêler d'organisation les gens râlaient. »
Croyance, erronée, qu'au vue des destructions la guerre allait s'arrêter.
« Et autre chose encore : je n'ai pas entendu une seule personne insulter les ennemis, ni les rendre coupables de la destruction. » Ne pas penser à se venger, mais assumer la vie quotidienne, du moins d'abord.
« Ecrit à la craie sur la porte d'une maison, la première et dernière question : où es-tu, maman ? Donne donc des nouvelles ! Je vis maintenant à tel endroit. »
Une semaine plus tard, la ville anéantie est devenue le royaume des rats, des vers et des mouches, des odeurs.
Il n'y a plus de passé, d'avenir, il n'y a plus de temps que le présent.
La perte aurait pu mettre fin à ses aspirations littéraires ; or, c'est à partir de cette perte-là que Nossack va écrire. « Ce fut comme un accomplissement. »
Voilà, en vrac, la vision, par un « intellectuel » qui a survécu, par hasard, à un bombardement « déluge de fer, de feu, de sang ». Mais je suppose que le réel serait identique pour tout humain.
Ps ; aussi sur un sujet proche : une femme à Berlin : journal : 20 avril/22 juin 1945
Sur une réflexion ; l'oeuvre entière De W.G.Sebald
Et plus particulièrement : « de la destruction comme élément de l'histoire naturelle »
"Le métier, c'était la servitude ; l'écriture, la liberté." Hans Erich Nossack, l'auteur de ses mots, échappe par un heureux hasard aux bombardements sur Hambourg, cette opération militaire nommée Gomorrhe, suite de raids meurtriers étalé du 25 juillet au 3 août 1943 ; raids dont le but étaient de détruire un maximum de matériel et de tuer autant que possible. Si Hölderlin posait justement la question d'"à quoi bon des poètes en temps de détresse ? ", L'Effondrement, de Nossack, rédigé peu après le drame de Hambourg, est une réponse esthétique qui décrit la perte, l'anéantissement, la solitude, l'oubli presque obligatoire et la force, celle d'aller de l'avant - l'auteur s'étonnant tout soudainement d'être presque heureux de tout recommencer à zéro (avant de se ressaisir et de douter de la justesse de cette sensation). L'Effondrement est à ranger tout près des livres de Sebald (De la destruction) et Dagerman (Automne allemand). Une belle réédition de cette oeuvre mêlant la beauté (du texte) et l'effroi (du témoignage). Fortement recommandé.
Citations et extraits (2)
Ajouter une citation
«Et celui qui me raconta cela ne savait pas que, dans son langage sans image, il créait une image qu’aucun poète ne peut créer. Il dit : Quelqu’un est venu à nous dans la cave et a dit : maintenant il faut sortir, toute l’immeuble brûle et va s’écrouler. La plupart refusèrent, ils pensaient être là en sécurité. Mais ils ont tous trouvé la mort. Quelques-uns d’entre nous l’ont écouté. Pourtant, il en fallait du courage. Nous devions sortir par un trou, et devant ce trou les flammes ne cessaient d’aller et venir. Ce n’est si terrible, dit-il, j’ai bien réussi à arriver jusqu’à vous. Alors je me suis enveloppé la tête d’une couverture mouillée et j’ai rampé vers l’extérieur. Et nous étions dehors. Ensuite quelques-uns encore sont tombés dans la rue. Nous ne pouvions pas nous occuper d’eux. »
"N'allons pas poser de questions, mais acceptons le plus cruel. Qui c'est si le plus cruel est ce qui est déjà là ? À l'instant où nous nous détournons des ruines de notre ancien foyer, s'ouvre un chemin qui conduit au delà de l'effondrement."
autres livres classés : Hambourg (Allemagne)Voir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Hans Erich Nossack (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
QUIZ LIBRE (titres à compléter)
John Irving : "Liberté pour les ......................"
ours
buveurs d'eau
12 questions
290 lecteurs ont répondu
Thèmes :
roman
, littérature
, témoignageCréer un quiz sur ce livre290 lecteurs ont répondu