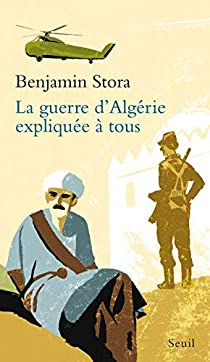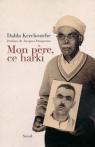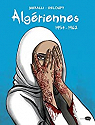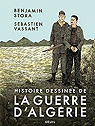Benjamin Stora/5
65 notes
Résumé :
La guerre d'Algérie fut le grand épisode traumatique de l'histoire de la France des Trente Glorieuses. Et les blessures ouvertes alors ne sont pas encore refermées, comme en témoignent les polémiques mémorielles récurrentes qu'elle continue de soulever.
Né à Constantine en Algérie, l'historien Benjamin Stora raconte ici cette guerre longtemps restée " sans nom ", ses épisodes majeurs (des massacres du Constantinois à la politique de la " terre brûlée ... >Voir plus
Né à Constantine en Algérie, l'historien Benjamin Stora raconte ici cette guerre longtemps restée " sans nom ", ses épisodes majeurs (des massacres du Constantinois à la politique de la " terre brûlée ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La guerre d'Algérie expliquée à tousVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (14)
Voir plus
Ajouter une critique
La guerre d'Algérie fut le plus grand episode traumatique des 30 glorineuses. Je suis né deux ans après Stora. Je n'ai jamais été en Algérie. Mon père oui, mon oncle aussi. Des amis sont nés la-bas. En juin 1962, j'avais 10 ans pas encore je suis né en octobre. le massacre de Setif en 1945 est un phénomène que j'ai découvert. Cette inégalité est à l'origine de tout. c'est le 2eme livre de cet auteur que je lis
L'histoire a toujours été mon talon d'Achille, et j'ai regretté bien des fois mon indifférence à son endroit…. Je suis contente d'être tombée sur ce petit livre qui est venu combler mes lacunes sur cette guerre à propos de laquelle je m'étais souvent interrogée sans pour autant faire le moindre effort de recherche pour en comprendre l'histoire.
Pourtant, elle est dans un coin de ma mémoire, cette guerre… dans un souvenir que je revois, comme aurait dit ma grand-mère « comme si c'était hier » ; j'avais une douzaine d'années et mon plus jeune oncle maternel était tout juste revenu de cette guerre d'Algérie dont je ne savais rien mais à propos de laquelle on entendait les adultes parler avec anxiété : FLN, OAS, Ben Bella et tout ça….. Cet oncle, célibataire, qui était tout juste revenu chez sa mère, ma grand-mère donc, m'avait un jour attirée dans sa chambre pour me montrer des photos qu'il avait ramenées de là-bas, je me souviens seulement d'une où il était juché sur une jeep dans son treillis militaire de circonstance ; Il me racontait des trucs que je ne comprenais pas.... J'étais perplexe, interrogative, mais toute gamine que j'étais, je compris qu'il avait besoin d'en parler… mais quand je sortis, ma grand-mère me fit comprendre que je ne devais pas me prêter à ces confidences, et dans son regard désespéré il m'a semblé comprendre qu'elle n'avait pas retrouvé tout à fait son fils d'avant…..
Voilà Voilà ! Quoi qu'il en soit, ce livre a répondu à mon attente, comprendre le contexte et les événements, sans parti pris. D'aucuns pourront l'estimer insuffisant. Pour ma part il a répondu à mon attente. Et, pour qui sait lire, il ne manque pas de laisser percevoir toutes les complexités de ce conflit, et les blessures profondes qui en ont résulté de part et d'autre, les pistes de réflexion ne manquent pas.
Pour aller plus loin, l'auteur indique d'autres ouvrages.
Pourtant, elle est dans un coin de ma mémoire, cette guerre… dans un souvenir que je revois, comme aurait dit ma grand-mère « comme si c'était hier » ; j'avais une douzaine d'années et mon plus jeune oncle maternel était tout juste revenu de cette guerre d'Algérie dont je ne savais rien mais à propos de laquelle on entendait les adultes parler avec anxiété : FLN, OAS, Ben Bella et tout ça….. Cet oncle, célibataire, qui était tout juste revenu chez sa mère, ma grand-mère donc, m'avait un jour attirée dans sa chambre pour me montrer des photos qu'il avait ramenées de là-bas, je me souviens seulement d'une où il était juché sur une jeep dans son treillis militaire de circonstance ; Il me racontait des trucs que je ne comprenais pas.... J'étais perplexe, interrogative, mais toute gamine que j'étais, je compris qu'il avait besoin d'en parler… mais quand je sortis, ma grand-mère me fit comprendre que je ne devais pas me prêter à ces confidences, et dans son regard désespéré il m'a semblé comprendre qu'elle n'avait pas retrouvé tout à fait son fils d'avant…..
Voilà Voilà ! Quoi qu'il en soit, ce livre a répondu à mon attente, comprendre le contexte et les événements, sans parti pris. D'aucuns pourront l'estimer insuffisant. Pour ma part il a répondu à mon attente. Et, pour qui sait lire, il ne manque pas de laisser percevoir toutes les complexités de ce conflit, et les blessures profondes qui en ont résulté de part et d'autre, les pistes de réflexion ne manquent pas.
Pour aller plus loin, l'auteur indique d'autres ouvrages.
C'est tout un art d'être capable d'expliquer simplement, sans manichéisme, des faits historiques, surtout lorsqu'ils sont encore très contemporains.
La mode est plutôt à la simplification nécessitée par l'endoctrinement de nos jeunes générations. L'histoire est de plus en plus souvent dictée par le politique via la Loi.
Ici, c'est un ton juste, des questions anodines, pertinentes et simples qui permettent à l'historien de tisser en finesse la trame de ce drame que, je parie, quasiment aucun élève du primaire au Lycée, n'est capable de situer dans le temps et dans l'enchaînement.
Cet ouvrage s'adresse à eux.
Il peut réparer efficacement ce déficit pour ceux de nos jeunes adultes en devenir qui veulent construire le futur sur l'acceptation du passé.
La mode est plutôt à la simplification nécessitée par l'endoctrinement de nos jeunes générations. L'histoire est de plus en plus souvent dictée par le politique via la Loi.
Ici, c'est un ton juste, des questions anodines, pertinentes et simples qui permettent à l'historien de tisser en finesse la trame de ce drame que, je parie, quasiment aucun élève du primaire au Lycée, n'est capable de situer dans le temps et dans l'enchaînement.
Cet ouvrage s'adresse à eux.
Il peut réparer efficacement ce déficit pour ceux de nos jeunes adultes en devenir qui veulent construire le futur sur l'acceptation du passé.
Une petite soixantaine de pages pour nous expliquer une guerre qui n'a pas dit son nom pendant longtemps: c'est peu c'est très peu. On se demande bien pourquoi Stora a pondu ce petit texte qui en fait explique quelque chose qui est connu depuis belle lurette, du moins pour celui qui s'intéresse à son environnement, car ces explications sont bien succinctes et simplistes surtout au format question simplistes de Jean-Baptiste Péretié
pour réponses brèves Il est vrai que Stora précise plusieurs fois que les choses en fait sont bien plus complexes mais bon la réponse va être simple pour ne pas embrouiller le lecteur. Il en a écrit bien d'autres que vous trouverez chez les libraires. Par contre si c'est pour informer les plus jeunes qui n'ont pas connu cette guerre à mon sens c'est raté.
Je n'ai donc pas appris grand-chose pour ne pas dire rien. C'est la doxa de l'après-guerre d'Algérie où on reste bien dans un problème uniquement franco algérien avec tous les grands poncifs « Je vous ai compris » l'OAS, le petit Clamart, Charonne, la gégène, Ben Bella et j'en passe
Avec beaucoup de tact pour ne pas braquer personne , pardon quelqu'un On renvoie tout le monde dos à dos et termine son petit fascicule par un « ...qui n'empêche pas le dialogue et la compréhension entre Français et Algériens »
On se demande bien quelle est l'utilité de pondre ce petit résumé « pour les nuls» mise à part son petit prix (et encore) de 8.90 € TTC chez Seuil
Certes sa bibliographie sur l'Algérie est plutôt fournie donc ce qu'on ne trouve pas ici on peut le trouver par là .Et au moins les faits sont généralement admis, ils ne posent pas de problème d'interprétation polémique. C'est tellement neutre que personne ne pourra s'en irriter et c'est de l'histoire propre certifiée conforme.
Pas terrible
pour réponses brèves Il est vrai que Stora précise plusieurs fois que les choses en fait sont bien plus complexes mais bon la réponse va être simple pour ne pas embrouiller le lecteur. Il en a écrit bien d'autres que vous trouverez chez les libraires. Par contre si c'est pour informer les plus jeunes qui n'ont pas connu cette guerre à mon sens c'est raté.
Je n'ai donc pas appris grand-chose pour ne pas dire rien. C'est la doxa de l'après-guerre d'Algérie où on reste bien dans un problème uniquement franco algérien avec tous les grands poncifs « Je vous ai compris » l'OAS, le petit Clamart, Charonne, la gégène, Ben Bella et j'en passe
Avec beaucoup de tact pour ne pas braquer personne , pardon quelqu'un On renvoie tout le monde dos à dos et termine son petit fascicule par un « ...qui n'empêche pas le dialogue et la compréhension entre Français et Algériens »
On se demande bien quelle est l'utilité de pondre ce petit résumé « pour les nuls» mise à part son petit prix (et encore) de 8.90 € TTC chez Seuil
Certes sa bibliographie sur l'Algérie est plutôt fournie donc ce qu'on ne trouve pas ici on peut le trouver par là .Et au moins les faits sont généralement admis, ils ne posent pas de problème d'interprétation polémique. C'est tellement neutre que personne ne pourra s'en irriter et c'est de l'histoire propre certifiée conforme.
Pas terrible
La série "expliqué à" au Seuil donne l'impression d'être destinée aux enfants, mais en fait elle est vraiment à mettre entre toutes les mains et elle est d'une qualité historique remarquable.
Chaque thème est traité par un spécialiste (ici, Benjamin Stora pour le guerre d'Algérie) et donne des explications très claires à partir de questions simples.
Benjamin Stora nous offre ici une description claire et limpide des événements qui ont conduits à la Guerre d'Algérie, puis de ceux qui se sont déroulés ensuite.
Il permet de comprendre ce qui s'est passé et réalise une excellente synthèse de toutes les dimensions du sujet.
Je vous recommande vivement ce court ouvrage éclairant et passionnant.
Chaque thème est traité par un spécialiste (ici, Benjamin Stora pour le guerre d'Algérie) et donne des explications très claires à partir de questions simples.
Benjamin Stora nous offre ici une description claire et limpide des événements qui ont conduits à la Guerre d'Algérie, puis de ceux qui se sont déroulés ensuite.
Il permet de comprendre ce qui s'est passé et réalise une excellente synthèse de toutes les dimensions du sujet.
Je vous recommande vivement ce court ouvrage éclairant et passionnant.
critiques presse (2)
Dans ce texte concis et lumineux, [Stora] restitue, à travers des faits précis, la densité des «mémoires blessées», toujours «en conflit les unes avec les autres».
Lire la critique sur le site : Liberation
Benjamin Stora réussit à expliquer clairement une période très complexe.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Citations et extraits (10)
Voir plus
Ajouter une citation
– Dès le mois de janvier 1955, c'est-à-dire deux mois seulement après le
début de la guerre, la torture est dénoncée publiquement. L'écrivain
François Mauriac publie un article à ce sujet dans le journal L'Express.
Toujours en 1955, des rapports sont rédigés et adressés aux plus hauts
responsables politiques. La torture est donc connue. Elle n'est pas employée
pour la première fois, loin de là, au moment de la bataille d'Alger. Mais son utilisation courante durant cette année 1957 va provoquer une prise de conscience. Plusieurs soldats font paraître leur témoignage. Je cite l'un d’eux :
«Nous sommes désespérés de voir jusqu'à quel point peut s'abaisser la nature humaine et de voir des Français employer des procédés qui relèvent de
la barbarie nazie.».
– La comparaison avec les méthodes nazies
est-elle juste?
– Infliger des souffrances physiques insupportables
pour faire parler était une pratique
de la Gestapo. Paul Teitgen, secrétaire
général de la police d'Alger, qui démissionne
pour protester contre les pratiques
du général Massu et des parachutistes, écrit
ainsi :«En visitant les centres d'hébergement,
j'ai reconnu sur certains assignés les
traces profondes des sévices ou des tortures
qu'il y a quatorze ans je subissais personnellement
dans les caves de la Gestapo à
Nancy.»
Mais la Seconde Guerre mondiale
– notamment l'ampleur de la machine exterminatrice
nazie – ne peut être comparée
à la guerre d'Algérie.
début de la guerre, la torture est dénoncée publiquement. L'écrivain
François Mauriac publie un article à ce sujet dans le journal L'Express.
Toujours en 1955, des rapports sont rédigés et adressés aux plus hauts
responsables politiques. La torture est donc connue. Elle n'est pas employée
pour la première fois, loin de là, au moment de la bataille d'Alger. Mais son utilisation courante durant cette année 1957 va provoquer une prise de conscience. Plusieurs soldats font paraître leur témoignage. Je cite l'un d’eux :
«Nous sommes désespérés de voir jusqu'à quel point peut s'abaisser la nature humaine et de voir des Français employer des procédés qui relèvent de
la barbarie nazie.».
– La comparaison avec les méthodes nazies
est-elle juste?
– Infliger des souffrances physiques insupportables
pour faire parler était une pratique
de la Gestapo. Paul Teitgen, secrétaire
général de la police d'Alger, qui démissionne
pour protester contre les pratiques
du général Massu et des parachutistes, écrit
ainsi :«En visitant les centres d'hébergement,
j'ai reconnu sur certains assignés les
traces profondes des sévices ou des tortures
qu'il y a quatorze ans je subissais personnellement
dans les caves de la Gestapo à
Nancy.»
Mais la Seconde Guerre mondiale
– notamment l'ampleur de la machine exterminatrice
nazie – ne peut être comparée
à la guerre d'Algérie.
– Il est difficile de généraliser autant de cas individuels.
Tous les appelés ne vivent pas la même guerre, selon
l'époque à laquelle ils sont mobilisés, le lieu où ils sont
affectés, ou encore la fonction qu'ils occupent. Mais on
peut tenter de trouver des points communs et ainsi cerner
des expériences partagées. Pour beaucoup de soldats
venus de la métropole, la guerre d'Algérie commence
par une épreuve pénible: la traversée de la Méditerranée,
entassés dans un paquebot, parfois dans les cales. Cette
traversée représente pour eux un saut vers l'inconnu –
c'est généralement la première fois qu'ils voyagent hors
de l'Hexagone. Une fois sur le sol algérien, ils suivent
une période d'instruction. Ils apprennent à tirer mais
surtout à marcher, à «crapahuter». Ils doivent aussi apprendre
à supporter l'éloignement, l'absence de femmes,
la répétition des tâches, l'ennui... (…)
– Mais comment se passe la guerre, pour eux, au quotidien?
– Ils mènent des opérations de surveillance, par exemple
dans une rue ou près d'une ferme. Ils arrêtent des «suspects
» au hasard, lors d'opérations de «ratissage». Ils
doivent faire face à un ennemi le plus souvent invisible,
qui connaît beaucoup mieux le terrain qu'eux. Leur entraînement
est médiocre, ils sont éparpillés sur de vastes
étendues, ce qui les rend vulnérables.
Ainsi, le 18 mai 1956, à Palestro (l'actuelle Lakhdaria),
une commune située au nord de l'Algérie, 21 soldats
tombent dans une embuscade de l'ALN. Un seul survit,
délivré cinq jours plus tard par des parachutistes. Les cadavres
des autres jeunes Français sont retrouvés mutilés.
En métropole, la nouvelle provoque une très grande
émotion. Comme si elle suscitait une soudaine prise de
conscience.
Pour le public, cette embuscade réveille en quelque sorte
la vraie nature du conflit qui se déroule en Algérie: une
guerre où de jeunes Français meurent dans des conditions
atroces. Palestro n'est pas la seule attaque de ce
type contre des soldats du contingent mais, pour ces derniers,
elle devient l'exemple par excellence de ce qu'ils
redoutent: tomber dans un guet-apens, se trouver dans
l'incapacité de se défendre, être tués puis mutilés. L'embuscade
de Palestro nourrit les récits qu'ils se racontent
entre eux. Elle alimente leurs angoisses quotidiennes.
Car, en Algérie, les soldats font l'expérience de l'attente
inquiète, de la peur, de la violence.
Tous les appelés ne vivent pas la même guerre, selon
l'époque à laquelle ils sont mobilisés, le lieu où ils sont
affectés, ou encore la fonction qu'ils occupent. Mais on
peut tenter de trouver des points communs et ainsi cerner
des expériences partagées. Pour beaucoup de soldats
venus de la métropole, la guerre d'Algérie commence
par une épreuve pénible: la traversée de la Méditerranée,
entassés dans un paquebot, parfois dans les cales. Cette
traversée représente pour eux un saut vers l'inconnu –
c'est généralement la première fois qu'ils voyagent hors
de l'Hexagone. Une fois sur le sol algérien, ils suivent
une période d'instruction. Ils apprennent à tirer mais
surtout à marcher, à «crapahuter». Ils doivent aussi apprendre
à supporter l'éloignement, l'absence de femmes,
la répétition des tâches, l'ennui... (…)
– Mais comment se passe la guerre, pour eux, au quotidien?
– Ils mènent des opérations de surveillance, par exemple
dans une rue ou près d'une ferme. Ils arrêtent des «suspects
» au hasard, lors d'opérations de «ratissage». Ils
doivent faire face à un ennemi le plus souvent invisible,
qui connaît beaucoup mieux le terrain qu'eux. Leur entraînement
est médiocre, ils sont éparpillés sur de vastes
étendues, ce qui les rend vulnérables.
Ainsi, le 18 mai 1956, à Palestro (l'actuelle Lakhdaria),
une commune située au nord de l'Algérie, 21 soldats
tombent dans une embuscade de l'ALN. Un seul survit,
délivré cinq jours plus tard par des parachutistes. Les cadavres
des autres jeunes Français sont retrouvés mutilés.
En métropole, la nouvelle provoque une très grande
émotion. Comme si elle suscitait une soudaine prise de
conscience.
Pour le public, cette embuscade réveille en quelque sorte
la vraie nature du conflit qui se déroule en Algérie: une
guerre où de jeunes Français meurent dans des conditions
atroces. Palestro n'est pas la seule attaque de ce
type contre des soldats du contingent mais, pour ces derniers,
elle devient l'exemple par excellence de ce qu'ils
redoutent: tomber dans un guet-apens, se trouver dans
l'incapacité de se défendre, être tués puis mutilés. L'embuscade
de Palestro nourrit les récits qu'ils se racontent
entre eux. Elle alimente leurs angoisses quotidiennes.
Car, en Algérie, les soldats font l'expérience de l'attente
inquiète, de la peur, de la violence.
– Tu avais quel âge au moment de la guerre
d'Algérie? En as-tu des souvenirs?
– Je suis né en Algérie en 1950. J'ai donc grandi
pendant cette guerre. Elle s'est déroulée quand
j'avais entre 4 et 11 ans. J'ai beaucoup de souvenirs
de cette période, certains très vifs, d'autres plus
flous, comme le sont parfois les souvenirs d'enfance.
Je garde en mémoire des sensations, des émotions ,
des odeurs, la délicieuse tfina (le plat des Juifs de
Constantine, ma ville de naissance), les pique-niques
sur la plage de Stora... Mais aussi des souvenirs plus
douloureux, comme les drames qui ont touché ma famille.
Je me souviens particulièrement du moment où nous
avons quitté l'Algérie avec mes parents et ma soeur, en juin 1962. (…)
Moi, j'étais un enfant et je savais que c'était un exil sans retour,
que je laissais derrière moi le pays qui m'avait vu naître.
Mais aujourd'hui, mon travail d'historien, c'est de prendre de la
distance par rapport à mes souvenirs personnels, mon cas individuel,
pour raconter une histoire beaucoup plus large. Une histoire qui concerne
les peuples de France et d'Algérie, et qui a encore de fortes répercussions
aujourd'hui. J'essaye de comprendre, et de faire partager mes connaissances
sur cette guerre, qui a arraché des gens à leur terre natale et qui a permis
aux Algériens d'arracher leur indépendance. Je pense que ce mot "arrachement"
est l'un de ceux qui permettent de définir la guerre d'Algérie.
d'Algérie? En as-tu des souvenirs?
– Je suis né en Algérie en 1950. J'ai donc grandi
pendant cette guerre. Elle s'est déroulée quand
j'avais entre 4 et 11 ans. J'ai beaucoup de souvenirs
de cette période, certains très vifs, d'autres plus
flous, comme le sont parfois les souvenirs d'enfance.
Je garde en mémoire des sensations, des émotions ,
des odeurs, la délicieuse tfina (le plat des Juifs de
Constantine, ma ville de naissance), les pique-niques
sur la plage de Stora... Mais aussi des souvenirs plus
douloureux, comme les drames qui ont touché ma famille.
Je me souviens particulièrement du moment où nous
avons quitté l'Algérie avec mes parents et ma soeur, en juin 1962. (…)
Moi, j'étais un enfant et je savais que c'était un exil sans retour,
que je laissais derrière moi le pays qui m'avait vu naître.
Mais aujourd'hui, mon travail d'historien, c'est de prendre de la
distance par rapport à mes souvenirs personnels, mon cas individuel,
pour raconter une histoire beaucoup plus large. Une histoire qui concerne
les peuples de France et d'Algérie, et qui a encore de fortes répercussions
aujourd'hui. J'essaye de comprendre, et de faire partager mes connaissances
sur cette guerre, qui a arraché des gens à leur terre natale et qui a permis
aux Algériens d'arracher leur indépendance. Je pense que ce mot "arrachement"
est l'un de ceux qui permettent de définir la guerre d'Algérie.
Au total, pendant toute la guerre, près d’un million et demi de jeunes
français, de toutes origines sociales, iront en Algérie. Ce qui signifie que la
plupart des hommes nés entre 1932 et 1943 y ont été envoyés.
C'est toute une génération, parmi lesquels de futurs hommes politiques comme Jacques Chirac (président de la République de 1995 à 2007),
Michel Rocard (Premier ministre de 1988 à1991). Mais aussi de futures personnalités du spectacle, de la chanson ou du cinéma comme le chanteur Eddy Mitchell et le réalisateur Claude Lelouch. Ou encore des sportifs comme le cycliste Raymond Poulidor. Ces hommes jeunes forment ce que l'on appelle le «contingent».
C'est l'une des grandes différences entre la guerre d'Indochine et la guerre
d'Algérie. En Indochine, la guerre a été menée par un corps expéditionnaire,
c'est-à-dire des soldats professionnels. En Algérie, tous les hommes français
appartenant à certaines classes d'âge ont été mobilisés.
français, de toutes origines sociales, iront en Algérie. Ce qui signifie que la
plupart des hommes nés entre 1932 et 1943 y ont été envoyés.
C'est toute une génération, parmi lesquels de futurs hommes politiques comme Jacques Chirac (président de la République de 1995 à 2007),
Michel Rocard (Premier ministre de 1988 à1991). Mais aussi de futures personnalités du spectacle, de la chanson ou du cinéma comme le chanteur Eddy Mitchell et le réalisateur Claude Lelouch. Ou encore des sportifs comme le cycliste Raymond Poulidor. Ces hommes jeunes forment ce que l'on appelle le «contingent».
C'est l'une des grandes différences entre la guerre d'Indochine et la guerre
d'Algérie. En Indochine, la guerre a été menée par un corps expéditionnaire,
c'est-à-dire des soldats professionnels. En Algérie, tous les hommes français
appartenant à certaines classes d'âge ont été mobilisés.
-- L'inégalité du système colonial est-elle la seule cause du début de la guerre d'Algérie ?
Puisque la France était présente en Algérie depuis longtemps, pourquoi la guerre éclate-t-elle en novembre 1954 ?
-- C'est une question difficile. Pour comprendre le passé, mieux vaut fuir les visions simplistes, les interprétations trop rapides. Au contraire, il faut accepter la complexité de la réalité, chercher différentes explications, combiner plusieurs facteurs. Et tenter de restituer tel ou tel évènement dans son contexte.
Pour la guerre d'Algérie, le contexte de l'époque est celui d'une aspiration générale des peuples colonisés à l'indépendance. Cette aspiration s'affirme de plus en plus depuis la fin de Seconde Guerre mondiale. Les grandes puissances coloniales (le Grande-Bretagne et la France principalement) doivent y faire face. Dans certains pays, l'indépendance est acquise de manière relativement pacifique. C'est le cas par exemple en Syrie et au Liban, en 1946. Dans d'autres pays, la guerre éclate. C'est le cas en Indochine (le Vietnam actuel) à laquelle la France refuse d'accorder clairement l'indépendance. La guerre d'Indochine dure de 1946 à 1954 et s'achève par la défaite militaire de la France à Diên Biên Phu. En Algérie, ceux qui veulent l'indépendance ne peuvent ignorer cette défaite, qui leur prouve qu'ils ont une chance de vaincre la puissance coloniale.
Puisque la France était présente en Algérie depuis longtemps, pourquoi la guerre éclate-t-elle en novembre 1954 ?
-- C'est une question difficile. Pour comprendre le passé, mieux vaut fuir les visions simplistes, les interprétations trop rapides. Au contraire, il faut accepter la complexité de la réalité, chercher différentes explications, combiner plusieurs facteurs. Et tenter de restituer tel ou tel évènement dans son contexte.
Pour la guerre d'Algérie, le contexte de l'époque est celui d'une aspiration générale des peuples colonisés à l'indépendance. Cette aspiration s'affirme de plus en plus depuis la fin de Seconde Guerre mondiale. Les grandes puissances coloniales (le Grande-Bretagne et la France principalement) doivent y faire face. Dans certains pays, l'indépendance est acquise de manière relativement pacifique. C'est le cas par exemple en Syrie et au Liban, en 1946. Dans d'autres pays, la guerre éclate. C'est le cas en Indochine (le Vietnam actuel) à laquelle la France refuse d'accorder clairement l'indépendance. La guerre d'Indochine dure de 1946 à 1954 et s'achève par la défaite militaire de la France à Diên Biên Phu. En Algérie, ceux qui veulent l'indépendance ne peuvent ignorer cette défaite, qui leur prouve qu'ils ont une chance de vaincre la puissance coloniale.
Videos de Benjamin Stora (53)
Voir plusAjouter une vidéo
Quelles cicatrices a laissé la colonisation française ? Que doit faire la France pour guérir ces maux ? Doit-elle s'excuser ?
Cet échange comprend Pascal Blanchard, historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations, chercheur-associé au CRHIM et co-directeur du Groupe de recherche Achac sur les représentations, les discours et les imaginaires coloniaux et postcoloniaux, et Benjamin Stora, docteur en Histoire et en Sociologie, ancien Président du Musée national de l'histoire de l'immigration.
Le Collège des Bernardins est un espace de liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans la compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de l'homme.
Une rencontre animée par Alexandre Wirth.
Découvrez l'actualité du Collège des Bernardins sur notre site : https://www.collegedesbernardins.fr/
Chapitrage :
0:00 Pourquoi parle-t-on encore de la colonisation ? 4:50 La responsabilité de la République 11:05 Les responsabilités individuelles 14:05 La reconnaissance par l'Etat des crimes 17:50 L'Indochine VS l'Algérie 23:12 Les autres puissances coloniales 26:48 La mémoire en tant qu'instrument diplomatique 37:35 La Françafrique 39:00 La repentance en tant qu'instrument politique
Cet échange comprend Pascal Blanchard, historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations, chercheur-associé au CRHIM et co-directeur du Groupe de recherche Achac sur les représentations, les discours et les imaginaires coloniaux et postcoloniaux, et Benjamin Stora, docteur en Histoire et en Sociologie, ancien Président du Musée national de l'histoire de l'immigration.
Le Collège des Bernardins est un espace de liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans la compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de l'homme.
Une rencontre animée par Alexandre Wirth.
Découvrez l'actualité du Collège des Bernardins sur notre site : https://www.collegedesbernardins.fr/
Chapitrage :
0:00 Pourquoi parle-t-on encore de la colonisation ? 4:50 La responsabilité de la République 11:05 Les responsabilités individuelles 14:05 La reconnaissance par l'Etat des crimes 17:50 L'Indochine VS l'Algérie 23:12 Les autres puissances coloniales 26:48 La mémoire en tant qu'instrument diplomatique 37:35 La Françafrique 39:00 La repentance en tant qu'instrument politique
+ Lire la suite
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Benjamin Stora (46)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3205 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3205 lecteurs ont répondu