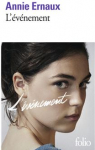Annie Ernaux
Pierre-Louis Fort (Éditeur scientifique)Olivier Tomasini (Collaborateur)/5 4314 notes
Annie Ernaux
La place
Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris Normandie et se servait toujours de son Opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite "place au soleil". Et dévoile aussi la distance, douloureuse, surve... >Voir plus
Pierre-Louis Fort (Éditeur scientifique)Olivier Tomasini (Collaborateur)/5 4314 notes
Résumé :
Annie Ernaux
La place
Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris Normandie et se servait toujours de son Opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite "place au soleil". Et dévoile aussi la distance, douloureuse, surve... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La placeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (448)
Voir plus
Ajouter une critique
J'ai un peu de colère ce matin, un peu d'indignation : je viens de lire La Place. Probablement pas de quoi se mettre en rogne, penseront certains. Peut-être, mais c'est assez spécial pour moi cette affaire.
Comme Annie Ernaux, je suis née dans le trou du cul de la Normandie, à quelques kilomètres d'elle seulement, dans l'une des villes citées dans l'ouvrage. Comme elle, je suis issue d'un milieu ouvrier mâtiné de paysan. Comme elle, je suis la seule de ma famille à avoir suivi des études supérieures. Comme elle, j'ai vu chaque jour se creuser un peu plus le fossé social qui me sépare encore aujourd'hui — et plus que jamais — de ma famille.
Je vais même vous faire une petite confidence supplémentaire, c'est qu'à la différence d'Annie Ernaux, même parmi les culs terreux, ma famille était considérée comme le top du top de la ringardise et de l'arriération sociale. Nous ne partions jamais en vacances, ne portions aucune marque, n'étions jamais au courant des nouveautés, mes parents avaient une 2 CV pourrie sur toute la durée des années 1980, époque où elle était ultra passée de mode à la campagne et pas du tout vintage… (Exemples pris parmi une multitude d'autres qu'il n'est pas nécessaire de déballer ici.)
Comme Annie Ernaux, je suis désormais enseignante loin des terres chéries où j'ai grandi. Voilà pourquoi je me permets d'être indignée par ce livre que je trouve, malgré toutes les précautions dont se barde l'auteure, très méprisant pour la condition sociale de ses parents.
Personnellement, j'y perçois du racisme. Certes, ce n'est pas du racisme ordinaire, mais c'est du racisme de classe. Pour moi, ce qui constitue l'essence même du racisme, ce n'est pas de dire qu'il existe des différences entre les groupes humains, car ça, il faudrait vraiment être atteint d'une forme de cécité assez invalidante pour ne pas les percevoir. le vrai racisme, c'est de classer les groupes humains sur la base même de ces différences ; de dire que ça c'est mieux ou ça c'est moins bien parce que je suis plus ceci ou moins cela.
Or, quand je lis Annie Ernaux, à aucun moment je ne ressens de bienveillance pour les classes populaires. Elle nous fait une liste longue comme le bras de leurs manquements ou de leurs insuffisances sans jamais la nuancer par les aspects puants de la bourgeoisie à laquelle elle accède et qui pourtant sont absents chez les classes populaires. Elle n'aime pas le milieu dont elle est issue et ça se voit, ça suinte de partout, ça transpire.
Moi non plus mon père n'a jamais lu de livre, moi aussi mon père est un rustre fini, pourtant, combien de fois me suis-je dit auprès de gens très bien sous tous aspects, très bien nés, qui ont une bonne PLACE, combien de fois me suis-je dit, que vous êtes cons mes braves et que mon père vous torcherait si vous aviez l'un et l'autre à résoudre un problème auquel vous n'avez jamais eu à faire face ni l'un ni l'autre.
J'ai vécu auprès d'Amérindiens analphabètes qui m'ont fascinée. J'ai vécu auprès de chercheurs imbuvables et imbus qui m'ont révulsée. J'ai vécu auprès de certains culs terreux normands absolument sans intérêt ; j'ai vécu auprès de certains culs terreux normands dont la puissance de raisonnement m'impressionne encore aujourd'hui et à laquelle je me réfère bien des années après avoir quitté mon milieu et ma Normandie natale.
Donc je ne peux pas lire ce livre sans m'indigner quelque peu. (À titre de comparaison, si je place un autre Normand dans la balance, lui aussi transfuge de classe, comme Annie Ernaux, en la personne de Michel Onfray, lorsque je lis son petit opuscule intitulé le Corps de mon père, je perçois un rapport au père et aux classes populaires tout autre et qui, personnellement, me sied beaucoup mieux.) Je n'y ressens aucun amour des classes populaires, juste un sentiment de culpabilité de leur avoir tourné le dos et d'essayer vaguement de se racheter en écrivant ce bouquin.
Mais cette écriture !!?? Cette écriture !! L'écriture plate, la bien nommée. Comme c'est méprisant. Je cite : « Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de " passionnant ", ou d' " émouvant ". Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. »
Voilà l'argument le plus petit, le plus mesquin qu'on puisse imaginer. Encore heureux qu'elle n'est pas devenue peintre d'art sans quoi, pour faire le portrait de ses parents, elle se serait sentie obligée d'utiliser un gros rouleau de peintre en bâtiment. Quelle connerie ! C'est d'autant plus une connerie que dans ses autres romans par la suite, elle ne s'est plus défaite de ce style (ou de ce non style, c'est selon), preuve qu'il n'a qu'un rapport assez éloigné et douteux avec le propos.
Pour en finir avec ce non style, j'aimerais convoquer une citation de Herman Broch dans Les Somnambules et qui m'est revenue à l'esprit à la lecture de ce livre : « Au fond de tout cela il y a une logique complètement dépouillée d'ornements et il semble qu'on ne fait pas une conclusion trop risquée en disant qu'une pareille logique requiert en tous lieux un style dépouillé d'ornements. Certes, ce style apparaît même aussi bon et aussi juste que l'est tout ce qui est nécessaire. Et cependant, c'est le néant, c'est la mort qui sont liés à ce dépouillement d'ornements, derrière lui se cache la figure monstrueuse d'un trépas, où le temps s'est effondré en ruines. »
Pourtant, j'aurais aimé aimer ; j'aurais aimé me sentir en résonance avec cette auteure qui a vécu des choses si proches de celles que j'ai vécues et que je vis encore. Il est vrai qu'elle restitue bien la sensation de se sentir étrangère chez soi, de ne plus avoir grand-chose à partager quand on se voit. Mais elle occulte un autre aspect : elle nous parle d'un " héritage ", sous-entendant qu'il est lourd à porter dans le milieu bourgeois où elle évolue désormais, sans jamais nous en dire quoi que ce soit si ce n'est que du négatif. J'ai peine à croire que son père ne lui ait absolument rien légué de positif et qui lui serve encore aujourd'hui. Pourtant, pas une ligne ne l'évoque.
En somme, ce que je lis dans cette platitude, c'est un portrait sans aménité, sans chaleur. Elle écrit dans l'extrait que j'évoque plus haut " les faits marquants " de la vie de son père. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Sa naissance à elle n'est-elle pas un fait marquant de l'existence de son père ? Elle évoque rapidement, très rapidement le fait qu'elle ait eu une soeur qui est décédée en bas âge. D'où sa naissance à elle, d'où le fait que ses parents soient " âgés ", d'où le fait qu'ils lui " passent " beaucoup de ses lubies, notamment les longues études. Elle n'en dit pas un mot.
J'ai bien connu des gens comme le père d'Annie Ernaux, des Normands simples et pudiques, pas expansifs mais avec beaucoup de coeur, des gens sincères et droits, et j'ai plus de respect et d'amour pour eux qu'elle ne semble en éprouver pour son propre père.
Bref, un drôle d'hommage qui, sous des airs de vouloir saluer sa mémoire, sonne à mes oreilles comme une ultime marque de mépris et d'incompréhension. Désolée de ne pas vous suivre Annie Ernaux, désolée de ne pas goûter votre snobisme (au sens premier " sine nobilitate ") des couches populaires qui se sont saignées pour que vous soyez ce que vous êtes. J'en viens, j'en suis et c'est peut-être pour ça que je réagis si fort aujourd'hui. D'autant plus fort que le non style de cet ouvrage a donné des idées à de bas suiveurs comme Delphine de Vigan, pour ne citer qu'elle, dont la prose et l'éthique me dégoûtent.
Aussi, plus que jamais, souvenez-vous que ce que j'exprime ici n'est que mon avis, un avis pas forcément à sa place, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. (suite aux commentaires) : J'ai omis de parler, puisque la barque était déjà bien pleine, de certains petits côtés racoleurs dans l'écriture d'Annie Ernaux qui me déplaisent au plus haut point, loin du respect que j'aurais attendu vis-à-vis d'un père, quand bien même on ne partage rien avec lui et l'on ne le comprend pas.
Par exemple, parmi plusieurs autres, l'évocation totalement gratuite du fait que pendant la toilette mortuaire de son père, elle ait vu son sexe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, et surtout, qu'est-ce que ça apporte au portrait ou pseudo-portrait ? Ce voyeurisme ordinaire me débecte au plus haut point, et c'est précisément cet aspect, ainsi que l'écriture plate et l'autojustification de ses choix d'écriture qu'a repris Delphine de Vigan, en bon âne suiveur, dans sa mixture imbuvable.
P. S. 2 (après l'attribution du Prix Nobel à cette auteure de « machins » vaguement écrits) : Il fut un temps où recevoir le Prix Nobel, ça signifiait « avoir du talent », littérairement parlant, mais comme cette notion est subjective, on peut toujours vous rétorquer que c'est une question de goût, que vous n'avez rien compris à ceci ou à cela, etc.
Désormais, la valeur cardinale n'est plus le talent littéraire, c'est-à-dire l'aptitude à générer de l'émotion chez le lecteur, à l'élever, à le faire réfléchir, non, maintenant, c'est la politique des quotas vis-à-vis des « minorités » : une femme / un homme ; une blanche / un noir ; un juif / une homo, etc. Et le talent dans tout ça ??? le mot « talent » signifiait à l'origine « celui ou celle qui est possesseur d'un don particulier ».
Virginia Woolf, par exemple, elle qui ne reçut jamais le Prix Nobel, possédait pourtant un talent, quelque chose de rare et d'unique, dont elle fit don à l'humanité. Excusez-moi, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas qu'Annie Ernaux, et quelques autres parmi les derniers Prix Nobel, soient affublés d'un quelconque don particulier. D'où ma surprise, pour ne pas dire ma stupeur, face à de telles mises sur piédestal de statues fort ordinaires. Cela fait suite, peut-être, au " président normal ", c'est dans l'air du temps, il faut croire...
Comme Annie Ernaux, je suis née dans le trou du cul de la Normandie, à quelques kilomètres d'elle seulement, dans l'une des villes citées dans l'ouvrage. Comme elle, je suis issue d'un milieu ouvrier mâtiné de paysan. Comme elle, je suis la seule de ma famille à avoir suivi des études supérieures. Comme elle, j'ai vu chaque jour se creuser un peu plus le fossé social qui me sépare encore aujourd'hui — et plus que jamais — de ma famille.
Je vais même vous faire une petite confidence supplémentaire, c'est qu'à la différence d'Annie Ernaux, même parmi les culs terreux, ma famille était considérée comme le top du top de la ringardise et de l'arriération sociale. Nous ne partions jamais en vacances, ne portions aucune marque, n'étions jamais au courant des nouveautés, mes parents avaient une 2 CV pourrie sur toute la durée des années 1980, époque où elle était ultra passée de mode à la campagne et pas du tout vintage… (Exemples pris parmi une multitude d'autres qu'il n'est pas nécessaire de déballer ici.)
Comme Annie Ernaux, je suis désormais enseignante loin des terres chéries où j'ai grandi. Voilà pourquoi je me permets d'être indignée par ce livre que je trouve, malgré toutes les précautions dont se barde l'auteure, très méprisant pour la condition sociale de ses parents.
Personnellement, j'y perçois du racisme. Certes, ce n'est pas du racisme ordinaire, mais c'est du racisme de classe. Pour moi, ce qui constitue l'essence même du racisme, ce n'est pas de dire qu'il existe des différences entre les groupes humains, car ça, il faudrait vraiment être atteint d'une forme de cécité assez invalidante pour ne pas les percevoir. le vrai racisme, c'est de classer les groupes humains sur la base même de ces différences ; de dire que ça c'est mieux ou ça c'est moins bien parce que je suis plus ceci ou moins cela.
Or, quand je lis Annie Ernaux, à aucun moment je ne ressens de bienveillance pour les classes populaires. Elle nous fait une liste longue comme le bras de leurs manquements ou de leurs insuffisances sans jamais la nuancer par les aspects puants de la bourgeoisie à laquelle elle accède et qui pourtant sont absents chez les classes populaires. Elle n'aime pas le milieu dont elle est issue et ça se voit, ça suinte de partout, ça transpire.
Moi non plus mon père n'a jamais lu de livre, moi aussi mon père est un rustre fini, pourtant, combien de fois me suis-je dit auprès de gens très bien sous tous aspects, très bien nés, qui ont une bonne PLACE, combien de fois me suis-je dit, que vous êtes cons mes braves et que mon père vous torcherait si vous aviez l'un et l'autre à résoudre un problème auquel vous n'avez jamais eu à faire face ni l'un ni l'autre.
J'ai vécu auprès d'Amérindiens analphabètes qui m'ont fascinée. J'ai vécu auprès de chercheurs imbuvables et imbus qui m'ont révulsée. J'ai vécu auprès de certains culs terreux normands absolument sans intérêt ; j'ai vécu auprès de certains culs terreux normands dont la puissance de raisonnement m'impressionne encore aujourd'hui et à laquelle je me réfère bien des années après avoir quitté mon milieu et ma Normandie natale.
Donc je ne peux pas lire ce livre sans m'indigner quelque peu. (À titre de comparaison, si je place un autre Normand dans la balance, lui aussi transfuge de classe, comme Annie Ernaux, en la personne de Michel Onfray, lorsque je lis son petit opuscule intitulé le Corps de mon père, je perçois un rapport au père et aux classes populaires tout autre et qui, personnellement, me sied beaucoup mieux.) Je n'y ressens aucun amour des classes populaires, juste un sentiment de culpabilité de leur avoir tourné le dos et d'essayer vaguement de se racheter en écrivant ce bouquin.
Mais cette écriture !!?? Cette écriture !! L'écriture plate, la bien nommée. Comme c'est méprisant. Je cite : « Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de " passionnant ", ou d' " émouvant ". Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. »
Voilà l'argument le plus petit, le plus mesquin qu'on puisse imaginer. Encore heureux qu'elle n'est pas devenue peintre d'art sans quoi, pour faire le portrait de ses parents, elle se serait sentie obligée d'utiliser un gros rouleau de peintre en bâtiment. Quelle connerie ! C'est d'autant plus une connerie que dans ses autres romans par la suite, elle ne s'est plus défaite de ce style (ou de ce non style, c'est selon), preuve qu'il n'a qu'un rapport assez éloigné et douteux avec le propos.
Pour en finir avec ce non style, j'aimerais convoquer une citation de Herman Broch dans Les Somnambules et qui m'est revenue à l'esprit à la lecture de ce livre : « Au fond de tout cela il y a une logique complètement dépouillée d'ornements et il semble qu'on ne fait pas une conclusion trop risquée en disant qu'une pareille logique requiert en tous lieux un style dépouillé d'ornements. Certes, ce style apparaît même aussi bon et aussi juste que l'est tout ce qui est nécessaire. Et cependant, c'est le néant, c'est la mort qui sont liés à ce dépouillement d'ornements, derrière lui se cache la figure monstrueuse d'un trépas, où le temps s'est effondré en ruines. »
Pourtant, j'aurais aimé aimer ; j'aurais aimé me sentir en résonance avec cette auteure qui a vécu des choses si proches de celles que j'ai vécues et que je vis encore. Il est vrai qu'elle restitue bien la sensation de se sentir étrangère chez soi, de ne plus avoir grand-chose à partager quand on se voit. Mais elle occulte un autre aspect : elle nous parle d'un " héritage ", sous-entendant qu'il est lourd à porter dans le milieu bourgeois où elle évolue désormais, sans jamais nous en dire quoi que ce soit si ce n'est que du négatif. J'ai peine à croire que son père ne lui ait absolument rien légué de positif et qui lui serve encore aujourd'hui. Pourtant, pas une ligne ne l'évoque.
En somme, ce que je lis dans cette platitude, c'est un portrait sans aménité, sans chaleur. Elle écrit dans l'extrait que j'évoque plus haut " les faits marquants " de la vie de son père. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Sa naissance à elle n'est-elle pas un fait marquant de l'existence de son père ? Elle évoque rapidement, très rapidement le fait qu'elle ait eu une soeur qui est décédée en bas âge. D'où sa naissance à elle, d'où le fait que ses parents soient " âgés ", d'où le fait qu'ils lui " passent " beaucoup de ses lubies, notamment les longues études. Elle n'en dit pas un mot.
J'ai bien connu des gens comme le père d'Annie Ernaux, des Normands simples et pudiques, pas expansifs mais avec beaucoup de coeur, des gens sincères et droits, et j'ai plus de respect et d'amour pour eux qu'elle ne semble en éprouver pour son propre père.
Bref, un drôle d'hommage qui, sous des airs de vouloir saluer sa mémoire, sonne à mes oreilles comme une ultime marque de mépris et d'incompréhension. Désolée de ne pas vous suivre Annie Ernaux, désolée de ne pas goûter votre snobisme (au sens premier " sine nobilitate ") des couches populaires qui se sont saignées pour que vous soyez ce que vous êtes. J'en viens, j'en suis et c'est peut-être pour ça que je réagis si fort aujourd'hui. D'autant plus fort que le non style de cet ouvrage a donné des idées à de bas suiveurs comme Delphine de Vigan, pour ne citer qu'elle, dont la prose et l'éthique me dégoûtent.
Aussi, plus que jamais, souvenez-vous que ce que j'exprime ici n'est que mon avis, un avis pas forcément à sa place, c'est-à-dire, pas grand-chose.
P. S. (suite aux commentaires) : J'ai omis de parler, puisque la barque était déjà bien pleine, de certains petits côtés racoleurs dans l'écriture d'Annie Ernaux qui me déplaisent au plus haut point, loin du respect que j'aurais attendu vis-à-vis d'un père, quand bien même on ne partage rien avec lui et l'on ne le comprend pas.
Par exemple, parmi plusieurs autres, l'évocation totalement gratuite du fait que pendant la toilette mortuaire de son père, elle ait vu son sexe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, et surtout, qu'est-ce que ça apporte au portrait ou pseudo-portrait ? Ce voyeurisme ordinaire me débecte au plus haut point, et c'est précisément cet aspect, ainsi que l'écriture plate et l'autojustification de ses choix d'écriture qu'a repris Delphine de Vigan, en bon âne suiveur, dans sa mixture imbuvable.
P. S. 2 (après l'attribution du Prix Nobel à cette auteure de « machins » vaguement écrits) : Il fut un temps où recevoir le Prix Nobel, ça signifiait « avoir du talent », littérairement parlant, mais comme cette notion est subjective, on peut toujours vous rétorquer que c'est une question de goût, que vous n'avez rien compris à ceci ou à cela, etc.
Désormais, la valeur cardinale n'est plus le talent littéraire, c'est-à-dire l'aptitude à générer de l'émotion chez le lecteur, à l'élever, à le faire réfléchir, non, maintenant, c'est la politique des quotas vis-à-vis des « minorités » : une femme / un homme ; une blanche / un noir ; un juif / une homo, etc. Et le talent dans tout ça ??? le mot « talent » signifiait à l'origine « celui ou celle qui est possesseur d'un don particulier ».
Virginia Woolf, par exemple, elle qui ne reçut jamais le Prix Nobel, possédait pourtant un talent, quelque chose de rare et d'unique, dont elle fit don à l'humanité. Excusez-moi, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas qu'Annie Ernaux, et quelques autres parmi les derniers Prix Nobel, soient affublés d'un quelconque don particulier. D'où ma surprise, pour ne pas dire ma stupeur, face à de telles mises sur piédestal de statues fort ordinaires. Cela fait suite, peut-être, au " président normal ", c'est dans l'air du temps, il faut croire...
Un texte que j'ai trouvé froid. le regard est distancié. On ne ressent pas d'émotion. L'auteure évoque là son enfance et parle plus précisément de son père, bâtissant même son roman autour de la mort de celui-ci. En fait Annie Ernaux semble gênée par la condition modeste de sa famille, elle fera tout pour s'élever, pour se sortir de ce milieu et accéder à la petite bourgeoisie. Je trouve qu'il y a un peu de mépris, et beaucoup de honte vis à vis d'une famille trop humble, pas assez cultivée. J'ai été choquée par le regard de l'auteure sur sa famille et ce monde qu'elle ne juge pas digne d'elle. Elle ne semble pas avoir de véritable affection pour sa famille, elle regarde tout de haut comme le ferait un simple spectateur. Ce livre dont j'attendais beaucoup, première rencontre avec Annie Ernaux, me laisse sur ma faim, et je ne suis pas certaine de vouloir découvrir d'autres oeuvres de cette auteure.
Lien : http://araucaria.20six.fr
Lien : http://araucaria.20six.fr
Il y a quelques jours j'ai découvert Annie Ernaux et son récit "Une femme" ; j'ai souhaité poursuivre cette prise de contact particulièrement émouvante avec "La place", oeuvre réputée indissociable de la susnommée.
Indissociables, elles le sont fondamentalement, comme le sont deux géniteurs. Dans "Une femme", l'auteur retrace l'existence de sa mère ; dans "La place", elle nous livre leurs heures écourtées de son père, parti le premier. Ce récit autobiographique a été écrit quelques années avant "Une femme" et pourtant je suis heureuse d'avoir lu les deux textes "dans le désordre". J'ai ainsi mieux visualisé la mère de l'auteur, fatalement moins mise en avant ici et pourtant essentielle à la pleine appréciation de l'éclairage donné au père. Je pense que sans cette connaissance profonde de "la femme", j'aurais moins bien compris "l'homme" et partant de là, "le couple", "la famille" et enfin, "la fille".
"La place" m'a beaucoup touchée mais moins émue qu'"Une femme". Au-delà de l'indissociation, ces deux récits sont intimement imbriqués et, telles les pièces d'un puzzle, ils se complètent avec harmonie, recelant la même trame forte, le même ton convaincant, le même style efficace, la même pudeur délectable et le même reflet réaliste. Si j'ai été moins émue, je ne peux incriminer ni le fond ni la forme du récit mais mon rapport personnel à mon propre père et à ma propre mère. Car, en effet, la puissance d'évocation d'Annie Ernaux crée réellement ce prodige : chaque lecteur peut être confronté à sa propre histoire, éparpillée parmi ses mots. Selon son passif et ses affinités avec ses parents, il y trouvera l'émotion là où il l'attend ou, au contraire, là où il ne l'attend pas.
Indissociables, elles le sont fondamentalement, comme le sont deux géniteurs. Dans "Une femme", l'auteur retrace l'existence de sa mère ; dans "La place", elle nous livre leurs heures écourtées de son père, parti le premier. Ce récit autobiographique a été écrit quelques années avant "Une femme" et pourtant je suis heureuse d'avoir lu les deux textes "dans le désordre". J'ai ainsi mieux visualisé la mère de l'auteur, fatalement moins mise en avant ici et pourtant essentielle à la pleine appréciation de l'éclairage donné au père. Je pense que sans cette connaissance profonde de "la femme", j'aurais moins bien compris "l'homme" et partant de là, "le couple", "la famille" et enfin, "la fille".
"La place" m'a beaucoup touchée mais moins émue qu'"Une femme". Au-delà de l'indissociation, ces deux récits sont intimement imbriqués et, telles les pièces d'un puzzle, ils se complètent avec harmonie, recelant la même trame forte, le même ton convaincant, le même style efficace, la même pudeur délectable et le même reflet réaliste. Si j'ai été moins émue, je ne peux incriminer ni le fond ni la forme du récit mais mon rapport personnel à mon propre père et à ma propre mère. Car, en effet, la puissance d'évocation d'Annie Ernaux crée réellement ce prodige : chaque lecteur peut être confronté à sa propre histoire, éparpillée parmi ses mots. Selon son passif et ses affinités avec ses parents, il y trouvera l'émotion là où il l'attend ou, au contraire, là où il ne l'attend pas.
« La place », où Annie Ernaux se fait la biographe de son père. Quel bel hommage, et quelle belle illustration du défunt ascenseur social !
Annie Ernaux, biographe de son père, et partiellement d'elle-même par la même occasion.
« La place » est un petit ouvrage (à peine plus de cent pages) qu'on peut qualifier de minimaliste : c'est parfois froid, sans vraiment de pathos… et pourtant Dieu sait si le sujet s'y prête, au pathos. S'il s'agit là d'un exercice de style, c'est parfaitement réussi ; et même si, habituellement, j'ai toujours du mal avec ce genre de prose, je dois avouer que là, elle m'a emmené…
Grace à ce style épuré, je suppose ; car autrement, comment emmener le lecteur au terme d'une histoire comme il y en a tant : le père qui s'extrait de sa condition ouvrière pour tenir un café-épicerie, et la fille qui bénéficie de « l'ascenseur social de la République » ; brillantes études, enseignement, agrégation… Et au fur et à mesure que les échelons sont franchis, un écart qui se creuse avec son milieu social d'origine, inexorablement.
Et puis… d'origine normande, comme l'auteur, j'ai connu dans mon enfance ce genre de café-épicerie, il y en avait deux près de chez moi ; c'était avant le Super-égé et la Coop, bien sûr. Rien que d'en parler ici, leur odeur particulière, un mélange de fumée de tabac, de produits d'entretien et de cidre « dur », servi « à la tireuse » me monte aux narines…et le souvenir de ma mère me disant : « va me chercher un paquet de chicorée chez P. ». Chez P. … C'était plus loin que chez H., mais c'était moins cher…
Bref, un petit ouvrage au style particulier, mais qui m'a ouvert la porte des souvenirs d'enfance…avec parfois des expressions locales en usage chez mes grands parents comme « quart moins d'onze heures » pour onze heures moins le quart, probablement héritées de l'anglais.
Annie Ernaux, biographe de son père, et partiellement d'elle-même par la même occasion.
« La place » est un petit ouvrage (à peine plus de cent pages) qu'on peut qualifier de minimaliste : c'est parfois froid, sans vraiment de pathos… et pourtant Dieu sait si le sujet s'y prête, au pathos. S'il s'agit là d'un exercice de style, c'est parfaitement réussi ; et même si, habituellement, j'ai toujours du mal avec ce genre de prose, je dois avouer que là, elle m'a emmené…
Grace à ce style épuré, je suppose ; car autrement, comment emmener le lecteur au terme d'une histoire comme il y en a tant : le père qui s'extrait de sa condition ouvrière pour tenir un café-épicerie, et la fille qui bénéficie de « l'ascenseur social de la République » ; brillantes études, enseignement, agrégation… Et au fur et à mesure que les échelons sont franchis, un écart qui se creuse avec son milieu social d'origine, inexorablement.
Et puis… d'origine normande, comme l'auteur, j'ai connu dans mon enfance ce genre de café-épicerie, il y en avait deux près de chez moi ; c'était avant le Super-égé et la Coop, bien sûr. Rien que d'en parler ici, leur odeur particulière, un mélange de fumée de tabac, de produits d'entretien et de cidre « dur », servi « à la tireuse » me monte aux narines…et le souvenir de ma mère me disant : « va me chercher un paquet de chicorée chez P. ». Chez P. … C'était plus loin que chez H., mais c'était moins cher…
Bref, un petit ouvrage au style particulier, mais qui m'a ouvert la porte des souvenirs d'enfance…avec parfois des expressions locales en usage chez mes grands parents comme « quart moins d'onze heures » pour onze heures moins le quart, probablement héritées de l'anglais.
♫Qui sait où c'est sa 𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮 !?
Un camping, un palace
Un perrier en terrasse
Au comptoir un blanc-cass'
Faut-il rester de glace !? ♫
- François Morel - 2016 -
----♪---♫---🐄---🛒---🐄---♫---♪----
Elle regarde la mère
Sous les yeux de son père
Et l'enfant en elle se terre...
Sois heureuse avec ce que tu as
Faut pas péter plus haut qu'on l'a
A table, mieux valait se taire
Peur indicible du mot de travers
Ou commettre des impairs
Alors elle a recopié des phrases, des vers
Dans son vieux pardessus râpé
Il s'en allait l'hiver, l'été
Là où restait quelque humanité
Là où les gens savent encore parler
De l'avenir même s'ils sont fatigués
Il ignorait qu'un jour, elle en parlerait...
Et Juliette avait encore son nez
Aragon n'était pas un minet
Sartre était déjà bien engagé
Au Café de Flore,
y avait déjà des folles
Tous ces mots et ces phrases disent les limites et la couleur du monde où vécut son père, où Annie a vécu aussi,
Il lui fallait revoir sa Normandie...
Mais quand on a juste quinze ans
On n'a pas le coeur assez grand...
C'est fou c'qu'un crépuscule de printemps
Elle a connu des marées hautes et des marées basses,
Elle a rencontré des tempêtes et des bourrasques,
Chaque amour morte à une nouvelle a fait 𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮
Décrire la vision d'un monde où tout coûte cher
Allo Papa Ernaux Annie et à 𝙉𝙊𝘽𝙀𝙇 manières...
Un camping, un palace
Un perrier en terrasse
Au comptoir un blanc-cass'
Faut-il rester de glace !? ♫
- François Morel - 2016 -
----♪---♫---🐄---🛒---🐄---♫---♪----
Elle regarde la mère
Sous les yeux de son père
Et l'enfant en elle se terre...
Sois heureuse avec ce que tu as
Faut pas péter plus haut qu'on l'a
A table, mieux valait se taire
Peur indicible du mot de travers
Ou commettre des impairs
Alors elle a recopié des phrases, des vers
Dans son vieux pardessus râpé
Il s'en allait l'hiver, l'été
Là où restait quelque humanité
Là où les gens savent encore parler
De l'avenir même s'ils sont fatigués
Il ignorait qu'un jour, elle en parlerait...
Et Juliette avait encore son nez
Aragon n'était pas un minet
Sartre était déjà bien engagé
Au Café de Flore,
y avait déjà des folles
Tous ces mots et ces phrases disent les limites et la couleur du monde où vécut son père, où Annie a vécu aussi,
Il lui fallait revoir sa Normandie...
Mais quand on a juste quinze ans
On n'a pas le coeur assez grand...
C'est fou c'qu'un crépuscule de printemps
Elle a connu des marées hautes et des marées basses,
Elle a rencontré des tempêtes et des bourrasques,
Chaque amour morte à une nouvelle a fait 𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮
Décrire la vision d'un monde où tout coûte cher
Allo Papa Ernaux Annie et à 𝙉𝙊𝘽𝙀𝙇 manières...
critiques presse (1)
Le livre avec lequel Annie Ernaux a véritablement trouvé sa voix, application du principe d’« écriture plate » qu’elle a forgé, c’est-à-dire sans émotion, à l’appui d’un vocabulaire simple et de phrases dépouillées à l’extrême.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Citations et extraits (345)
Voir plus
Ajouter une citation
C'était un dimanche, au début de l'après-midi.
Ma mère est apparue dans le haut de l'escalier. Elle se tamponnait les yeux avec la serviette de table qu'elle avait dû emporter avec elle en montant dans la chambre après le déjeuner. Elle a dit d'une voix neutre: "C'est fini." Je ne me souviens pas des minutes qui ont suivi. Je revois seulement les yeux de mon père fixant quelque chose derrière moi, loin, et ses lèvres retroussées au-dessus des gencives. Je crois avoir demandé à ma mère de lui fermer les yeux. Autour du lit, il y avait aussi la sœur de ma mère et son mari. Ils se sont proposés pour aider à la toilette, au rasage, parce qu'il fallait se dépêcher avant que le corps ne se raidisse. Ma mère a pensé qu'on pourrait le revêtir du costume qu'il avait étrenné pour mon mariage trois ans avant. Toute cette scène se déroulait très simplement, sans cris, ni sanglots, ma mère avait seulement les yeux rouges et un rictus continuel.
Ma mère est apparue dans le haut de l'escalier. Elle se tamponnait les yeux avec la serviette de table qu'elle avait dû emporter avec elle en montant dans la chambre après le déjeuner. Elle a dit d'une voix neutre: "C'est fini." Je ne me souviens pas des minutes qui ont suivi. Je revois seulement les yeux de mon père fixant quelque chose derrière moi, loin, et ses lèvres retroussées au-dessus des gencives. Je crois avoir demandé à ma mère de lui fermer les yeux. Autour du lit, il y avait aussi la sœur de ma mère et son mari. Ils se sont proposés pour aider à la toilette, au rasage, parce qu'il fallait se dépêcher avant que le corps ne se raidisse. Ma mère a pensé qu'on pourrait le revêtir du costume qu'il avait étrenné pour mon mariage trois ans avant. Toute cette scène se déroulait très simplement, sans cris, ni sanglots, ma mère avait seulement les yeux rouges et un rictus continuel.
Il s'énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je m'usais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et " ne pas prendre un ouvrier ". Mais que j'aime me casser la tête lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l'âge. Il avait parfois l'air de penser que j'étais malheureuse.
Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à dix-sept ans, autour de nous toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l'usine ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu'on ne me prenne pour une paresseuse et lui un crâneur. Comme une excuse : « On ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. » Il disait que j'apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c'était seulement de ses mains.
Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à dix-sept ans, autour de nous toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l'usine ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu'on ne me prenne pour une paresseuse et lui un crâneur. Comme une excuse : « On ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. » Il disait que j'apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c'était seulement de ses mains.
Aux vacances d'été, j'invitais à Y… une ou deux copines de fac, des filles " sans préjugés " qui affirmaient « c'est le cœur qui compte ». Car, à la manière de ceux qui veulent prévenir tout regard condescendant sur leur famille, j'annonçais : « Tu sais chez moi c'est " simple ". » Mon père était heureux d'accueillir ces jeunes filles si bien élevées, leur parlait beaucoup, par souci de politesse évitant de laisser tomber la conversation, s'intéressant vivement à tout ce qui concernait mes amies. La composition des repas était source d'inquiétude, « est-ce que " mademoiselle " Geneviève aime les tomates ? » Il se mettait en quatre. Quand la famille d'une de ces amies me recevait, j'étais admise à partager de façon naturelle un mode de vie que ma venue ne changeait pas. À entrer dans leur monde qui ne redoutait aucun regard étranger, et qui m'était ouvert parce que j'avais oublié les manières, les idées et les goûts du mien. En donnant un caractère de fête à ce qui, dans ces milieux, n'était qu'une visite banale, mon père voulait honorer mes amies et passer pour quelqu'un qui a du savoir-vivre. Il révélait surtout une infériorité qu'elles reconnaissaient malgré elles, en disant par exemple, « bonjour monsieur, comme ça va-ti ? »
Un jour, avec un regard fier : « Je ne t'ai jamais fait honte. »
Un jour, avec un regard fier : « Je ne t'ai jamais fait honte. »
À la fin d'un été, j'ai " amené à la maison " un étudiant de sciences politiques avec qui j'étais liée. Rite solennel consacrant le droit d'entrer dans une famille, effacé dans les milieux modernes, aisés, où les copains entraient et sortaient librement. Pour recevoir ce jeune homme, il a mis une cravate, échangé ses bleus contre un pantalon du dimanche. Il exultait, sûr de pouvoir considérer mon futur mari comme son fils, d'avoir avec lui, par-delà les différences d'instruction, une connivence d'hommes. Il lui a montré son jardin, le garage qu'il avait construit seul, de ses mains. Offrande de ce qu'il savait faire, avec l'espoir que sa valeur serait reconnue de ce garçon qui aimait sa fille. À celui-ci, il suffisait d'être " bien élevé ", c'était la qualité que mes parents appréciaient le plus, elle leur apparaissait une conquête difficile. Ils n'ont pas cherché à savoir, comme ils l'auraient fait pour un ouvrier, s'il était courageux et ne buvait pas. Conviction profonde que le savoir et les bonnes manières étaient la marque d'une excellence intérieure, innée.
Il n’osait plus me raconter des histoires de son enfance. Je ne lui parlais plus de mes études. Sauf le latin, parce qu’il avait servi la messe, elles lui étaient incompréhensibles et il refusait de faire mine de s’y intéresser, à la différence de ma mère. Il se fâchait quand je me plaignais du travail ou critiquais les cours. Le mot « prof » lui déplaisait, ou « dirlo », même « bouquin ». Et toujours la peur OU PEUT-ETRE LE DÉSIR que je n’y arrive pas.
Il s’énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je m’usais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j’aime me casser la tête lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l’âge. Il avait parfois l’air de penser que j’étais malheureuse.
Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à dix-sept ans, autour de nous toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l’usine, ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu’on ne me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Comme une excuse : « On ne l’a jamais poussée, elle avait ça dans elle. ». Il disait que j’apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c’était seulement travailler de ses mains.
Il s’énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je m’usais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j’aime me casser la tête lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l’âge. Il avait parfois l’air de penser que j’étais malheureuse.
Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte que je ne gagne pas encore ma vie à dix-sept ans, autour de nous toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l’usine, ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Il craignait qu’on ne me prenne pour une paresseuse et lui pour un crâneur. Comme une excuse : « On ne l’a jamais poussée, elle avait ça dans elle. ». Il disait que j’apprenais bien, jamais que je travaillais bien. Travailler, c’était seulement travailler de ses mains.
Videos de Annie Ernaux (95)
Voir plusAjouter une vidéo
En 2011, Annie Ernaux a fait don au département des Manuscrits de la BnF de tous les brouillons, notes préparatoires et copies corrigées de ses livres publiés depuis "Une femme" (1988). Une décennie et un prix Nobel de littérature plus tard, elle évoque pour "Chroniques", le magazine de la BnF, la relation qu'elle entretient avec les traces de son travail.
Retrouvez le dernier numéro de "Chroniques" en ligne : https://www.bnf.fr/fr/chroniques-le-magazine-de-la-bnf
Retrouvez le dernier numéro de "Chroniques" en ligne : https://www.bnf.fr/fr/chroniques-le-magazine-de-la-bnf
autres livres classés : Pères et fillesVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Annie Ernaux (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La place (Annie Ernaux)
De quel roman la narratrice doit-elle expliquer un passage pour les épreuves pratiques du Capes ?
Le Père Goriot
Madame Bovary
15 questions
158 lecteurs ont répondu
Thème : La place de
Annie ErnauxCréer un quiz sur ce livre158 lecteurs ont répondu