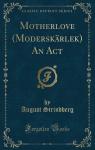Critiques de August Strindberg (83)
Brrrr !… Voici une pièce glaçante ; une pièce venue du froid et pas seulement parce que son auteur est suédois. Non, une pièce glaçante car elle est crépusculaire, sans espoir, sans issue sauf l'issue fatale.
Il s'agit d'une courte pièce en trois actes, dite pièce de chambre, c'est-à-dire un drame dépouillé de toutes sortes de scènes digestives entre les moments forts. Ici, il n'y a qu'un moment et c'est précisément celui qui aurait été le point d'orgue, l'apogée d'une pièce de forme plus classique. Une sorte de nouvelle théâtrale si vous me permettez cette approximation.
Il y a donc peu de personnages en général et peu de personnages secondaires en particulier. On est tout de suite introduit dans la situation paroxysmique. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail du synopsis, peut-être n'est-il pas inutile de nous arrêter quelques instants sur cet étrange titre.
Bien évidemment, il n'est jamais question d'oiseau marin dans cette pièce un peu comme dans La Mouette de Tchékhov. C'est donc un titre symbolique mais je vous avoue que, forte de mon incroyance et de mon ignorance en matière religieuse, j'ai cherché longtemps quel pouvait bien être le symbole en question. Alors que toute bonne chrétienne un peu au fait des iconographies sacrées aurait de suite perçu la métaphore.
La réponse se trouve pour partie dans la biologie et pour partie dans les interprétations humaines et le credo chrétien. Le pélican, en tant qu'oiseau marin, n'a rien d'extraordinaire dans sa façon d'élever ses petits. Il fait un nid, pond quelques œufs dont il sort deux ou trois oisillons odieux avec des têtes nues de dinosaures embryonnaires qui peu à peu se déguisent en oiseaux de mer. Pour assurer la croissance de ces jolies petites bêtes, les parents se succèdent au nid avec un jabot plein de bouts de poissons sanguinolents plus ou moins fraîchement pêchés et à divers stades de leur digestion. Les petits oviraptors fourragent alors généreusement dans les entrailles de leurs parents pour en extraire des victuailles qui pourraient, avec un regard mal affûté, faire penser à quelque organe vital du parent en question.
De là à imaginer que le pélican va jusqu'à se sacrifier pour sa progéniture en leur donnant à manger son propre cœur, il n'y a qu'un pas pour le mauvais observateur de la nature, (dont les théologiens et iconographes chrétiens font partie puisqu'en plus d'une très mauvaise observation biologique, ils représentent sur leurs églises des pélicans avec des têtes d'aigles, preuve d'une mauvaise observation artistique) désireux de trouver à tout prix dans la faune des manifestations du sacrifice du Christ. (Je signale au passage que pour cette même raison, le pélican a été choisi pour les représentations héraldiques dans le sud-est de l'Europe, et, ce faisant, par Hergé comme symbole de la Syldavie.)
Ceci dit — pardonnez-moi cette longue digression —, voici donc au moins l'un des thèmes de la pièce qui nous serait ainsi révélé : le sacrifice pour les enfants. Mais de suite, une nouvelle ambiguïté se fait jour : qui est le Pélican ? le père ou la mère ? S'il s'agit de la mère, comme il est probable puisque c'est le personnage principal, s'agit-il d'une franche ironie, d'un sarcasme de l'auteur ou d'une envie de ce dernier de mettre le doigt sur la notion de " perception de sacrifice " et la distance qui peut la séparer du sacrifice véritable ?
Car, bien qu'elle s'imagine (peut-être sincèrement ?) avoir admirablement rempli sa mission conjugale et maternelle tout au long de sa vie, la mère dont il est question ici ressemble à tout sauf à quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, et tout particulièrement à l'endroit de ses enfants. Elle apparaît aussi aimante qu'une clef à molette et les a laissés jeûner dans le froid la majeure partie de leur existence.
Toutefois, se rend-elle seulement compte de la vie qu'elle leur a offert ? Le père, quant à lui, vient de mourir et l'on saute déjà sur le couvercle du cercueil pour connaître la part d'héritage qui échoit à chacun.
Le fils et la fille sont faméliques bien que cette dernière vienne de célébrer son mariage avec un drôle d'individu qui semble nourrir d'étranges relations d'intimité avec la mère…
Je ne vous en dit pas davantage mais sachez seulement qu'il se dégage une glauquissime impression de cette pièce ou Strindberg veut nous dire que nous nous berçons d'illusions et que nous nous cachons derrière les paravents factices des apparences. Et quand on se décide à lever ces voiles et ces caches, on ne doit s'attendre à découvrir que le visage hideux de la mort…
Encore un dernier mot, peut-être, car j'ai jusqu'à présent gardé le silence sur un trait pourtant saillant de la pièce et de son auteur, à savoir que le texte est constellé, qu'il suinte et qu'il transpire par tous les pores une franche misogynie. On peut également affirmer qu'il exsude une vison absolument calamiteuse et désolante de la maternité, présentée comme un insupportable fardeau pour la mère et carrément pire que l'enfer pour les rejetons…
Joli programme, n'est-ce pas ? Mais ce n'est bien sûr qu'un avis à plumes blanches muni d'un grand bec au-dessous duquel une longue poche disgracieuse, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Il s'agit d'une courte pièce en trois actes, dite pièce de chambre, c'est-à-dire un drame dépouillé de toutes sortes de scènes digestives entre les moments forts. Ici, il n'y a qu'un moment et c'est précisément celui qui aurait été le point d'orgue, l'apogée d'une pièce de forme plus classique. Une sorte de nouvelle théâtrale si vous me permettez cette approximation.
Il y a donc peu de personnages en général et peu de personnages secondaires en particulier. On est tout de suite introduit dans la situation paroxysmique. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail du synopsis, peut-être n'est-il pas inutile de nous arrêter quelques instants sur cet étrange titre.
Bien évidemment, il n'est jamais question d'oiseau marin dans cette pièce un peu comme dans La Mouette de Tchékhov. C'est donc un titre symbolique mais je vous avoue que, forte de mon incroyance et de mon ignorance en matière religieuse, j'ai cherché longtemps quel pouvait bien être le symbole en question. Alors que toute bonne chrétienne un peu au fait des iconographies sacrées aurait de suite perçu la métaphore.
La réponse se trouve pour partie dans la biologie et pour partie dans les interprétations humaines et le credo chrétien. Le pélican, en tant qu'oiseau marin, n'a rien d'extraordinaire dans sa façon d'élever ses petits. Il fait un nid, pond quelques œufs dont il sort deux ou trois oisillons odieux avec des têtes nues de dinosaures embryonnaires qui peu à peu se déguisent en oiseaux de mer. Pour assurer la croissance de ces jolies petites bêtes, les parents se succèdent au nid avec un jabot plein de bouts de poissons sanguinolents plus ou moins fraîchement pêchés et à divers stades de leur digestion. Les petits oviraptors fourragent alors généreusement dans les entrailles de leurs parents pour en extraire des victuailles qui pourraient, avec un regard mal affûté, faire penser à quelque organe vital du parent en question.
De là à imaginer que le pélican va jusqu'à se sacrifier pour sa progéniture en leur donnant à manger son propre cœur, il n'y a qu'un pas pour le mauvais observateur de la nature, (dont les théologiens et iconographes chrétiens font partie puisqu'en plus d'une très mauvaise observation biologique, ils représentent sur leurs églises des pélicans avec des têtes d'aigles, preuve d'une mauvaise observation artistique) désireux de trouver à tout prix dans la faune des manifestations du sacrifice du Christ. (Je signale au passage que pour cette même raison, le pélican a été choisi pour les représentations héraldiques dans le sud-est de l'Europe, et, ce faisant, par Hergé comme symbole de la Syldavie.)
Ceci dit — pardonnez-moi cette longue digression —, voici donc au moins l'un des thèmes de la pièce qui nous serait ainsi révélé : le sacrifice pour les enfants. Mais de suite, une nouvelle ambiguïté se fait jour : qui est le Pélican ? le père ou la mère ? S'il s'agit de la mère, comme il est probable puisque c'est le personnage principal, s'agit-il d'une franche ironie, d'un sarcasme de l'auteur ou d'une envie de ce dernier de mettre le doigt sur la notion de " perception de sacrifice " et la distance qui peut la séparer du sacrifice véritable ?
Car, bien qu'elle s'imagine (peut-être sincèrement ?) avoir admirablement rempli sa mission conjugale et maternelle tout au long de sa vie, la mère dont il est question ici ressemble à tout sauf à quelqu'un qui se sacrifie pour les autres, et tout particulièrement à l'endroit de ses enfants. Elle apparaît aussi aimante qu'une clef à molette et les a laissés jeûner dans le froid la majeure partie de leur existence.
Toutefois, se rend-elle seulement compte de la vie qu'elle leur a offert ? Le père, quant à lui, vient de mourir et l'on saute déjà sur le couvercle du cercueil pour connaître la part d'héritage qui échoit à chacun.
Le fils et la fille sont faméliques bien que cette dernière vienne de célébrer son mariage avec un drôle d'individu qui semble nourrir d'étranges relations d'intimité avec la mère…
Je ne vous en dit pas davantage mais sachez seulement qu'il se dégage une glauquissime impression de cette pièce ou Strindberg veut nous dire que nous nous berçons d'illusions et que nous nous cachons derrière les paravents factices des apparences. Et quand on se décide à lever ces voiles et ces caches, on ne doit s'attendre à découvrir que le visage hideux de la mort…
Encore un dernier mot, peut-être, car j'ai jusqu'à présent gardé le silence sur un trait pourtant saillant de la pièce et de son auteur, à savoir que le texte est constellé, qu'il suinte et qu'il transpire par tous les pores une franche misogynie. On peut également affirmer qu'il exsude une vison absolument calamiteuse et désolante de la maternité, présentée comme un insupportable fardeau pour la mère et carrément pire que l'enfer pour les rejetons…
Joli programme, n'est-ce pas ? Mais ce n'est bien sûr qu'un avis à plumes blanches muni d'un grand bec au-dessous duquel une longue poche disgracieuse, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Petit voyage spatio-temporel avec une des oeuvres d' August Strindberg, Le sacristain romantique de Ranö, composé en 1888, qui nous entraîne sur les pas de son héros Alrik Lundsted dans la Suède du 19ème siècle, à la fin du règne d'Oscar 1er (1799-1859) fils unique de Charles XIV Jean qui n'est autre que Jean-Baptiste Bernadotte, le béarnais devenu roi de Suède.
En apparence, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme pauvre qui ayant quitté sa province pour la capitale afin d'assouvir sa passion, la musique, espère gravir les échelons sociaux grâce à son don. Mais une fois la lecture avancée, on comprend rapidement que le propos va au-delà du simple récit d'apprentissage. Le lecteur pressent que la réalité, notamment ses difficultés financières, vont en quelques mois le ramener à des exigences moindres, l'obligeant à se rabattre vers des objectifs beaucoup moins ambitieux : il ne sera pas professeur de musique (malgré son talent reconnu à l'Académie de musique) mais organiste et instituteur après avoir passer un concours d'aptitude et suivi le Séminaire.
Une défaite personnelle qu'il ne voudra pas reconnaître une fois isolé comme sacristain à Ranö dans un archipel loin du tumulte de la société. Ses lectures, notamment, celles de l'oeuvre de James Fenimore Cooper lui permettront de résister et d'accepter son nouvel environnement.
Si l'histoire débute par la description réaliste des activités quotidiennes du village où Alrik Lundsted gagne sa vie comme commis chez un épicier, dans l'attente d'un départ éminent pour Stockholm, ses aspirations sont vite dévoilées alors que son passé est tu.
Ainsi ce qui apparaît être les simples tribulations d'un jeune homme, plein d'espoir et rêveur, partant à la conquête et à la découverte de la vie artistique et culturelle de Stockholm, se révèle être en fait une incursion dans une âme blessée qui progressivement nous introduit dans un univers où réalité et fantasme se mêlent abolissant la frontière entre les deux mondes grâce au talent d' August Strindberg.
Au delà des anecdotes historiques de la vie et des usages de la Suède du 19ème siècle, au delà de toutes les références culturelles et artistiques (oeuvres de musiciens, de poètes de l'époque) qui ponctuent le récit, l'intérêt de cette lecture réside à mon sens dans l'art et la manière d'amener le lecteur dans l'intimité de son héros, nous le rendant de plus en plus attachant au fil des pages, lorsqu'on comprend pourquoi ce futur jeune artiste à l'imagination fertile s'est réfugié depuis son jeune âge dans le rêve et, que l'auteur nous livre son secret.
Je peux dire que ma première incursion dans l'univers strindbergien (aussi difficile d'écrire qu'à prononcer) m'a séduite et m'a donné envie d'aller plus loin, notamment de découvrir une autre de ses oeuvres, Inferno, un récit autobiographique.
Le seul petit bémol mais Strindberg n'y est pour rien c'est que je ne suis pas musicienne et que certains passages sont emprunts d'une technicité qui m'a un peu dépassé.
Pour les lecteurs non avertis dont je fais partie, la postface d'Elena Balzamo, qui est aussi l'auteur d'une biographie August Strindberg : visages et destin, donne tous les éclairages nécessaires pour comprendre Le sacristain romantique de Ranö et l'univers si particulier de Strindberg. auteur, dramaturge, peintre et journaliste à la vie tumultueuse et tourmentée.
Une oeuvre à rapprocher de Niels Lyhne (Entre la vie et le rêve) publiée en 1880 du poète et botaniste danois Jens Peter Jacobsen (1847-1885) qui nous emportait aussi dans une balade romantique en suivant le parcours chaotique d'un jeune homme qui lui était issu d'une famille aisée. Mais la ressemblance s'arrête là.
Une lecture émouvante et troublante entre rêve et réalité.
Mais qui est le magicien? L'auteur, August Strindberg ou son héros Alrik Lundsted...
Lundsted serait-t-il le reflet déformé de Strindberg ?
Je vous laisse le soin de supputer sur cette performance en allant mettre le nez dans son oeuvre....
En apparence, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme pauvre qui ayant quitté sa province pour la capitale afin d'assouvir sa passion, la musique, espère gravir les échelons sociaux grâce à son don. Mais une fois la lecture avancée, on comprend rapidement que le propos va au-delà du simple récit d'apprentissage. Le lecteur pressent que la réalité, notamment ses difficultés financières, vont en quelques mois le ramener à des exigences moindres, l'obligeant à se rabattre vers des objectifs beaucoup moins ambitieux : il ne sera pas professeur de musique (malgré son talent reconnu à l'Académie de musique) mais organiste et instituteur après avoir passer un concours d'aptitude et suivi le Séminaire.
Une défaite personnelle qu'il ne voudra pas reconnaître une fois isolé comme sacristain à Ranö dans un archipel loin du tumulte de la société. Ses lectures, notamment, celles de l'oeuvre de James Fenimore Cooper lui permettront de résister et d'accepter son nouvel environnement.
Si l'histoire débute par la description réaliste des activités quotidiennes du village où Alrik Lundsted gagne sa vie comme commis chez un épicier, dans l'attente d'un départ éminent pour Stockholm, ses aspirations sont vite dévoilées alors que son passé est tu.
Ainsi ce qui apparaît être les simples tribulations d'un jeune homme, plein d'espoir et rêveur, partant à la conquête et à la découverte de la vie artistique et culturelle de Stockholm, se révèle être en fait une incursion dans une âme blessée qui progressivement nous introduit dans un univers où réalité et fantasme se mêlent abolissant la frontière entre les deux mondes grâce au talent d' August Strindberg.
Au delà des anecdotes historiques de la vie et des usages de la Suède du 19ème siècle, au delà de toutes les références culturelles et artistiques (oeuvres de musiciens, de poètes de l'époque) qui ponctuent le récit, l'intérêt de cette lecture réside à mon sens dans l'art et la manière d'amener le lecteur dans l'intimité de son héros, nous le rendant de plus en plus attachant au fil des pages, lorsqu'on comprend pourquoi ce futur jeune artiste à l'imagination fertile s'est réfugié depuis son jeune âge dans le rêve et, que l'auteur nous livre son secret.
Je peux dire que ma première incursion dans l'univers strindbergien (aussi difficile d'écrire qu'à prononcer) m'a séduite et m'a donné envie d'aller plus loin, notamment de découvrir une autre de ses oeuvres, Inferno, un récit autobiographique.
Le seul petit bémol mais Strindberg n'y est pour rien c'est que je ne suis pas musicienne et que certains passages sont emprunts d'une technicité qui m'a un peu dépassé.
Pour les lecteurs non avertis dont je fais partie, la postface d'Elena Balzamo, qui est aussi l'auteur d'une biographie August Strindberg : visages et destin, donne tous les éclairages nécessaires pour comprendre Le sacristain romantique de Ranö et l'univers si particulier de Strindberg. auteur, dramaturge, peintre et journaliste à la vie tumultueuse et tourmentée.
Une oeuvre à rapprocher de Niels Lyhne (Entre la vie et le rêve) publiée en 1880 du poète et botaniste danois Jens Peter Jacobsen (1847-1885) qui nous emportait aussi dans une balade romantique en suivant le parcours chaotique d'un jeune homme qui lui était issu d'une famille aisée. Mais la ressemblance s'arrête là.
Une lecture émouvante et troublante entre rêve et réalité.
Mais qui est le magicien? L'auteur, August Strindberg ou son héros Alrik Lundsted...
Lundsted serait-t-il le reflet déformé de Strindberg ?
Je vous laisse le soin de supputer sur cette performance en allant mettre le nez dans son oeuvre....
Couple et confinement ne font pas toujours bon ménage…nous l'allons montrer tout à l'heure...
Drôlerie macabre.
« Nous souffrons et nous faisons souffrir les autres. Nous n'en savons pas davantage. » faisait dire Herman Bang à l'un des personnages de son roman Mikaël.
Cette citation de l'auteur danois, qui a mis en scène certaines pièces d'August Strindberg pourrait résumer le jeu sordide et absurde que se font subir Alice et son époux, le capitaine Edgar, dans cette comédie diabolique.
« On ne devrait jamais désapprendre le rire… » L'auteur et peintre suédois a traversé plusieurs périodes artistiques, passant du réalisme au symbolisme et a même écrit un essai en français.
Avec « La danse de mort » (« Dödsdansen » : titre original), le dramaturge scandinave semble pencher vers l'irréel, l'impression d'être dans un monde incertain, isolé de tout, une île vaguement danoise, un purgatoire insulaire que vient perturber Kurt, le passif témoin des monstruosités de ces époux confinés, aigris par la médiocrité de leur existence facultative, qui ne cessent de s'agonir d'injures (on voudrait d'ailleurs pouvoir remonter le temps et assister à la pièce montée à Broadway avec Helen Mirren et Ian Mckellen).
« Voici comment j'ai compris l'art de la vie : éliminer… autrement dit : effacer et continuer. Je me suis, de bonne heure, fait un sac où je mettais les humiliations. Et quand il était plein, je le jetais à la mer. » Maudits par le destin ou le hasard (cette pièce prenant des allures prémonitoires de « Fin de Partie » de Beckett), Alice et Edgar sont condamnés à rester ensemble dans cette valse funèbre de « l'entrée des Boyards », où le dernier souffle, le souffle de mort, toujours prochain reste en perpétuel sursis ; « satisfait ? le jour où je pourrai mourir, je serai satisfait. »
« Je sais être seul… ». Peut-être inspiré des propres déboires sentimentaux de l'auteur, trois fois divorcé, ce couple vit un « inferno » et ne parvient pourtant pas à se départir de son amour : un « mythe de Sisyphe » marital.
Tack så mycket August !
Qu'en pensez-vous ?
Drôlerie macabre.
« Nous souffrons et nous faisons souffrir les autres. Nous n'en savons pas davantage. » faisait dire Herman Bang à l'un des personnages de son roman Mikaël.
Cette citation de l'auteur danois, qui a mis en scène certaines pièces d'August Strindberg pourrait résumer le jeu sordide et absurde que se font subir Alice et son époux, le capitaine Edgar, dans cette comédie diabolique.
« On ne devrait jamais désapprendre le rire… » L'auteur et peintre suédois a traversé plusieurs périodes artistiques, passant du réalisme au symbolisme et a même écrit un essai en français.
Avec « La danse de mort » (« Dödsdansen » : titre original), le dramaturge scandinave semble pencher vers l'irréel, l'impression d'être dans un monde incertain, isolé de tout, une île vaguement danoise, un purgatoire insulaire que vient perturber Kurt, le passif témoin des monstruosités de ces époux confinés, aigris par la médiocrité de leur existence facultative, qui ne cessent de s'agonir d'injures (on voudrait d'ailleurs pouvoir remonter le temps et assister à la pièce montée à Broadway avec Helen Mirren et Ian Mckellen).
« Voici comment j'ai compris l'art de la vie : éliminer… autrement dit : effacer et continuer. Je me suis, de bonne heure, fait un sac où je mettais les humiliations. Et quand il était plein, je le jetais à la mer. » Maudits par le destin ou le hasard (cette pièce prenant des allures prémonitoires de « Fin de Partie » de Beckett), Alice et Edgar sont condamnés à rester ensemble dans cette valse funèbre de « l'entrée des Boyards », où le dernier souffle, le souffle de mort, toujours prochain reste en perpétuel sursis ; « satisfait ? le jour où je pourrai mourir, je serai satisfait. »
« Je sais être seul… ». Peut-être inspiré des propres déboires sentimentaux de l'auteur, trois fois divorcé, ce couple vit un « inferno » et ne parvient pourtant pas à se départir de son amour : un « mythe de Sisyphe » marital.
Tack så mycket August !
Qu'en pensez-vous ?
La Sonate Des Spectres est une pièce expressionniste par excellence. Les traits y sont grossis, mais pas dans un but caricatural. Les symboles y sont nombreux. Nous ne sommes pas dans la réalité, pas dans la science-fiction, mais dans un monde à part, entre les deux, à la frontière, un monde allégorique, presque dans les vapeurs de l’absinthe et les visions qu'elle entraîne.
L'argument de la pièce pourrait se résumer comme suit : nous sommes tous des fantômes, l'ombre de nous-mêmes, vidés de notre substance réelle par les contraintes sociales. Car nous sommes tous faux, nous cultivons tous une image qui n'est pas la nôtre véritable, et cela, tout le monde le sait. Donc, nul ne peut démasquer la fausseté de l'autre sous peine de se voir mis au jour lui aussi, dans toute sa hideur et dans tous ses mensonges.
Ainsi tenus en respect les uns par les autres, nous jouons tous un peu une petite musique consensuelle, le bruit de fond insipide dont nous nous satisfaisons au lieu de jouer la musique vraie de nos âmes, celle qui nous caractériserait.
Qui se cache derrière cette perruque ? ce corset ? ce titre de noblesse ? cette fonction subalterne ? ce visage ridé ? Nous supporterions-nous les uns les autres si nous nous présentions tels que nous sommes vraiment ? si nous ne parlions que le langage de la vérité ?
August Strindberg crée une ambiance très spéciale, où l'on voit de l'extérieur l'intérieur, voire, l'intériorité des gens. Si je dois prendre une image, j'aurais tendance à évoquer certains tableaux de Hopper où l'on est un spectateur indiscret chez les autres et, bien que Strindberg décrive précisément les décors, j'ai eu le sentiment que ce type d'ambiance serait extraordinairement bien rendu avec un décor minimaliste à la Dogville, le film de Lars von Trier, où l'œil — cet horrible, ce pernicieux — passe au travers de toutes les cloisons.
La pièce, qui compte trois actes, s'ouvre sur la rencontre entre un étudiant qui vient de risquer sa vie pour porter secours aux habitants d'une maison effondrée avec un vieux monsieur en fauteuil roulant. Le vieux semble tout connaître des gens et des lieux alentour, et ne tarde pas, à la façon qu'a l'étudiant de parler, à mettre un nom sur sa tête en prétextant qu'il a très bien connu son père.
De fil en aiguille, le vieux se propose d'être le protecteur, le bienfaiteur de cet étudiant sans le sou et de l'introduire dans la maison d'un colonel noble, dont la simple vue de la fille charmante a séduit le jeune homme. Lui, qui dans ses rêves les plus fous n'osait pas pouvoir ne serait-ce qu'adresser la parole à cette créature divine, aura donc la possibilité d'être introduit dans ce monde. Et que va-t-il y trouver dans ce monde ? C'est ce que je vous laisse le soin de découvrir par vous même.
Une pièce assez atypique, pas pour du Strindberg j'entends, mais par rapport au théâtre de cette époque. Une pièce et un auteur qui marquent indubitablement une évolution de cet art et un pas de plus franchi vers la modernité. Personnellement, ce n'est pas ce que j'aime le mieux dans le théâtre mais j'ai été suffisamment dérangée, mise un peu mal à l'aise pour croire qu'elle a de l'intérêt. En outre, ce que j'exprime ici n'est que la musique de mon avis spectral, c'est-à-dire, pas grand-chose.
L'argument de la pièce pourrait se résumer comme suit : nous sommes tous des fantômes, l'ombre de nous-mêmes, vidés de notre substance réelle par les contraintes sociales. Car nous sommes tous faux, nous cultivons tous une image qui n'est pas la nôtre véritable, et cela, tout le monde le sait. Donc, nul ne peut démasquer la fausseté de l'autre sous peine de se voir mis au jour lui aussi, dans toute sa hideur et dans tous ses mensonges.
Ainsi tenus en respect les uns par les autres, nous jouons tous un peu une petite musique consensuelle, le bruit de fond insipide dont nous nous satisfaisons au lieu de jouer la musique vraie de nos âmes, celle qui nous caractériserait.
Qui se cache derrière cette perruque ? ce corset ? ce titre de noblesse ? cette fonction subalterne ? ce visage ridé ? Nous supporterions-nous les uns les autres si nous nous présentions tels que nous sommes vraiment ? si nous ne parlions que le langage de la vérité ?
August Strindberg crée une ambiance très spéciale, où l'on voit de l'extérieur l'intérieur, voire, l'intériorité des gens. Si je dois prendre une image, j'aurais tendance à évoquer certains tableaux de Hopper où l'on est un spectateur indiscret chez les autres et, bien que Strindberg décrive précisément les décors, j'ai eu le sentiment que ce type d'ambiance serait extraordinairement bien rendu avec un décor minimaliste à la Dogville, le film de Lars von Trier, où l'œil — cet horrible, ce pernicieux — passe au travers de toutes les cloisons.
La pièce, qui compte trois actes, s'ouvre sur la rencontre entre un étudiant qui vient de risquer sa vie pour porter secours aux habitants d'une maison effondrée avec un vieux monsieur en fauteuil roulant. Le vieux semble tout connaître des gens et des lieux alentour, et ne tarde pas, à la façon qu'a l'étudiant de parler, à mettre un nom sur sa tête en prétextant qu'il a très bien connu son père.
De fil en aiguille, le vieux se propose d'être le protecteur, le bienfaiteur de cet étudiant sans le sou et de l'introduire dans la maison d'un colonel noble, dont la simple vue de la fille charmante a séduit le jeune homme. Lui, qui dans ses rêves les plus fous n'osait pas pouvoir ne serait-ce qu'adresser la parole à cette créature divine, aura donc la possibilité d'être introduit dans ce monde. Et que va-t-il y trouver dans ce monde ? C'est ce que je vous laisse le soin de découvrir par vous même.
Une pièce assez atypique, pas pour du Strindberg j'entends, mais par rapport au théâtre de cette époque. Une pièce et un auteur qui marquent indubitablement une évolution de cet art et un pas de plus franchi vers la modernité. Personnellement, ce n'est pas ce que j'aime le mieux dans le théâtre mais j'ai été suffisamment dérangée, mise un peu mal à l'aise pour croire qu'elle a de l'intérêt. En outre, ce que j'exprime ici n'est que la musique de mon avis spectral, c'est-à-dire, pas grand-chose.
La folie est comme une île qui s'enfonce lentement dans la mer. Elle vous isole et vous noie. Et si Sartre déclarait "L'enfer c'est les autres ", August Strindberg témoigne que son enfer à lui est surtout la peur irraisonnée de l'autre, de tous les autres, même les plus proches, les plus chers. Cette constante méfiance fait d'un homme, pour sa plus grande souffrance, un damné, un maudit, un être voué à une douloureuse solitude.
Inferno est le récit autobiographique de cette "damnation". Entre 1894 et 1896, Strindberg va traverser une profonde crise intérieure. Malgré l'amour, le couple qu'il forme avec sa deuxième épouse, Frida Uhl, est devenu pour lui une véritable prison. Ils sont alors établis à Paris où le dramaturge jouit d'un certain succès. Pourtant, cette reconnaissance qui devrait le combler ne suffit pas à le rendre heureux. Strindberg aspire à un idéal bien plus haut et le couple se déchire sans fin. Une séparation provisoire est alors décidée. Frida repartie en Suède, Strindberg éprouve un immense soulagement. Il va enfin pouvoir se consacrer à l'alchimie, science obscure et mystérieuse pour laquelle il se sent appelé. Totalement seul, dédaignant les quelques amis qui le réclament encore, il travaille à ses expériences.
Pourtant il se sent mal, plus mal que jamais. Persuadé d'être constamment surveillé, il perd le sommeil. La nuit, des courants électriques lui traversent le corps, le laissant exsangue. Des puissances occultes voudraient le châtier et des gens qu'il n'arrive pas à nommer souhaitent sa mort. Tout lui devient symbole et signe funeste. Il s'essaye même à la magie noire. Strindberg est en train de perdre la raison.
C'est une perte qui vient logiquement s'ajouter à toutes les autres. Car Strindberg a déjà perdu sa femme, sa fille, son désir d'écrire et sa foi. Cela est plus que suffisant pour ébranler l'âme d'un homme. Malheureux, sans cesse tourmenté, il se console en buvant de l'absinthe, ce qui ne fait qu'aggraver ses hallucinations. Se sentant persécuté, il fuit d'un logement à l'autre et même d'un pays à l'autre, en proie à des délires paranoïaques de plus en plus grands. Sa solitude lui est alors comme un poison qui le ronge. "La terre c’est l’enfer, la prison construite avec une intelligence supérieure, de telle sorte que je ne puis faire un pas sans froisser le bonheur des autres, et que les autres ne peuvent rester heureux sans me faire souffrir." Il voudrait retrouver sa fille, conscient que cette enfant lui permet d'exprimer le meilleur de lui-même, mais il se défie de sa belle famille et de sa femme. Cette expérience douloureuse lui inspirera d'ailleurs l'une de ses meilleures pièces, "Père".
Puis, viendra la découverte de l'œuvre de son compatriote, Emanuel Swedenborg, scientifique et théologien dont les écrits feront basculer Strindberg dans le mysticisme et le repentir.
Durant cette période difficile pendant laquelle il faillit plusieurs fois être interné, August Strindberg tenait un journal. Inferno en serait, selon ses dires, une "reproduction". Il a choisi de l'écrire en français et bien qu'il ne possède pas parfaitement cette langue d'adoption, l'écriture est précise, fluide et le récit s'organise avec méthode, attestant probablement d'un travail de réécriture. Malgré toutes ces qualités, la lecture fut éprouvante parce que dérangeante. Plus le récit progresse vers un état de folie, plus les pauses deviennent nécessaires et j'ai dû souvent reprendre mon souffle pour venir à bout de ce récit oppressant. Car Strindberg ne nous épargne pas et livre un vrai témoignage de ces années de souffrance psychique. On devine bien dans quel enfer il est descendu, dans quelle solitude il s'est enfoncé, poussé toujours plus loin par ses angoisses et ses peurs qui ont fini par le couper du monde.
Mais parallèlement au malaise, j'ai ressenti une profonde compassion pour cet homme qui se croit menacé de toutes parts et dont le pire ennemi n'est autre que lui-même. Durant ces années, Strindberg se détruit et fait le vide autour de lui. Ceux qui l'aiment encore n'ont d'autre choix que de le quitter, tant il leur fait du mal, sans toujours le vouloir. Et la conscience aiguë qu'il a de ce gâchis lui cause un chagrin profond. Il sait tout ce qu'il manque. Mais il est comme "à côté" des autres et les démons dont il sent sans cesse la présence autour de lui ne sont peut-être, au fond, que les tourments de sa culpabilité.
Alors, bien sûr, il y a quelques considérations misogynes et aigrelettes qui parsèment le texte deci delà, fortifiant sa légende et faisant de lui un personnage parfois très irritant. Strindberg avait, semble-t-il, un don pour ne laisser personne indifférent, suscitant l'engouement ou le rejet. Mais lire Inferno nous le rend plus proche, presque plus "humain". C'est une vraie confession, que je pense sincère, et dont certains passages m'ont bouleversée car plus encore que la folie, l'enfer est peut-être la peur de devenir fou, la pleine conscience de ce lent enlisement.
Inferno est le récit autobiographique de cette "damnation". Entre 1894 et 1896, Strindberg va traverser une profonde crise intérieure. Malgré l'amour, le couple qu'il forme avec sa deuxième épouse, Frida Uhl, est devenu pour lui une véritable prison. Ils sont alors établis à Paris où le dramaturge jouit d'un certain succès. Pourtant, cette reconnaissance qui devrait le combler ne suffit pas à le rendre heureux. Strindberg aspire à un idéal bien plus haut et le couple se déchire sans fin. Une séparation provisoire est alors décidée. Frida repartie en Suède, Strindberg éprouve un immense soulagement. Il va enfin pouvoir se consacrer à l'alchimie, science obscure et mystérieuse pour laquelle il se sent appelé. Totalement seul, dédaignant les quelques amis qui le réclament encore, il travaille à ses expériences.
Pourtant il se sent mal, plus mal que jamais. Persuadé d'être constamment surveillé, il perd le sommeil. La nuit, des courants électriques lui traversent le corps, le laissant exsangue. Des puissances occultes voudraient le châtier et des gens qu'il n'arrive pas à nommer souhaitent sa mort. Tout lui devient symbole et signe funeste. Il s'essaye même à la magie noire. Strindberg est en train de perdre la raison.
C'est une perte qui vient logiquement s'ajouter à toutes les autres. Car Strindberg a déjà perdu sa femme, sa fille, son désir d'écrire et sa foi. Cela est plus que suffisant pour ébranler l'âme d'un homme. Malheureux, sans cesse tourmenté, il se console en buvant de l'absinthe, ce qui ne fait qu'aggraver ses hallucinations. Se sentant persécuté, il fuit d'un logement à l'autre et même d'un pays à l'autre, en proie à des délires paranoïaques de plus en plus grands. Sa solitude lui est alors comme un poison qui le ronge. "La terre c’est l’enfer, la prison construite avec une intelligence supérieure, de telle sorte que je ne puis faire un pas sans froisser le bonheur des autres, et que les autres ne peuvent rester heureux sans me faire souffrir." Il voudrait retrouver sa fille, conscient que cette enfant lui permet d'exprimer le meilleur de lui-même, mais il se défie de sa belle famille et de sa femme. Cette expérience douloureuse lui inspirera d'ailleurs l'une de ses meilleures pièces, "Père".
Puis, viendra la découverte de l'œuvre de son compatriote, Emanuel Swedenborg, scientifique et théologien dont les écrits feront basculer Strindberg dans le mysticisme et le repentir.
Durant cette période difficile pendant laquelle il faillit plusieurs fois être interné, August Strindberg tenait un journal. Inferno en serait, selon ses dires, une "reproduction". Il a choisi de l'écrire en français et bien qu'il ne possède pas parfaitement cette langue d'adoption, l'écriture est précise, fluide et le récit s'organise avec méthode, attestant probablement d'un travail de réécriture. Malgré toutes ces qualités, la lecture fut éprouvante parce que dérangeante. Plus le récit progresse vers un état de folie, plus les pauses deviennent nécessaires et j'ai dû souvent reprendre mon souffle pour venir à bout de ce récit oppressant. Car Strindberg ne nous épargne pas et livre un vrai témoignage de ces années de souffrance psychique. On devine bien dans quel enfer il est descendu, dans quelle solitude il s'est enfoncé, poussé toujours plus loin par ses angoisses et ses peurs qui ont fini par le couper du monde.
Mais parallèlement au malaise, j'ai ressenti une profonde compassion pour cet homme qui se croit menacé de toutes parts et dont le pire ennemi n'est autre que lui-même. Durant ces années, Strindberg se détruit et fait le vide autour de lui. Ceux qui l'aiment encore n'ont d'autre choix que de le quitter, tant il leur fait du mal, sans toujours le vouloir. Et la conscience aiguë qu'il a de ce gâchis lui cause un chagrin profond. Il sait tout ce qu'il manque. Mais il est comme "à côté" des autres et les démons dont il sent sans cesse la présence autour de lui ne sont peut-être, au fond, que les tourments de sa culpabilité.
Alors, bien sûr, il y a quelques considérations misogynes et aigrelettes qui parsèment le texte deci delà, fortifiant sa légende et faisant de lui un personnage parfois très irritant. Strindberg avait, semble-t-il, un don pour ne laisser personne indifférent, suscitant l'engouement ou le rejet. Mais lire Inferno nous le rend plus proche, presque plus "humain". C'est une vraie confession, que je pense sincère, et dont certains passages m'ont bouleversée car plus encore que la folie, l'enfer est peut-être la peur de devenir fou, la pleine conscience de ce lent enlisement.
Après avoir hésité plusieurs fois à lire cette pièce qui semblait éloignée de ce à quoi nous avait habitués Strindberg, je me suis enfin lancée. Et je le dis tout de go : impossible pour moi de résumer même succinctement l'intrigue ; comme le dit un personnage de la pièce, "c'est un peu compliqué", et comme lui répond du tac au tac un autre, "c'est terriblement compliqué". C'est plein de personnages soit morts, soit bizarres d'une façon ou d'une autre. Au centre se trouve une maison typique du bonheur bourgeois, mais emplie de secrets et où quelqu'un vient de mourir. Un vieillard semble tramer une vengeance, tout au moins un plan en rapport avec les habitants de cette maison, tandis qu'un étudiant qui voit des apparitions, des fantômes, des revenants, des morts quoi, se trouve impliqué bien malgré lui dans les projets du vieillard.
Ce n'est pas tant ce qu'on découvre sur les habitants de la maison et d'autres leur étant liés qui provoque de l'étonnement - ils ont tous commis quelques turpitudes, d'autres plus que d'autres et plus infâmantes, comme des meurtres et ce genre de choses. C'est plutôt cette ronde de personnages qui intrigue, tellement ils paraissent pour la plupart interchangeables, chacun ou presque se dédoublant, parfois dans plusieurs autres personnages. Ainsi, La Cuisinière qui apparaît dans l'acte II commet les mêmes actions - affamer ses maîtres de diverses manières - qu'on avait mis sur le compte du Vieux plus tôt dans la pièce ; et c'est loin d'être le seul exemple. Ainsi également, un personnage qui était un maître de maison est devenu un domestique, et un autre dans le même temps est passé de domestique à maître. Tous se mentent, chacun se fait passer pour ce qu'il n'est pas, et le personnage qui incarne le mieux ce principe, visuellement et physiquement, c'est celui appelé La Momie - en fait l'épouse du maître de maison (si tant est qu'on sache qui est le maître de maison), dont la beauté et la jeunesse ont été figée bien des années plus tôt dans une statue qui ne lui ressemble plus en rien, au point que chacun est effaré de son apparence réelle.
Revient également un autre leitmotiv : celui de la confrontation des classes sociales. Vous aviez sans doute compris que dans ce jeu de chaises musicales pointait le bout de son nez une critique sociale qu'on avait déjà vu à l'oeuvre, au hasard, dans Mademoiselle Julie. Mais ici c'est traité de façon différente, d'une part à cause du style de la Sonate des spectres, d'autre part parce que, même s'il est fait quelques allusions, voire plus, à des mariages, des fiançailles et de relations amoureuses ratées, c'est peu de chose par rapport à la question des classes sociales. Ce n'est pas pour rien que La Cuisinière qu'on voit apparaître à la fin de l'acte II, alors que restent les deux derniers "maîtres de maison", leur dit : "Vous nous prenez tout notre suc et nous vous prenons le vôtre; nous suçons votre sang et vous recevez en échange de l'eau, avec du colorant."
Au milieu de cette corruption dont il est abondamment débattu et qui semble toucher tout le monde, restent deux personnages qui sont... comment les appeler... des âmes pures. L'Étudiant et La Jeune Fille trouvent l'amour et le réconfort l'un auprès de l'autre. Vous avouerez que ce n'est pas souvent chez Strindberg... Oui, mais La Jeune Fille a vécu trop longtemps dans cette maison corrompue, elle n'est pas de force à supporter tout ça. Elle est donc malade dès le début de la pièce et... elle meurt, allez hop ! Reste l'Étudiant, celui qui a le don de voir au-delà des apparences.
Pièce à la fois imprégnée de symbolisme et d'expressionnisme, on pourrait lui trouver une parenté avec certaines oeuvres de Munch et Ensor, notamment. Je pense par exemple à Soirée sur l'avenue Karl Johan de Munch, avec son défilé de passants qui ressemblent à des spectres, et vous n'aurez pas de mal à trouver un tableau d'Ensor qui convienne. Cela dit, La Sonate des spectres part un peu dans tous les sens, que ce soit complètement voulu ou pas (répétons-le, "c'est terriblement compliqué"), avec tous ses personnages grotesques - pourtant au sens noble du terme. Une seconde lecture permettrait peut-être de mieux cerner sa composition, pas évidente à déceler d'un seul coup d'œil. Pour ma part, j'ai pas plus envie que ça de la relire...
Lien : https://musardises-en-depit-..
Ce n'est pas tant ce qu'on découvre sur les habitants de la maison et d'autres leur étant liés qui provoque de l'étonnement - ils ont tous commis quelques turpitudes, d'autres plus que d'autres et plus infâmantes, comme des meurtres et ce genre de choses. C'est plutôt cette ronde de personnages qui intrigue, tellement ils paraissent pour la plupart interchangeables, chacun ou presque se dédoublant, parfois dans plusieurs autres personnages. Ainsi, La Cuisinière qui apparaît dans l'acte II commet les mêmes actions - affamer ses maîtres de diverses manières - qu'on avait mis sur le compte du Vieux plus tôt dans la pièce ; et c'est loin d'être le seul exemple. Ainsi également, un personnage qui était un maître de maison est devenu un domestique, et un autre dans le même temps est passé de domestique à maître. Tous se mentent, chacun se fait passer pour ce qu'il n'est pas, et le personnage qui incarne le mieux ce principe, visuellement et physiquement, c'est celui appelé La Momie - en fait l'épouse du maître de maison (si tant est qu'on sache qui est le maître de maison), dont la beauté et la jeunesse ont été figée bien des années plus tôt dans une statue qui ne lui ressemble plus en rien, au point que chacun est effaré de son apparence réelle.
Revient également un autre leitmotiv : celui de la confrontation des classes sociales. Vous aviez sans doute compris que dans ce jeu de chaises musicales pointait le bout de son nez une critique sociale qu'on avait déjà vu à l'oeuvre, au hasard, dans Mademoiselle Julie. Mais ici c'est traité de façon différente, d'une part à cause du style de la Sonate des spectres, d'autre part parce que, même s'il est fait quelques allusions, voire plus, à des mariages, des fiançailles et de relations amoureuses ratées, c'est peu de chose par rapport à la question des classes sociales. Ce n'est pas pour rien que La Cuisinière qu'on voit apparaître à la fin de l'acte II, alors que restent les deux derniers "maîtres de maison", leur dit : "Vous nous prenez tout notre suc et nous vous prenons le vôtre; nous suçons votre sang et vous recevez en échange de l'eau, avec du colorant."
Au milieu de cette corruption dont il est abondamment débattu et qui semble toucher tout le monde, restent deux personnages qui sont... comment les appeler... des âmes pures. L'Étudiant et La Jeune Fille trouvent l'amour et le réconfort l'un auprès de l'autre. Vous avouerez que ce n'est pas souvent chez Strindberg... Oui, mais La Jeune Fille a vécu trop longtemps dans cette maison corrompue, elle n'est pas de force à supporter tout ça. Elle est donc malade dès le début de la pièce et... elle meurt, allez hop ! Reste l'Étudiant, celui qui a le don de voir au-delà des apparences.
Pièce à la fois imprégnée de symbolisme et d'expressionnisme, on pourrait lui trouver une parenté avec certaines oeuvres de Munch et Ensor, notamment. Je pense par exemple à Soirée sur l'avenue Karl Johan de Munch, avec son défilé de passants qui ressemblent à des spectres, et vous n'aurez pas de mal à trouver un tableau d'Ensor qui convienne. Cela dit, La Sonate des spectres part un peu dans tous les sens, que ce soit complètement voulu ou pas (répétons-le, "c'est terriblement compliqué"), avec tous ses personnages grotesques - pourtant au sens noble du terme. Une seconde lecture permettrait peut-être de mieux cerner sa composition, pas évidente à déceler d'un seul coup d'œil. Pour ma part, j'ai pas plus envie que ça de la relire...
Lien : https://musardises-en-depit-..
Scandaleuse, mademoiselle Julie, qui danse avec les domestiques en cette soirée de Saint Jean, au lieu de rester avec son père, le Comte ?
Sa présence déroute le 'peuple', dérange la bienséance. Sont-ils obligés de la tolérer parmi eux, eu égard à sa condition ?
« Ne prenez pas ça comme un ordre ! Aujourd'hui c'est la fête et nous sommes tous égaux, sans distinction de rangs ! »
Devient-elle l'une des leurs ? Quid du respect qu'ils estiment devoir à leurs maîtres (pour se respecter eux-mêmes) ?
Est-ce la question du désir, qui est au centre de la pièce ? Fugace, alors - le petit coup d'un soir. Jeu de séduction pour elle, faire fi des conventions. S'amuser, et s'accrocher sans pudeur lorsqu'il s'avère que le domestique, prétendument amoureux, se dérobe une fois 'la chose' faite et montre froidement ses intentions.
La pièce a choqué à sa sortie, à la fin du XIXe siècle.
Il semble exagéré de la trouver 'crue' et féministe, aujourd'hui.
L'auteur nous parle d'émancipation féminine, certes, mais limitée.
J'y ai surtout perçu des enjeux de pouvoir, de domination - homme/femme, maître/serviteur, dominant/dominé - avec un mouvement d'alternance perpétuel. Et la volonté de s'extraire d'une condition sociale déterminée à la naissance.
Légère déception, je m'attendais à un texte plus universel, à la fois plus 'flamboyant' et plus subtil, après avoir entendu l'envoûtante Anna Mouglalis* en parler.
___
* Elle joue actuellement la pièce au théâtre de l'Atelier, à Paris (jusqu'au 3 novembre).
Sa présence déroute le 'peuple', dérange la bienséance. Sont-ils obligés de la tolérer parmi eux, eu égard à sa condition ?
« Ne prenez pas ça comme un ordre ! Aujourd'hui c'est la fête et nous sommes tous égaux, sans distinction de rangs ! »
Devient-elle l'une des leurs ? Quid du respect qu'ils estiment devoir à leurs maîtres (pour se respecter eux-mêmes) ?
Est-ce la question du désir, qui est au centre de la pièce ? Fugace, alors - le petit coup d'un soir. Jeu de séduction pour elle, faire fi des conventions. S'amuser, et s'accrocher sans pudeur lorsqu'il s'avère que le domestique, prétendument amoureux, se dérobe une fois 'la chose' faite et montre froidement ses intentions.
La pièce a choqué à sa sortie, à la fin du XIXe siècle.
Il semble exagéré de la trouver 'crue' et féministe, aujourd'hui.
L'auteur nous parle d'émancipation féminine, certes, mais limitée.
J'y ai surtout perçu des enjeux de pouvoir, de domination - homme/femme, maître/serviteur, dominant/dominé - avec un mouvement d'alternance perpétuel. Et la volonté de s'extraire d'une condition sociale déterminée à la naissance.
Légère déception, je m'attendais à un texte plus universel, à la fois plus 'flamboyant' et plus subtil, après avoir entendu l'envoûtante Anna Mouglalis* en parler.
___
* Elle joue actuellement la pièce au théâtre de l'Atelier, à Paris (jusqu'au 3 novembre).
Le Pélican est l'histoire d'une famille déchirée arrivée à un point de non-retour. Le père est mort récemment, et tout de suite, on ressent que rien ne va dans cette famille où la seule domestique, dès le tout début, reproche à la mère de s'être montrée maltraitante envers ses enfants et ses employés.
Le père est mort récemment, il semble que la famille soit quasiment ruinée, le fils va être obligé de trouver une chambre à louer parce que la fille et son mari reviennent tout juste de leur voyage de noces écourté pour s'installer dans la maison. Une maison où il fait froid et où la présence du père est palpable de façon continue, comme un fantôme : ainsi, son fauteuil à bascule ne cesse de se balancer, terrifiant la mère. Une mère qui prétend avoir nourri ses enfants de son sang, d'où la métaphore du pélican. Sauf qu'elle les affamés au lieu de les nourrir, qu'elle ne les obligeait à vivre dans un froid continuel, qu'elle a trompé son mari et refilé son jeune amant à sa fille tout en continuant à coucher avec lui, et qu'elle n'a cessé de voler l'argent de la famille, trompant tout le monde. Le véritable pélican, ce n'est donc pas elle.
Toute cette famille a vécu dans un mensonge continuel, étouffée par une femme qui a mené son mari indirectement à la mort. C'est là une charge terrible contre une forme d'illusion : celle du bonheur familial, du doux foyer, de la mère aimante, des liens du sang plus fort que tout. Une illusion qu'a portée le XIXème siècle avec son modèle bourgeois qui n'est qu'apparences et tromperies. L'image des somnambules, qui revient sans cesse, est là pour mettre le doigt sur l'incapacité de la société à regarder les choses en face et à s'émanciper.
La pièce va vite et fort, jusqu'à se refermer sur des personnages qui n'ont plus d'issue. Parce que la mère ne peut se sortir de son rôle, comme les enfants sont incapables de lui échapper, tout en ayant enfin compris qui elle était. Les répliques, en revanche, courtes au début deviennent plus longues au fil des trois actes, et particulièrement dans le troisième et dernier. Les personnages développent alors, en lien avec le style des dialogues tendant un peu à l'emphase, comportement de plus en plus excessif, tout comme le père, dans le passé, avait montré un comportement délirant où il avait hurlé dans la nuit. Cet excès, qui n'est pas nouveau chez Strinberg, est probablement nécessaire pour en arriver à la fin terrible de la pièce. Ce côté excessif de Strindberg n'est pas ce que je préfère chez lui, encore qu'ici ça n'atteigne pas un degré qui m'insupporterait.
Le sujet est très fort, forcément très sombre (enfin bon, on est chez Strindberg, faut pas s'attendre à nager dans un océan de roses à l'odeur enivrante), le traitement efficace malgré mon petit bémol sur le style - question de goût, pour le coup. Dans le même genre de sujet, j'ai préféré Amour maternel, pièce plus ancienne, plus sobre et plus courte au Pélican, pièce de 1907 - une des dernières de Strindberg. Mais si on a envie de s'attaquer au sujet de la famille, avec ce qu'elle peut avoir de malsain, ainsi qu'à la dénonciation de la société corsetée du tournant de la fin du XIXème et du début du XXème, c'est à lire.
On notera que Strindberg a dit avoir beaucoup souffert à cause de cette pièce qu'il a songé à détruire, de l'écriture aux représentations, sans pour autant regretter de l'avoir écrite. Ce qui laisse penser que son implication dans Le Pélican fut énorme, peut-être encore plus que d'habitude. Déjà que, hein...
Le père est mort récemment, il semble que la famille soit quasiment ruinée, le fils va être obligé de trouver une chambre à louer parce que la fille et son mari reviennent tout juste de leur voyage de noces écourté pour s'installer dans la maison. Une maison où il fait froid et où la présence du père est palpable de façon continue, comme un fantôme : ainsi, son fauteuil à bascule ne cesse de se balancer, terrifiant la mère. Une mère qui prétend avoir nourri ses enfants de son sang, d'où la métaphore du pélican. Sauf qu'elle les affamés au lieu de les nourrir, qu'elle ne les obligeait à vivre dans un froid continuel, qu'elle a trompé son mari et refilé son jeune amant à sa fille tout en continuant à coucher avec lui, et qu'elle n'a cessé de voler l'argent de la famille, trompant tout le monde. Le véritable pélican, ce n'est donc pas elle.
Toute cette famille a vécu dans un mensonge continuel, étouffée par une femme qui a mené son mari indirectement à la mort. C'est là une charge terrible contre une forme d'illusion : celle du bonheur familial, du doux foyer, de la mère aimante, des liens du sang plus fort que tout. Une illusion qu'a portée le XIXème siècle avec son modèle bourgeois qui n'est qu'apparences et tromperies. L'image des somnambules, qui revient sans cesse, est là pour mettre le doigt sur l'incapacité de la société à regarder les choses en face et à s'émanciper.
La pièce va vite et fort, jusqu'à se refermer sur des personnages qui n'ont plus d'issue. Parce que la mère ne peut se sortir de son rôle, comme les enfants sont incapables de lui échapper, tout en ayant enfin compris qui elle était. Les répliques, en revanche, courtes au début deviennent plus longues au fil des trois actes, et particulièrement dans le troisième et dernier. Les personnages développent alors, en lien avec le style des dialogues tendant un peu à l'emphase, comportement de plus en plus excessif, tout comme le père, dans le passé, avait montré un comportement délirant où il avait hurlé dans la nuit. Cet excès, qui n'est pas nouveau chez Strinberg, est probablement nécessaire pour en arriver à la fin terrible de la pièce. Ce côté excessif de Strindberg n'est pas ce que je préfère chez lui, encore qu'ici ça n'atteigne pas un degré qui m'insupporterait.
Le sujet est très fort, forcément très sombre (enfin bon, on est chez Strindberg, faut pas s'attendre à nager dans un océan de roses à l'odeur enivrante), le traitement efficace malgré mon petit bémol sur le style - question de goût, pour le coup. Dans le même genre de sujet, j'ai préféré Amour maternel, pièce plus ancienne, plus sobre et plus courte au Pélican, pièce de 1907 - une des dernières de Strindberg. Mais si on a envie de s'attaquer au sujet de la famille, avec ce qu'elle peut avoir de malsain, ainsi qu'à la dénonciation de la société corsetée du tournant de la fin du XIXème et du début du XXème, c'est à lire.
On notera que Strindberg a dit avoir beaucoup souffert à cause de cette pièce qu'il a songé à détruire, de l'écriture aux représentations, sans pour autant regretter de l'avoir écrite. Ce qui laisse penser que son implication dans Le Pélican fut énorme, peut-être encore plus que d'habitude. Déjà que, hein...
Il devient pour moi de plus en plus difficile de parler des pièces de Strindberg. Je commence à en avoir quelques-unes à mon actif, même si j'ai encore du boulot pour en voir le bout (environ soixante pièces), et je deviens de plus en plus perplexe. J'ai comme l'impression que ses problèmes relationnels avec les femmes (qu'il s'agisse de ses épouses, de sa mère, de sa belle-mère, etc.) l'ont, soit amené à analyser les déchirements du couple et les rapports de domination entre hommes et femmes (qui est son grand sujet, sinon l'unique), mais aussi entre parents et enfants, ainsi que la question des conventions sociales, avec une véritable acuité ; et que paradoxalement, par moments, ces mêmes problèmes relationnels avec les femmes l'amènent à s'égarer plus ou moins. Dans Le Lien, il me semble que c'est le plus qui l'emporte sur le moins.
Car qu'est-ce qu'on a finalement, à part une pièce misogyne à l'extrême ? On ne peut certes pas réduire le Lien à une explosion de misogynie, mais ladite explosion est tellement présente qu'elle rend la pièce difficilement lisible dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que la lecture est d'une part rendue pénible par la misogynie qui l'imprègne (et pourtant, on est habitué à la misogynie avec Strindberg, hein), et que d'autre part, elle en devient difficile à interpréter, à analyser, parce que cet épanchement misogyne cache, au moins au premier abord, tout ce qui pourrait être intéressant. Et comme la lecture en est pénible, on n'a guère envie d'y revenir et de se fatiguer à essayer de comprendre le message de Strindberg, qu'il porte ici de manière assez confuse à mon sens. J'ai donc tenté de dépasser le stade de la lassitude, mais avec peine.
Ce drame est centré sur une procédure judiciaire, qui concerne la séparation entre le baron et la baronne Sprengel. Mais il présente en parallèle une autre affaire, très différente, qui porte sur une plainte pour diffamation de la part d'une domestique à l'encontre de son maître. Même si les deux affaires sont jugées l'une après l'autre (celle pour diffamation d'abord, celle pour séparation ensuite), elles alternent au début de la pièce l'une avec l'autre par le biais de dialogues entre plusieurs personnages, ainsi que par le biais des scènes de jugement. Surtout, elles rendent compte des mêmes phénomènes : les deux femmes sont affreuses, l'une ayant volé et ensuite accusé de diffamation son maître, obtenant de surcroît gain de cause (ce qui le ruine à cause de l'amende à payer), l'autre parce qu'elle a trompé son mari et qu'elle manigance des stratagèmes peu glorieux, voire pire, pour piétiner son mari. Et dans les deux affaires, la justice est impuissante, voire incompétente.
Déjà, cette affaire de vol et de diffamation est de trop, elle est là pour montrer et démontrer et rédémontrer à quel point les femmes sont puissantes, méchantes, cruelles et terribles, quand les hommes sont, eux, leurs victimes, mais aussi les victimes de la société, complètement désarmés face à la sournoiserie féminine. D'ailleurs la pièce débute par un dialogue entre deux hommes qui, après avoir parlé des deux affaires (à l'attention du spectateur), se livrent à des récriminations contre leurs femmes, qui selon eux, en sus d'être des mégères, veulent intervertir les rôles masculins et féminins. Le baron Sprengel ne dira pas autre chose à propos de son épouse pendant le procès. Donc bon, ça va, on a compris, c'est peut-être pas la peine de redire vingt fois la même chose.
Évidemment, étant donné qu'on nous montre essentiellement le couple Sprengel dérapant en plein tribunal, transformant le procès en scène de ménage et règlements de comptes grandiloquents, le Lien traite aussi des relations conflictuelles dans le couple : c'est précisément dans cette pièce que Strindberg parle de la "doublure de la robe" (désolée, je n'ai pas lu le texte original, et de toute façon je dois connaître trois mots de suédois, donc il m'est impossible de témoigner de la fidélité de la traduction), à savoir de la haine comme revers inéluctable de l'amour. Le souci, c'est que ce sujet a tellement été traité par Strindberg dans son théâtre, avant et après Le Lien, qu'on trouve facilement dans son oeuvre d'autres pièces où ce même sujet est traité plus finement et plus efficacement. Et on peut se demander si l'aspect autobiographique de cette pièce - qui fait référence au divorce de Strinberg et de Siri von Essen - ne la rend pas un brin outrancière par manque de recul. Est-ce qu'il n'y pas d'ailleurs paradoxe à dénoncer le manque total de retenue des protagonistes - les deux se lamentant entre deux scènes au tribunal à propos de leur attitude, qu'ils jugent indigne -, dans un drame qui rejoue ce qu'a réellement vécu, au moins symboliquement sinon exactement, l'auteur ?
Bref, on retrouve dans Le Lien les thématiques, pour ne pas dire les obsessions, de Strindberg : rapports de domination dans le couple, amour indissociable de la haine, le père vu comme victime de la société, l'importance du lien paternel, le besoin d'émancipation de la femme à n'importe quel prix, la femme terrifiante, et j'en passe. Comme c'est écrit dans ce que j'appellerai "la manière déplaisante" de Strindberg, avec une montée hystérique du drame, qui, pour ne rien gâcher, est le fait du personnage principal féminin, ce n'est pas une pièce que j'ai envie de recommander ; d'un autre côté, si on veut cerner un chouïa Strindberg, c'est à connaître. Alors, lire Le Lien ou ne pas le lire ? À vous de choisir.
Challenge Théâtre 2020
Car qu'est-ce qu'on a finalement, à part une pièce misogyne à l'extrême ? On ne peut certes pas réduire le Lien à une explosion de misogynie, mais ladite explosion est tellement présente qu'elle rend la pièce difficilement lisible dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que la lecture est d'une part rendue pénible par la misogynie qui l'imprègne (et pourtant, on est habitué à la misogynie avec Strindberg, hein), et que d'autre part, elle en devient difficile à interpréter, à analyser, parce que cet épanchement misogyne cache, au moins au premier abord, tout ce qui pourrait être intéressant. Et comme la lecture en est pénible, on n'a guère envie d'y revenir et de se fatiguer à essayer de comprendre le message de Strindberg, qu'il porte ici de manière assez confuse à mon sens. J'ai donc tenté de dépasser le stade de la lassitude, mais avec peine.
Ce drame est centré sur une procédure judiciaire, qui concerne la séparation entre le baron et la baronne Sprengel. Mais il présente en parallèle une autre affaire, très différente, qui porte sur une plainte pour diffamation de la part d'une domestique à l'encontre de son maître. Même si les deux affaires sont jugées l'une après l'autre (celle pour diffamation d'abord, celle pour séparation ensuite), elles alternent au début de la pièce l'une avec l'autre par le biais de dialogues entre plusieurs personnages, ainsi que par le biais des scènes de jugement. Surtout, elles rendent compte des mêmes phénomènes : les deux femmes sont affreuses, l'une ayant volé et ensuite accusé de diffamation son maître, obtenant de surcroît gain de cause (ce qui le ruine à cause de l'amende à payer), l'autre parce qu'elle a trompé son mari et qu'elle manigance des stratagèmes peu glorieux, voire pire, pour piétiner son mari. Et dans les deux affaires, la justice est impuissante, voire incompétente.
Déjà, cette affaire de vol et de diffamation est de trop, elle est là pour montrer et démontrer et rédémontrer à quel point les femmes sont puissantes, méchantes, cruelles et terribles, quand les hommes sont, eux, leurs victimes, mais aussi les victimes de la société, complètement désarmés face à la sournoiserie féminine. D'ailleurs la pièce débute par un dialogue entre deux hommes qui, après avoir parlé des deux affaires (à l'attention du spectateur), se livrent à des récriminations contre leurs femmes, qui selon eux, en sus d'être des mégères, veulent intervertir les rôles masculins et féminins. Le baron Sprengel ne dira pas autre chose à propos de son épouse pendant le procès. Donc bon, ça va, on a compris, c'est peut-être pas la peine de redire vingt fois la même chose.
Évidemment, étant donné qu'on nous montre essentiellement le couple Sprengel dérapant en plein tribunal, transformant le procès en scène de ménage et règlements de comptes grandiloquents, le Lien traite aussi des relations conflictuelles dans le couple : c'est précisément dans cette pièce que Strindberg parle de la "doublure de la robe" (désolée, je n'ai pas lu le texte original, et de toute façon je dois connaître trois mots de suédois, donc il m'est impossible de témoigner de la fidélité de la traduction), à savoir de la haine comme revers inéluctable de l'amour. Le souci, c'est que ce sujet a tellement été traité par Strindberg dans son théâtre, avant et après Le Lien, qu'on trouve facilement dans son oeuvre d'autres pièces où ce même sujet est traité plus finement et plus efficacement. Et on peut se demander si l'aspect autobiographique de cette pièce - qui fait référence au divorce de Strinberg et de Siri von Essen - ne la rend pas un brin outrancière par manque de recul. Est-ce qu'il n'y pas d'ailleurs paradoxe à dénoncer le manque total de retenue des protagonistes - les deux se lamentant entre deux scènes au tribunal à propos de leur attitude, qu'ils jugent indigne -, dans un drame qui rejoue ce qu'a réellement vécu, au moins symboliquement sinon exactement, l'auteur ?
Bref, on retrouve dans Le Lien les thématiques, pour ne pas dire les obsessions, de Strindberg : rapports de domination dans le couple, amour indissociable de la haine, le père vu comme victime de la société, l'importance du lien paternel, le besoin d'émancipation de la femme à n'importe quel prix, la femme terrifiante, et j'en passe. Comme c'est écrit dans ce que j'appellerai "la manière déplaisante" de Strindberg, avec une montée hystérique du drame, qui, pour ne rien gâcher, est le fait du personnage principal féminin, ce n'est pas une pièce que j'ai envie de recommander ; d'un autre côté, si on veut cerner un chouïa Strindberg, c'est à connaître. Alors, lire Le Lien ou ne pas le lire ? À vous de choisir.
Challenge Théâtre 2020
Après Mademoiselle Julie et Créanciers, j'ai décidé de sauter une bonne dizaine d'années avec Danse de mort, une pièce écrite à la toute fin du dix-neuvième siècle, en 1900. Et Danse de mort va probablement vous rappeler quelque chose...
Un couple, Edgar et Alice, vit marié depuis 25 ans dans la forteresse d'une petite île. Lui est capitaine de la forteresse, sans qu'on sache très bien à quoi il s'occupe la plupart du temps - ses rodomontades permanentes nous empêchent de cerner clairement ses fonctions. Alice fut comédienne, et il semblerait qu'avoir abandonné son métier pour son mari constitue un motif sérieux d'amertume pour elle - mais nous apprendrons que ce n'est pas si évident que ça. Ces deux-là semblent se haïr, se jettent à la tête sans cesse des mots doux, se rendent la vie infernale. L'arrivée de Kurt, le cousin d'Alice, va jeter de l'huile sur le feu et servir à la fois de de révélateur et d'élément cathartique : eh oui, on n'est pas loin d'Edward Albeee quelques bonnes dizaines d'années avant Qui a peur de Virginia Woolf ? (et en effectuant quelques recherches, il m'a été confirmé que Strindberg avait bien été une influence pour Albee. Il faut dire que le contraire eût été étonnant !)
Danse de mort doit sa réussite, son efficacité à deux points essentiels - hormis le sujet et les personnages, bien sûr. D'une part, Strindberg a placé sa pièce sous le triple signe de l'isolement. Je le disais, Edgar et Alice vivent sur une petite île, donc vivant dans une petite communauté. Mais de cette communauté, et de leurs familles respectives, ils se sont exclus, notamment par la faute d'Edgar. Mais pas seulement, car ils affichent tous deux constamment, dans leurs dialogues, leur mépris pour à peu près toutes les personnes dont ils parlent. Et puis, évidemment, ils se sont isolés l'un de l'autre, ils se sont retirés en eux-mêmes, ne cherchant pas ou plus à se connaître, encore moins à échanger - du moins, à échanger sans s'engueuler et s'en mettre plein la tronche. Ajoutez à cela la forteresse (architecturale) dans laquelle ils vivent, et qui n'est finalement qu'une représentation de leur forteresse mentale : Strindberg n'a pas lésiné sur les symboles, sans d'ailleurs que ce soit lourd.
D'autre part, même si je m'y connais peu de ce côté-là, il me semble que Strindberg a travaillé avec l'idée d'un rythme musical propre à la pièce. Bien entendu, le titre, le piano d'Alice et les chansons qui reviennent parfois se prêtent à cette interprétation. Mais on sent surtout - et il faudrait sans doute passer plus de temps à étudier cet aspect des choses pour en donner une véritable analyse - que la pièce suit différents tempos, selon l'enchaînement des scènes. Vers la fin notamment, le rythme s'emballe carrément, pour retomber soudain dans la dernière scène, avec des personnages épuisés. Et je vous laisserai découvrir pourquoi Strindberg a jugé bon d'intituler son drame Danse de mort.
Donc, une bonne surprise pour moi qui n'avait pas beaucoup goûté l'art de Strindberg jusqu'ici. J'ai découvert un auteur plus fin que je ne m'y attendais, qui manie de façon très habile le drame et l'humour - car sous le drame de la vie devenue un enfer, l'humour couve toujours dans Danse de mort.
Challenge Théâtre 2018-2019
Un couple, Edgar et Alice, vit marié depuis 25 ans dans la forteresse d'une petite île. Lui est capitaine de la forteresse, sans qu'on sache très bien à quoi il s'occupe la plupart du temps - ses rodomontades permanentes nous empêchent de cerner clairement ses fonctions. Alice fut comédienne, et il semblerait qu'avoir abandonné son métier pour son mari constitue un motif sérieux d'amertume pour elle - mais nous apprendrons que ce n'est pas si évident que ça. Ces deux-là semblent se haïr, se jettent à la tête sans cesse des mots doux, se rendent la vie infernale. L'arrivée de Kurt, le cousin d'Alice, va jeter de l'huile sur le feu et servir à la fois de de révélateur et d'élément cathartique : eh oui, on n'est pas loin d'Edward Albeee quelques bonnes dizaines d'années avant Qui a peur de Virginia Woolf ? (et en effectuant quelques recherches, il m'a été confirmé que Strindberg avait bien été une influence pour Albee. Il faut dire que le contraire eût été étonnant !)
Danse de mort doit sa réussite, son efficacité à deux points essentiels - hormis le sujet et les personnages, bien sûr. D'une part, Strindberg a placé sa pièce sous le triple signe de l'isolement. Je le disais, Edgar et Alice vivent sur une petite île, donc vivant dans une petite communauté. Mais de cette communauté, et de leurs familles respectives, ils se sont exclus, notamment par la faute d'Edgar. Mais pas seulement, car ils affichent tous deux constamment, dans leurs dialogues, leur mépris pour à peu près toutes les personnes dont ils parlent. Et puis, évidemment, ils se sont isolés l'un de l'autre, ils se sont retirés en eux-mêmes, ne cherchant pas ou plus à se connaître, encore moins à échanger - du moins, à échanger sans s'engueuler et s'en mettre plein la tronche. Ajoutez à cela la forteresse (architecturale) dans laquelle ils vivent, et qui n'est finalement qu'une représentation de leur forteresse mentale : Strindberg n'a pas lésiné sur les symboles, sans d'ailleurs que ce soit lourd.
D'autre part, même si je m'y connais peu de ce côté-là, il me semble que Strindberg a travaillé avec l'idée d'un rythme musical propre à la pièce. Bien entendu, le titre, le piano d'Alice et les chansons qui reviennent parfois se prêtent à cette interprétation. Mais on sent surtout - et il faudrait sans doute passer plus de temps à étudier cet aspect des choses pour en donner une véritable analyse - que la pièce suit différents tempos, selon l'enchaînement des scènes. Vers la fin notamment, le rythme s'emballe carrément, pour retomber soudain dans la dernière scène, avec des personnages épuisés. Et je vous laisserai découvrir pourquoi Strindberg a jugé bon d'intituler son drame Danse de mort.
Donc, une bonne surprise pour moi qui n'avait pas beaucoup goûté l'art de Strindberg jusqu'ici. J'ai découvert un auteur plus fin que je ne m'y attendais, qui manie de façon très habile le drame et l'humour - car sous le drame de la vie devenue un enfer, l'humour couve toujours dans Danse de mort.
Challenge Théâtre 2018-2019
Une femme, Mme X., entre dans un café en voyant Mlle Y. assise à une table, seule, une veille de Noël. Mme X. babille, papote, bavasse, montre les cadeaux qu'elle a achetés pour sa famille ; elle donne tout l'air d'être du genre nunuche, égocentrique, écervelée. Cependant, toutes deux sont actrices, toutes deux sont amies, mais il y a un froid qui, selon Mme X., s'est installé entre elles depuis un moment, et dont elle ne comprend pas la cause. Dans ce faux dialogue, car Mlle Y. ne prononcera jamais un mot, Mme X. va laisser ses pensées défiler tout haut, ce qui permettra au lecteur de comprendre avant elle la cause du problème et de la croire très naïve. Mais à force de penser tout haut, elle aussi va saisir le nœud de l'affaire : au lieu d'en être consternée, elle en sortira plus forte.
Pièce extrêmement courte - mais, à ma grande surprise, paraît-il, une des pièces les plus jouées de Strindberg en Suède -, où ce n'est pas l'analyse psychologique qui prend le dessus. En y regardant de près, on pourrait presque y voir une préfiguration du théâtre de Nathalie Sarraute, avec ce personnage muet et cette question du malaise non dit. Je n'irai pas trop loin, cela dit, dans cette direction, ce serait m'aventurer sur des chemins risqués.
Le grand intérêt de cette petite pièce, c'est surtout sa forme, ce dialogue qui n'en est pas un, et qui a beaucoup choqué à l'époque : on n'avait jamais vu ça, quelle horreur ! Et il est bien certain que O'Neill s'en est souvenu pour son drame Avant le petit-déjeuner.
Pièce extrêmement courte - mais, à ma grande surprise, paraît-il, une des pièces les plus jouées de Strindberg en Suède -, où ce n'est pas l'analyse psychologique qui prend le dessus. En y regardant de près, on pourrait presque y voir une préfiguration du théâtre de Nathalie Sarraute, avec ce personnage muet et cette question du malaise non dit. Je n'irai pas trop loin, cela dit, dans cette direction, ce serait m'aventurer sur des chemins risqués.
Le grand intérêt de cette petite pièce, c'est surtout sa forme, ce dialogue qui n'en est pas un, et qui a beaucoup choqué à l'époque : on n'avait jamais vu ça, quelle horreur ! Et il est bien certain que O'Neill s'en est souvenu pour son drame Avant le petit-déjeuner.
Trois personnages. Tout d'abord Adolphe, qui se plaint de sa femme Tekla, dont il ne peut se passer, dont les absences le rendent malade, et qui n'arrête pas de se plaindre. Gustave, plus ou moins un ami, du moins pour le temps de la scène un confident, qui s'échine à convaincre Adolphe que Tekla lui pourrit la vie et qu'il doit s'affranchir de sa tutelle dévastatrice. Pas d'acte, pas de scène à proprement parler, mais une construction très efficace puisque répartie entre trois confrontations successives, rythmées par les sorties et les entrées des trois personnages : Adolphe / Gustave - Adolphe / Telkla - Telkla / Gustave.
Nous voici donc repartis, après Mademoiselle Julie, dans le monde de souffrances de Strindberg, de ses récriminations contre les femmes, et des malheurs qui découlent des relations entre les deux sexes. Certes, Strindberg a évité les écueils de sa pièce précédente : pas de personnage franchement caricatural ou hystérique ici. Encore que... encore que Tekla la castratrice, telle qu'elle est montrée par Strindberg, c'est un peu lourd à mon goût. Donc, impossibilité de communiquer entre hommes et femmes, relations malsaines de couples, etc., etc. Alors oui, on sait que Strinberg était malheureux en mariage avec Siri à l'époque. Mais, personnellement, je m'en contrefous.
Je ne trouve pas la pièce novatrice, je ne trouve pas l'idée de la vengeance ourdie en sourdine d'une originalité débordante, et, même si je ne considère pas la pièce comme inintéressante, elle ne restera pas marquée au fer rouge dans ma mémoire. Et je considère que Strindberg a tout de même poussé le bouchon un peu loin en accusant Ibsen de l'avoir plagié avec Hedda Gabler. Mais bon, il est bien connu qu'ils se détestaient et nous mettrons cet accès de mauvaise humeur sur le compte de leurs relations pour le moins difficiles.
Ah, il faut que j'ajoute un petit quelque chose : d'habitude, je lis scrupuleusement les préface des livres, plutôt après le texte principal, d'ailleurs. Là, j'ai tenté très fort de lire celle de Marc-Vincent Howlett, avec ses phrases toutes sur le même modèle, telle "Un tel truisme n'infirme pas la thèse foucaltienne de l'absence de l'auteur ; il ne fait que déplacer la position de l'auteur, le sujet est décentré, pour..." Rassurez-vous, j'arrête là. Cette préface pompeuse, destinée avec ostentation à un public qui serait le plus étriqué possible, a eu raison de moi ; d'autant que j'en avais lue une autre, dans une autre édition, bien plus accessible et donc bien plus intelligente. Je ne dis donc pas merci aux éditions Circé pour ce morceau de grandiloquence pontifiante et ennuyeuse à souhait. de quoi vous dégoûter de Strindberg, du théâtre, et de la littérature tout court.
Challenge Théâtre 2018-2019
Nous voici donc repartis, après Mademoiselle Julie, dans le monde de souffrances de Strindberg, de ses récriminations contre les femmes, et des malheurs qui découlent des relations entre les deux sexes. Certes, Strindberg a évité les écueils de sa pièce précédente : pas de personnage franchement caricatural ou hystérique ici. Encore que... encore que Tekla la castratrice, telle qu'elle est montrée par Strindberg, c'est un peu lourd à mon goût. Donc, impossibilité de communiquer entre hommes et femmes, relations malsaines de couples, etc., etc. Alors oui, on sait que Strinberg était malheureux en mariage avec Siri à l'époque. Mais, personnellement, je m'en contrefous.
Je ne trouve pas la pièce novatrice, je ne trouve pas l'idée de la vengeance ourdie en sourdine d'une originalité débordante, et, même si je ne considère pas la pièce comme inintéressante, elle ne restera pas marquée au fer rouge dans ma mémoire. Et je considère que Strindberg a tout de même poussé le bouchon un peu loin en accusant Ibsen de l'avoir plagié avec Hedda Gabler. Mais bon, il est bien connu qu'ils se détestaient et nous mettrons cet accès de mauvaise humeur sur le compte de leurs relations pour le moins difficiles.
Ah, il faut que j'ajoute un petit quelque chose : d'habitude, je lis scrupuleusement les préface des livres, plutôt après le texte principal, d'ailleurs. Là, j'ai tenté très fort de lire celle de Marc-Vincent Howlett, avec ses phrases toutes sur le même modèle, telle "Un tel truisme n'infirme pas la thèse foucaltienne de l'absence de l'auteur ; il ne fait que déplacer la position de l'auteur, le sujet est décentré, pour..." Rassurez-vous, j'arrête là. Cette préface pompeuse, destinée avec ostentation à un public qui serait le plus étriqué possible, a eu raison de moi ; d'autant que j'en avais lue une autre, dans une autre édition, bien plus accessible et donc bien plus intelligente. Je ne dis donc pas merci aux éditions Circé pour ce morceau de grandiloquence pontifiante et ennuyeuse à souhait. de quoi vous dégoûter de Strindberg, du théâtre, et de la littérature tout court.
Challenge Théâtre 2018-2019
Une mère qui veut que sa fille de 18 ans vienne jouer aux cartes avec elle plutôt que d'aller se baigner avec des jeunes gens de son âge. Seulement, la fille vient tout juste d'arriver à un tournant de sa vie ; c'est la prise de conscience que le soi-disant amour maternel toujours vanté haut et fort par la mère est avant tout mensonge, égoïsme et volonté d'empêcher toute émancipation de la fille. Deux personnages extérieurs se font l'écho de deux points de vue radicalement différents ; la "tante" Augusta, soutenant la mère envers et contre tout, taxant la fille d'ingratitude, et Lisen, une des rares amies de la jeune fille (peut-être même la seule), qui tente de la réveiller et de l'inciter à prendre son envol, quitte à la brusquer carrément.
Le sujet valait largement la peine d'être scruté par Strindberg. Même s'il n'est pas le premier ni le dernier à le traiter, il fait bon voir un auteur s'attaquer intelligemment à la relation mère-fille, qui relève parfois du tabou tellement on peut avoir tendance à la nimber d'une sainte auréole (rassurez-vous, je ne pense pas pour autant que toutes les mères soient maltraitantes ou que l'amour maternel ne soit qu'un vaste mensonge universel !) La pièce est subtile dans son étude psychologique - c'est-à-dire tout le contraire de Mademoiselle Julie (hum). Ce drame a ceci de spécifique qu'il ne nous conduit pas là où on l'attendrait : Strindberg montre comment s'émanciper est extrêmement compliqué pour une jeune fille, comment elle peut à la fois éprouver du dégoût pour sa mère et ne pas être capable de s'en détacher, jusqu'à en vouloir à la seule personne qui cherche à la tirer de son cloaque, jusqu'à choisir de s'enfermer dans cette relation malsaine de mère à fille.
C'est une histoire ordinaire, mais riche d'implications et de méandres psychologiques, avec des personnages et des dialogues qui sonnent juste. Et qui, pour le coup, aurait mérité un traitement plus long, d'autant que les personnages d'Augusta et, surtout, celui de Lisen, recèlent des ambiguïtés ici non développées. Si je me serais bien passée des dialogues fatigants de Mademoiselle Julie, je reste donc un chouïa sur ma faim en ce qui concerne Amour maternel, qui, cependant, ne manque pas d'intérêt, loin s'en faut.
Le sujet valait largement la peine d'être scruté par Strindberg. Même s'il n'est pas le premier ni le dernier à le traiter, il fait bon voir un auteur s'attaquer intelligemment à la relation mère-fille, qui relève parfois du tabou tellement on peut avoir tendance à la nimber d'une sainte auréole (rassurez-vous, je ne pense pas pour autant que toutes les mères soient maltraitantes ou que l'amour maternel ne soit qu'un vaste mensonge universel !) La pièce est subtile dans son étude psychologique - c'est-à-dire tout le contraire de Mademoiselle Julie (hum). Ce drame a ceci de spécifique qu'il ne nous conduit pas là où on l'attendrait : Strindberg montre comment s'émanciper est extrêmement compliqué pour une jeune fille, comment elle peut à la fois éprouver du dégoût pour sa mère et ne pas être capable de s'en détacher, jusqu'à en vouloir à la seule personne qui cherche à la tirer de son cloaque, jusqu'à choisir de s'enfermer dans cette relation malsaine de mère à fille.
C'est une histoire ordinaire, mais riche d'implications et de méandres psychologiques, avec des personnages et des dialogues qui sonnent juste. Et qui, pour le coup, aurait mérité un traitement plus long, d'autant que les personnages d'Augusta et, surtout, celui de Lisen, recèlent des ambiguïtés ici non développées. Si je me serais bien passée des dialogues fatigants de Mademoiselle Julie, je reste donc un chouïa sur ma faim en ce qui concerne Amour maternel, qui, cependant, ne manque pas d'intérêt, loin s'en faut.
Je connais mal Strindberg. Peut-être ai-je vu autrefois une représentation de Mademoiselle Julie, mais sans même que je me souvienne pourquoi, je ne me rappelle de rien.
Peut-être que, comme pour Mulukuku il y a quelques jours, le boulevard qui m'est laissé en l'absence de précédente critique, l'ivresse d'être le premier rédacteur (je blague), me pousse à me lancer. J'y vais !
Je connais donc mal August Strindberg, mais je connais mieux désormais le jeune Strindberg, car c'est lui le fils de la servante dont il raconte les 18 premières années (1849-1867) à la troisième personne, choix singulier qui ajoute une distance dans le récit de ses souffrances et de ses frustrations, écho au sentiment d'étrangeté qu'il éprouve et de la solitude qu'il subit et subira : "Sa sympathie pour les hommes ne devait pas être payée de retour."
Le personnage, le sujet du livre, est donc le fils de la servante d'un bourgeois obtus, père taciturne remarié à la mort de la mère avec la gouvernante. "Toute sa vie, il aura ce regret de sa mère, il se sentira seul."
Le père est un obstacle avant de n'être plus rien, incapable de compréhension et plus encore d'amour pour son fils ainé, de surcroît accablé d'un petit frère. "Il resta comme le gui, qui ne peut pousser sans être soutenu par un arbre : il devint une plante grimpante qui devait se chercher un tuteur."
J'ai été impressionné par la puissance de ce personnage, ce qu'il parvient à devenir quand tout paraît devoir l'entraver, la famille, la société suédoise puritaine qui réprouve "son instinct sexuel", la religion qu'il affronte avec orgueil : "Sa chair était trop jeune et trop saine pour avoir le désir d'être cloué la croix."
Nous sommes encore sous les Lumières, au moment d'un compromis social profitable à la bourgeoisie qui "maintient une certaine apparence démocratique". Mais Strindberg n'est pas dupe et, dans sa solitude, il rêve avec confiance à l'avènement d'un monde heureux. Sa critique sociale est pleine d'espoir.
Mais ça c'est le jeune Strindberg, le fils de la servante. Plus tard il changera, abandonnera ses idéaux démocratiques, et l'éternel persécuté sera aussi victime du délire de la persécution. Mais ça, c'est une autre histoire.
Peut-être que, comme pour Mulukuku il y a quelques jours, le boulevard qui m'est laissé en l'absence de précédente critique, l'ivresse d'être le premier rédacteur (je blague), me pousse à me lancer. J'y vais !
Je connais donc mal August Strindberg, mais je connais mieux désormais le jeune Strindberg, car c'est lui le fils de la servante dont il raconte les 18 premières années (1849-1867) à la troisième personne, choix singulier qui ajoute une distance dans le récit de ses souffrances et de ses frustrations, écho au sentiment d'étrangeté qu'il éprouve et de la solitude qu'il subit et subira : "Sa sympathie pour les hommes ne devait pas être payée de retour."
Le personnage, le sujet du livre, est donc le fils de la servante d'un bourgeois obtus, père taciturne remarié à la mort de la mère avec la gouvernante. "Toute sa vie, il aura ce regret de sa mère, il se sentira seul."
Le père est un obstacle avant de n'être plus rien, incapable de compréhension et plus encore d'amour pour son fils ainé, de surcroît accablé d'un petit frère. "Il resta comme le gui, qui ne peut pousser sans être soutenu par un arbre : il devint une plante grimpante qui devait se chercher un tuteur."
J'ai été impressionné par la puissance de ce personnage, ce qu'il parvient à devenir quand tout paraît devoir l'entraver, la famille, la société suédoise puritaine qui réprouve "son instinct sexuel", la religion qu'il affronte avec orgueil : "Sa chair était trop jeune et trop saine pour avoir le désir d'être cloué la croix."
Nous sommes encore sous les Lumières, au moment d'un compromis social profitable à la bourgeoisie qui "maintient une certaine apparence démocratique". Mais Strindberg n'est pas dupe et, dans sa solitude, il rêve avec confiance à l'avènement d'un monde heureux. Sa critique sociale est pleine d'espoir.
Mais ça c'est le jeune Strindberg, le fils de la servante. Plus tard il changera, abandonnera ses idéaux démocratiques, et l'éternel persécuté sera aussi victime du délire de la persécution. Mais ça, c'est une autre histoire.
A l'occasion de la sortie en salles d'une nouvelle-la 15ème- adaptation de la pièce d'August Strinberg, par la suédoise et muse de Bergman Liv Ullman, il est bien de revenir sur ce texte que j'ai découvert avec la précédente adaptation en 1999, celle du britannique Mike Figgis, qui m'avait donné envie de lire la pièce dans la foulée.
En effet, je me souviens avoir été à l'époque frappé par la puissance du texte une vraie tragédie qui nous amène magnifiquement dans un jeu de séduction-répulsion aussi bien pervers qu'érotique entre deux personnes de classe sociale différente, et chacun, au fil d'une seule nuit, va tour à tour soit dominer l'autre, soit être à sa merci, avant une fin forcément tragique (dans une tragédie, c'est un peu logique que la fin le soit, non?).
Bref, voilà donc une oeuvre pleine d''acuité et de justesse sur les faux semblants dans un jeu de séduction, avec des personnages complexes et qui frappait par son universalité et sa modernité, plus d'un siècle après l'avoir écrit.
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
En effet, je me souviens avoir été à l'époque frappé par la puissance du texte une vraie tragédie qui nous amène magnifiquement dans un jeu de séduction-répulsion aussi bien pervers qu'érotique entre deux personnes de classe sociale différente, et chacun, au fil d'une seule nuit, va tour à tour soit dominer l'autre, soit être à sa merci, avant une fin forcément tragique (dans une tragédie, c'est un peu logique que la fin le soit, non?).
Bref, voilà donc une oeuvre pleine d''acuité et de justesse sur les faux semblants dans un jeu de séduction, avec des personnages complexes et qui frappait par son universalité et sa modernité, plus d'un siècle après l'avoir écrit.
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
De prime abord, on pourrait penser que La danse de mort est un de ces textes qu’il faudrait offrir en prélude amoureux à tous les couples qui envisagent de se marier. Prenez-garde au cérémonial qui menace votre amour : August Strindberg place ses personnages au cœur du cercle des Enfers. Dans une forteresse isolée, sur une île isolée, Alice et le Capitaine vivent en tête-à-tête, rejetés et méprisants du reste de l’humanité, se haïssant mutuellement, et sans doute ne s’aimant pas eux-mêmes. La pièce commence comme un morceau de théâtre absurde –Eugène Ionesco s’en serait-il inspiré pour écrire sa Cantatrice chauve ?- et nous montre deux personnages qui cherchent à meubler l’ennui en l’embellissant de querelles et de jeux triviaux. L’évènement perturbateur provient de l’extérieur en la personne de Kurt. Cousin d’Alice, ancien ami du Capitaine, il est le responsable des fiançailles du couple. Animé de bonnes intentions, il n’avait jamais imaginé la déchéance qui les guetterait à l’issue de cette union. Progressivement, il va découvrir la réalité de leur vie sur cette île et chercher à comprendre les raisons qui ont conduit le Alice et le Capitaine, de l’amour à la haine.
Si la La danse de mort n’était qu’une évocation de ce triste cheminement, August Strindberg ne mériterait pas la réputation qu’on lui attribue. A l’image de son auteur, les personnages sont complexes : ils se battent contre les autres mais aussi contre eux-mêmes dans une quête de signification. Le 19e siècle est passé, la foi religieuse et la tragédie épique sont passées –le 20e siècle arrive : comment pourra-t-on le meubler ? Ni Alice, ni le Capitaine, ni même Kurt ne semblent encore avoir de croyances profondément enracinées. Dieu a déserté le ciel, et les hommes sont en train de déserter la terre, alors, avec quoi repeuplera-t-on le théâtre terrestre ? Finalement, La danse de mort parle bien moins d’amour que de métaphysique, et si la thématique du couple semble toutefois importante, c’est parce qu’elle est la situation intersubjective privilégiée qui permet de se couler dans l’introspection. L’être humain n’arrivant jamais totalement à se définir seul et par lui-même, August Strindberg le place en face de son reflet –ce qui suscite bien plus souvent de la haine que de l’amour, quoique les deux ne soient peut-être pas si éloignés l’un de l’autre qu’il n’y paraît.
Il serait dommage de croire que La danse de mort est une pièce seulement désespérée. Elle ne l’est pas, et c’est justement ce qui en fait sa grandeur. Elle se moque d’elle-même, elle se moque de ses personnages, elle se moque de son auteur, de ses lecteurs et spectateurs –et, en se moquant, elle aime d’autant plus qu’elle connaît désormais les faiblesses et les terreurs de ses sujets. La tentation de l’absurde est évitée de justesse : après avoir oscillé entre tragédie et comédie, La danse de mort opte pour l’ironie, qui en est une sublime synthèse.
Lien : http://colimasson.over-blog...
Si la La danse de mort n’était qu’une évocation de ce triste cheminement, August Strindberg ne mériterait pas la réputation qu’on lui attribue. A l’image de son auteur, les personnages sont complexes : ils se battent contre les autres mais aussi contre eux-mêmes dans une quête de signification. Le 19e siècle est passé, la foi religieuse et la tragédie épique sont passées –le 20e siècle arrive : comment pourra-t-on le meubler ? Ni Alice, ni le Capitaine, ni même Kurt ne semblent encore avoir de croyances profondément enracinées. Dieu a déserté le ciel, et les hommes sont en train de déserter la terre, alors, avec quoi repeuplera-t-on le théâtre terrestre ? Finalement, La danse de mort parle bien moins d’amour que de métaphysique, et si la thématique du couple semble toutefois importante, c’est parce qu’elle est la situation intersubjective privilégiée qui permet de se couler dans l’introspection. L’être humain n’arrivant jamais totalement à se définir seul et par lui-même, August Strindberg le place en face de son reflet –ce qui suscite bien plus souvent de la haine que de l’amour, quoique les deux ne soient peut-être pas si éloignés l’un de l’autre qu’il n’y paraît.
Il serait dommage de croire que La danse de mort est une pièce seulement désespérée. Elle ne l’est pas, et c’est justement ce qui en fait sa grandeur. Elle se moque d’elle-même, elle se moque de ses personnages, elle se moque de son auteur, de ses lecteurs et spectateurs –et, en se moquant, elle aime d’autant plus qu’elle connaît désormais les faiblesses et les terreurs de ses sujets. La tentation de l’absurde est évitée de justesse : après avoir oscillé entre tragédie et comédie, La danse de mort opte pour l’ironie, qui en est une sublime synthèse.
Lien : http://colimasson.over-blog...
Ecrite en 1887, la pièce sera créée à Berlin en 1890. Une fois de plus, les rapports du couple sont au centre de l’oeuvre de Strinberg. Le capitaine et sa femme Laura sont en désaccord sur l’éducation à donner à Bertha, leur fille. Le capitaine a décidé de l’envoyer en ville, suivre des études qui lui permettraient éventuellement de devenir institutrice. Bertha est d’accord avec ce projet, mais Laura y est opposée : elle ne veut pas que sa fille soit éduquée par d’autres, et qu’elle puisse se détacher d’elle. Elle ourdit un stratagème, en distillant dans l’esprit de son mari le doute sur sa paternité, elle essaie de le pousser vers la folie, le coupe de ses amis, et le met en posture d’être déclaré aliéné.
C’est une pièce très sombre, dans laquelle les relations entre les époux se résument à une lutte de deux volontés, une lutte pour le pouvoir. Laura est la plus forte, car elle est sans scrupules, prête à user de la ruse, et de tous les stratagèmes possibles pour arriver à ses fins. Le pouvoir de la femme s’appuie sur la certitude, celle de savoir qui est le père de l’enfant, et par là décider du futur, de la transmission. L’homme quand à lui ne peut que faire des conjectures, il est dans l’ignorance, dans une forme de dépendance.
La pièce n’échappe pas à une forme de misogynie : Laura est vraiment terrifiante, elle précipite en pleine connaissance de cause son mari vers la folie, et n’a de cesse que de triompher complètement de lui, alors que le capitaine est de bonne foi, il est dépeint comme généreux, même si sans doute trop naïf, et donc désarmé devant les menées de sa femme, qui par exemple n’hésite pas à mentir, à présenter sous un jour inquiétant au médecin qu’elle a fait venir, les comportements de son mari.
Mais on peut aussi lire ce drame comme celui d’un homme à qui sa raison échappe lorsqu’il prend conscience des limites de l’esprit humain, de l’incertitude sur les choses les plus essentielles. Le capitaine est présenté comme un savant, comme un scientifique reconnu dans son domaine. Il ne peut pourtant savoir avec une certitude absolue, si Bertha est bien sa fille. Plutôt que d’interpréter toutes les interrogations autour de cette question comme des indices d’un basculement dans la folie, on peut aussi les voir comme une sorte d’angoisse métaphysique, d’un homme confronté à sa finitude. Là aussi Laura s’avère inférieure : pas sur le plan moral mais intellectuel cette fois, ce type de questionnement étant en dehors de sa portée. Dans tous les cas, pour triompher, elle utilise les aspects nobles de son mari, sa sincérité, sa droiture, son intellect, pour le mener vers l’abîme et le détruire. L’homme et la femme semblent dans la pièce des ennemis mortels, presque des représentants de deux espèces différentes, irrémédiablement en conflit, qui résulte de leurs natures opposées.
Pessimiste au possible, pas dépourvu d’une forme de mauvaise foi, mais très fort, très intense.
C’est une pièce très sombre, dans laquelle les relations entre les époux se résument à une lutte de deux volontés, une lutte pour le pouvoir. Laura est la plus forte, car elle est sans scrupules, prête à user de la ruse, et de tous les stratagèmes possibles pour arriver à ses fins. Le pouvoir de la femme s’appuie sur la certitude, celle de savoir qui est le père de l’enfant, et par là décider du futur, de la transmission. L’homme quand à lui ne peut que faire des conjectures, il est dans l’ignorance, dans une forme de dépendance.
La pièce n’échappe pas à une forme de misogynie : Laura est vraiment terrifiante, elle précipite en pleine connaissance de cause son mari vers la folie, et n’a de cesse que de triompher complètement de lui, alors que le capitaine est de bonne foi, il est dépeint comme généreux, même si sans doute trop naïf, et donc désarmé devant les menées de sa femme, qui par exemple n’hésite pas à mentir, à présenter sous un jour inquiétant au médecin qu’elle a fait venir, les comportements de son mari.
Mais on peut aussi lire ce drame comme celui d’un homme à qui sa raison échappe lorsqu’il prend conscience des limites de l’esprit humain, de l’incertitude sur les choses les plus essentielles. Le capitaine est présenté comme un savant, comme un scientifique reconnu dans son domaine. Il ne peut pourtant savoir avec une certitude absolue, si Bertha est bien sa fille. Plutôt que d’interpréter toutes les interrogations autour de cette question comme des indices d’un basculement dans la folie, on peut aussi les voir comme une sorte d’angoisse métaphysique, d’un homme confronté à sa finitude. Là aussi Laura s’avère inférieure : pas sur le plan moral mais intellectuel cette fois, ce type de questionnement étant en dehors de sa portée. Dans tous les cas, pour triompher, elle utilise les aspects nobles de son mari, sa sincérité, sa droiture, son intellect, pour le mener vers l’abîme et le détruire. L’homme et la femme semblent dans la pièce des ennemis mortels, presque des représentants de deux espèces différentes, irrémédiablement en conflit, qui résulte de leurs natures opposées.
Pessimiste au possible, pas dépourvu d’une forme de mauvaise foi, mais très fort, très intense.
Bouuuuuuuuuuuuuuhhhhhh.... Si j'ai un peu de mal avec Tchekhov, que dire de Strindberg et de sa Mademoiselle Julie ? J'avoue que la lecture de la pièce m'a laissé un goût de déception très amer. Et quand je pense que Strindberg voulait inventer un théâtre moderne, face au théâtre de son temps qu'il trouvait moribond, je me dis que, bon, c'est bien joli, tout ça... mais qu'Ibsen, qu'il méprisait plutôt, a été bien plus inventif que lui. Car sur des thèmes qui se recoupent un tant soit peu (liberté individuelle, rapports hommes/femmes, société fin-de-siècle corsetée), Strindberg donne à mon avis en plein dans l'outrance un peu vaine, quand son aîné fait preuve de finesse et va beaucoup plus loin dans l'exploration des thématiques, notamment dans celle de la recherche d'émancipation individuelle. Mademoiselle Julie me donne bizarrement des sensations de lourdeur, alors qu'on l'a tant discutée, analysée, disséquée. Mais j'ai beau y réfléchir, je ne vois décidément ce qu'on y trouve de si talentueux.
Un lieu, une nuit (celle de la Saint-Jean), trois personnages : Julie, l'aristocrate, Jean et Kristin ses domestiques. L'une est en train de chuter, ou veut chuter, ou ne peut se retenir de chuter, l'autre veut s'élever socialement, la troisième garde sa place et dit s'en satisfaire. Julie va passer la nuit à jouer à un jeu de séduction, de domination, de répulsion, de soumission, avec Jean, pour finir par se suicider avec un rasoir. Alors on a vite compris le coup des rapports de force qui s'inversent entre maîtresse et domestique ainsi qu'entre homme et femme, et, même si on est pas très au fait de l'histoire de la Suède au XIXème, on saisit tout aussi vite que le jeu des personnages s'inscrit dans un contexte de bouleversement social. Ça pourrait être très intéressant, d'autres se sont frottés à ces sujets avec audace, bonheur, finesse... Mais ici, c'est d'une lourdeur !
Strindberg a fait de Julie une espèce d'hystérique dont on ne sait ce qui la motive, ce qu'elle cherche. Jean, même dans sa cruauté, est insipide, et Kristin n'est là que pour relayer l'opinion publique, à savoir qu'il faut être capable de rester à sa place. Et Julie de pleurer, de crier, de se lamenter, d'espérer, d'être aguicheuse, puis dégoûtée, passant d'un état à l'autre sans transition. Je sais bien que Strindberg connaissait quelques soucis dans son mariage à l'époque, mais qu'avait-t-il besoin de créer un personnage aussi outré ? Franchement, si c'était pour se venger de sa femme, à qui il a donné le rôle à la création, c'est pas un motif bien joli-joli... le nadir, c'est l'épisode du serin : Julie s'est décidée à partir avec Jean pour bâtir des châteaux en Espagne, et veut emmener avec elle son serin : le seul être qui lui soit fidèle, selon elle. Oui, bon alors, partir avec une cage et un oiseau dedans pour voyager des journées entières, c'est pas bien malin, lui dit Jean. Et voilà que Julie se met à déclamer qu'elle préfère que Jean tue l'oiseau plutôt que de l'abandonner. Et hop, Jean coupe la tête de l'oiseau. Et voilà Julie qui crie "Il y a du sang entre nous !". Et ne veut plus partir (enfin ça, le coup de "Partons !", "Ne partons plus", ils vont le faire tous les deux un certain nombre de fois). D'ailleurs, dix minutes plus tard, la voilà qui dit dit : "Ne pensons plus au serin." (ou un truc dans le genre). Alors, franchement, j'appelle ça du plagiat. Un sale type qui enlève une jeune étourdie plus élevée que lui socialement, qu'il a séduite et qui, avant de se sauver à cheval avec elle, pend sa chienne à un arbre, ça ressemble quand même beaucoup à la scène du serin. Et c'est dans... Les Hauts de Hurlevent. Sauf qu'Emily Brontë a imaginé cet acte de cruauté de Heathcliff pour une bonne raison - Heathcliff, c'est le Mal, quelqu'un qui vit pour sa vengeance (pour faire vite), pas juste un mec creux qui veut monter un hôtel sans argent -, que ça s'insère parfaitement dans l'histoire, dans la psychologie des personnages et dans la structure du roman, et que ce n'est pas juste là pour nous faire entendre des hurlements pénibles à l'oreille, même lorsqu'on reste simple lecteur.
Strindberg admirait Zola : là-dessus, je n'ai aucun doute. de Zola, il me semble qu'il a finalement retenu surtout ce qu'il était le plus outrancier, le plus exagéré, le plus immodéré. J'aime Zola, mais c'est quand même le genre à en faire des tonnes. Mais bon, même quand ça m'agace, je me dis que ça colle bien avec son projet des Rougon-Macquart. Dans le cas de Mademoiselle Julie, je ne saisis pas l'intérêt d'en faire des tonnes. Je l'ai dit, je préfère lire Ibsen, que je trouve tellement plus fin. de même, je préfère La ronde de Schnitzler, pour son côté bien plus subversif, ou Anatole, du même Schnitzler, plus fin, lui aussi, lorsqu'il aborde les rapports homme/femme ou les rapports entre les classes sociales. Non, décidément, ; je n'aime pas Mademoiselle Julie !
Challenge Théâtre 2017-2018
Un lieu, une nuit (celle de la Saint-Jean), trois personnages : Julie, l'aristocrate, Jean et Kristin ses domestiques. L'une est en train de chuter, ou veut chuter, ou ne peut se retenir de chuter, l'autre veut s'élever socialement, la troisième garde sa place et dit s'en satisfaire. Julie va passer la nuit à jouer à un jeu de séduction, de domination, de répulsion, de soumission, avec Jean, pour finir par se suicider avec un rasoir. Alors on a vite compris le coup des rapports de force qui s'inversent entre maîtresse et domestique ainsi qu'entre homme et femme, et, même si on est pas très au fait de l'histoire de la Suède au XIXème, on saisit tout aussi vite que le jeu des personnages s'inscrit dans un contexte de bouleversement social. Ça pourrait être très intéressant, d'autres se sont frottés à ces sujets avec audace, bonheur, finesse... Mais ici, c'est d'une lourdeur !
Strindberg a fait de Julie une espèce d'hystérique dont on ne sait ce qui la motive, ce qu'elle cherche. Jean, même dans sa cruauté, est insipide, et Kristin n'est là que pour relayer l'opinion publique, à savoir qu'il faut être capable de rester à sa place. Et Julie de pleurer, de crier, de se lamenter, d'espérer, d'être aguicheuse, puis dégoûtée, passant d'un état à l'autre sans transition. Je sais bien que Strindberg connaissait quelques soucis dans son mariage à l'époque, mais qu'avait-t-il besoin de créer un personnage aussi outré ? Franchement, si c'était pour se venger de sa femme, à qui il a donné le rôle à la création, c'est pas un motif bien joli-joli... le nadir, c'est l'épisode du serin : Julie s'est décidée à partir avec Jean pour bâtir des châteaux en Espagne, et veut emmener avec elle son serin : le seul être qui lui soit fidèle, selon elle. Oui, bon alors, partir avec une cage et un oiseau dedans pour voyager des journées entières, c'est pas bien malin, lui dit Jean. Et voilà que Julie se met à déclamer qu'elle préfère que Jean tue l'oiseau plutôt que de l'abandonner. Et hop, Jean coupe la tête de l'oiseau. Et voilà Julie qui crie "Il y a du sang entre nous !". Et ne veut plus partir (enfin ça, le coup de "Partons !", "Ne partons plus", ils vont le faire tous les deux un certain nombre de fois). D'ailleurs, dix minutes plus tard, la voilà qui dit dit : "Ne pensons plus au serin." (ou un truc dans le genre). Alors, franchement, j'appelle ça du plagiat. Un sale type qui enlève une jeune étourdie plus élevée que lui socialement, qu'il a séduite et qui, avant de se sauver à cheval avec elle, pend sa chienne à un arbre, ça ressemble quand même beaucoup à la scène du serin. Et c'est dans... Les Hauts de Hurlevent. Sauf qu'Emily Brontë a imaginé cet acte de cruauté de Heathcliff pour une bonne raison - Heathcliff, c'est le Mal, quelqu'un qui vit pour sa vengeance (pour faire vite), pas juste un mec creux qui veut monter un hôtel sans argent -, que ça s'insère parfaitement dans l'histoire, dans la psychologie des personnages et dans la structure du roman, et que ce n'est pas juste là pour nous faire entendre des hurlements pénibles à l'oreille, même lorsqu'on reste simple lecteur.
Strindberg admirait Zola : là-dessus, je n'ai aucun doute. de Zola, il me semble qu'il a finalement retenu surtout ce qu'il était le plus outrancier, le plus exagéré, le plus immodéré. J'aime Zola, mais c'est quand même le genre à en faire des tonnes. Mais bon, même quand ça m'agace, je me dis que ça colle bien avec son projet des Rougon-Macquart. Dans le cas de Mademoiselle Julie, je ne saisis pas l'intérêt d'en faire des tonnes. Je l'ai dit, je préfère lire Ibsen, que je trouve tellement plus fin. de même, je préfère La ronde de Schnitzler, pour son côté bien plus subversif, ou Anatole, du même Schnitzler, plus fin, lui aussi, lorsqu'il aborde les rapports homme/femme ou les rapports entre les classes sociales. Non, décidément, ; je n'aime pas Mademoiselle Julie !
Challenge Théâtre 2017-2018
Théâtre complet, tome 2 : Le voyage de Pierre l'Heureux - La femme de sire Bengt - Camarades - Père - Mademoiselle Julie - Créanciers - Les gens de Hemsö - Paris - La plus forte - Simoun - Les Clefs du ciel
August Strindberg
August Strindberg
Les créanciers
Ecrite en 1888 en suédois, la pièce est créée en 1889 en danois à Copenhague. En 1891, Strinberg va accuser Ibsen d'avoir plagié sa pièce dans Hedda Gabler, mais les relations entre les deux dramaturges scandinaves étaient pour le moins complexes.
Nous sommes dans une stations balnéaire. Deux hommes parlent, leur entretien est centré sur une absente, la femme d'Adolf, un peintre. Gustav, son interlocuteur, le fait douter de ce qu'il croit savoir sur son épouse et sur leur relation. Il l'a décidé à abandonner la peinture au profit de la sculpture. Gustav s'éclipse avant l'arrivée de Tekla, l'épouse. Mais il reste présent, se dissimule, épie la conversation du couple, et se manifeste même à Gustav, qui sait qu'il est là. La conversation du couple vire rapidement à la confrontation, Adolf fait part à Tekla d'une nouvelle vision de leur relation, son épouse ne comprend pas le changement intervenu chez son mari, qui semble possédé par l'esprit d'un autre. Adolf, se retire, mais écoute et observe. Gustav à son tour vient parler à Tekla, qui le connaît fort bien, parce qu'il est son premier mari, qu'elle a quitté avant de refaire sa vie avec Adolf, elle a même écrit un livre qui a fait quelque bruit sur sa vie avec Gustav. Un jeu entre ressentiment et séduction s'engage, qui finit par achever Adolf, qui vient perdre connaissance dans le salon.
Redoutablement efficace, brillante et terrifiante à la fois, la pièce est un véritable morceau de bravoure. Gustav est un manipulateur redoutable, qui prend littéralement possession d'Adolf, qui profite de ses fragilités, de sa sensibilité, de son attachement même à Tekla, pour le faire douter de tout, lui faire voir par ses yeux, lui communiquer son ressentiment et son aigreur. le dialogue entre les époux tourne à un dialogue de sourds, puisque Tekla s'adresse à Adolf tel qu'elle l'a connu, et qu'elle a en face d'elle quelqu'un d'autre, changé, presque possédé, par l'esprit de Gustav. Enfin dans la troisième partie, la relation entre Tekla et Gustav paraît bien plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer, ce qui éclaire aussi d'une autre manière la personnalité de Tekla.
Il y a aussi l'étonnant dispositif, dans lequel les deux protagonistes masculins, même lorsqu'ils ne sont plus sur la scène, assistent à ce qui se passe, et ont une influence sur l'échange, puisque l'homme qui discute avec Tekla sait que leur dialogue est suivi par un troisième personnage, à qui le discours est destiné autant qu'à la femme. Tekla est la seule qui ne s'adresse qu'à une seule personne à la fois, ce qui la met en porte-à-faux et rend son discours inefficace. Elle est complètement dépassée, niée, par l'alliance des deux hommes. Au-delà de la manipulation (Adolf ignore qui est Gustav), leur connivence paraît instinctive, et plus forte que l'amour d'Adolf pour Tekla.
Une pièce remarquable.
Ecrite en 1888 en suédois, la pièce est créée en 1889 en danois à Copenhague. En 1891, Strinberg va accuser Ibsen d'avoir plagié sa pièce dans Hedda Gabler, mais les relations entre les deux dramaturges scandinaves étaient pour le moins complexes.
Nous sommes dans une stations balnéaire. Deux hommes parlent, leur entretien est centré sur une absente, la femme d'Adolf, un peintre. Gustav, son interlocuteur, le fait douter de ce qu'il croit savoir sur son épouse et sur leur relation. Il l'a décidé à abandonner la peinture au profit de la sculpture. Gustav s'éclipse avant l'arrivée de Tekla, l'épouse. Mais il reste présent, se dissimule, épie la conversation du couple, et se manifeste même à Gustav, qui sait qu'il est là. La conversation du couple vire rapidement à la confrontation, Adolf fait part à Tekla d'une nouvelle vision de leur relation, son épouse ne comprend pas le changement intervenu chez son mari, qui semble possédé par l'esprit d'un autre. Adolf, se retire, mais écoute et observe. Gustav à son tour vient parler à Tekla, qui le connaît fort bien, parce qu'il est son premier mari, qu'elle a quitté avant de refaire sa vie avec Adolf, elle a même écrit un livre qui a fait quelque bruit sur sa vie avec Gustav. Un jeu entre ressentiment et séduction s'engage, qui finit par achever Adolf, qui vient perdre connaissance dans le salon.
Redoutablement efficace, brillante et terrifiante à la fois, la pièce est un véritable morceau de bravoure. Gustav est un manipulateur redoutable, qui prend littéralement possession d'Adolf, qui profite de ses fragilités, de sa sensibilité, de son attachement même à Tekla, pour le faire douter de tout, lui faire voir par ses yeux, lui communiquer son ressentiment et son aigreur. le dialogue entre les époux tourne à un dialogue de sourds, puisque Tekla s'adresse à Adolf tel qu'elle l'a connu, et qu'elle a en face d'elle quelqu'un d'autre, changé, presque possédé, par l'esprit de Gustav. Enfin dans la troisième partie, la relation entre Tekla et Gustav paraît bien plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer, ce qui éclaire aussi d'une autre manière la personnalité de Tekla.
Il y a aussi l'étonnant dispositif, dans lequel les deux protagonistes masculins, même lorsqu'ils ne sont plus sur la scène, assistent à ce qui se passe, et ont une influence sur l'échange, puisque l'homme qui discute avec Tekla sait que leur dialogue est suivi par un troisième personnage, à qui le discours est destiné autant qu'à la femme. Tekla est la seule qui ne s'adresse qu'à une seule personne à la fois, ce qui la met en porte-à-faux et rend son discours inefficace. Elle est complètement dépassée, niée, par l'alliance des deux hommes. Au-delà de la manipulation (Adolf ignore qui est Gustav), leur connivence paraît instinctive, et plus forte que l'amour d'Adolf pour Tekla.
Une pièce remarquable.
Quelle lecture fastidieuse ! Le style n’est pas arrivé à capter mon cerveau. J’ai trouvé sublime, de cet auteur suédois, Le bouc émissaire. Est-ce une histoire de traduction ? Borg, inspecteur en pêcheries ayant une haute opinion de lui-même, va bien sûr se faire détester par les habitants de ce port d’une île suédoise. De jolies phrases sur la nature et le fond des mers, rebutant sur les scientifiques. Ensuite ça part sur une histoire d’amour avec des comportements tordus qui m’ont échappés. Trop misogyne à mon goût, manque d’humour. Désolée de faire baisser la note à ce roman qui n’a, jusqu’à maintenant, que des critiques élogieuses.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de August Strindberg
Lecteurs de August Strindberg (820)Voir plus
Quiz
Voir plus
À une lettre près ! 🍕... 🃏
Anne Perry a prévenu, nous pourrions avoir à traverser "Un *** dangereux". Indice, Q10.
seuil
deuil
10 questions
250 lecteurs ont répondu
Thèmes :
mots
, proches
, titres
, jeux de lettres
, historiettes
, baba yagaCréer un quiz sur cet auteur250 lecteurs ont répondu