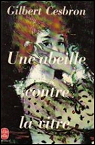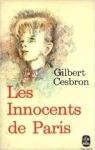Critiques de Gilbert Cesbron (227)
« On croit rêver » est le deuxième roman de Gilbert Cesbron (1945), juste après « Les Innocents de Paris » (1944). Œuvre de jeunesse donc, (l’auteur a trente-deux ans et une belle carrière devant lui), et œuvre de débutant : quel thème va-t-il choisir ? quel style va-t-il appliquer ? Son premier roman « Les Innocents de Paris », paru en 1944, mais écrit en 1942, racontait le Paris de 1923. Celui-ci, sorti en 1945, situe son intrigue au cœur des années 30. Mais l’actualité récente (guerre, Occupation, Renaissance), ne l’intéressait pas, il s’en explique dans la préface : « Les puissants, les importants, les imposteurs nous utilisent non comme partenaires ou comme enjeu, mais comme pions. Je le compris dans les années quarante, et quant à moi, le refusai ». C’est la raison pour laquelle l’actualité politique ne figure pas souvent, presque jamais, dans les romans de Gilbert Cesbron : peut-être faut-il y voir le paradoxe qui traverse toute son œuvre : apparemment datée, elle est toujours d’une grande actualité, non pas politique, mais sociale, intellectuelle et morale.
Toujours dans sa préface, Gilbert Cesbron confesse qu’il s’est adonné (humblement) à un pastiche de Stendhal, qui est un de ses auteurs favoris : Bixio, le héros de « On croit rêver » est en effet une sorte de Fabrice Del Dongo, évoluant à la façon d’un Bonaparte (tous les titres de chapitres font référence à l’épopée napoléonienne) dans une société futile et frivole (celle des années 30) et de plus révolue. Ce qui explique aussi le titre : « J’ai donc entassé pêle-mêle, dans une couverture aux couleurs assez riantes, ce que j’avais vu, deviné, inventé, sans qu’on puisse distinguer très clairement la frontière entre le vrai et le vraisemblable : On croit rêver, on vivait seulement… »
« On croit rêver » aurait pu être une chronique sarcastique sur cet entre-deux-guerres où le monde dansait au bord d’un précipice, et présenter ses héros comme des marionnettes ridicules. Il n’en est rien, Cesbron s’il montre parfois de la gaucherie avec ses personnages (Bixio et son amie Martine, surtout), ne les aime pas moins, et leur accorde une sympathie dont il ne se déniera jamais.
Comme tous les romans de Cesbron, « On croit rêver » est un roman d’amour : tout au long du livre, Bixio et Martine se cherchent et ne se trouvent pas, la part du jeu et de la sincérité (comme chez Stendhal, et comme chez Musset) n’est pas aisément définissable et laisse la part aux apparences : « On croit rêver » … C’est la société et le monde autour d’eux, étourdissant, qui en est la cause…
Ce deuxième roman conforte l’auteur dans le genre auquel il va s’absorber dans toute son œuvre : « La victoire de 45 ne pouvait rien changer à cela ; mes yeux s’étaient ouverts. Il ne s’agissait pas de ricaner de tout, mais de s’attacher désormais aux êtres sans défense, de rechercher passionnément l’intérêt des « gens sans intérêt » et dans la mesure où l’on est le maître de choisir, de préférer le cœur à l’esprit ».
Si ça, ce n’est pas une profession de foi ! Foi en l’homme, foi en l’humanité (dans les deux sens : l’ensemble des hommes, et le caractère de ce qui est humain, fraternel et compatissant).
Chacun des livres de Gilbert Cesbron (romans essais, théâtre, poésie) nous ramène à ce credo, qui est aussi un rappel à l’ordre et un cri d’alerte : l’Histoire n’en finit pas de mordre la queue, et nous revivons, différemment peut-être, mais avec autant d’angoisse et de désinvolture mélangées, ce qu’ont vécu nos aînés…
Toujours dans sa préface, Gilbert Cesbron confesse qu’il s’est adonné (humblement) à un pastiche de Stendhal, qui est un de ses auteurs favoris : Bixio, le héros de « On croit rêver » est en effet une sorte de Fabrice Del Dongo, évoluant à la façon d’un Bonaparte (tous les titres de chapitres font référence à l’épopée napoléonienne) dans une société futile et frivole (celle des années 30) et de plus révolue. Ce qui explique aussi le titre : « J’ai donc entassé pêle-mêle, dans une couverture aux couleurs assez riantes, ce que j’avais vu, deviné, inventé, sans qu’on puisse distinguer très clairement la frontière entre le vrai et le vraisemblable : On croit rêver, on vivait seulement… »
« On croit rêver » aurait pu être une chronique sarcastique sur cet entre-deux-guerres où le monde dansait au bord d’un précipice, et présenter ses héros comme des marionnettes ridicules. Il n’en est rien, Cesbron s’il montre parfois de la gaucherie avec ses personnages (Bixio et son amie Martine, surtout), ne les aime pas moins, et leur accorde une sympathie dont il ne se déniera jamais.
Comme tous les romans de Cesbron, « On croit rêver » est un roman d’amour : tout au long du livre, Bixio et Martine se cherchent et ne se trouvent pas, la part du jeu et de la sincérité (comme chez Stendhal, et comme chez Musset) n’est pas aisément définissable et laisse la part aux apparences : « On croit rêver » … C’est la société et le monde autour d’eux, étourdissant, qui en est la cause…
Ce deuxième roman conforte l’auteur dans le genre auquel il va s’absorber dans toute son œuvre : « La victoire de 45 ne pouvait rien changer à cela ; mes yeux s’étaient ouverts. Il ne s’agissait pas de ricaner de tout, mais de s’attacher désormais aux êtres sans défense, de rechercher passionnément l’intérêt des « gens sans intérêt » et dans la mesure où l’on est le maître de choisir, de préférer le cœur à l’esprit ».
Si ça, ce n’est pas une profession de foi ! Foi en l’homme, foi en l’humanité (dans les deux sens : l’ensemble des hommes, et le caractère de ce qui est humain, fraternel et compatissant).
Chacun des livres de Gilbert Cesbron (romans essais, théâtre, poésie) nous ramène à ce credo, qui est aussi un rappel à l’ordre et un cri d’alerte : l’Histoire n’en finit pas de mordre la queue, et nous revivons, différemment peut-être, mais avec autant d’angoisse et de désinvolture mélangées, ce qu’ont vécu nos aînés…
Quelle est cette abeille contre la vitre ? C’est le mime Marceau, vous vous souvenez, enfermé dans un coffre invisible d’où il cherche à sortir en appuyant ses mains affolées contre un mur qu’il est seul à voir. L’abeille, c’est Isabelle, qui répète à l’infini les gestes désespérées du mime.
Isabelle – ce merveilleux prénom est dur à porter, parfois – est deux fois disgraciée : elle est une femme dans un monde d’hommes, et elle est une jeune femme laide dans un monde d’hommes et de femmes qui se réfèrent à un canon en dehors duquel il n’y a pas de place. Laide, c’est même pire que ça : Isa a un corps sculptural, un corps de statue, mais elle est affligée, hélas d’un bec-de-lièvre. La Nature, ou le Créateur, ou qui vous voulez, fait preuve parfois d’une cruauté sans nom : Isa peut éveiller le désir mais comme disent les phallocrates : « c’est un remède contre l’amour ». Et l’Amour, Dieu sait si Isa en demande, elle le cherche, mais il se détourne. Mais un jour…
Gilbert Cesbron nous a habitués à des cas difficiles, parfois extrêmes. Ici il met en scène deux fléaux, deux injustices : celle, plusieurs fois millénaire, de la condition féminine, et celle tout aussi ancienne qui veut que le monde appartienne aux beaux aux forts, aux riches et aux intelligents, plutôt qu’aux laids, aux faibles, aux pauvres et aux ignorants.
En 1964, la défense des droits des femmes était encore à l’état embryonnaire (même si « Le Deuxième sexe » datait déjà de 1949) (on a un peu avancé, mais il y a encore du chemin à faire). Il fallait donc à Gilbert Cesbron un certain courage pour aborder ce sujet, à cette époque. Dans un monde d’hommes, façonné par eux à leur discrétion et à leur disposition, la femme est-elle autre chose qu’un « objet » ? D’accord, ce n’est pas « La Servante écarlate », et beaucoup d’hommes inconsciemment reprennent les gestes de leurs pères et de leurs grands-pères, tout comme beaucoup de femmes font comme maman et mamie… Mais ce n’est pas parce qu’il en a toujours été ainsi qu’il faut continuer. Question de dignité…
L’autre disgrâce est plus intime, elle est personnelle. Le problème d’être une femme dans un milieu d’hommes, Isa le partage avec des millions d’autres femmes. Mais sa laideur, comme sa souffrance, lui appartiennent en propre : elle ne peut pas les partager, pire, elle ne peut pas aimer ou être aimée comme elle le voudrait. Un amour qui se cacherait derrière la pitié n’est pas vraiment de l’amour. Isa méprise les hommes qui ne voient dans les femmes que des objets de plaisir, et s’enferme dans une espèce de tour d’ivoire, fière et désespérée.
J’ai toujours frémi en pensant à ces handicapés profonds qui « ont conscience » de leur état. J’imagine que c’est la même chose pour ces personnes, hommes ou femmes, que le malheur, l’adversité, ou une malheureuse carte à la naissance ont condamnées.
Gilbert Cesbron, avec cet immense et magnifique esprit de compassion qu’on lui connaît, nous fait aimer cette petite sœur de Sarn dans sa recherche éperdue d’un amour impossible. Sa plume incisive et chaleureuse en même temps souligne la cruauté et l’absurdité des idées reçues devenues dogmes, des convictions imbéciles, des préceptes qui préfèrent une secrétaire avenante à une secrétaire efficace, où le paraître, encore une fois, passe avant l’être.
Isa-vraiment-belle est un des plus magnifiques portraits que l’auteur nous a donnés. La dernière scène est d’une superbe intensité.
Isabelle – ce merveilleux prénom est dur à porter, parfois – est deux fois disgraciée : elle est une femme dans un monde d’hommes, et elle est une jeune femme laide dans un monde d’hommes et de femmes qui se réfèrent à un canon en dehors duquel il n’y a pas de place. Laide, c’est même pire que ça : Isa a un corps sculptural, un corps de statue, mais elle est affligée, hélas d’un bec-de-lièvre. La Nature, ou le Créateur, ou qui vous voulez, fait preuve parfois d’une cruauté sans nom : Isa peut éveiller le désir mais comme disent les phallocrates : « c’est un remède contre l’amour ». Et l’Amour, Dieu sait si Isa en demande, elle le cherche, mais il se détourne. Mais un jour…
Gilbert Cesbron nous a habitués à des cas difficiles, parfois extrêmes. Ici il met en scène deux fléaux, deux injustices : celle, plusieurs fois millénaire, de la condition féminine, et celle tout aussi ancienne qui veut que le monde appartienne aux beaux aux forts, aux riches et aux intelligents, plutôt qu’aux laids, aux faibles, aux pauvres et aux ignorants.
En 1964, la défense des droits des femmes était encore à l’état embryonnaire (même si « Le Deuxième sexe » datait déjà de 1949) (on a un peu avancé, mais il y a encore du chemin à faire). Il fallait donc à Gilbert Cesbron un certain courage pour aborder ce sujet, à cette époque. Dans un monde d’hommes, façonné par eux à leur discrétion et à leur disposition, la femme est-elle autre chose qu’un « objet » ? D’accord, ce n’est pas « La Servante écarlate », et beaucoup d’hommes inconsciemment reprennent les gestes de leurs pères et de leurs grands-pères, tout comme beaucoup de femmes font comme maman et mamie… Mais ce n’est pas parce qu’il en a toujours été ainsi qu’il faut continuer. Question de dignité…
L’autre disgrâce est plus intime, elle est personnelle. Le problème d’être une femme dans un milieu d’hommes, Isa le partage avec des millions d’autres femmes. Mais sa laideur, comme sa souffrance, lui appartiennent en propre : elle ne peut pas les partager, pire, elle ne peut pas aimer ou être aimée comme elle le voudrait. Un amour qui se cacherait derrière la pitié n’est pas vraiment de l’amour. Isa méprise les hommes qui ne voient dans les femmes que des objets de plaisir, et s’enferme dans une espèce de tour d’ivoire, fière et désespérée.
J’ai toujours frémi en pensant à ces handicapés profonds qui « ont conscience » de leur état. J’imagine que c’est la même chose pour ces personnes, hommes ou femmes, que le malheur, l’adversité, ou une malheureuse carte à la naissance ont condamnées.
Gilbert Cesbron, avec cet immense et magnifique esprit de compassion qu’on lui connaît, nous fait aimer cette petite sœur de Sarn dans sa recherche éperdue d’un amour impossible. Sa plume incisive et chaleureuse en même temps souligne la cruauté et l’absurdité des idées reçues devenues dogmes, des convictions imbéciles, des préceptes qui préfèrent une secrétaire avenante à une secrétaire efficace, où le paraître, encore une fois, passe avant l’être.
Isa-vraiment-belle est un des plus magnifiques portraits que l’auteur nous a donnés. La dernière scène est d’une superbe intensité.
« Entre chiens et loups » est un livre les plus denses de Gilbert Cesbron. Injustement méconnu au profit d’autres titres, pleinement justifiés, d’ailleurs, il mérite d’être remis en lumière, non seulement pour la multiplicité de ses thèmes, d’une portée universelle et de toutes les époques, mais également pour la résonnance toute actuelle qu’il révèle.
Gilbert Cesbron est un homme de son temps. Il a pris comme ligne de vie la devise de Térence dans son « Heautontimorumenos » : « Homo sum ; humani nihil a me alienum puto » (Je suis un homme ; j'estime que rien d'humain ne m'est étranger). Les grands et les petits malheurs de son époque trouvent un écho chez lui, et lui, se voulant à la fois témoin et d’une certaine façon penseur (mais pas donneur de leçons), il nous fait partager ses joies et ses peines, ses espoirs et ses déceptions – qui sont aussi les nôtres.
En 1962, date où ce livre sort en librairie, la France et l’Algérie viennent de signer, en mars, les accords d’Evian, qui mettent fin à huit ans de conflit armé (et bien plus de guerres intestines). C’est dire si ce thème, qui est largement évoqué dans le roman, est prégnant dans l’esprit des lecteurs. Mais il est loin d’être le seul.
« Entre chiens et loups » (qui sont les « chiens » ? qui sont les « loups » ?) raconte l’histoire de Roland Guérin. C’est un professeur (de français) lambda, pas plus courageux ni plus lâche que les autres, mais qui se pose des questions sur tout un tas de choses, et notamment celle-ci : qu’est-ce que le vrai courage ? Il est vrai qu’il est le fils du commandant Guérin, un héros de guerre (on pense à « La Tradition Fontquernie »),et que son copain Georges a, lui, fait « le bon choix » en devenant officier de carrière. Mais Roland, dans sa nature profonde est un non-violent. Longtemps, dans l’anonymat, il a écrit des pamphlets antimilitaristes. Et puis un jour, il prend conscience que les motivations sont aussi recevables (ou irrecevables) des deux côtés. Il s’engage, et découvre alors le côté obscur de la guerre (sang, mort, torture, fin de l’innocence et massacre des innocents). Revenu en France et dans son lycée, il est toujours non-violent, et toujours dans le doute. C’est au cours d’une manifestation où figurent Algériens et Français qu’il va enfin faire face à son destin.
Voici un roman bouleversant. Il n’est pas le premier, Gilbert Cesbron nous a habitués depuis longtemps à partager l’univers de ses héros, à la fois banal, quelquefois comique, souvent tragique, dans lequel nous nous reconnaissons très souvent, soit que nous avons eu la même pensée, soit que nous avons vécus des évènements similaires, personnellement ou par personne interposée. Les questions que se posent Roland ne sont pas politiques, mais plutôt existentielles, elles tiennent simplement à la nature humaine : comment fait-on pour vivre quand on est celui qu’on est, pas celui qu’on voudrait être, ni celui que les autres voudraient qu’on soit. Parmi les thèmes abordés, en plus de la guerre et de ses horreurs, l’engagement peut être cité, le sens patriotique, tout ce qui fait qu’on peut, ou qu’on doit, « prendre parti ». Mais à mon avis, les deux thèmes majeurs qui sont évoqués sont le courage (qu’est-ce que le vrai courage ?) et surtout la violence, avec son corollaire la non-violence.
Ce qui fait de ce livre un livre d’actualité, c’est aussi ce fait qu’un homme ou une femme puisse clairement exprimer ses idées sans être mis dans la ligne de mire de la société (et pas seulement par les opposants à ses idées). Roland Guérin est un professeur qui ne sort de son rang que pour exprimer un point de vue humaniste et fraternel. Gilbert Cesbron aurait pu en faire un modèle chrétien (lui-même est un catholique convaincu), il en fait un modèle civil et surtout humain.
Pour tout ça, merci, monsieur Cesbron. Vous êtes un grand monsieur et un grand écrivain.
Gilbert Cesbron est un homme de son temps. Il a pris comme ligne de vie la devise de Térence dans son « Heautontimorumenos » : « Homo sum ; humani nihil a me alienum puto » (Je suis un homme ; j'estime que rien d'humain ne m'est étranger). Les grands et les petits malheurs de son époque trouvent un écho chez lui, et lui, se voulant à la fois témoin et d’une certaine façon penseur (mais pas donneur de leçons), il nous fait partager ses joies et ses peines, ses espoirs et ses déceptions – qui sont aussi les nôtres.
En 1962, date où ce livre sort en librairie, la France et l’Algérie viennent de signer, en mars, les accords d’Evian, qui mettent fin à huit ans de conflit armé (et bien plus de guerres intestines). C’est dire si ce thème, qui est largement évoqué dans le roman, est prégnant dans l’esprit des lecteurs. Mais il est loin d’être le seul.
« Entre chiens et loups » (qui sont les « chiens » ? qui sont les « loups » ?) raconte l’histoire de Roland Guérin. C’est un professeur (de français) lambda, pas plus courageux ni plus lâche que les autres, mais qui se pose des questions sur tout un tas de choses, et notamment celle-ci : qu’est-ce que le vrai courage ? Il est vrai qu’il est le fils du commandant Guérin, un héros de guerre (on pense à « La Tradition Fontquernie »),et que son copain Georges a, lui, fait « le bon choix » en devenant officier de carrière. Mais Roland, dans sa nature profonde est un non-violent. Longtemps, dans l’anonymat, il a écrit des pamphlets antimilitaristes. Et puis un jour, il prend conscience que les motivations sont aussi recevables (ou irrecevables) des deux côtés. Il s’engage, et découvre alors le côté obscur de la guerre (sang, mort, torture, fin de l’innocence et massacre des innocents). Revenu en France et dans son lycée, il est toujours non-violent, et toujours dans le doute. C’est au cours d’une manifestation où figurent Algériens et Français qu’il va enfin faire face à son destin.
Voici un roman bouleversant. Il n’est pas le premier, Gilbert Cesbron nous a habitués depuis longtemps à partager l’univers de ses héros, à la fois banal, quelquefois comique, souvent tragique, dans lequel nous nous reconnaissons très souvent, soit que nous avons eu la même pensée, soit que nous avons vécus des évènements similaires, personnellement ou par personne interposée. Les questions que se posent Roland ne sont pas politiques, mais plutôt existentielles, elles tiennent simplement à la nature humaine : comment fait-on pour vivre quand on est celui qu’on est, pas celui qu’on voudrait être, ni celui que les autres voudraient qu’on soit. Parmi les thèmes abordés, en plus de la guerre et de ses horreurs, l’engagement peut être cité, le sens patriotique, tout ce qui fait qu’on peut, ou qu’on doit, « prendre parti ». Mais à mon avis, les deux thèmes majeurs qui sont évoqués sont le courage (qu’est-ce que le vrai courage ?) et surtout la violence, avec son corollaire la non-violence.
Ce qui fait de ce livre un livre d’actualité, c’est aussi ce fait qu’un homme ou une femme puisse clairement exprimer ses idées sans être mis dans la ligne de mire de la société (et pas seulement par les opposants à ses idées). Roland Guérin est un professeur qui ne sort de son rang que pour exprimer un point de vue humaniste et fraternel. Gilbert Cesbron aurait pu en faire un modèle chrétien (lui-même est un catholique convaincu), il en fait un modèle civil et surtout humain.
Pour tout ça, merci, monsieur Cesbron. Vous êtes un grand monsieur et un grand écrivain.
Gilbert Cesbron, souvent, aborde des problèmes de société au travers de cas particuliers. D’autre fois, il s’attache à nous faire partager des sensibilités d’enfants, d’adolescents, de malades, de vieillards, de « morceaux d’humanité ». Et d’autre fois encore, comme dans « La Souveraine » il met l’accent sur les liens plus ou moins forts et plus ou moins ténus qui lient les êtres les uns avec les autres, ou qui lient les êtres avec certains lieux, ou qui lient les êtres avec leur passé.
« La Souveraine », c’est Mme R… Bien qu’elle se prénomme Marie (le plus beau des prénoms), on ne la connaît pas autrement dans le roman. Sans doute l’auteur a-t-il voulu porter son attention sur le personnage et sa fonction dans l’histoire, plutôt que sur l’être humain qui est derrière. Mme R… est souveraine du domaine de Boismort, le Château et le parc qui l’entoure. Autrefois c’était un château heureux, avec un « souverain » (Mr R…), une « souveraine » (Mme R…), et deux enfants royaux Hélène et Edgard. Mais Edgard est mort un jour dans un incendie, Mr. R… l’a suivi peu après, Hélène s’est mariée, et Mme R est restée seule souveraine de Boismort, avec l’homme de peine, Frédéric, que les enfants appellent Codic, l’homme des vignes Poindreau, surnommé Cangouine, et Mme Juliette, la bonne. Plus Armand, un ancien soupirant qui n’a jamais oublié... Mme R est souveraine d’un domaine qui se meurt… Mais voici que sa petite-fille Sybille, la fille d’Hélène, vient au château. Et le lien qui va s’établir entre Sybille et sa grand-mère est d’une si grande qualité qu’on pourrait même croire que tout va renaître comme avant… Mais le temps suit son chemin sans savoir ce que pense les gens…
C’est avec une infinie tendresse et une grande finesse psychologique que Gilbert Cesbron nous fait vivre ce lien entre la grand-mère et la petite fille. Il y a de l’affection, certes, mais il semble bien aussi que Mme R. (à moins que ce ne soit Marie) ait envie à passer à Sybille le relais de Boismort, dont un jour elle pourrait être souveraine : le domaine n’est pas seulement celui du château ni du parc, il est aussi celui de toute son histoire, et de celle de ses habitants…
« La Souveraine » est un roman sur le temps : sa fuite, bien entendu, mais aussi sa permanence, à travers le souvenir : Gilbert Cesbron nous dit qu’il y a corrélation entre le temps (passé, essentiellement), les lieux, et l’amour. Il nous le dit avec ses mots, toujours d’une extraordinaire justesse, des mots qui nous font d’emblée entrer dans la vie des personnages, comme s’ils étaient proches de nous. Tout cela sans mièvrerie, sans sensiblerie. Il peut y avoir du pathétique chez Cesbron, il n’y a jamais de pathos. Lisez Cesbron avec votre cœur autant qu’avec votre esprit, je vous garantis que vous ne le trouverez pas démodé. Son écriture toujours aussi fluide, se lit toujours très bien. Elle n’est pas dénuée, très souvent, d’une certaine poésie :
« Le vent fit trois fois le tour de la maison blanche sans rencontrer une seule issue. Des molletons étouffaient les rainures des fenêtres, feutraient les défauts des portes : la demeure entière vivait en pantoufles. Derrière chaque croisée, écluse de velours, des triples rideaux pesaient sur leurs embrasses et débordaient les cordelières à glands »
« Tant pis pour eux souffla le vent. Je leur portais le parfum de la dernière rose blanche. Ils préfèrent l’odeur du cigare… »
Cesbron reste un auteur méconnu. A redécouvrir d’urgence.
« La Souveraine », c’est Mme R… Bien qu’elle se prénomme Marie (le plus beau des prénoms), on ne la connaît pas autrement dans le roman. Sans doute l’auteur a-t-il voulu porter son attention sur le personnage et sa fonction dans l’histoire, plutôt que sur l’être humain qui est derrière. Mme R… est souveraine du domaine de Boismort, le Château et le parc qui l’entoure. Autrefois c’était un château heureux, avec un « souverain » (Mr R…), une « souveraine » (Mme R…), et deux enfants royaux Hélène et Edgard. Mais Edgard est mort un jour dans un incendie, Mr. R… l’a suivi peu après, Hélène s’est mariée, et Mme R est restée seule souveraine de Boismort, avec l’homme de peine, Frédéric, que les enfants appellent Codic, l’homme des vignes Poindreau, surnommé Cangouine, et Mme Juliette, la bonne. Plus Armand, un ancien soupirant qui n’a jamais oublié... Mme R est souveraine d’un domaine qui se meurt… Mais voici que sa petite-fille Sybille, la fille d’Hélène, vient au château. Et le lien qui va s’établir entre Sybille et sa grand-mère est d’une si grande qualité qu’on pourrait même croire que tout va renaître comme avant… Mais le temps suit son chemin sans savoir ce que pense les gens…
C’est avec une infinie tendresse et une grande finesse psychologique que Gilbert Cesbron nous fait vivre ce lien entre la grand-mère et la petite fille. Il y a de l’affection, certes, mais il semble bien aussi que Mme R. (à moins que ce ne soit Marie) ait envie à passer à Sybille le relais de Boismort, dont un jour elle pourrait être souveraine : le domaine n’est pas seulement celui du château ni du parc, il est aussi celui de toute son histoire, et de celle de ses habitants…
« La Souveraine » est un roman sur le temps : sa fuite, bien entendu, mais aussi sa permanence, à travers le souvenir : Gilbert Cesbron nous dit qu’il y a corrélation entre le temps (passé, essentiellement), les lieux, et l’amour. Il nous le dit avec ses mots, toujours d’une extraordinaire justesse, des mots qui nous font d’emblée entrer dans la vie des personnages, comme s’ils étaient proches de nous. Tout cela sans mièvrerie, sans sensiblerie. Il peut y avoir du pathétique chez Cesbron, il n’y a jamais de pathos. Lisez Cesbron avec votre cœur autant qu’avec votre esprit, je vous garantis que vous ne le trouverez pas démodé. Son écriture toujours aussi fluide, se lit toujours très bien. Elle n’est pas dénuée, très souvent, d’une certaine poésie :
« Le vent fit trois fois le tour de la maison blanche sans rencontrer une seule issue. Des molletons étouffaient les rainures des fenêtres, feutraient les défauts des portes : la demeure entière vivait en pantoufles. Derrière chaque croisée, écluse de velours, des triples rideaux pesaient sur leurs embrasses et débordaient les cordelières à glands »
« Tant pis pour eux souffla le vent. Je leur portais le parfum de la dernière rose blanche. Ils préfèrent l’odeur du cigare… »
Cesbron reste un auteur méconnu. A redécouvrir d’urgence.
« La tradition Fontquernie » (1947) est le troisième roman publié par Gilbert Cesbron, après « Les innocents de Paris » (1944) et « On croit rêver » (1945).
C’est un roman fort, comme les précédents, qui dépeint l’itinéraire d’un jeune homme qui « n’entre pas » dans le canon de sa famille : chez les Fontquernie, (et même « de » Fontquernie) on a une tradition aristocratique bien établie : l’honneur du nom, de la race, et de tout ce qui en porte l’apparence : le goût des armes, des chevaux, des sports virils, de la guerre… Antoine, le dernier des trois frères Fontquernie, ne se sent pas à sa place dans ce monde : il aime les livres plus que les chevaux, il est sensible, timide et réservé. Il n’aime pas parler haut et fort, ni commander. Il y a bien Isabelle, mais le pays du cœur est encore bien mystérieux... Pourtant, quand la guerre éclate (la drôle de guerre, en 39-40), il est prêt à faire son devoir comme ses frères. Et c’est au front qu’il apprendra la vérité sur sa naissance. Avant d’accomplir à son tour la tragique « tradition Fontquernie ».
Encore un livre, diront certains (toujours les mêmes) qui est daté, démodé et pas dans l’esprit du jour. Pourtant, c’est un magnifique témoignage sur se qui se passait pendant plusieurs générations dans des familles (pas toutes aristocratiques, d’ailleurs) où la tradition familiale était érigée en règle, et où y déroger était un crime de lèse-famille, punissable de bannissement. Antoine, bizarrement, ne connaît pas le poids de la tradition comme ses frères. On en apprend la raison au cours du roman. Mais pendant toute son enfance et toute son adolescence il a souffert de cette différence. Et quand il finit par en connaître la cause, il est trop tard.
Il y a deux thèmes dans ce livre : la tradition familiale lourde et pesante (différente de la « tradition » qui clôt le roman), et le syndrome du vilain petit canard qui n’est pas comme les autres. Gilbert Cesbron pose son regard à la fois critique et compatissant sur ces deux aspects du roman : la tradition n’est pas coupable en elle-même, c’est surtout que l’orgueil, l’amour-propre et l’égoïsme empêchent de voir ce qu’elle a de pernicieux et de dangereux pour des âmes moins fortes, et donc empêchent toute correction, tout aménagement. Et surtout excluent tout « dommage collatéral ». Le drame d’Antoine n'est pas tant d’être exclus de la tradition, mais d’en ignorer les raisons. Le plus dramatique, c’est que cela n’empêche pas l’amour entre les êtres.
Gilbert Cesbron, on le sait est un auteur d’une honnêteté morale sans faille. Il dresse ici un portrait critique (mais pas à charge) d’une certaine société, et, avec un beau sens de la psychologie, il présente un personnage « décalé », victime au fond d’une tragédie de type « antique », une fatalité que personne n’a vu venir, qui était pourtant inscrite dans l’histoire dès le début.
Gilbert Cesbron a ce don extraordinaire d’émouvoir sans pathos, par une extrême simplicité de mots, il touche le lecteur au cœur, sans aucun effet, et sans la mièvrerie que pourraient générer ces évènements mélodramatiques et tragiques.
C’est une chose un peu oubliée aujourd’hui, ça s’appelle la pudeur.
C’est un roman fort, comme les précédents, qui dépeint l’itinéraire d’un jeune homme qui « n’entre pas » dans le canon de sa famille : chez les Fontquernie, (et même « de » Fontquernie) on a une tradition aristocratique bien établie : l’honneur du nom, de la race, et de tout ce qui en porte l’apparence : le goût des armes, des chevaux, des sports virils, de la guerre… Antoine, le dernier des trois frères Fontquernie, ne se sent pas à sa place dans ce monde : il aime les livres plus que les chevaux, il est sensible, timide et réservé. Il n’aime pas parler haut et fort, ni commander. Il y a bien Isabelle, mais le pays du cœur est encore bien mystérieux... Pourtant, quand la guerre éclate (la drôle de guerre, en 39-40), il est prêt à faire son devoir comme ses frères. Et c’est au front qu’il apprendra la vérité sur sa naissance. Avant d’accomplir à son tour la tragique « tradition Fontquernie ».
Encore un livre, diront certains (toujours les mêmes) qui est daté, démodé et pas dans l’esprit du jour. Pourtant, c’est un magnifique témoignage sur se qui se passait pendant plusieurs générations dans des familles (pas toutes aristocratiques, d’ailleurs) où la tradition familiale était érigée en règle, et où y déroger était un crime de lèse-famille, punissable de bannissement. Antoine, bizarrement, ne connaît pas le poids de la tradition comme ses frères. On en apprend la raison au cours du roman. Mais pendant toute son enfance et toute son adolescence il a souffert de cette différence. Et quand il finit par en connaître la cause, il est trop tard.
Il y a deux thèmes dans ce livre : la tradition familiale lourde et pesante (différente de la « tradition » qui clôt le roman), et le syndrome du vilain petit canard qui n’est pas comme les autres. Gilbert Cesbron pose son regard à la fois critique et compatissant sur ces deux aspects du roman : la tradition n’est pas coupable en elle-même, c’est surtout que l’orgueil, l’amour-propre et l’égoïsme empêchent de voir ce qu’elle a de pernicieux et de dangereux pour des âmes moins fortes, et donc empêchent toute correction, tout aménagement. Et surtout excluent tout « dommage collatéral ». Le drame d’Antoine n'est pas tant d’être exclus de la tradition, mais d’en ignorer les raisons. Le plus dramatique, c’est que cela n’empêche pas l’amour entre les êtres.
Gilbert Cesbron, on le sait est un auteur d’une honnêteté morale sans faille. Il dresse ici un portrait critique (mais pas à charge) d’une certaine société, et, avec un beau sens de la psychologie, il présente un personnage « décalé », victime au fond d’une tragédie de type « antique », une fatalité que personne n’a vu venir, qui était pourtant inscrite dans l’histoire dès le début.
Gilbert Cesbron a ce don extraordinaire d’émouvoir sans pathos, par une extrême simplicité de mots, il touche le lecteur au cœur, sans aucun effet, et sans la mièvrerie que pourraient générer ces évènements mélodramatiques et tragiques.
C’est une chose un peu oubliée aujourd’hui, ça s’appelle la pudeur.
« Les Innocents de Paris » est le premier roman de Gilbert Cesbron. L’auteur a 29 ans en 1942. Le roman ne parle pas d’Occupation ni de Résistance. Bien au contraire il nous transporte dans un autre Paris, vingt ans auparavant, Un Paris totalement différent, bien entendu, et d’autant plus qu’il est vécu à hauteur d’enfant.
Le Paris de 1923 est encore celui des « fortifs », cette ceinture de fortifications censées empêcher l’entrée dans Paris de toute armée étrangère. Gilbert Cesbron situe l’action de son roman dans le XVIIème arrondissement, de part et d’autre du Boulevard Pereire (en gros entre le boulevard des Maréchaux au Nord et la Plaine Monceau au Sud). La ville de pierre et de béton se situe plus loin : ici c’est la « Cité de bois », une agglomération faite de cabanes au milieu de terrains vagues et de jardins potagers. C’est le territoire d’une bande de gamins qui bien entendu rêvent d’aventures, ont les yeux plus gros que le ventre, et font de leur cabane en planches une île au trésor. Pour ces aventuriers de la dèche, les occasions d’aventure sont rares, il faut se les inventer : c’est ainsi qu’on projette des expéditions dans des pays lointains, au-delà des boulevards, ou dans la Plaine Monceau, pour se frotter aux enfants bourgeois. Et parfois ces expéditions tournent au vinaigre…
Les enfants, ces « Innocents de Paris », occupent tout le devant de la scène. Les adultes, quand ils entrent dans le décor, sont souvent réduits au rôle de silhouettes, sauf peut-être quelques-uns dont M. Veûf, qui est leur ami. Peu de femmes (il n’y a pas de fillettes dans la bande), mais une bande de six de garçons, Le Gosse, Martin, Cypriano, Vévu (qui a un feveu fur la langue), Milord, et Lancelot, qui font leur apprentissage de petits hommes.
Gilbert Cesbron, on le sait, a toujours un regard passionné sur l’enfance, et encore plus sur l’enfance malheureuse ou déshéritée. Il restitue avec une infini tendresse tous les sentiments multiples et contradictoires qui animent ces enfants, dans des situations difficiles, sans doute, mais pas malheureux parce que, n’ayant pas le souci de l’avenir, ils vivent pleinement le présent. Sauf, bien entendu quand ils sont confrontés à des difficultés plus grandes qu’eux, ou pire, à l’inéluctable. Il faut s’appeler Gilbert Cesbron pour cerner avec compassion, pudeur et finesse, ce qui se passe dans ces petites têtes…
Au milieu des pérégrinations enfantines, un moment fort s’impose à nous. Alors que Martin est en « expédition » chez un photographe, il tombe sur un vieillard qui lui raconte la Commune de Paris, à laquelle il a pris part. Moment d’Histoire saisissant, qui vaut tous les exposés en salle de classe.
Pour un livre qui va avoir quatre-vingts ans, il reste remarquablement écrit, et facile à lire. La raison essentielle ne vient pas seulement de l’écriture (limpide et très vivante) mais du thème même de l’enfance qui, de quelque côté qu’on le prenne, nous saisit toujours de la même émotion : l’auteur nous renvoie à notre propre enfance, et à cette innocence (qui justifie le titre du roman), innocence qui n’existe qu’à cet âge et que malgré nos efforts, nous ne retrouverons pas. Et puis, ce roman est encore un roman d’initiation : comment nos petits héros apprennent la vie, à travers ses joies et ses peines…
Gilbert Cesbron écrit ici son premier roman, et c’est un premier succès. Il y en aura beaucoup d’autres, et la raison de ce succès est bien connue : il s’adresse autant au cœur qu’à l’esprit. Gilbert Cesbron nous touche et nous émeut en même temps qu’il nous informe et nous alerte, tout en nous divertissant. Merci, monsieur Cesbron.
Le Paris de 1923 est encore celui des « fortifs », cette ceinture de fortifications censées empêcher l’entrée dans Paris de toute armée étrangère. Gilbert Cesbron situe l’action de son roman dans le XVIIème arrondissement, de part et d’autre du Boulevard Pereire (en gros entre le boulevard des Maréchaux au Nord et la Plaine Monceau au Sud). La ville de pierre et de béton se situe plus loin : ici c’est la « Cité de bois », une agglomération faite de cabanes au milieu de terrains vagues et de jardins potagers. C’est le territoire d’une bande de gamins qui bien entendu rêvent d’aventures, ont les yeux plus gros que le ventre, et font de leur cabane en planches une île au trésor. Pour ces aventuriers de la dèche, les occasions d’aventure sont rares, il faut se les inventer : c’est ainsi qu’on projette des expéditions dans des pays lointains, au-delà des boulevards, ou dans la Plaine Monceau, pour se frotter aux enfants bourgeois. Et parfois ces expéditions tournent au vinaigre…
Les enfants, ces « Innocents de Paris », occupent tout le devant de la scène. Les adultes, quand ils entrent dans le décor, sont souvent réduits au rôle de silhouettes, sauf peut-être quelques-uns dont M. Veûf, qui est leur ami. Peu de femmes (il n’y a pas de fillettes dans la bande), mais une bande de six de garçons, Le Gosse, Martin, Cypriano, Vévu (qui a un feveu fur la langue), Milord, et Lancelot, qui font leur apprentissage de petits hommes.
Gilbert Cesbron, on le sait, a toujours un regard passionné sur l’enfance, et encore plus sur l’enfance malheureuse ou déshéritée. Il restitue avec une infini tendresse tous les sentiments multiples et contradictoires qui animent ces enfants, dans des situations difficiles, sans doute, mais pas malheureux parce que, n’ayant pas le souci de l’avenir, ils vivent pleinement le présent. Sauf, bien entendu quand ils sont confrontés à des difficultés plus grandes qu’eux, ou pire, à l’inéluctable. Il faut s’appeler Gilbert Cesbron pour cerner avec compassion, pudeur et finesse, ce qui se passe dans ces petites têtes…
Au milieu des pérégrinations enfantines, un moment fort s’impose à nous. Alors que Martin est en « expédition » chez un photographe, il tombe sur un vieillard qui lui raconte la Commune de Paris, à laquelle il a pris part. Moment d’Histoire saisissant, qui vaut tous les exposés en salle de classe.
Pour un livre qui va avoir quatre-vingts ans, il reste remarquablement écrit, et facile à lire. La raison essentielle ne vient pas seulement de l’écriture (limpide et très vivante) mais du thème même de l’enfance qui, de quelque côté qu’on le prenne, nous saisit toujours de la même émotion : l’auteur nous renvoie à notre propre enfance, et à cette innocence (qui justifie le titre du roman), innocence qui n’existe qu’à cet âge et que malgré nos efforts, nous ne retrouverons pas. Et puis, ce roman est encore un roman d’initiation : comment nos petits héros apprennent la vie, à travers ses joies et ses peines…
Gilbert Cesbron écrit ici son premier roman, et c’est un premier succès. Il y en aura beaucoup d’autres, et la raison de ce succès est bien connue : il s’adresse autant au cœur qu’à l’esprit. Gilbert Cesbron nous touche et nous émeut en même temps qu’il nous informe et nous alerte, tout en nous divertissant. Merci, monsieur Cesbron.
Des enfants, il y en a dans tous les livres de Gilbert Cesbron. Le premier roman écrit par l’auteur, en 1944 s’intitulait déjà « Les innocents de Paris » et racontait l’histoire d’une poignée de titis, de poulbots, d’enfants de la rue qui survivaient dans les quartiers déshérités de la capitale. Le ton était donné à l’œuvre : l’enfance ne quittera plus Gilbert Cesbron. Et ce titre : « Les innocents de Paris » est tout un programme » : l’enfance, c’est l’innocence. C’est la société qui, au fur et à mesure de l’évolution de l’enfant, le modèle, le sculpte, et parfois le pervertit. Vision rousseauiste, sans doute, mais transcendée par Cesbron avec cet élément capital qu’est l’amour, qui peut arriver à corriger, ou du moins atténuer, les vicissitudes de l’existence.
« Mais moi je vous aimais » en est la démonstration.
Yann est un petit garçon de sept ans au début de l’histoire. Il est comme on dit « un peu spécial ». Notre langue de bois d’aujourd’hui dirait avec cynisme et cruauté, tout en étant dans le vrai : « c’est un handicapé léger ». Nous sommes dans les années 70, la psychiatrie infantile avait fait quelques progrès depuis les fadas et les innocents de village, mais quand on n’était « pas comme les autres », on vous le faisait sentir. Yann l’apprend à ses dépens quand on le traite de tous les noms, oh gentiment, personne ne lui veut de mal, mais « c’est juste que… » Un seul homme lui accordera un regard différent, Jean-Louis. Mais la société des « gens normaux », des « neurotypiques » comme on dit chez les autistes, n’est pas prête à accueillir les gens « anormaux » (ça c’est le terme cru et abominable qu’on utilise couramment).
Le thème du roman, il est dans le titre : « Mais moi je vous aimais » : Il ne s’agit pas ici seulement d’un roman qui parle d’un cas particulier, d’un cas clinique : c’est un roman d’amour. L’amour impossible et immense qu’un petit garçon veut donner et que personne ne veut recevoir, ni même voir. Le handicap de Yann n’est pas si profond qu’il empêche les sentiments, au contraire, il les amplifie et sa demande d’amour est infinie. D’autant plus que s’il demande de l’amour, il est également prêt à en donner. Des tonnes. Mais en face, les gens « normaux », « sages » « intelligents » ont décrété qu’il n’y avait rien à tirer de cette tête de bois, et surtout pas un sentiment quelconque : « Le petit con » c’est ainsi qu’on l’appelle, sans méchanceté, mais sans affection.
Il n’y a qu’un autre assoiffé d’amour qui peut répondre. Mais est-ce suffisant. Les gens qui refusent de voir la vérité en face, ou de la voir différemment, sont contre eux. Mais au-delà d’eux il y a la machine à emboutir de Saint-Ex, l’Administration, le Règlement, la Loi, tout ce qui met les choses dans un ordre établi, en dehors duquel on est rejeté. Et cette machine-là, bien qu’elle soit animée par des hommes et des femmes, ne connaît pas l’amour. L’amour, la compréhension, le dialogue, la main tendue, ce sont des notions d’êtres humains (en principe) et pas des notions de machines…
Le drame de Yann est donc l’incompréhension : il aime tant et voudrait tant être aimé en retour. Mais l’incompréhension est également dans le cas d’en face, et se traduit de plus par le refus, par peur, par bêtise, par conformisme idiot… Et pourtant, il suffirait d’aimer…
Gilbert Cesbron est le romancier de l’enfance, de l’enfance malheureuse en particulier, c’est aussi le romancier du partage, de la compréhension mutuelle, de l’acceptation de la différence, et de l’amour.
Un roman certes, à replacer dans son époque (le suivi de tels enfants est beaucoup mieux assuré aujourd’hui, même s’il y a encore beaucoup de progrès à faire), un roman un peu daté par son style parfois appuyé (Cesbron sait être pathétique sans toutefois tomber dans le pathos), mais d’une force émotionnelle qui n’a pas pris une ride. Un roman qui ne peut laisser personne indifférent.
« Mais moi je vous aimais » en est la démonstration.
Yann est un petit garçon de sept ans au début de l’histoire. Il est comme on dit « un peu spécial ». Notre langue de bois d’aujourd’hui dirait avec cynisme et cruauté, tout en étant dans le vrai : « c’est un handicapé léger ». Nous sommes dans les années 70, la psychiatrie infantile avait fait quelques progrès depuis les fadas et les innocents de village, mais quand on n’était « pas comme les autres », on vous le faisait sentir. Yann l’apprend à ses dépens quand on le traite de tous les noms, oh gentiment, personne ne lui veut de mal, mais « c’est juste que… » Un seul homme lui accordera un regard différent, Jean-Louis. Mais la société des « gens normaux », des « neurotypiques » comme on dit chez les autistes, n’est pas prête à accueillir les gens « anormaux » (ça c’est le terme cru et abominable qu’on utilise couramment).
Le thème du roman, il est dans le titre : « Mais moi je vous aimais » : Il ne s’agit pas ici seulement d’un roman qui parle d’un cas particulier, d’un cas clinique : c’est un roman d’amour. L’amour impossible et immense qu’un petit garçon veut donner et que personne ne veut recevoir, ni même voir. Le handicap de Yann n’est pas si profond qu’il empêche les sentiments, au contraire, il les amplifie et sa demande d’amour est infinie. D’autant plus que s’il demande de l’amour, il est également prêt à en donner. Des tonnes. Mais en face, les gens « normaux », « sages » « intelligents » ont décrété qu’il n’y avait rien à tirer de cette tête de bois, et surtout pas un sentiment quelconque : « Le petit con » c’est ainsi qu’on l’appelle, sans méchanceté, mais sans affection.
Il n’y a qu’un autre assoiffé d’amour qui peut répondre. Mais est-ce suffisant. Les gens qui refusent de voir la vérité en face, ou de la voir différemment, sont contre eux. Mais au-delà d’eux il y a la machine à emboutir de Saint-Ex, l’Administration, le Règlement, la Loi, tout ce qui met les choses dans un ordre établi, en dehors duquel on est rejeté. Et cette machine-là, bien qu’elle soit animée par des hommes et des femmes, ne connaît pas l’amour. L’amour, la compréhension, le dialogue, la main tendue, ce sont des notions d’êtres humains (en principe) et pas des notions de machines…
Le drame de Yann est donc l’incompréhension : il aime tant et voudrait tant être aimé en retour. Mais l’incompréhension est également dans le cas d’en face, et se traduit de plus par le refus, par peur, par bêtise, par conformisme idiot… Et pourtant, il suffirait d’aimer…
Gilbert Cesbron est le romancier de l’enfance, de l’enfance malheureuse en particulier, c’est aussi le romancier du partage, de la compréhension mutuelle, de l’acceptation de la différence, et de l’amour.
Un roman certes, à replacer dans son époque (le suivi de tels enfants est beaucoup mieux assuré aujourd’hui, même s’il y a encore beaucoup de progrès à faire), un roman un peu daté par son style parfois appuyé (Cesbron sait être pathétique sans toutefois tomber dans le pathos), mais d’une force émotionnelle qui n’a pas pris une ride. Un roman qui ne peut laisser personne indifférent.
A la fin de « Terre des Hommes », (que nous devrions tous avoir lu au moins une fois dans notre vie) Saint-Ex disait :
« Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres et je me dis : voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie… » Puis, plus loin : « Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie, dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. » Puis encore plus loin : « Et je regagnai mon wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère de leur sort. Et ce n’est point la charité ici qui me tourmente. Il ne s’agit point de s’attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C’est quelque chose comme l’espèce humaine et non l’individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c’est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n’est point cette misère, dans laquelle, après tout, on s’installe aussi bien que dans la paresse. Des générations d’Orientaux vivent dans la crasse et s’y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. »
C’est dans ce texte que Gilbert Cesbron a trouvé le titre de son roman. Cesbron n’est jamais mauvais. Il est quelquefois moins bon, mais il n’est jamais meilleur que quand il parle des enfants. Ses meilleurs romans sont souvent ceux où ils se penchent sur le cas d’enfants : malheureux, pauvres, déclassés, disgraciés physiquement ou mentalement, ou comme ici ballotés, déchirés entre deux parents en instance de divorce. Encore une fois il est inexact de dire que Cesbron traite de « cas sociaux » ou de « phénomènes de société », inévitablement, en élargissant le débat, il est vrai qu’on en arrive là, mais au départ, Cesbron parle de gens, de personnes, d’enfants qu’il a connus ou dont on lui a raconté l’histoire. Et c’est cette histoire qu’il nous raconte à son tour, avec toute sa compassion, sa tendresse et son humanité.
Martin a sept ans. Ses parents sont en instance de divorce. En sortant de l’audience de conciliation, Agnès, sa maman, a un malaise et ne peut garder le petit garçon. Marc, le papa, le confie à son propre père, le grand-père de l’enfant, puis, voyant que l’état d’Agnès ne s’améliore pas, à Nounou Perraut, l’ancienne nourrice d’Agnès qui vit à la campagne. Martin est ravi de cette vie dans la nature, même si Nounou Perraut vit dans la précarité dans une ferme insalubre. Marc, horrifié, reprend Martin avec lui et le remet au grand-père. Celui-ci, âgé et malade, meurt d’une crise cardiaque. Marc se tourne alors vers Alain, le parrain de Marc. Un week-end où il se retrouve seul, Martin s’enfuit veut retourner chez Nounou Perrault, mais se perd et échoue… chez Marion, la maîtresse de Marc. Celle-ci appelle Alain, le dernier « hébergeur » de Martin. Elle leur confie le soin à tous deux de dire à Marc qu’elle ne l’aime plus. D’ailleurs, Marc et Agnès, bousculés par tous ces évènements et conscients des conséquences qu’en subit Martin, décident de se donner une deuxième chance.
Une fin heureuse, finalement, dans une histoire (un divorce) où il n’y a que des perdants : le père, la mère, la maîtresse, et indirectement le grand-père, la nounou et le parrain, et surtout Martin première victime d’une bataille dont il est à la fois l’enjeu l’exclusion. Martin c’est l’incompris, c’est aussi celui qui ne comprend pas, dans toute sa pureté, dans toute son innocence ce qui se passe autour de lui. Le plus triste, dans ce divorce (et sans doute dans la majorité des divorces), c’est que ce n’est pas l’amour qui est mis en question, il y a de l’amour dans l’air et de la part de tous les personnages, mais des égoïsmes mesquins, de mauvais calculs, et de l’aveuglement. Il faut être Gilbert Cesbron pour saisir tout cela et nous le restituer avec tant d’émotion, de générosité et de tendresse.
Les enfants du divorce passent aujourd’hui par les mêmes difficulté, pire même, parce que les égoïsmes sont sans doute plus pointus que dans les années 60. C’est pourquoi ce roman, même si l’écriture est un peu désuète, ne sera jamais démodé.
« Je me penchai sur ce front lisse, sur cette douce moue des lèvres et je me dis : voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie… » Puis, plus loin : « Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie, dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. » Puis encore plus loin : « Et je regagnai mon wagon. Je me disais : ces gens ne souffrent guère de leur sort. Et ce n’est point la charité ici qui me tourmente. Il ne s’agit point de s’attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C’est quelque chose comme l’espèce humaine et non l’individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c’est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n’est point cette misère, dans laquelle, après tout, on s’installe aussi bien que dans la paresse. Des générations d’Orientaux vivent dans la crasse et s’y plaisent. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C’est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. »
C’est dans ce texte que Gilbert Cesbron a trouvé le titre de son roman. Cesbron n’est jamais mauvais. Il est quelquefois moins bon, mais il n’est jamais meilleur que quand il parle des enfants. Ses meilleurs romans sont souvent ceux où ils se penchent sur le cas d’enfants : malheureux, pauvres, déclassés, disgraciés physiquement ou mentalement, ou comme ici ballotés, déchirés entre deux parents en instance de divorce. Encore une fois il est inexact de dire que Cesbron traite de « cas sociaux » ou de « phénomènes de société », inévitablement, en élargissant le débat, il est vrai qu’on en arrive là, mais au départ, Cesbron parle de gens, de personnes, d’enfants qu’il a connus ou dont on lui a raconté l’histoire. Et c’est cette histoire qu’il nous raconte à son tour, avec toute sa compassion, sa tendresse et son humanité.
Martin a sept ans. Ses parents sont en instance de divorce. En sortant de l’audience de conciliation, Agnès, sa maman, a un malaise et ne peut garder le petit garçon. Marc, le papa, le confie à son propre père, le grand-père de l’enfant, puis, voyant que l’état d’Agnès ne s’améliore pas, à Nounou Perraut, l’ancienne nourrice d’Agnès qui vit à la campagne. Martin est ravi de cette vie dans la nature, même si Nounou Perraut vit dans la précarité dans une ferme insalubre. Marc, horrifié, reprend Martin avec lui et le remet au grand-père. Celui-ci, âgé et malade, meurt d’une crise cardiaque. Marc se tourne alors vers Alain, le parrain de Marc. Un week-end où il se retrouve seul, Martin s’enfuit veut retourner chez Nounou Perrault, mais se perd et échoue… chez Marion, la maîtresse de Marc. Celle-ci appelle Alain, le dernier « hébergeur » de Martin. Elle leur confie le soin à tous deux de dire à Marc qu’elle ne l’aime plus. D’ailleurs, Marc et Agnès, bousculés par tous ces évènements et conscients des conséquences qu’en subit Martin, décident de se donner une deuxième chance.
Une fin heureuse, finalement, dans une histoire (un divorce) où il n’y a que des perdants : le père, la mère, la maîtresse, et indirectement le grand-père, la nounou et le parrain, et surtout Martin première victime d’une bataille dont il est à la fois l’enjeu l’exclusion. Martin c’est l’incompris, c’est aussi celui qui ne comprend pas, dans toute sa pureté, dans toute son innocence ce qui se passe autour de lui. Le plus triste, dans ce divorce (et sans doute dans la majorité des divorces), c’est que ce n’est pas l’amour qui est mis en question, il y a de l’amour dans l’air et de la part de tous les personnages, mais des égoïsmes mesquins, de mauvais calculs, et de l’aveuglement. Il faut être Gilbert Cesbron pour saisir tout cela et nous le restituer avec tant d’émotion, de générosité et de tendresse.
Les enfants du divorce passent aujourd’hui par les mêmes difficulté, pire même, parce que les égoïsmes sont sans doute plus pointus que dans les années 60. C’est pourquoi ce roman, même si l’écriture est un peu désuète, ne sera jamais démodé.
Si vous êtes chrétien ou si vous l’avez été, si vous ne l’êtes pas mais que vous avez un esprit ouvert et que vous acceptez qu’il puisse y avoir d’autre points de vue que le vôtre (et aussi valable, cela va sans dire), vous pourrez entrer dans ce livre sans trop de problème. Si au contraire vous êtes réfractaire à toute spiritualité, vous risquez d’être rebuté dès les premiers chapitres. Eh oui, on le sait, Gilbert Cesbron est un auteur chrétien, et de plus militant. Dans les années 50 et 60, la religion pesait encore dans la société. Mais Cesbron n’est pas tout à fait comme les écrivains de sa génération : son combat est avant tout humain : il ne fait pas de catéchisme, il prêche par l’exemple, et il cherche à comprendre avant de juger. Cette vision résolument « humaniste » lui a valu le surnom de « chrétien de gauche », d’autant plus qu’il dénonce les grands scandales de son époque (et de la nôtre, hélas !)
« Vous verrez le ciel ouvert » pose clairement le problème de la foi. Or, c’est un problème personnel, c’est un choix intime, personne n’est autorisé à nous dire pour qui il faut croire (c’est exactement comme pour le vote) mais on nous donne le choix. Les raisons qui nous poussent à faire ce choix ne regardent que nous.
Nous sommes donc dans les années 50, dans un pays de montagne où la vie n’est pas facile : un chantier énorme où les ouvriers sont exploités et meurent parfois sur le lieu de travail, des villageois excédés par les expropriations et la rapacité des financiers, un curé qui voit son église désertée, on sent qu’il va se passer quelque chose. C’est Odette, la fille du cafetier qui va déclencher toute l’affaire. C’est une ado perdue, entre un père indifférent et une mère impotente et malade, qu’elle désespère de voir guérir un jour. Ayant vu un film sur Bernadette Soubirous, elle déclare avoir vu la Vierge, et déclenche ainsi tout le processus des apparitions.
Qu’est-ce qui fait qu’on croit ou qu’on ne croit pas ? Odette a-t-elle agi par calcul, voire par perversité pour punir tous ceux qui la dédaignent ? Le sait-elle seulement elle-même ? Ou bien est-ce l’amour pour sa mère qui la pousse à croire si fort qu’elle « force le Ciel » ? Ou bien n’est-ce pas une névrose qui crée des hallucinations ? Où est la vérité et où est l’illusion ? Et s’il y a illusion, à qui est-elle destinée ? Les protagonistes du roman se posent ces questions, en fonction de leurs propres croyances et de leurs propres doutes.
La foi n’est pas le seul sujet de ce roman fort, révoltant et sacrément interrogateur : le scandale des chantiers assassins, le déni de dignité de tous ces personnages pathétiques, la commercialisation du « miracle » … Gilbert Cesbron n’oublie rien, ni personne, ni même les failles de son propre camp. Nous avons eu souvent l’occasion de le souligner dans d‘autres chroniques, c’est un auteur sans doute désuet et passé de mode, (encore que son message soit toujours d’actualité), mais il reste un témoin privilégié de son époque, qu’il restitue avec une scrupuleuse honnêteté.
Un roman donc, à lire avec autant d’honnêteté qu’il a été écrit : sans préjugés, et avec plus de compassion que de critique stérile.
« Vous verrez le ciel ouvert » pose clairement le problème de la foi. Or, c’est un problème personnel, c’est un choix intime, personne n’est autorisé à nous dire pour qui il faut croire (c’est exactement comme pour le vote) mais on nous donne le choix. Les raisons qui nous poussent à faire ce choix ne regardent que nous.
Nous sommes donc dans les années 50, dans un pays de montagne où la vie n’est pas facile : un chantier énorme où les ouvriers sont exploités et meurent parfois sur le lieu de travail, des villageois excédés par les expropriations et la rapacité des financiers, un curé qui voit son église désertée, on sent qu’il va se passer quelque chose. C’est Odette, la fille du cafetier qui va déclencher toute l’affaire. C’est une ado perdue, entre un père indifférent et une mère impotente et malade, qu’elle désespère de voir guérir un jour. Ayant vu un film sur Bernadette Soubirous, elle déclare avoir vu la Vierge, et déclenche ainsi tout le processus des apparitions.
Qu’est-ce qui fait qu’on croit ou qu’on ne croit pas ? Odette a-t-elle agi par calcul, voire par perversité pour punir tous ceux qui la dédaignent ? Le sait-elle seulement elle-même ? Ou bien est-ce l’amour pour sa mère qui la pousse à croire si fort qu’elle « force le Ciel » ? Ou bien n’est-ce pas une névrose qui crée des hallucinations ? Où est la vérité et où est l’illusion ? Et s’il y a illusion, à qui est-elle destinée ? Les protagonistes du roman se posent ces questions, en fonction de leurs propres croyances et de leurs propres doutes.
La foi n’est pas le seul sujet de ce roman fort, révoltant et sacrément interrogateur : le scandale des chantiers assassins, le déni de dignité de tous ces personnages pathétiques, la commercialisation du « miracle » … Gilbert Cesbron n’oublie rien, ni personne, ni même les failles de son propre camp. Nous avons eu souvent l’occasion de le souligner dans d‘autres chroniques, c’est un auteur sans doute désuet et passé de mode, (encore que son message soit toujours d’actualité), mais il reste un témoin privilégié de son époque, qu’il restitue avec une scrupuleuse honnêteté.
Un roman donc, à lire avec autant d’honnêteté qu’il a été écrit : sans préjugés, et avec plus de compassion que de critique stérile.
Certains romanciers sont dans la fiction pure et simple. D’autres combinent les histoires romanesques avec un regard de témoin sur le monde qui les entoure. Gilbert Cesbron est de ces derniers : les histoires qu’il nous raconte sont ancrées dans la réalité. Il peut y avoir de la poésie chez Gilbert Cesbron, il peut y avoir du rêve ou de la féérie (pas souvent mais ça peut arriver, surtout avec les enfants), mais il n’y aura jamais de tricherie : les situations qu’il décrit, les personnages qu’il peint, ont leurs modèles dans la vraie vie. On a dit de ce grand écrivain qu’il s’attaquait à de grands thèmes de société : le cancer, le mal-être des ados, l’enfance délinquante, le racisme, etc. Mais non, c’est tout le contraire : Cesbron n’écrit pas sur des « thèmes », il écrit sur des « gens », malades, vieux, condamnés par la justice ou la société, rejetés parce que ceci, ou cela ou encore cela… Ces gens ont existé et à travers eux, l’auteur aborde avec intelligence, pudeur et souvent compassion, ces maux de notre époque (de la sienne, en fait, mais s’il vivait aujourd’hui il aurait encore du grain à moudre). Alors oui, Gilbert Cesbron est bien témoin de ce siècle qui « appelle au secours » pour citer un de ses essais. Un témoin actif qui appelle au réveil des consciences.
« Avoir été » (1960) est un des romans les plus percutants de Gilbert Cesbron. Le titre, cet infinitif passé, indique clairement le sujet ; non pas le temps qui passe, mais le temps passé, ou plus exactement, la constatation que le temps a passé. On dit que la vieillesse est un naufrage. Le naufrage n’est pas tant la décrépitude, l’âge, la maladie, la perte des repères, tout ça au bout du compte fait partie d’une certaine logique, (aussi inacceptable que l’inéluctable ou la mort, je vous l’accorde), le naufrage, c’est quand on se rend compte qu’on a été, qu’on a vécu, et qu’on n’a pas rempli son contrat avec la vie comme on aurait voulu, ou comme on aurait dû. Oh je sais, il y a des vieillards heureux, ou qui se disent tels, mais ce ne sont pas eux les naufragés.
Kléber vit au quotidien cette situation : il a vécu et bien vécu, il a assumé sa vie et n’a rien à se reprocher, bien au contraire puisqu’il a recueilli Patrick, orphelin de guerre (la seconde, Kléber, lui c’était la première) mais face à l’appétit de vie du gamin, il est désemparé, il n’a pas les mêmes cartes, il n’a plus de « répondant ». Avant, dans le temps d’avant, il savait gérer, maintenant il ne sait plus, tout a changé : le jeu, les cartes et les joueurs. Et puis on ne peut pas se contenter d’accepter sans rien dire, on est obligé de se poser la question « Qu’est-ce que j’ai raté ? »
La même histoire, racontée aujourd’hui, devrait prendre en compte, en plus du drame intime de la vieillesse, (même dans un environnement favorable), et en plus du conflit des générations, la maladie, cette mort lente qu’on appelle Alzheimer, qui détruit le malade et use de façon pernicieuse et inéluctable toute la bonne volonté, toute l’abnégation et tout l’amour des accompagnants. Chacun de nous de près ou de loin a été ou sera un jour confronté à ce problème. Si Gilbert Cesbron avait vécu, il est certain qu’il aurait fait de ce sujet un roman majeur, une pièce de théâtre bouleversante, un essai porteur de questions…
Cesbron n’est pas un auteur drôle, ses romans ont toujours une part de tragique : nous l’avons dit, Cesbron est un témoin et le monde autour de nous est tragique, non seulement dans le présent mais dans l’avenir que nous nous préparons, et que d’une certaine façon, nous aurons mérité. Mais Gilbert Cesbron en même temps est un auteur infiniment attachant, parce que bon et compatissant, bien sûr, et aussi parce que porteur d’espérance. En plus c’est un merveilleux écrivain au ton familier et direct qui s’adresse directement au cœur du lecteur autant qu’à son esprit. Et ce n’est pas donné à tout le monde !
« Avoir été » (1960) est un des romans les plus percutants de Gilbert Cesbron. Le titre, cet infinitif passé, indique clairement le sujet ; non pas le temps qui passe, mais le temps passé, ou plus exactement, la constatation que le temps a passé. On dit que la vieillesse est un naufrage. Le naufrage n’est pas tant la décrépitude, l’âge, la maladie, la perte des repères, tout ça au bout du compte fait partie d’une certaine logique, (aussi inacceptable que l’inéluctable ou la mort, je vous l’accorde), le naufrage, c’est quand on se rend compte qu’on a été, qu’on a vécu, et qu’on n’a pas rempli son contrat avec la vie comme on aurait voulu, ou comme on aurait dû. Oh je sais, il y a des vieillards heureux, ou qui se disent tels, mais ce ne sont pas eux les naufragés.
Kléber vit au quotidien cette situation : il a vécu et bien vécu, il a assumé sa vie et n’a rien à se reprocher, bien au contraire puisqu’il a recueilli Patrick, orphelin de guerre (la seconde, Kléber, lui c’était la première) mais face à l’appétit de vie du gamin, il est désemparé, il n’a pas les mêmes cartes, il n’a plus de « répondant ». Avant, dans le temps d’avant, il savait gérer, maintenant il ne sait plus, tout a changé : le jeu, les cartes et les joueurs. Et puis on ne peut pas se contenter d’accepter sans rien dire, on est obligé de se poser la question « Qu’est-ce que j’ai raté ? »
La même histoire, racontée aujourd’hui, devrait prendre en compte, en plus du drame intime de la vieillesse, (même dans un environnement favorable), et en plus du conflit des générations, la maladie, cette mort lente qu’on appelle Alzheimer, qui détruit le malade et use de façon pernicieuse et inéluctable toute la bonne volonté, toute l’abnégation et tout l’amour des accompagnants. Chacun de nous de près ou de loin a été ou sera un jour confronté à ce problème. Si Gilbert Cesbron avait vécu, il est certain qu’il aurait fait de ce sujet un roman majeur, une pièce de théâtre bouleversante, un essai porteur de questions…
Cesbron n’est pas un auteur drôle, ses romans ont toujours une part de tragique : nous l’avons dit, Cesbron est un témoin et le monde autour de nous est tragique, non seulement dans le présent mais dans l’avenir que nous nous préparons, et que d’une certaine façon, nous aurons mérité. Mais Gilbert Cesbron en même temps est un auteur infiniment attachant, parce que bon et compatissant, bien sûr, et aussi parce que porteur d’espérance. En plus c’est un merveilleux écrivain au ton familier et direct qui s’adresse directement au cœur du lecteur autant qu’à son esprit. Et ce n’est pas donné à tout le monde !
"Mais moi je vous aimais" est le genre de livres trouvés dans une boîte à livres et qui restent finalement longtemps au fin fond d'une étagère. Le genre de livres qui m'attiraient sur le moment, mais de moins en moins au fil du temps. Le genre de livres pour lesquels il me faut une raison, un prétexte pour me décider à les lire enfin. Pour le Défi Lecture 2022, il me reste quatre catégories à valider, dont « lire un livre avec le mot "mais" ou un de ses homophones dans le titre ». Et dans mon immense pal, seul "Mais moi je vous aimais" correspondait. Le but des défis, en ce qui me concerne en tout cas, étant justement de taper au maximum dans ma pal, me voilà donc à donner sa chance à ce roman qui attend d'être lu depuis très très longtemps.
Et si j'ai eu quelque peu du mal avec le style de narration, je ne regrette absolument pas cette lecture, globalement troublante.
Yann est un petit garçon dont l'esprit aura toujours sept ans alors que son corps grandira normalement. Instable émotionnellement, avec des angoisses excessives et un besoin constant d'amour, d'affection et d'attention, et avec un QI de 66, bien des qualificatifs lui sont attribués : idiot, imbécile, simple d'esprit, inadapté, fou, anormal. En termes officiels (de l'époque), il est ce que l'on appelle un "débile léger". À travers l'enfance de Yann, Gilbert Cesbron nous parle de ces enfants "abandonniques", que personne ne veut, refilés aux uns et aux autres, ballotés d'une institution à une autre (alors que peu adaptée à leurs troubles) : des enfants que personne ne veut aimer.
Aujourd'hui, bien des progrès ont vu le jour en ce qui concerne ces enfants, que ce soit au niveau des moyens, des diagnostics, des traitements (médicamenteux ou non), du soutien et des aides apportés à la famille, etc. Dans "Mais moi je vous aimais", les événements se déroulent de la fin des années 1970 au milieu des années 1980. Il faut donc tenir compte du contexte et des circonstances de l'époque, et de ses aprioris également.
Comme dit plus haut, j'ai eu quelques difficultés avec le style de l'auteur, pas toujours très "lisse", manquant de fluidité. J'ai ressenti également quelques lenteurs, dûes en partie à certains chapitres un peu trop longs. Mais ce qui m'a le plus dérangée, c'est de passer constamment de la conjugaison au passé à celle au présent alors que les événements sont relatés chronologiquement. C'est très déstabilisant.
En ce qui concerne les personnages, je n'ai absolument rien à reprocher à l'auteur. Ils sont scrupuleusement bien creusés, Yann particulièrement. Gilbert Cesbron a su évoquer et expliquer ses moindres ressentis et réactions comme s'il pouvait réellement se mettre à sa place (c'est en tout cas l'impression que j'ai eue tout au long de ma lecture). J'ai perçu et pu comprendre sa propre réalité. Les autres personnages, les plus importants pour Yann, sont également bien campés, comme le Pr. Quirinat, Jean-Louis Lerouville, Mme Jeanne, ou M. Benoît. L'auteur offre à son histoire une dimension psychologique non négligeable et très appréciable.
Quant à l'histoire en elle-même, malgré les longueurs, elle reste troublante et saisissante du début à la fin. Si l'auteur évoque souvent les notions de rejet et d'abandon, il n'en oublie pas pour autant celles de bonté, de bienveillance et de bienfaisance, et surtout d'amour. Elle se termine comme elle a commencé, telle une boucle bouclée. J'aurais préféré un autre dénouement, mais bon...
Pour résumer, même si je lui trouve quelques défauts, j'ai tout de même apprécié ce roman, qui aborde la psychiatrie infantile tout en sensibilité et humanité.
Et si j'ai eu quelque peu du mal avec le style de narration, je ne regrette absolument pas cette lecture, globalement troublante.
Yann est un petit garçon dont l'esprit aura toujours sept ans alors que son corps grandira normalement. Instable émotionnellement, avec des angoisses excessives et un besoin constant d'amour, d'affection et d'attention, et avec un QI de 66, bien des qualificatifs lui sont attribués : idiot, imbécile, simple d'esprit, inadapté, fou, anormal. En termes officiels (de l'époque), il est ce que l'on appelle un "débile léger". À travers l'enfance de Yann, Gilbert Cesbron nous parle de ces enfants "abandonniques", que personne ne veut, refilés aux uns et aux autres, ballotés d'une institution à une autre (alors que peu adaptée à leurs troubles) : des enfants que personne ne veut aimer.
Aujourd'hui, bien des progrès ont vu le jour en ce qui concerne ces enfants, que ce soit au niveau des moyens, des diagnostics, des traitements (médicamenteux ou non), du soutien et des aides apportés à la famille, etc. Dans "Mais moi je vous aimais", les événements se déroulent de la fin des années 1970 au milieu des années 1980. Il faut donc tenir compte du contexte et des circonstances de l'époque, et de ses aprioris également.
Comme dit plus haut, j'ai eu quelques difficultés avec le style de l'auteur, pas toujours très "lisse", manquant de fluidité. J'ai ressenti également quelques lenteurs, dûes en partie à certains chapitres un peu trop longs. Mais ce qui m'a le plus dérangée, c'est de passer constamment de la conjugaison au passé à celle au présent alors que les événements sont relatés chronologiquement. C'est très déstabilisant.
En ce qui concerne les personnages, je n'ai absolument rien à reprocher à l'auteur. Ils sont scrupuleusement bien creusés, Yann particulièrement. Gilbert Cesbron a su évoquer et expliquer ses moindres ressentis et réactions comme s'il pouvait réellement se mettre à sa place (c'est en tout cas l'impression que j'ai eue tout au long de ma lecture). J'ai perçu et pu comprendre sa propre réalité. Les autres personnages, les plus importants pour Yann, sont également bien campés, comme le Pr. Quirinat, Jean-Louis Lerouville, Mme Jeanne, ou M. Benoît. L'auteur offre à son histoire une dimension psychologique non négligeable et très appréciable.
Quant à l'histoire en elle-même, malgré les longueurs, elle reste troublante et saisissante du début à la fin. Si l'auteur évoque souvent les notions de rejet et d'abandon, il n'en oublie pas pour autant celles de bonté, de bienveillance et de bienfaisance, et surtout d'amour. Elle se termine comme elle a commencé, telle une boucle bouclée. J'aurais préféré un autre dénouement, mais bon...
Pour résumer, même si je lui trouve quelques défauts, j'ai tout de même apprécié ce roman, qui aborde la psychiatrie infantile tout en sensibilité et humanité.
Un ds ouvrages les plus vonnus de l'auteur,plongee dans la misere quotidienne et son lot de malheurs.L'auteur a un style particulier qui fait passer l'ensemble de facon plaisante et garde l'interet debout en bout.Un bon moyen de connaître l'oeuvre de l'auteur et de decider,si,oui ou non vous souhaitez poursuivre la découverte de l'oeuvre de l'auteur.
Gulbert Cesbron est un écrivain de l'émotion,ici il nous conte un proces avec un accusé que tout designe comme coupable et qui va devoir sauver sa peau.Il excelle dans ces recits durs et intenses et encore ici il nous livre un recit qui prend aux tripes.A decouvrir d'urgence.
S'il est quelque chose de flagrant, c'est l'absence de tout personnage féminin (ou presque). Cesbron ne fait la part belle qu'aux enfants mâles et à leurs pulsions de découvertes. Mais Cesbron est de son époque, et il est difficile de le blâmer pour ça.
Ces histoires sont plaisantes, dans un Paris et alentours qui se prépare doucement à une guerre, se relevant à peine des précédentes. Les personnages cocasses, la langue bien de son temps est un plaisir.
Si vous aimez Tom Sawyer, ou la plupart des dessins animés où l'enfance s'amuse, vivante, vous apprécierez.
Si ce n'est pas un chef d'oeuvre, ni le plus original des livres, Cesbron peut ajouter cet opus à toute une série dont il peut être fier. Il est clairement un auteur sous-coté.
Ces histoires sont plaisantes, dans un Paris et alentours qui se prépare doucement à une guerre, se relevant à peine des précédentes. Les personnages cocasses, la langue bien de son temps est un plaisir.
Si vous aimez Tom Sawyer, ou la plupart des dessins animés où l'enfance s'amuse, vivante, vous apprécierez.
Si ce n'est pas un chef d'oeuvre, ni le plus original des livres, Cesbron peut ajouter cet opus à toute une série dont il peut être fier. Il est clairement un auteur sous-coté.
Gilbert Cesbron n’est pas un auteur « confortable » : si vous lisez un de ses livres, il y a de fortes chances pour que vous soyez touché ou ému, souvent bouleversé, parfois même bousculés et carrément révoltés. C’est l’apanage de ces auteurs qui nous montrent notre société – et nous-mêmes – sous un jour réel, celui-là même que nous essayons d’occulter.
« Il est plus tard que tu ne penses » (1958) ne déroge pas à la règle, c’est un roman dont la puissance d’émotion est particulièrement forte, et qui ne laisse personne insensible. Le sujet, il est vrai, est un creuset d’émotions sans fins, il s’agit de l’euthanasie, de sa légitimité (ou pas), et au-delà de l’attitude à prendre devant la vie et devant la mort :
Jean Cormier a administré à sa femme Jeanne, atteinte d’un cancer en phase terminale, une dose léthale de morphine. Pour ce geste, il est jugé aux assises. Est-il coupable ou innocent ?
Le sujet était d’actualité dans les années 50, il l’est encore aujourd’hui. Faut-il invoquer ce problème de date, d’époque ? Oui et non. Beaucoup de choses ont changé aujourd’hui : la médecine a changé, les personnes atteintes d’un cancer ont plus de chances de s’en sortir qu’autrefois, et la médecine progresse de jour en jour. Les mentalités ont changé : l’appréhension et la compréhension de la maladie, grâce à un accompagnement plus personnalisé, a permis d’border différemment la maladie. Enfin la loi a changé, en déculpabilisant (un peu, car il reste beaucoup à faire) ce qui est un crime d’amour, d’intention bienveillante, et non pas un crime passionnel, d’intention malveillante. Ce qui n’a pas changé le côté » humain de la chose » : la souffrance et la douleur, la vie et la mort. Nous avons tous vécu ces moments-là, soit indirectement, chez nos parents, nos amis ou nos proches, soit directement dans notre propre chair. Il ne faut pas nous en raconter : seul le malade connaît l’intensité de la douleur, autour de lui, on la devine, on la pressent, mais on ne peut pas le soulager de ce fardeau, le malade est seul à assumer dans son corps (et aussi dans son esprit) sa maladie. Nous, à côté, nous apportons notre amour, notre compassion, mais… ça ne suffit pas. Comme dit Sabine Sicaud :
Une feuille a son mal qu’ignore l’autre feuille.
Et le mal de l’oiseau, l’autre oiseau n’en sait rien.
Gilbert Cesbron s’est fait un devoir d’évoquer dans ses romans des faits de société ou des faits humains, qui le préoccupent (et qui devraient nous préoccuper aussi) la misère, le racisme, l’intolérance, l’enfance malheureuse, la vieillesse, le handicap, et la foi face à tous ces problèmes.
Alors oui, on dit maintenant, c’est un écrivain d’une autre époque, il n’a plus sa place aujourd’hui, il n’est plus « d’actualité », son style est daté, en plus il milite pour un catholicisme ringard… Ceux qui parlent ainsi, je les invite à relire Gilbert Cesbron : les faits de société qu’il pourfendait dans les années 50 et 60, sont toujours là : misère, racisme et intolérance, plus que jamais présents, constituent même avec une certaine hypocrisie, le grain à moudre de nos politiques, quant aux faits humains, tant qu’il y aura la maladie et la mort, et tant qu’il y aura des riches et des pauvres, et tant qu’il y aura des bons et des méchants, il y aura de l’injustice et du malheur. Son style a vieilli, certes, mais quand vous lisez certains textes contemporains… bref, vous m’avez compris. Enfin, l’engagement catholique de Cesbron est beaucoup plus proche d’un abbé Pierre ou d’un Saint Vincent de Paul que des « cardinaux en costumes » que chante Francis Cabrel.
Il faut lire, ou relire, Gilbert Cesbron : son message reste le même, à soixante-dix ans de distance, et il est toujours d’actualité. Il reste à dire une dernière chose, une des particularités de Gilbert Cesbron, qui le démarque de beaucoup de ses confrères – y compris catholiques – c’est qu’il ressort de ses écrits (en dehors de tout dogme ou de toute idéologie) une authenticité complète, une droiture de pensée, une honnêteté pour tout dire, qui se traduit notamment par une empathie profonde avec ses personnages (et avec le lecteur, du même coup), une compassion dont la sincérité ne peut être mise en doute, une émotion profonde, de nature à éveiller les consciences.
« Il est plus tard que tu ne penses » (1958) ne déroge pas à la règle, c’est un roman dont la puissance d’émotion est particulièrement forte, et qui ne laisse personne insensible. Le sujet, il est vrai, est un creuset d’émotions sans fins, il s’agit de l’euthanasie, de sa légitimité (ou pas), et au-delà de l’attitude à prendre devant la vie et devant la mort :
Jean Cormier a administré à sa femme Jeanne, atteinte d’un cancer en phase terminale, une dose léthale de morphine. Pour ce geste, il est jugé aux assises. Est-il coupable ou innocent ?
Le sujet était d’actualité dans les années 50, il l’est encore aujourd’hui. Faut-il invoquer ce problème de date, d’époque ? Oui et non. Beaucoup de choses ont changé aujourd’hui : la médecine a changé, les personnes atteintes d’un cancer ont plus de chances de s’en sortir qu’autrefois, et la médecine progresse de jour en jour. Les mentalités ont changé : l’appréhension et la compréhension de la maladie, grâce à un accompagnement plus personnalisé, a permis d’border différemment la maladie. Enfin la loi a changé, en déculpabilisant (un peu, car il reste beaucoup à faire) ce qui est un crime d’amour, d’intention bienveillante, et non pas un crime passionnel, d’intention malveillante. Ce qui n’a pas changé le côté » humain de la chose » : la souffrance et la douleur, la vie et la mort. Nous avons tous vécu ces moments-là, soit indirectement, chez nos parents, nos amis ou nos proches, soit directement dans notre propre chair. Il ne faut pas nous en raconter : seul le malade connaît l’intensité de la douleur, autour de lui, on la devine, on la pressent, mais on ne peut pas le soulager de ce fardeau, le malade est seul à assumer dans son corps (et aussi dans son esprit) sa maladie. Nous, à côté, nous apportons notre amour, notre compassion, mais… ça ne suffit pas. Comme dit Sabine Sicaud :
Une feuille a son mal qu’ignore l’autre feuille.
Et le mal de l’oiseau, l’autre oiseau n’en sait rien.
Gilbert Cesbron s’est fait un devoir d’évoquer dans ses romans des faits de société ou des faits humains, qui le préoccupent (et qui devraient nous préoccuper aussi) la misère, le racisme, l’intolérance, l’enfance malheureuse, la vieillesse, le handicap, et la foi face à tous ces problèmes.
Alors oui, on dit maintenant, c’est un écrivain d’une autre époque, il n’a plus sa place aujourd’hui, il n’est plus « d’actualité », son style est daté, en plus il milite pour un catholicisme ringard… Ceux qui parlent ainsi, je les invite à relire Gilbert Cesbron : les faits de société qu’il pourfendait dans les années 50 et 60, sont toujours là : misère, racisme et intolérance, plus que jamais présents, constituent même avec une certaine hypocrisie, le grain à moudre de nos politiques, quant aux faits humains, tant qu’il y aura la maladie et la mort, et tant qu’il y aura des riches et des pauvres, et tant qu’il y aura des bons et des méchants, il y aura de l’injustice et du malheur. Son style a vieilli, certes, mais quand vous lisez certains textes contemporains… bref, vous m’avez compris. Enfin, l’engagement catholique de Cesbron est beaucoup plus proche d’un abbé Pierre ou d’un Saint Vincent de Paul que des « cardinaux en costumes » que chante Francis Cabrel.
Il faut lire, ou relire, Gilbert Cesbron : son message reste le même, à soixante-dix ans de distance, et il est toujours d’actualité. Il reste à dire une dernière chose, une des particularités de Gilbert Cesbron, qui le démarque de beaucoup de ses confrères – y compris catholiques – c’est qu’il ressort de ses écrits (en dehors de tout dogme ou de toute idéologie) une authenticité complète, une droiture de pensée, une honnêteté pour tout dire, qui se traduit notamment par une empathie profonde avec ses personnages (et avec le lecteur, du même coup), une compassion dont la sincérité ne peut être mise en doute, une émotion profonde, de nature à éveiller les consciences.
Sans queue ni tête.
Pour une charmante pépite comme “l’opéra de Paris”, il y a au moins 10 autres nouvelles absurdes et sans aucun intérêt, où la poésie (trop) visiblement recherchée est bien faiblarde et pataude.
L’obsession de la mort (pour faire plus “conte” ?) est glauque. Parfois, il y a un paragraphe réussi dans une nouvelle de 4 pages...
Ces nouvelles sont dans l’ordre chronologique, écrites sur une très longue période. Alors par lassitude, j’ai sauté 100 pages mais j’ai retrouvé le même niveau décevant vers la fin.
Pour finir, quand même, nom d’un chien, que l’image de couverture est belle ! Je ne m'en lasse pas et garde le livre pour ça sinon, je le destinais pour la boîte à lire la plus proche.
Pour une charmante pépite comme “l’opéra de Paris”, il y a au moins 10 autres nouvelles absurdes et sans aucun intérêt, où la poésie (trop) visiblement recherchée est bien faiblarde et pataude.
L’obsession de la mort (pour faire plus “conte” ?) est glauque. Parfois, il y a un paragraphe réussi dans une nouvelle de 4 pages...
Ces nouvelles sont dans l’ordre chronologique, écrites sur une très longue période. Alors par lassitude, j’ai sauté 100 pages mais j’ai retrouvé le même niveau décevant vers la fin.
Pour finir, quand même, nom d’un chien, que l’image de couverture est belle ! Je ne m'en lasse pas et garde le livre pour ça sinon, je le destinais pour la boîte à lire la plus proche.
C'est un témoignage extrêmement fort que je viens de terminer, un grand livre dont je me souviendrai longtemps.
Gilbert Cesbron, écrivain catholique aux ouvrages quelque peu datés pourrait-on penser et pourtant que de trésors pour celui qui veut bien s'en donner la peine.
"Les saints vont en enfer", livre où la religion tient une grande place, pouvant rebuter celui qui veut démarrer sa lecture, pourtant c'est avant tout un roman sur les hommes, sur ces prêtres ouvriers tendant la main à tous, aux plus pauvres, aux sans abris. Ils forment un réseau de "copains" toujours là pour dépanner, aider, secourir malgré les doutes, l'incertitude, le découragement.
Un dévouement sans pareil pour ces hommes en compétition dans ces quartiers avec le parti communiste mais ils doivent lutter également contre les représentants de leur église.
Pierre, Madeleine, Étienne, Jean, tant de personnages si bien décrits, au service de cette histoire, si attachants et qui composent les habitants de Sagny.
Roman écrit en 1951, époque où le mouvement des prêtres ouvriers se développait, il en resterait encore aujourd'hui en France même si pour ma part j'en ai rarement entendu parler.
De ce livre émane surtout un message de paix et de solidarité qui fait du bien, c'est pourquoi je vous encourage vivement à le lire, histoire d'y réfléchir un peu avant de reprendre nos vies.
Gilbert Cesbron, écrivain catholique aux ouvrages quelque peu datés pourrait-on penser et pourtant que de trésors pour celui qui veut bien s'en donner la peine.
"Les saints vont en enfer", livre où la religion tient une grande place, pouvant rebuter celui qui veut démarrer sa lecture, pourtant c'est avant tout un roman sur les hommes, sur ces prêtres ouvriers tendant la main à tous, aux plus pauvres, aux sans abris. Ils forment un réseau de "copains" toujours là pour dépanner, aider, secourir malgré les doutes, l'incertitude, le découragement.
Un dévouement sans pareil pour ces hommes en compétition dans ces quartiers avec le parti communiste mais ils doivent lutter également contre les représentants de leur église.
Pierre, Madeleine, Étienne, Jean, tant de personnages si bien décrits, au service de cette histoire, si attachants et qui composent les habitants de Sagny.
Roman écrit en 1951, époque où le mouvement des prêtres ouvriers se développait, il en resterait encore aujourd'hui en France même si pour ma part j'en ai rarement entendu parler.
De ce livre émane surtout un message de paix et de solidarité qui fait du bien, c'est pourquoi je vous encourage vivement à le lire, histoire d'y réfléchir un peu avant de reprendre nos vies.
Années 1950. Alain Robert, 11 ans, veut sauver un des chiens perdus sans collier, pour lui éviter aller à la fourrière et être euthanasié. Mais lui aussi est un des chiens perdus sans collier : il fait partie des enfants abandonnés par les parents pendant la guerre. Pris en charge par l'Assistance Publique, son dossier est son frère : il le suit partout. Il est, comme la plupart de ces enfants, antisocial, et les familles d'adoption ne veulent plus de lui. Son obscession est de retrouver ses parents, mais dans le bottin, il y a trop De Robert, et aussi trop d'Alain !
Alors le juge pour enfants Lamy ( L'ami ... des enfants ? ), l'homme cardinal trop rare, qui exprime la pensée de Gilbert Cesbron, place l'enfant en foyer. Un foyer avec des enfants de l'AP, et des petites frappes [dont les familles seraient en 2022, qualifiées de dysfonctionnelles].
Il ne s'agit pas de n'importe quel foyer. le directeur est surnommé par les jeunes Croc Blanc, et les éducateurs sont Mammy, Buffalo, Frangine, Clémenceau, Tomawak l'instituteur, et Chef Robert qui est nouveau. Alain va se faire des copains : Radar, Taka, Olaf, Velours, Ballon Captif, et le sombre Paulo l'invincible enfant du malheur.
Pour le juge Lamy, ce foyer de campagne a de gros avantages sur la ville : nature, potager... le seul inconvénient est qu'il n'y a pas de parents pour aimer les jeunes ; les éducateurs, dont le but est de les guider vers une formation, les aiment, mais les liens de sang leur manquent.
.
Gilbert Cesbron est un humaniste. [ L'humanisme est un concept qui dépasse la philosophie ]. Au printemps 1972, il met fin à son métier d'homme de radio et se tourne vers l'action sociale en devenant secrétaire général du Secours catholique.
Cesbron, dans ses livres, s'insurge souvent sur l'inhumanité du pouvoir, qui est ici représenté par le substitut.
On suit le juge Lamy sur plusieurs affaires ; il vieillit trop vite, passe des heures impossibles en déplacements pour convaincre le substitut ( proc ), jeune émoulu sorti de l'école qui veut appliquer le règlement à la lettre ; il court chez les parents pour les convaincre que l'enfant serait mieux au centre que dans une famille qui se dispute, dont le père boit et la mère se prostitue par voie de conséquence ( verbe tabou dont on ne parle pas ) ;
il dit qu'à propos des délits mineurs, on ne doit pas juger le jeune sur des faits, mais sur ce qu'il est, sur ce qu'est son entourage. Bien sûr, je suis d'accord :)
... Et dès que je le trouve, je lis : "C'est Mozart qu'on assassine".
.
Antisocial, tu perds ton sang froid
Repense à toutes ces années de service
Antisocial, bientôt les années de sévices
Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus
Qu'on ne rattrape plus
Alors le juge pour enfants Lamy ( L'ami ... des enfants ? ), l'homme cardinal trop rare, qui exprime la pensée de Gilbert Cesbron, place l'enfant en foyer. Un foyer avec des enfants de l'AP, et des petites frappes [dont les familles seraient en 2022, qualifiées de dysfonctionnelles].
Il ne s'agit pas de n'importe quel foyer. le directeur est surnommé par les jeunes Croc Blanc, et les éducateurs sont Mammy, Buffalo, Frangine, Clémenceau, Tomawak l'instituteur, et Chef Robert qui est nouveau. Alain va se faire des copains : Radar, Taka, Olaf, Velours, Ballon Captif, et le sombre Paulo l'invincible enfant du malheur.
Pour le juge Lamy, ce foyer de campagne a de gros avantages sur la ville : nature, potager... le seul inconvénient est qu'il n'y a pas de parents pour aimer les jeunes ; les éducateurs, dont le but est de les guider vers une formation, les aiment, mais les liens de sang leur manquent.
.
Gilbert Cesbron est un humaniste. [ L'humanisme est un concept qui dépasse la philosophie ]. Au printemps 1972, il met fin à son métier d'homme de radio et se tourne vers l'action sociale en devenant secrétaire général du Secours catholique.
Cesbron, dans ses livres, s'insurge souvent sur l'inhumanité du pouvoir, qui est ici représenté par le substitut.
On suit le juge Lamy sur plusieurs affaires ; il vieillit trop vite, passe des heures impossibles en déplacements pour convaincre le substitut ( proc ), jeune émoulu sorti de l'école qui veut appliquer le règlement à la lettre ; il court chez les parents pour les convaincre que l'enfant serait mieux au centre que dans une famille qui se dispute, dont le père boit et la mère se prostitue par voie de conséquence ( verbe tabou dont on ne parle pas ) ;
il dit qu'à propos des délits mineurs, on ne doit pas juger le jeune sur des faits, mais sur ce qu'il est, sur ce qu'est son entourage. Bien sûr, je suis d'accord :)
... Et dès que je le trouve, je lis : "C'est Mozart qu'on assassine".
.
Antisocial, tu perds ton sang froid
Repense à toutes ces années de service
Antisocial, bientôt les années de sévices
Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus
Qu'on ne rattrape plus
Ce livre retrace la vie d'Alain Guerin avec tout sd qui compose une vie,lrs peurs les doutes les combats dans la France de l'apres guerre.L'auteur nous offre ici un superbe ouvrage,presqu'un teportage au plus pres de son héros qui a la force et la foufgue de ses convictions.Un bel ouvrage à re-découvrir.
Gilbert Cesbron (1913-1979), c'est une évidence, est un "grand témoin" du XXème siècle. Son œuvre, dense, forte, et profondément émouvante, est un long témoignage sur le côté obscur des trente glorieuses. De l'immédiate après-guerre aux années 70, il se penche, avec une émotion et une compassion communicatives, sur les oubliés de la croissance, les laissés-pour-compte du progrès, les pauvres, les malheureux, les déclassés, tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont rejetés par la société. Patiemment, de roman en roman, Gilbert Cesbron brosse un tableau de la France, non pas, comme un Zola ou un Balzac avec un souci documentaire à la limite de l'étude sociologique, mais au ras du petit peuple. Le réalisme de Cesbron n'a d'autre but qu'attirer l'attention du lecteur sur la misère - les misères - qui l'entoure et qu'il ne voit pas, et ce faisant, de l'amener vers une attitude de compréhension, voire de compassion ou de charité. On le sait, Cesbron est un écrivain catholique. Mais il n'en fait pas un drapeau. Il se place plus dans le sillage de l'abbé Pierre que dans celui du Pape (même si ce pape s'appelle Jean XXIII).
La technique de Cesbron est reconnaissable : chaque roman examine et approfondit un thème de société : Les bidonvilles de l'après-guerre (Les Saints vont en enfer) Les tourments de l'adolescence (Notre prison est un royaume), la jeunesse délinquante (Chiens perdus sans collier), le naufrage de la vieillesse (Avoir été), l'euthanasie (Il est plus tard que tu ne penses), la violence (Entre chiens et loups), le racisme (Je suis mal dans ta peau), la foi et ses dérives (Vous verrez le ciel ouvert) l'enfance handicapée (Mais moi je vous aimais), etc.
Chiens perdus sans collier (1954) raconte l'histoire d'une poignée de gamins venant de milieux défavorisés (parents indignes ou dépassés, ou pas de parents du tout), qui, ayant été entraînés dans la délinquance, doivent répondre de leurs délits devant un juge. Gilbert Cesbron dresse un double portrait : d'une part, avec le regard tendre et compatissant qu'on lui connaît, il nous dépeint ces enfants déboussolés, tiraillés entre le monde d'adultes auxquels ils voudraient ressembler (à tort, souvent) et celui de l'enfance dont inconsciemment ils voudraient gardé la pureté et l'innocence; d'autre part, il nous montre une galerie de "belles personnes" dont la fonction consiste à encadrer et canaliser ces gamins (en particulier le juge Lamy et tout le personnel de la maison d'accueil), et qui à force d'amour et de sollicitude, leur apporte un peu de l'affection dont ils ont été sevrés.
Après Les Saints vont en enfer et Notre prison est un royaume, Chiens perdus sans colliers est un autre "grand" Cesbron, qu'on peut lire aujourd'hui encore à la fois comme un témoignage sur une époque révolue (encore que, si le contexte a changé, les situations dramatiques sont identiques) et comme une réflexion sur le Bien et le Mal, avec des victimes et des bourreaux, mais aussi des héros du quotidien, comme le juge et les éducateurs.
A noter une belle adaptation au cinéma : un film de Jean Delannoy en 1955, avec Jean Gabin dans le rôle du juge Lamy
La technique de Cesbron est reconnaissable : chaque roman examine et approfondit un thème de société : Les bidonvilles de l'après-guerre (Les Saints vont en enfer) Les tourments de l'adolescence (Notre prison est un royaume), la jeunesse délinquante (Chiens perdus sans collier), le naufrage de la vieillesse (Avoir été), l'euthanasie (Il est plus tard que tu ne penses), la violence (Entre chiens et loups), le racisme (Je suis mal dans ta peau), la foi et ses dérives (Vous verrez le ciel ouvert) l'enfance handicapée (Mais moi je vous aimais), etc.
Chiens perdus sans collier (1954) raconte l'histoire d'une poignée de gamins venant de milieux défavorisés (parents indignes ou dépassés, ou pas de parents du tout), qui, ayant été entraînés dans la délinquance, doivent répondre de leurs délits devant un juge. Gilbert Cesbron dresse un double portrait : d'une part, avec le regard tendre et compatissant qu'on lui connaît, il nous dépeint ces enfants déboussolés, tiraillés entre le monde d'adultes auxquels ils voudraient ressembler (à tort, souvent) et celui de l'enfance dont inconsciemment ils voudraient gardé la pureté et l'innocence; d'autre part, il nous montre une galerie de "belles personnes" dont la fonction consiste à encadrer et canaliser ces gamins (en particulier le juge Lamy et tout le personnel de la maison d'accueil), et qui à force d'amour et de sollicitude, leur apporte un peu de l'affection dont ils ont été sevrés.
Après Les Saints vont en enfer et Notre prison est un royaume, Chiens perdus sans colliers est un autre "grand" Cesbron, qu'on peut lire aujourd'hui encore à la fois comme un témoignage sur une époque révolue (encore que, si le contexte a changé, les situations dramatiques sont identiques) et comme une réflexion sur le Bien et le Mal, avec des victimes et des bourreaux, mais aussi des héros du quotidien, comme le juge et les éducateurs.
A noter une belle adaptation au cinéma : un film de Jean Delannoy en 1955, avec Jean Gabin dans le rôle du juge Lamy
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le livre qui vous a bouleversé
Mijouet
136 livres

Auteurs oubliés?
madameduberry
41 livres
Auteurs proches de Gilbert Cesbron
Quiz
Voir plus
Gilbert Cesbron
Né à Paris en ?
1903
1913
1923
1933
12 questions
33 lecteurs ont répondu
Thème :
Gilbert CesbronCréer un quiz sur cet auteur33 lecteurs ont répondu