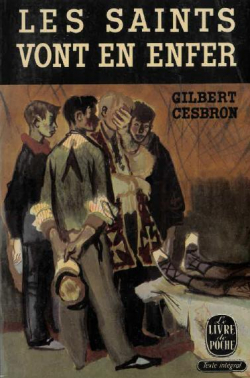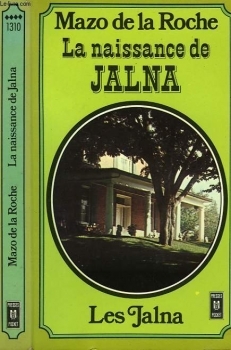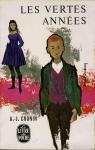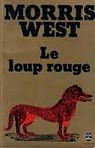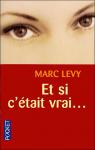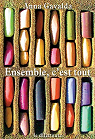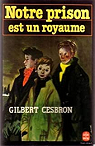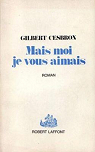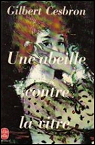CHAPITRES :
0:00 - Titre
C :
0:06 - CRÉATION - Paul Bourget
0:17 - CRÉATION DE L'HOMME - Jean Dutourd
0:28 - CROIRE - Comte de Las Cases
D :
0:38 - DÉBAUCHE - Restif de la Bretonne
0:51 - DÉCEPTION - Fréron
1:04 - DÉLUGE - Jean-François Ducis
1:15 - DÉMOCRATE - Georges Clemenceau
1:26 - DERRIÈRE - Montaigne
1:36 - DOCTRINE - Édouard Herriot
1:46 - DOULEUR - Honoré de Balzac
1:58 - DOUTE - Henri Poincaré
E :
2:11 - ÉCHAFAUD - Émile Pontich
2:23 - ÉCOUTER - Rohan-Chabot
2:33 - ÉGALITÉ - Ernest Jaubert
2:43 - ÉGOCENTRISME - René Bruyez
3:00 - ÉGOÏSME - Comte d'Houdetot
3:10 - ÉLECTION - Yves Mirande
3:21 - ENFANT - Remy de Gourmont
3:33 - ENNUI - Emil Cioran
3:41 - ENSEIGNER - Jacques Cazotte
3:53 - ENTENTE - Gilbert Cesbron
4:05 - ENTERREMENT - Jean-Jacques Rousseau
4:14 - ÉPOUSE - André Maurois
4:37 - ÉPOUSER UNE FEMME - Maurice Blondel
4:48 - ESPOIR - Paul Valéry
4:57 - ESPRIT - Vicomte de Freissinet de Valady
5:07 - EXPÉRIENCE - Barbey d'Aurevilly
F :
5:18 - FATALITÉ - Anne-Marie Swetchine
5:27 - FIDÉLITÉ - Rivarol
5:41 - Générique
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE :
Jean Delacour, Tout l'esprit français, Paris, Albin Michel, 1974.
IMAGES D'ILLUSTRATION :
Paul Bourget : https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bourget#/media/File:Paul_Bourget_7.jpg
Jean Dutourd : https://www.purepeople.com/media/jean-dutourd-est-mort-a-l-age-de-91_m544292
Comte de Las Cases : https://www.babelio.com/auteur/Emmanuel-de-Las-Cases/169833
Restif de la Bretonne : https://fr.wikiquote.org/wiki/Nicolas_Edme_Restif_de_La_Bretonne#/media/Fichier:NicolasRestifdeLaBretonne.jpg
Fréron : https://www.musicologie.org/Biographies/f/freron_elie_catherine.html
Jean-François Ducis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-François_Ducis#/media/Fichier:Jean-François_Ducis_par_le_baron_Gérard.jpg
Georges Clemenceau : https://www.lareorthe.fr/Georges-Clemenceau_a58.html
Montaigne : https://www.walmart.ca/fr/ip/Michel-Eyquem-De-Montaigne-N-1533-1592-French-Essayist-And-Courtier-Line-Engraving-After-A-Painting-By-An-Unknown-16Th-Century-Artist-Poster-Print-18/1T9RWV8P5A9D
Édouard Herriot : https://www.babelio.com/auteur/Edouard-Herriot/78775
Honoré de Balzac : https://www.hachettebnf.fr/sites/default/files/images/intervenants/000000000042_L_Honor%25E9_de_Balzac___%255Bphotographie_%255B...%255DAtelier_Nadar_btv1b53118945v.JPEG
Henri Poincaré : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Henri_Poincaré_-_Dernières_pensées%2C_1920_%28page_16_crop%29.jpg
René Bruyez : https://aaslan.com/english/gallery/sculpture/Bruyez.html
Yves Mirande : https://www.abebooks.com/photographs/Yves-MIRANDE-auteur-superviseur-film-CHANCE/31267933297/bd#&gid=1&pid=1
Remy de Gourmont : https://www.editionsdelherne.com/publication/cahier-gourmont/
Emil Cioran : https://www.penguin.com.au/books/the-trouble-with

Gilbert Cesbron
EAN : 9782253010296
Le Livre de Poche (30/11/-1)
/5
123 notesLe Livre de Poche (30/11/-1)
Résumé :
Si le roman de Cesbron n'a rien perdu de son pouvoir émotionnel, c'est qu'il jette une lumière impitoyable sur la misère dans les quartiers populaires. Marcel l'ivrogne qui bat son gosse, Ahmed le Nord-Africain indicateur de police, Suzanne la prostituée convertie. tout un monde d'épuisement et de déchéance entoure Pierre, le successeur du père Bernard, et donne un sens a son sacrifice. Alors que Bernard a abandonné le combat, Pierre est décidé à le mener jour après... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les Saints vont en enferVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (16)
Voir plus
Ajouter une critique
Paru chez Robert Laffont en 1952, édité en Livre de Poche en 1965, « Les saints vont en enfer » est -avec « Chiens perdus sans collier », « Il est plus tard que tu ne penses » et « Entre chiens et loups »- un des ouvrages les plus connus de Gilbert Cesbron, écrivain français d'inspiration catholique.
Dans « Les saints vont en enfer » il est question de la place du prêtre ouvrier dans la société française des années 1950. Pierre, jeune prêtre ouvrier, est affecté à Sagny (nom inventé), en pleine banlieue parisienne. Après son travail à l'usine, il aide les habitants du quartier ainsi que ceux qui y transitent, que ce soit pour trouver un endroit où passer la nuit, pour obtenir un travail même temporaire ou tout simplement pour manger quelque chose. Pierre se donne à fond dans sa mission mais quand il se met à fréquenter Henri, un gars du Parti -entendez, du Parti Communiste- ses supérieurs -qui se sont rendus compte que Pierre s'était également lié d'amitié avec une prostituée, avec un opposant espagnol vivant en France sous une fausse identité, avec un père au chômage maltraitant régulièrement son enfant- finissent par lui recommander de faire d'autres choix ou de rentrer dans un couvent, laissant ainsi sa place à quelqu'un de plus « normal ». Pierre -qui est un des saints du titre de l'ouvrage- se le tient pour dit, mais il fera un autre choix ...
Évidemment, Dieu et les hommes sont au centre de l'ouvrage. Et l'auteur nous dépeint au travers de Pierre, avec beaucoup de justesse, ce que furent les prêtres ouvriers dans cette France des années 1950. Eux, qui étaient à la fois des hommes d'église et des ouvriers se voulant intégrés dans la « vraie vie », se mettaient fraternellement au service de tous, sans parfois accorder une place suffisante à leur ministère. D'une certaine façon, leur hiérarchie pouvait le leur reprocher puisqu'ils n'accordaient pas la priorité ou le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission qui était de diffuser la Parole du Christ. Cette question irrigue tout le récit ce qui conduit à penser que « Les saints vont en enfer » est d'abord un roman sur la foi et sur le doute qui peut animer l'homme qui la porte ; mais ce roman pose aussi la question de l'engagement, engagement personnifié par Pierre, mais aussi par Henri. Tous deux hommes d'action -impliqués avec enthousiasme dans leurs missions respectives-, ils connaitront successivement espoir, puis doute et abattement. Leur amitié restera intacte mais ils se demanderont sans cesse s'ils ont la capacité réelle à pouvoir changer le monde et quelle est l'utilité réelle de leurs combats respectifs. Accessoirement, ce roman constitue également à sa manière une sorte d'analyse et de révolte sociales, les protagonistes évoluant dans une banlieue sordide, sur fonds de baraquements et de pré-fabriqués, de chômage, d'alcoolisme, de prostitution, d'enfants battus, bref de misère noire et d'absence de tout espoir possible dans le lendemain.
Qu'en penser ? le propos est louable et l'auteur -qui a manifestement pénétré la réalité sociale de la société française de son époque- déborde d'humanité, d'empathie et de tendresse pour les êtres humains, malgré leurs défauts et leurs faiblesses. Son appel à la solidarité, à la fraternité, à l'espoir, mais aussi à l'engagement de l'Église catholique pourra interpeler le lecteur. le style fluide, l'écriture très visuelle, le sens juste et évident des dialogues -vrais et simples- apportent une touche singulière à l'ensemble. Mais on pourra regretter le caractère désuet de l'ouvrage : la France a bien changé ; les Mines du Nord et ses dangers, ses vies gâchées, ses mineurs ressemblant à des zombies n'ayant plus la force de regarder femme et enfants sont loin derrière nous ; l'industrie n'a plus la place prépondérante qu'elle occupait ; le travail à la chaîne n'est plus aussi répandu ; les banlieues sont convoitées par les promoteurs et les futurs accédants à la propriété ; on n'expulse plus aussi facilement les locataires indélicats ; le PC et les syndicats n'ont plus la place qu'ils occupaient sur l'échiquier sociopolitique ; la mortalité infantile s'est considérablement amenuisée ; les prêtres ouvriers ont disparu, etc. Certes, il y a encore ici ou là des endroits où règnent la faim, l'insécurité, le froid, la violence et le manque d'espoir. On pourra également regretter ce côté naïf et moraliste, ce côté archétypal des protagonistes, la mise en scène théâtrale de certains entretiens, une représentation trop manichéenne du monde, l'utilisation de prénoms à forte connotation religieuse et l'intention délibérément populaire, pour ne pas dire idéologique, du propos. Je mets donc quatre étoiles.
Dans « Les saints vont en enfer » il est question de la place du prêtre ouvrier dans la société française des années 1950. Pierre, jeune prêtre ouvrier, est affecté à Sagny (nom inventé), en pleine banlieue parisienne. Après son travail à l'usine, il aide les habitants du quartier ainsi que ceux qui y transitent, que ce soit pour trouver un endroit où passer la nuit, pour obtenir un travail même temporaire ou tout simplement pour manger quelque chose. Pierre se donne à fond dans sa mission mais quand il se met à fréquenter Henri, un gars du Parti -entendez, du Parti Communiste- ses supérieurs -qui se sont rendus compte que Pierre s'était également lié d'amitié avec une prostituée, avec un opposant espagnol vivant en France sous une fausse identité, avec un père au chômage maltraitant régulièrement son enfant- finissent par lui recommander de faire d'autres choix ou de rentrer dans un couvent, laissant ainsi sa place à quelqu'un de plus « normal ». Pierre -qui est un des saints du titre de l'ouvrage- se le tient pour dit, mais il fera un autre choix ...
Évidemment, Dieu et les hommes sont au centre de l'ouvrage. Et l'auteur nous dépeint au travers de Pierre, avec beaucoup de justesse, ce que furent les prêtres ouvriers dans cette France des années 1950. Eux, qui étaient à la fois des hommes d'église et des ouvriers se voulant intégrés dans la « vraie vie », se mettaient fraternellement au service de tous, sans parfois accorder une place suffisante à leur ministère. D'une certaine façon, leur hiérarchie pouvait le leur reprocher puisqu'ils n'accordaient pas la priorité ou le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission qui était de diffuser la Parole du Christ. Cette question irrigue tout le récit ce qui conduit à penser que « Les saints vont en enfer » est d'abord un roman sur la foi et sur le doute qui peut animer l'homme qui la porte ; mais ce roman pose aussi la question de l'engagement, engagement personnifié par Pierre, mais aussi par Henri. Tous deux hommes d'action -impliqués avec enthousiasme dans leurs missions respectives-, ils connaitront successivement espoir, puis doute et abattement. Leur amitié restera intacte mais ils se demanderont sans cesse s'ils ont la capacité réelle à pouvoir changer le monde et quelle est l'utilité réelle de leurs combats respectifs. Accessoirement, ce roman constitue également à sa manière une sorte d'analyse et de révolte sociales, les protagonistes évoluant dans une banlieue sordide, sur fonds de baraquements et de pré-fabriqués, de chômage, d'alcoolisme, de prostitution, d'enfants battus, bref de misère noire et d'absence de tout espoir possible dans le lendemain.
Qu'en penser ? le propos est louable et l'auteur -qui a manifestement pénétré la réalité sociale de la société française de son époque- déborde d'humanité, d'empathie et de tendresse pour les êtres humains, malgré leurs défauts et leurs faiblesses. Son appel à la solidarité, à la fraternité, à l'espoir, mais aussi à l'engagement de l'Église catholique pourra interpeler le lecteur. le style fluide, l'écriture très visuelle, le sens juste et évident des dialogues -vrais et simples- apportent une touche singulière à l'ensemble. Mais on pourra regretter le caractère désuet de l'ouvrage : la France a bien changé ; les Mines du Nord et ses dangers, ses vies gâchées, ses mineurs ressemblant à des zombies n'ayant plus la force de regarder femme et enfants sont loin derrière nous ; l'industrie n'a plus la place prépondérante qu'elle occupait ; le travail à la chaîne n'est plus aussi répandu ; les banlieues sont convoitées par les promoteurs et les futurs accédants à la propriété ; on n'expulse plus aussi facilement les locataires indélicats ; le PC et les syndicats n'ont plus la place qu'ils occupaient sur l'échiquier sociopolitique ; la mortalité infantile s'est considérablement amenuisée ; les prêtres ouvriers ont disparu, etc. Certes, il y a encore ici ou là des endroits où règnent la faim, l'insécurité, le froid, la violence et le manque d'espoir. On pourra également regretter ce côté naïf et moraliste, ce côté archétypal des protagonistes, la mise en scène théâtrale de certains entretiens, une représentation trop manichéenne du monde, l'utilisation de prénoms à forte connotation religieuse et l'intention délibérément populaire, pour ne pas dire idéologique, du propos. Je mets donc quatre étoiles.
C'est un témoignage extrêmement fort que je viens de terminer, un grand livre dont je me souviendrai longtemps.
Gilbert Cesbron, écrivain catholique aux ouvrages quelque peu datés pourrait-on penser et pourtant que de trésors pour celui qui veut bien s'en donner la peine.
"Les saints vont en enfer", livre où la religion tient une grande place, pouvant rebuter celui qui veut démarrer sa lecture, pourtant c'est avant tout un roman sur les hommes, sur ces prêtres ouvriers tendant la main à tous, aux plus pauvres, aux sans abris. Ils forment un réseau de "copains" toujours là pour dépanner, aider, secourir malgré les doutes, l'incertitude, le découragement.
Un dévouement sans pareil pour ces hommes en compétition dans ces quartiers avec le parti communiste mais ils doivent lutter également contre les représentants de leur église.
Pierre, Madeleine, Étienne, Jean, tant de personnages si bien décrits, au service de cette histoire, si attachants et qui composent les habitants de Sagny.
Roman écrit en 1951, époque où le mouvement des prêtres ouvriers se développait, il en resterait encore aujourd'hui en France même si pour ma part j'en ai rarement entendu parler.
De ce livre émane surtout un message de paix et de solidarité qui fait du bien, c'est pourquoi je vous encourage vivement à le lire, histoire d'y réfléchir un peu avant de reprendre nos vies.
Gilbert Cesbron, écrivain catholique aux ouvrages quelque peu datés pourrait-on penser et pourtant que de trésors pour celui qui veut bien s'en donner la peine.
"Les saints vont en enfer", livre où la religion tient une grande place, pouvant rebuter celui qui veut démarrer sa lecture, pourtant c'est avant tout un roman sur les hommes, sur ces prêtres ouvriers tendant la main à tous, aux plus pauvres, aux sans abris. Ils forment un réseau de "copains" toujours là pour dépanner, aider, secourir malgré les doutes, l'incertitude, le découragement.
Un dévouement sans pareil pour ces hommes en compétition dans ces quartiers avec le parti communiste mais ils doivent lutter également contre les représentants de leur église.
Pierre, Madeleine, Étienne, Jean, tant de personnages si bien décrits, au service de cette histoire, si attachants et qui composent les habitants de Sagny.
Roman écrit en 1951, époque où le mouvement des prêtres ouvriers se développait, il en resterait encore aujourd'hui en France même si pour ma part j'en ai rarement entendu parler.
De ce livre émane surtout un message de paix et de solidarité qui fait du bien, c'est pourquoi je vous encourage vivement à le lire, histoire d'y réfléchir un peu avant de reprendre nos vies.
Pierre arrive à Sagny pour une mission d'Eglise. Malheureusement Bernard qui y officiait avant lui s'en alla. Il ressentait un besoin d'être appelé ailleurs.
Le père Pigalle présente à Pierre une prostituée qu'il a sorti de l'enfer. Il l'a baptisé et demandé à Pierre s'il peut l'héberger. Pierre l'accueille mais avec la meilleure volonté du monde, il ne peut l'héberger. Il demande au curé de la paroisse où selon lui, il y a des solutions, mais ce dernier se ferme à toutes collaborations solidaires. Son presbytère est occupé au rez-de-chaussée et l'étage restera impérativement dévolu aux archives. Une fois que Suzanne sera retapée, il faudra qu'elle travaille, d'ailleurs c'est ce qu'elle-même souhaite. Gagner de l'argent … de l'argent propre. Pierre s'engage à lui trouver du boulot mais dit en toute honnêteté que jusqu'à présent pour le logement, il n'a pas de solution.
On voit l'état d'esprit différent entre la mission confié à Pierre : être présent aux éprouvés de la société, comme Jésus était présent aux pauvres et le curé de la paroisse qui ne va pas chercher la brebis perdue.
Paulette et Jacquot ont une fille grâce à l'intervention de Pierre qui a fait comprendre à la mère que son plan d'avorter n'était pas le bon.
Il y a de l'entraide dans le milieu des éprouvés.
Il existe un habitant de plus à Sagny, et c'est le Christ ! Il y a le meilleur et le moins bon, jamais le pire ! « Oh que je les aime, pense Pierre, que je les aime ! … . » Jamais il ne se résoudra à travailler à mi-temps ! Il s'agit d'être avec eux. Il pense à chacun d'eux … A Madeleine qui s'épuise. A Jean, le sombre qui s'exalte dans le Christ. A Henri le partagé … A Michel qui n'ose plus se montrer parce qu'il ne trouve pas de travail. A Luis, seul avec ses secrets … A Suzanne, la prostituée protégée du Père Pigalle … Au Père lui-même … Car un visage en appelle un autre et c'est cela, l'Eglise ! et cela, l'Amour !
Est-ce une hallucination ? Comme le premier soir et si souvent depuis, Pierre entend un cri. Serait-ce celui du petit Etienne qui subit les coups de son père Marcel éméché. Pierre vit dans l'horreur, l'enfer, le martyre, les représailles, n'empêche qu'il les aime tous et se veut résolument à leur service.
Jean et Luis mourront dans des conditions particulières. Toute l'impasse Zola sera en émoi. Etienne battu à mort par son père fut envoyé à l'hôpital. Celles et ceux qui étaient à son chevet ne lui donnaient aucune chance de vie. C'était le soir de Pâques par l'intervention de Dieu Etienne revient à la vie. Pierre, en lui rendant visite, a pu le constater.
Pierre sera affecté par une Eglise de règles mais le Christ n'a-t-il pas dit : « Tous ceux qui ne feront pas un peu plus que les pharisiens n'auront pas accès au Royaume. »
Nous sommes en présence d'un livre qui ne laisse pas indifférent. A raison d'un soir par semaine Gilbert Cesbron a passé deux ans avec ce milieu avant d'écrire son livre.
J'ai eu pas mal de difficultés d'entrer dans ce récit. Cela était dû à une période où j'avais plus de nécessités d'agir dans ma propre vie que de me plonger dans une histoire fictive. Et puis le style de Gilbert Cesbron, dans ce livre était très centré sur d'innombrables dialogues entre les protagonistes. Ce n'était pourtant pas du théâtre. Cela a affecté, selon moi, la prise de connaissance des particularités vécues par les personnes et une compréhension détaillée de l'histoire. Cependant dans le dernier tiers du livre, je suis arrivé à entrer pleinement dans l'histoire.
J'avais entre les mains un livre édités en 1952 aux pages jaunies et à la reliure branlante. Ce livre avait été acheté par ma grand-mère qui parlait beaucoup de livres et de son libraire qui la conseillait. J'aime la formule de livres et histoire livresque partagées.
Le père Pigalle présente à Pierre une prostituée qu'il a sorti de l'enfer. Il l'a baptisé et demandé à Pierre s'il peut l'héberger. Pierre l'accueille mais avec la meilleure volonté du monde, il ne peut l'héberger. Il demande au curé de la paroisse où selon lui, il y a des solutions, mais ce dernier se ferme à toutes collaborations solidaires. Son presbytère est occupé au rez-de-chaussée et l'étage restera impérativement dévolu aux archives. Une fois que Suzanne sera retapée, il faudra qu'elle travaille, d'ailleurs c'est ce qu'elle-même souhaite. Gagner de l'argent … de l'argent propre. Pierre s'engage à lui trouver du boulot mais dit en toute honnêteté que jusqu'à présent pour le logement, il n'a pas de solution.
On voit l'état d'esprit différent entre la mission confié à Pierre : être présent aux éprouvés de la société, comme Jésus était présent aux pauvres et le curé de la paroisse qui ne va pas chercher la brebis perdue.
Paulette et Jacquot ont une fille grâce à l'intervention de Pierre qui a fait comprendre à la mère que son plan d'avorter n'était pas le bon.
Il y a de l'entraide dans le milieu des éprouvés.
Il existe un habitant de plus à Sagny, et c'est le Christ ! Il y a le meilleur et le moins bon, jamais le pire ! « Oh que je les aime, pense Pierre, que je les aime ! … . » Jamais il ne se résoudra à travailler à mi-temps ! Il s'agit d'être avec eux. Il pense à chacun d'eux … A Madeleine qui s'épuise. A Jean, le sombre qui s'exalte dans le Christ. A Henri le partagé … A Michel qui n'ose plus se montrer parce qu'il ne trouve pas de travail. A Luis, seul avec ses secrets … A Suzanne, la prostituée protégée du Père Pigalle … Au Père lui-même … Car un visage en appelle un autre et c'est cela, l'Eglise ! et cela, l'Amour !
Est-ce une hallucination ? Comme le premier soir et si souvent depuis, Pierre entend un cri. Serait-ce celui du petit Etienne qui subit les coups de son père Marcel éméché. Pierre vit dans l'horreur, l'enfer, le martyre, les représailles, n'empêche qu'il les aime tous et se veut résolument à leur service.
Jean et Luis mourront dans des conditions particulières. Toute l'impasse Zola sera en émoi. Etienne battu à mort par son père fut envoyé à l'hôpital. Celles et ceux qui étaient à son chevet ne lui donnaient aucune chance de vie. C'était le soir de Pâques par l'intervention de Dieu Etienne revient à la vie. Pierre, en lui rendant visite, a pu le constater.
Pierre sera affecté par une Eglise de règles mais le Christ n'a-t-il pas dit : « Tous ceux qui ne feront pas un peu plus que les pharisiens n'auront pas accès au Royaume. »
Nous sommes en présence d'un livre qui ne laisse pas indifférent. A raison d'un soir par semaine Gilbert Cesbron a passé deux ans avec ce milieu avant d'écrire son livre.
J'ai eu pas mal de difficultés d'entrer dans ce récit. Cela était dû à une période où j'avais plus de nécessités d'agir dans ma propre vie que de me plonger dans une histoire fictive. Et puis le style de Gilbert Cesbron, dans ce livre était très centré sur d'innombrables dialogues entre les protagonistes. Ce n'était pourtant pas du théâtre. Cela a affecté, selon moi, la prise de connaissance des particularités vécues par les personnes et une compréhension détaillée de l'histoire. Cependant dans le dernier tiers du livre, je suis arrivé à entrer pleinement dans l'histoire.
J'avais entre les mains un livre édités en 1952 aux pages jaunies et à la reliure branlante. Ce livre avait été acheté par ma grand-mère qui parlait beaucoup de livres et de son libraire qui la conseillait. J'aime la formule de livres et histoire livresque partagées.
NB :Je dois signaler à mes amis littéraires la méprise suivante : une citation
n' est pas à sa place car elle concerne le roman " Voici le temps des imposteurs " et non " Les saints vont en enfer " . Merci pour votre compréhension . " Les saints vont en enfer " est un roman de Gilbert Cesbron , ce dernier est
avant tout un homme de radio avant de la quitter pour l' écriture . C' est à partir de l' année 1966 que j' ai lu et par hasard : Les chiens perdus sans colliers ". Et après j' ai eu à lire :" C' est Mozart qu' on assassine" , "Il est minuit
"docteur Schweitzer" . J' ai lu ces livres par ce que le ton de l' auteur est sincère et parce que la lecture est fluide et aisée . Ensuite j' ai découvert des qualités à cet auteur car lors qu' il a abandonné la radio , il s' est investi dans les actions sociales et caritatives . J' ai beaucoup apprécié son altruisme et d' aller porter secours aux nécessiteux , aux démunis , aux enfants des banlieues, aux malades ...C' est un homme de bonne volonté et actif socialement . Un homme qui a des convictions et qui ne triche pas .
' Les saints vont en enfer" est un livre écrit dans le contexte des Trente Glorieuses où la France a connu un essor économique, industriel et social formidable . Mais la médaille a son revers : les problèmes rencontrés dansles banlieues, les exclus et les SDF, les élèves exclus des écoles ...
A cette époque la vision des prêtres a changé et eux aussi au lieu de rester cloîtrer dans leurs chapelles , ont commencé à investir les usines , les ateliers et côtoyés les ouvriers et partagés avec eux leur peine . A cette époque , en France , il y a une société qui vivait dans l' aisance et le confort vu l' essor économique, social et culturel et l' autre côté , il y a les banlieusards .
Donc le thème essentiel de ce roman est l' implication des prêtres dans le monde du travail .
n' est pas à sa place car elle concerne le roman " Voici le temps des imposteurs " et non " Les saints vont en enfer " . Merci pour votre compréhension . " Les saints vont en enfer " est un roman de Gilbert Cesbron , ce dernier est
avant tout un homme de radio avant de la quitter pour l' écriture . C' est à partir de l' année 1966 que j' ai lu et par hasard : Les chiens perdus sans colliers ". Et après j' ai eu à lire :" C' est Mozart qu' on assassine" , "Il est minuit
"docteur Schweitzer" . J' ai lu ces livres par ce que le ton de l' auteur est sincère et parce que la lecture est fluide et aisée . Ensuite j' ai découvert des qualités à cet auteur car lors qu' il a abandonné la radio , il s' est investi dans les actions sociales et caritatives . J' ai beaucoup apprécié son altruisme et d' aller porter secours aux nécessiteux , aux démunis , aux enfants des banlieues, aux malades ...C' est un homme de bonne volonté et actif socialement . Un homme qui a des convictions et qui ne triche pas .
' Les saints vont en enfer" est un livre écrit dans le contexte des Trente Glorieuses où la France a connu un essor économique, industriel et social formidable . Mais la médaille a son revers : les problèmes rencontrés dansles banlieues, les exclus et les SDF, les élèves exclus des écoles ...
A cette époque la vision des prêtres a changé et eux aussi au lieu de rester cloîtrer dans leurs chapelles , ont commencé à investir les usines , les ateliers et côtoyés les ouvriers et partagés avec eux leur peine . A cette époque , en France , il y a une société qui vivait dans l' aisance et le confort vu l' essor économique, social et culturel et l' autre côté , il y a les banlieusards .
Donc le thème essentiel de ce roman est l' implication des prêtres dans le monde du travail .
Gilbert Cesbron. Encore un auteur des années 50 à 70 qui est passé à la trappe ! Et pourtant s'il y en a un dont on pourrait saluer la mémoire c'est bien lui. Homme de radio, il milita toute sa vie en faveur des pauvres et des déclassés, au point d'accepter quelques années avant sa mort le poste de secrétaire du Secours Catholique. Cette attention, ce regard vers les autres, ces qualités de compassion et de sollicitude, on les retrouve tout au long de son oeuvre :
Dans ses romans : Notre prison est un royaume (1948) - Les saints vont en enfer (1952) - Chiens perdus sans collier (1954) - Vous verrez le ciel ouvert (1956) - Il est plus tard que tu ne penses (1958) - Avoir été (1960) - Entre chiens et loups (1962) - C'est Mozart qu'on assassine (1966) pour citer les plus connus;
Dans ses pièces de théâtre : Il est minuit, docteur Schweitzer (1952), sa pièce la plus célèbre
Dans ses essais, ses contes, ses nouvelles, ses recueils de poésie…
Gilbert Cesbron ne s'en cache pas : il est catholique. Son ambition est de montrer la société qui l'entoure dans une optique chrétienne (oui, chrétienne plus que catholique, d'ailleurs) avec un regard compatissant et généreux. Il répugne à donner des leçons, il ne prétend pas que le recours à la pratique religieuse soit la solution à tous les problèmes, il ne fait pas de prosélytisme. Il ne veut pas se poser en moraliste, même s'il souhaite qu'une certaine morale accompagne les actions humaines le catholicisme de Gilbert Cesbron, celui qui irrigue son oeuvre, c'est celui de Saint Vincent de Paul ou de l'abbé Pierre pas celui du Pape et des cardinaux.
D'ailleurs, il ne s'agit pas tant de religion, dans les romans de Cesbron, que de compassion et de bienveillance. La plupart des thèmes évoqués sont des situations dramatiques autour de sujets de sociétés qui donnent lieu à débat, et qui souvent deviennent clivants. Ce sont justement les victimes, directes ou collatérales, de ces situations que le romancier met en scène, avec réalisme souvent, avec compassion toujours, et le regard se fait plus tendre encore quand il se penche sur les plus faibles, les plus fragiles, les malades, les vieux, les enfants.
Il convient ici de souligner et même de louer une particularité de Gilbert Cesbron : la faculté qu'il a de peindre de façon admirable l'enfance et l'adolescence. Peu d'écrivains ont réussi à restituer avec autant d'intelligence et d'acuité les joies naïves, les angoisses, les questionnements sans fins, les désespoirs parfois qui touchent les enfants, à plus forte raison quand ils sont malheureux. L'empathie qu'il éprouve se traduit dans une tendresse jamais mièvre, mais souvent bouleversante.
Les Saints vont en enfer décrit, dans les années d'après-guerre, un quartier misérable dans une banlieue industrielle qu'il appelle Sagny. Un prêtre-ouvrier, Pierre, ancien mineur dans les houillères du Nord, prend en charge une population hétéroclite qu'il va apprendre à aimer : un père alcoolique qui bat ses gosses, une prostituée, des chômeurs, des clandestins, des êtres perdus qui cherchent une issue sans la trouver…. Cesbron dresse un portrait terrible, impitoyable de la vie dans cette banlieue défavorisée, où la misère et la déchéance ont enlevé aux habitants dignité, et parfois même envie de vivre.
Il est bien évident qu'aujourd'hui, ce roman peut paraître tout à fait obsolète : de nos jours, les prêtres-ouvriers n'existent plus, nombre de situations décrites dans le roman ne sont plus imaginables, parce que le paysage a changé, au propre et au figuré. Et s'il y a toujours des bidonvilles, la population qui y habite n'est plus la même. le même livre, écrit à notre époque, aurait une connotation plus sociale que religieuse. Et pourtant, l'actualité nous le montre tous les jours, la misère existe toujours : les Restos du coeur, dont l'action n'était pas censée devenir pérenne, sont toujours là des décennies après !
C'est pourquoi, si l'on lit Cesbron aujourd'hui (et il faut le lire car c'est un bon écrivain, profond et attachant), c'est plus à titre de documentaire sur un état de la société à un moment donné. Reste cet énorme élan de tendresse envers les déshérités, qui nous touche au coeur et nous ramène à une conscience plus aigüe de la condition humaine, bien éloignée de notre petit bien-être physique et moral.
Dans ses romans : Notre prison est un royaume (1948) - Les saints vont en enfer (1952) - Chiens perdus sans collier (1954) - Vous verrez le ciel ouvert (1956) - Il est plus tard que tu ne penses (1958) - Avoir été (1960) - Entre chiens et loups (1962) - C'est Mozart qu'on assassine (1966) pour citer les plus connus;
Dans ses pièces de théâtre : Il est minuit, docteur Schweitzer (1952), sa pièce la plus célèbre
Dans ses essais, ses contes, ses nouvelles, ses recueils de poésie…
Gilbert Cesbron ne s'en cache pas : il est catholique. Son ambition est de montrer la société qui l'entoure dans une optique chrétienne (oui, chrétienne plus que catholique, d'ailleurs) avec un regard compatissant et généreux. Il répugne à donner des leçons, il ne prétend pas que le recours à la pratique religieuse soit la solution à tous les problèmes, il ne fait pas de prosélytisme. Il ne veut pas se poser en moraliste, même s'il souhaite qu'une certaine morale accompagne les actions humaines le catholicisme de Gilbert Cesbron, celui qui irrigue son oeuvre, c'est celui de Saint Vincent de Paul ou de l'abbé Pierre pas celui du Pape et des cardinaux.
D'ailleurs, il ne s'agit pas tant de religion, dans les romans de Cesbron, que de compassion et de bienveillance. La plupart des thèmes évoqués sont des situations dramatiques autour de sujets de sociétés qui donnent lieu à débat, et qui souvent deviennent clivants. Ce sont justement les victimes, directes ou collatérales, de ces situations que le romancier met en scène, avec réalisme souvent, avec compassion toujours, et le regard se fait plus tendre encore quand il se penche sur les plus faibles, les plus fragiles, les malades, les vieux, les enfants.
Il convient ici de souligner et même de louer une particularité de Gilbert Cesbron : la faculté qu'il a de peindre de façon admirable l'enfance et l'adolescence. Peu d'écrivains ont réussi à restituer avec autant d'intelligence et d'acuité les joies naïves, les angoisses, les questionnements sans fins, les désespoirs parfois qui touchent les enfants, à plus forte raison quand ils sont malheureux. L'empathie qu'il éprouve se traduit dans une tendresse jamais mièvre, mais souvent bouleversante.
Les Saints vont en enfer décrit, dans les années d'après-guerre, un quartier misérable dans une banlieue industrielle qu'il appelle Sagny. Un prêtre-ouvrier, Pierre, ancien mineur dans les houillères du Nord, prend en charge une population hétéroclite qu'il va apprendre à aimer : un père alcoolique qui bat ses gosses, une prostituée, des chômeurs, des clandestins, des êtres perdus qui cherchent une issue sans la trouver…. Cesbron dresse un portrait terrible, impitoyable de la vie dans cette banlieue défavorisée, où la misère et la déchéance ont enlevé aux habitants dignité, et parfois même envie de vivre.
Il est bien évident qu'aujourd'hui, ce roman peut paraître tout à fait obsolète : de nos jours, les prêtres-ouvriers n'existent plus, nombre de situations décrites dans le roman ne sont plus imaginables, parce que le paysage a changé, au propre et au figuré. Et s'il y a toujours des bidonvilles, la population qui y habite n'est plus la même. le même livre, écrit à notre époque, aurait une connotation plus sociale que religieuse. Et pourtant, l'actualité nous le montre tous les jours, la misère existe toujours : les Restos du coeur, dont l'action n'était pas censée devenir pérenne, sont toujours là des décennies après !
C'est pourquoi, si l'on lit Cesbron aujourd'hui (et il faut le lire car c'est un bon écrivain, profond et attachant), c'est plus à titre de documentaire sur un état de la société à un moment donné. Reste cet énorme élan de tendresse envers les déshérités, qui nous touche au coeur et nous ramène à une conscience plus aigüe de la condition humaine, bien éloignée de notre petit bien-être physique et moral.
Citations et extraits (12)
Voir plus
Ajouter une citation
« Voici un livre qui risque de déplaire un peu partout. Mais la prudence est-elle encore une vertu ?
Dans un monde où des hommes de même langage ne peuvent plus se comprendre sans interprète ; dans un temps où l’on assassine les médiateurs, et où l’honneur commande d’être écartelé : dans ce siècle où règne la croix sans le Christ, je veux n’être d’aucun parti. J’ai trop vu de partisans pour rester capable d’un autre choix. Ainsi je ne quitterai pas la main des hommes au milieu desquels j’ai grandi, parce que je tends la main à mes amis de Sagny.
Ceux-ci ne reconnaîtront peut-être pas leur visage dans ce livre ; et les autres ne reconnaîtront pas le mien. Chacun me traitera d’agent double. Mais l’honneur d’aujourd’hui commande encore de perdre sur les deux tableaux.
On chercherait en vain Sagny sur une carte ; mais, ce que j’en raconte, on le trouvera dans presque toute la banlieue de Paris à la condition d’y porter un œil pur et un cœur exempt de parti pris.
Je serais bien honteux de blesser quiconque avec ce livre ; et je n’espère y convaincre personne : chacun ne convainc que soi-même. Mais si j’ébranle quelques esprits libres, c’est assez.
A mes amis de Sagny, j’offre cette histoire que je n’avais pas le droit d’écrire, car je n’ai jamais été pauvre, ni prêtre, ni ouvrier.
A vous J., B., A., G., qui refusez que je vous cite, je donne ce livre où tout ce qui est pur vient de vous et, de moi, ce qui est besogneux.
J., B., A., G… Vous ai-je jamais appelés par vos noms de famille ?
Des saints aussi, on ne connaît que le prénom. »
Gilbert Cesbron
Dans un monde où des hommes de même langage ne peuvent plus se comprendre sans interprète ; dans un temps où l’on assassine les médiateurs, et où l’honneur commande d’être écartelé : dans ce siècle où règne la croix sans le Christ, je veux n’être d’aucun parti. J’ai trop vu de partisans pour rester capable d’un autre choix. Ainsi je ne quitterai pas la main des hommes au milieu desquels j’ai grandi, parce que je tends la main à mes amis de Sagny.
Ceux-ci ne reconnaîtront peut-être pas leur visage dans ce livre ; et les autres ne reconnaîtront pas le mien. Chacun me traitera d’agent double. Mais l’honneur d’aujourd’hui commande encore de perdre sur les deux tableaux.
On chercherait en vain Sagny sur une carte ; mais, ce que j’en raconte, on le trouvera dans presque toute la banlieue de Paris à la condition d’y porter un œil pur et un cœur exempt de parti pris.
Je serais bien honteux de blesser quiconque avec ce livre ; et je n’espère y convaincre personne : chacun ne convainc que soi-même. Mais si j’ébranle quelques esprits libres, c’est assez.
A mes amis de Sagny, j’offre cette histoire que je n’avais pas le droit d’écrire, car je n’ai jamais été pauvre, ni prêtre, ni ouvrier.
A vous J., B., A., G., qui refusez que je vous cite, je donne ce livre où tout ce qui est pur vient de vous et, de moi, ce qui est besogneux.
J., B., A., G… Vous ai-je jamais appelés par vos noms de famille ?
Des saints aussi, on ne connaît que le prénom. »
Gilbert Cesbron
page 118 [...] Pierre traversa la chaussée, courant vers la gare, évitant les taxis (ils encombraient la rue à présent !) mais pas les injures de leurs chauffeurs ; se précipita vers la salle d'attente des troisièmes. "S'il pouvait y être encore ! Mon Dieu, s'il pouvait ... - Salaud, se dit-il soudain en s'arrêtant, si tu avais une seule petite graine de foi, tu croirais qu'il est là, et il y serait !"
Il marcha, le cœur battant, jusqu'à cette porte qu'il poussa. La salle était presque vide : seule, une forme allongée dormait sur la banquette la plus éloignée. Pierre siffla le signal, et le dormeur tourna vers lui son visage.
- Étienne !
Vingt pas les séparaient : le temps, pour Pierre, de remercier Dieu et de reprendre souffle ; pour Étienne, celui de sourire, puis de craindre, puis de reprendre confiance.
- Pierre, comment m'as-tu trouvé ?
- J'ai ... j'ai deviné.
- A cause du journal ?
- Oui, mentit Pierre, à cause du journal.
Les cils battirent en pluie blonde.
- Tu vois, j'ai été bête de ne pas te le dire. Tu l'aurais forcément deviné, que je partirais pour leur village d'enfants ! (Pierre se rappela l'article : en Provence, une "république" d'enfants abandonnés...). Tu es gentil d'être venu me dire au revoir, Pierre ! J'ai sept cents francs que Denise m'a donnés : ça me conduit jusqu'à (il regarda son billet) Pont-Saint-Esprit. Après, je ferai du stop... Le train part à dix heures cinquante-cinq...
- Tu dormais, tu l'as manqué, dit Pierre.
- Quoi ?
- Regarde l'horloge ... Ah! non, tu as déjà vu un homme pleurer, sans blagues ? (Il pensa à Marcel). Écoute, vieux, je ne venais pas te dire au revoir mais t'empêcher de partir...
Le garçon releva lentement un regard encore noyé mais si froid que l'autre se sentit jugé, rangé parmi les bourreaux d'enfants, les indicateurs de police : le clan de Judas.
- Toi ? dit Étienne, toi qui étais mon ami ! ...
C'était la parole du Christ aux oliviers [...]
Il marcha, le cœur battant, jusqu'à cette porte qu'il poussa. La salle était presque vide : seule, une forme allongée dormait sur la banquette la plus éloignée. Pierre siffla le signal, et le dormeur tourna vers lui son visage.
- Étienne !
Vingt pas les séparaient : le temps, pour Pierre, de remercier Dieu et de reprendre souffle ; pour Étienne, celui de sourire, puis de craindre, puis de reprendre confiance.
- Pierre, comment m'as-tu trouvé ?
- J'ai ... j'ai deviné.
- A cause du journal ?
- Oui, mentit Pierre, à cause du journal.
Les cils battirent en pluie blonde.
- Tu vois, j'ai été bête de ne pas te le dire. Tu l'aurais forcément deviné, que je partirais pour leur village d'enfants ! (Pierre se rappela l'article : en Provence, une "république" d'enfants abandonnés...). Tu es gentil d'être venu me dire au revoir, Pierre ! J'ai sept cents francs que Denise m'a donnés : ça me conduit jusqu'à (il regarda son billet) Pont-Saint-Esprit. Après, je ferai du stop... Le train part à dix heures cinquante-cinq...
- Tu dormais, tu l'as manqué, dit Pierre.
- Quoi ?
- Regarde l'horloge ... Ah! non, tu as déjà vu un homme pleurer, sans blagues ? (Il pensa à Marcel). Écoute, vieux, je ne venais pas te dire au revoir mais t'empêcher de partir...
Le garçon releva lentement un regard encore noyé mais si froid que l'autre se sentit jugé, rangé parmi les bourreaux d'enfants, les indicateurs de police : le clan de Judas.
- Toi ? dit Étienne, toi qui étais mon ami ! ...
C'était la parole du Christ aux oliviers [...]
L'innocent qui va être fusillé, tu crois qu'il déteste les gars du peloton ? ou même l'officier ? ou même les juges ? - Mais non ! il sait bien qu'ils ne sont que des instruments, les instruments d'une mauvaise cause et d'un mauvais système. Pour nous, c'est la même chose : la Société est mauvaise ; même ceux qui en profitent en sont les victimes. Ça n'avance à rien de les détester : c'est le système qui est détestable. Lui, il faut l'attaquer, par tous les bouts ! Mais eux, il faut essayer de leur expliquer. Si vous croyez que ça donne de la force de détester, essayez seulement le contraire : d'aimer les autres, tous les autres - et vous verrez la force que ça vous donnera ! et la paix que ça créera en vous et autour de vous !... Créer la paix, c'est chic, dites ? La paix, c'est d'aimer les autres, pour les obliger à aimer les autres - et ainsi de suite, sur toute la terre ! Et ça n'est pas facile..., ajouta-t-il à mi-voix.
― Comment trouvez-vous Jean ?
― Malheureux
― Qu’est-ce qu’on peut faire pour lui ?
― Rien, répondit-elle à mi-voix : il a découvert le Christ mais le garde pour lui. Il ne l’a pas encore trouvé chez les autres.
― Peut-être est-il déçu, voyez-vous ? Peut-être porte-t-il un grand espoir … un amour secret … Vous ne répondez pas ?
― Si je n’avais pas compris Père, je vous répondrais !
― Et alors Madeleine demanda-t-il pour rompre le silence.
― J’ai choisi dit-elle d’une voix forte.
Il craignait tant de voir des larmes dans ses yeux qu’il enchaîna vite :
― Et Michel ? Quoi de neuf pour Michel ?
― Malheureux
― Qu’est-ce qu’on peut faire pour lui ?
― Rien, répondit-elle à mi-voix : il a découvert le Christ mais le garde pour lui. Il ne l’a pas encore trouvé chez les autres.
― Peut-être est-il déçu, voyez-vous ? Peut-être porte-t-il un grand espoir … un amour secret … Vous ne répondez pas ?
― Si je n’avais pas compris Père, je vous répondrais !
― Et alors Madeleine demanda-t-il pour rompre le silence.
― J’ai choisi dit-elle d’une voix forte.
Il craignait tant de voir des larmes dans ses yeux qu’il enchaîna vite :
― Et Michel ? Quoi de neuf pour Michel ?
Ce grand corps sans vie, Pierre l’étreint avec la brutalité désespérée des sauveteurs ― « Jean ! … Jean ! … » Il rappelle son copain. L’homme qui vacille au seuil de la mort lève ses paupières de marbre, penche la tête à droite comme le Christ ― il ne pourra plus la redresser ― et parle dans un souffle :
― J’étais là quand tu as crié … Pardon vieux …
Pierre éclate en sanglots. Il hurle : « Jean ! … Jean ! … Jésus ! … » Il ne sait plus lequel est le plus sourd, le plus lointain des deux ! Ils le laissent tomber tous les deux !
― J’étais là quand tu as crié … Pardon vieux …
Pierre éclate en sanglots. Il hurle : « Jean ! … Jean ! … Jésus ! … » Il ne sait plus lequel est le plus sourd, le plus lointain des deux ! Ils le laissent tomber tous les deux !
Videos de Gilbert Cesbron (11)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gilbert Cesbron (51)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Gilbert Cesbron
Né à Paris en ?
1903
1913
1923
1933
12 questions
33 lecteurs ont répondu
Thème :
Gilbert CesbronCréer un quiz sur ce livre33 lecteurs ont répondu