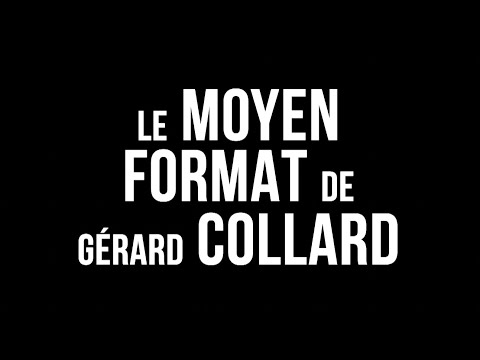Né(e) à : Romans-sur-Isère , le 14/07/1980
Jessica L. Nelson née dans la Drôme, est une romancière française, cofondatrice des éditions des Saints Pères.
Passionnée de littérature, elle crée avec des amis un site www.zone-litteraire.com et travaille dans le monde de l'édition, comme critique littéraire pour les revues Le Magazine littéraire, Citizen K, Sofa, au service des manuscrits, puis éditrice pour les éditions Balland, et dans la production audiovisuelle (Kuiv Productions).
Ajouter des informations
Quelques questions à propos de votre roman Brillant comme une larme
07/04/2020
Disparu aux portes de la vingtaine après avoir publié deux romans, Le Diable au corps et Le Bal du comte d`Orgel, Raymond Radiguet a traversé le ciel des lettres françaises comme une étoile filante. Dans son dernier roman, Brillant comme une larme, Jessica L. Nelson lui redonne vie, et nous plonge dans le théâtre vibrant de la vie culturelle parisienne de l’après-Première Guerre mondiale, où défilent aux côtés de cet enfant prodige Cocteau, Max Jacob, Picasso, Coco Chanel, André Breton et tant d’autres. Elle a répondu pour nous à quelques questions sur ce roman biographique et ses lectures.
Quelle est votre histoire personnelle avec Raymond Radiguet ? Comment avez-vous fait sa connaissance ?
J’ai lu, comme beaucoup, Le Diable au corps puis Le Bal du Comte d’Orgel lorsque j’avais une quinzaine d’années… Il me paraissait déjà incroyable qu’un garçon de quasiment mon âge ait écrit de pareils romans. Et puis je dois admettre que je l’ai un peu oublié. Ce sont les manuscrits et les dessins de Jean Cocteau, exécutés quelques mois après la mort de Radiguet, en 1924, rassemblés sous le titre Le Mystère de Jean l`oiseleur, qui m’ont donné envie de percer à jour le mystère Radiguet…
Il existe plusieurs biographies de Radiguet, citées dans la bibliographie qui clôt Brillant comme une larme. Pourquoi avez-vous fait le choix du roman pour parler de lui ?
Au départ je n’étais pas tout à fait certaine de la forme que prendrait ce texte, qui est en réalité un hommage vibrant à cet écrivain exceptionnel. La fiction s’est petit à petit imposée à moi parce qu’elle me permettait de le mettre en scène, de rester évidemment très fidèle à son histoire tout en comblant les zones d’ombre avec mon imagination et mes intuitions.
Qu’on l’ait lu ou pas, on a en tête l’image d’Épinal de Radiguet : l’enfant prodige des lettres à la carrière météorique. Comment avez-vous travaillé pour lui donner chair, pour insuffler de la vie dans cette silhouette réductrice ?
J’ai beaucoup lu et me suis imprégnée de l’ambiance bouillonnante qui régnait en ce début de siècle, siècle qui se remettait tout juste de la Première Guerre mondiale et qui a vu se croiser, à Paris, tous ces grands artistes ayant laissé leur nom et leur empreinte dans l’histoire. Documents, mémoires (ceux de Jean Hugo par exemple), essais et même romans… Et puis je connais bien l’œuvre de Jean Cocteau, qui m’a beaucoup épaulée dans ce processus.
Radiguet puise dans sa vie la matière de ses romans. Sa relation avec Alice Saunier pour Le Diable au corps, ses fréquentations parisiennes pour Le Bal du comte d’Orgel. Ses romans ont-ils nourri en retour le récit que vous faites de sa vie ? Comment s’est opéré ce jeu de miroirs ?
Il m’a semblé judicieux en effet de dessiner un parallèle entre les deux romans et ces 6 années que je mets en scène dans ce livre : d’une part, il y a cette histoire d’amour qui lui a inspiré Le Diable au corps et cette maturité dans le sentiment et la psychologie de la séduction qu’on lui a immédiatement reconnue ; et ensuite, il y a son immersion dans le monde des artistes et des écrivains, ses rencontres avec Max Jacob, André Salmon et bien sûr Jean Cocteau, qui ont nourri Le Bal du Comte d’Orgel.
Votre roman témoigne de la folle richesse de la vie de Radiguet. Et pourtant, on est surpris de voir les dates qui ouvrent chaque chapitre si rapprochées : tout tient en moins de sept ans. On pourrait presque faire défiler les pages comme celles d’un flip-book pour voir Radiguet et les Années folles s’animer comme par magie. Qu’est-ce qui vous a intéressée dans ce concentré de vie ?
Cette intensité, cette soif de vivre, d’aimer, de laisser son empreinte dans la postérité… Comme s’il avait su qu’il avait un destin, mais que ce destin serait très court.

Raymond l’adolescent se vieillit de quatre ans et écrit comme un adulte. Mais l’éditeur du Diable au corps le rajeunit pour en faire un coup d’édition. Ses traits lui valent le surnom de « sage chinois ». Et sa vie s’achève à l’âge où l’on quitte l’adolescence. Pourquoi semble-t-il échapper ainsi aux calendriers ?
Je crois qu’il s’en défiait et en jouait tout à la fois… Il avait très certainement compris que son jeune âge pouvait être à la fois un inconvénient et un atout. Donc il n’était pas d’accord qu’on s’accorde à lui trouver du génie sous prétexte qu’il écrivait avant même d’avoir atteint la vingtaine mais avait sans doute conscience que sa fougue et sa vitalité étaient les piliers de son succès.
André Salmon, Max Jacob, Coco Chanel, Picasso, Cocteau évidemment… Les fées se sont penchées sur le berceau de Radiguet. Mais l’on comprend à vous lire qu’il a tressé lui-même ce berceau, et attrapé les fées par la cravate pour qu’elles s’y penchent. Comment s’explique ce mélange d’ambition et de séduction qui le caractérise ?
Il me semble qu’il avait un rapport à la mort tout à fait particulier. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’ouvrir le roman sur cette scène très étonnante, où Jean Hugo et son épouse Valentine, Georges Auric, Jean Cocteau et Raymond, font tourner le guéridon ayant appartenu à Victor Hugo, grâce auquel il « parlait » à sa défunte fille Léopoldine. Lors de cette séance de spiritisme, qui a réellement eu lieu, un esprit se manifeste et dit à Raymond qu’il vient chercher sa jeunesse. Cela se passe en avril, et en décembre, Raymond s’éteint d’une fièvre typhoïde mal diagnostiquée. Je crois que dès l’enfance, Raymond Radiguet a été en présence, volontairement ou non, de la mort – quelques épisodes sont relatés dans le roman – et qu’il l’a défiée. Jusqu’au moment où elle lui a répondu…
Qu’est ce qui fait la singularité de Raymond Radiguet ? Qu’est ce qui le distingue des jeunes phénomènes de foire dont semble accoucher chaque rentrée littéraire, et que la rentrée suivante chasse dans l’oubli ?
Il suffit de (re)lire Le Diable et Le Bal pour le savoir et être convaincu que, quelle qu’ait été la promotion orchestrée par son éditeur à l’époque, ce sont deux romans qui devaient traverser les âges…
Quelques questions à propos de vos lectures
Quel est le livre qui vous a donné envie d`écrire ?
Ce sont surtout des auteurs. Jean Cocteau, évidemment. René Barjavel et Robert Merle, Anne Golon, pour les romans populaires du XXe siècle.
Quel est le livre que vous auriez rêvé d’écrire ?
La Nuit des temps, de René Barjavel.
Quelle est votre première grande découverte littéraire ?
Solal, et les autres romans d’Albert Cohen. A peu près à la même période, vers 18 ans, Moon Palace et l’œuvre de Paul Auster.
Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ?
La Difficulté d`être, de Cocteau.
Quel est le livre que vous avez honte de ne pas avoir lu ?
Ulysse de James Joyce.
Quelle est la perle méconnue que vous souhaiteriez faire découvrir à nos lecteurs ?
Il y en a tant ! En fait, je crois que je rêve de la découvrir : un vieux manuscrit qui n’aurait jamais été publié, et qui dormirait dans une malle dans un grenier, patientant d’être mis à jour…
Quel est le classique de la littérature dont vous trouvez la réputation surfaite ?
Aucun, si un livre est devenu un classique c’est qu’il a su toucher le cœur des lecteurs.
Avez-vous une citation fétiche issue de la littérature ?
"Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi" (Le Potomak, Jean Cocteau).
Et en ce moment que lisez-vous ?
Le Livre des morts tibétain (Pocket, 2011) et le nouveau roman de Jean-Christophe Rufin.
Découvrez Brillant comme une larme de Jessica L. Nelson aux éditions Albin Michel.
Entretien réalisé par Guillaume Teisseire
Comme d'autres avant elle, Louise se demande si les gens riront au bon endroit, s'ils seront émus par l'histoire de Goethe et Charlotte...
C'était renversant, et un peu effrayant. Comment les appelait-on, ces dames de lettres promptes à avoir un avis sur tout ? Les précieuses, les bas-bleus ? En plaisantant à demi, Gustave évoque le terme. Louise rètorque aussitôt :
- Savez-vous d'où il vient ?
- …
- Avez-vous entendu parler d'Elizabeth Montagu ?
C'était une salonnière londonienne du siècle dernier, avec des idées novatrices prônant l'égalité des sexes. Elle organisait des réunions auxquelles les hommes étaient admis pourvu qu'ils soient brillants, faisant fi des codes d'élégance vestimentaire.
- Que viennent faire les bas-bleus là-dedans ?
- L'un d'eux se présenta un jour en bas de soie bleue, afin de montrer qu'il suivait précisément les recommandations. Les invités s'autoproclamèrent le Cercle des bas bleus, en anglais Bluestocking Circle. Ce n'est qu'aujourd'hui que le terme a pris une nuance pèjorative.
- Ah, mais c'est qu'ils sont incomparables !
Louise fronce les sourcils. Le poète le constate et tente de se rattraper.
- George... n'est pas vraiment une femme !
- Ah oui ? Vous diriez donc que la relation que vous avez eue fut contre nature ?
- George pense comme un homme, même si elle n'en a pas les attributs.
Subitement, Louise se remémore les compliments que Flaubert lui faisait jadis. Lorsqu'il louait son intelligence virile, et qu'il se montrait désorienté qu'elle soit femelle et intellectuellement performante. Ces distinctions, elle les abhorre.
- Ce n'est pas parce qu'une femme se déguise en homme ou qu'elle abandonne son patronyme de naissance qu'elle deviendra plus puissante !
- Bien sûr que si. Parce que les hommes lui pardonneront d'être femme.
Musset marque une pause et reprend.
- L'histoire acceptera alors de les graver dans ses stèles. Personne ne saura qui était Aurore Dupin, baronne Dudevant...
Il se fige à révocation de son ancien amour.
- ... mais on louera pendant des siècles George Sand. Et George Eliot.
~ Me suggérez-vous de signer mes œuvres George Colet, désormais ?
As-tu entendu parler de notre égérie, Louise Colet ?
Gustave secoue la tête négativement. Sans doute Maxime, qui écume les soirées et les vernissages, l'a-t-il croisée. Mais sa retraite à Croisset l'empêche d'être au courant de tout...
- Gustave, sortez de votre grotte ! C'est la poétesse la plus talentueuse de sa génération ! Deux fois sacrée par le prix de l'Académie française. Protégée de Mme Récamier et de Chateaubriand... Amie de Nodier et des Girardin... Elle a ses entrées partout. Compte tenu de son origine provinciale et de son âge, c'est un exploit !
- James, voilà bientôt trois ans que je me consacre à l'écriture. Sans alcool, café ni tabac, sans nouvelles ou presque du monde extérieur, sans amour... !
Oh, Antigone !
Comment se prénomme la sœur d'Antigone ?
3099 lecteurs ont répondu