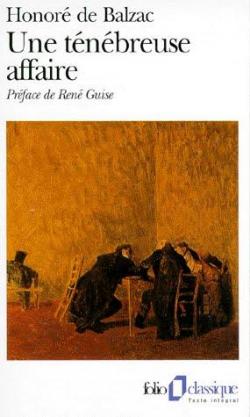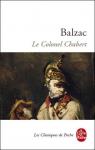Le titre est parfaitement choisi car cette affaire est presque nébuleuse. Comme le simple n'existe pas chez Balzac.
Le château de Gondreville semble être le centre de toutes les attentions de Corentin et son acolyte Peyrade, agents du ministre Fouché qui tentent de débusquer les énnemis de l'état, les pestiférés qui gardent encore les médaillon du bon roi Louis sur leur potrine.
Mais le rêve de ces policiers de paille est de pouvoir incarcérer les cinq cousins ainsi que la très jolie Mademoiselle de Cinq-Cygne. Un fois la propriété libérée de ses occcupant elle deviendra une proie facile pour ceux qui au nom du peuple racheteront les pierres et les terres pour une bouchée de pain.
Qu'en penser ?
Long, trés long, parfois interminable avec une foison de personnages qui obligent à de fréquents retours en arrière.
PERSONNAGES
– Me Jérôme-Sébastien BORDIN : ancien procureur au Châtelet (Un début dans la vie, 1842), il plaida le procès Simeuse (1806), puis celui des « chauffeurs de Mortagne » (L'Envers de l'histoire contemporaine, 1844).
– Diane d'Uxelles CADIGNAN (duchesse de Maufrigneuse, puis princesse de) : mariée à l'amant de sa mère, le duc de Maufrigneuse, elle usa largement de la liberté qu'il lui laissa avec de nombreux amants, qui vont de Victurnien d'Esgrignon (Le Cabinet des Antiques, 1839), Lucien de Rubempré (Splendeurs et misères des courtisanes, 1844), à Daniel d'Arthez (Les Secrets de la princesse de Cadignan, 1839).
– CHARGEBOEUF : famille noble de Champagne, dont la branche cadette était Cinq-Cygne. L'invention en remonte à Pierrette (1840), où une Chargeboeuf réside à Troyes. Ancien sous-préfet d'Arcis (1815) et père réel de Cécile Beauvisage, le vicomte René-Melchior de Chargeboeuf, muté à Sancerre en 1820 à la demande de Laurence de Cinq-Cygne, y fréquente, en 1823, le salon de Mme de la Baudraye (La Muse du Département, 1841). le chef de la maison, marquis de Chargeboeuf, surnommé « Le Boeuf », protégeait les Cinq-Cygne tout en leur suggérant de se rallier à l'Empire.
– Comtesse Laurence CINQ-CYGNE (puis marquise de) : héritière du nom de la branche cadette des Chargeboeuf, tante des jumeaux de Simeuse, âgée de vingt-trois ans en 1803, elle tiendra à Paris un des salons les plus fermés du faubourg Saint-Germain. Elle rend visite, en 1836, à Mme de la Chanterie, rue Chanoinesse (L'Envers de l'histoire contemporaine, 1844).
– CORENTIN : muscadin-policier formé par Peyrade, dont il est devenu le chef. Omniprésent dans La Comédie humaine, depuis le Dernier Chouan (1829), où il travaille à la perte du Gars et de Mlle de Verneuil, jusqu'au dernier épisode de Splendeurs et misères des courtisanes (1847). Cravaché par Laurence de Cinq-Cygne et décidé à le lui faire payer, il se souvient de Mlle de Verneuil : « J'en ai fait crever une qui la valait bien. »
– Comte Malin de GONDREVILLE : petit-fils d'un maçon de Troyes jadis employé à la construction de Gondreville, et ami d'enfance de Me Grévin. Danton les avait tous deux « placés », avant la Révolution, chez Me Bordin, procureur au Châtelet (Un début dans la vie, 1842). Ancien conventionnel (« Malin de l'Aube »), il prend possession en 1800 de la terre de Gondreville. Son personnage avait été créé, dans La Paix du ménage (1830), « comte de Gondreville », devenu « Malin de Gondreville » dans l'exemplaire corrigé de la Comédie humaine. La « coterie Limonville » (Le Contrat de mariage, 1835) devient dans Furne (1842) la « coterie Gondreville ». le nom de Gondreville remplace dans Sarrasine (Furne, 1844) celui, en pré-originale (Revue de Paris, 1830), du marquis d'Aligre, célèbre financier. Gondreville est enfin présenté comme « un pair constitutionnel qui restait dans la faveur de Louis XVIII » dans une addition du Furne corrigé au Cabinet des Antiques.
– Comte Roger de GRANVILLE (ou GRANDVILLE) : avocat de Michu en 1806, introduit sur épreuves par Balzac pour doubler Bordin, défenseur des jumeaux. Mal marié, il avait mené, avec Caroline Crochard, une « double vie » (Une double famille, 1830). Sa carrière fut brillante : substitut, avocat général et enfin procureur, amené à réhabiliter Birotteau (César Birotteau, 1837). Il tenta de protéger Lucien de Rubembré, après son arrestation, en négociant avec Vautrin (Splendeurs et misères des courtisanes, 1847).
– Robert et Adrien d'HAUTESERRE : Robert, l'aîné, « brutal » et « sans délicatesse », et Adrien, le cadet, d'« âme tendre et douce », inséparables des jumeaux de Simeuse. Robert trouva la mort à la redoute de la Moskowa (7 septembre 1812). Nommé général à la bataille de Dresde (26-27 août 1813), Adrien épousera Laurence de Cinq-Cygne. Il meurt en 1829.
– Comte Henri de MARSAY : fils naturel de lord Dudley et demi-frère de la marquise de San Réal (La Fille aux yeux d'or, 1834). L'« énorme figure » du comte de Marsay est omniprésente dans La Comédie humaine. Nommé premier ministre en 1831, il est, en 1833, président du Conseil lors de son récit, chez la princesse de Cadignan, des dessous d'Une ténébreuse affaire. Il meurt la même année, ou l'année suivante.
– PEYRADE : adjoint de Corentin, après avoir été son maître, et ancien jacobin. C'est le héros d'un roman ébauché en 1842 et finalement absorbé par Splendeurs et misères des courtisanes (Valentine et Valentin, Pl., XII, 351-361).
– Paul-Marie SIMEUSE (premier venu, et Marie-Paul) : fils jumeaux de Jean de Simeuse, nés en 1774, cousins de Laurence de Cinq-Cygne. Jugés en 1806 pour le soi-disant enlèvement de Malin, condamnés à vingt-quatre ans de travaux forcés, puis graciés par Napoléon, ils trouveront la mort à la bataille de Somo-Sierra, le 30 novembre 1808.
Le château de Gondreville semble être le centre de toutes les attentions de Corentin et son acolyte Peyrade, agents du ministre Fouché qui tentent de débusquer les énnemis de l'état, les pestiférés qui gardent encore les médaillon du bon roi Louis sur leur potrine.
Mais le rêve de ces policiers de paille est de pouvoir incarcérer les cinq cousins ainsi que la très jolie Mademoiselle de Cinq-Cygne. Un fois la propriété libérée de ses occcupant elle deviendra une proie facile pour ceux qui au nom du peuple racheteront les pierres et les terres pour une bouchée de pain.
Qu'en penser ?
Long, trés long, parfois interminable avec une foison de personnages qui obligent à de fréquents retours en arrière.
PERSONNAGES
– Me Jérôme-Sébastien BORDIN : ancien procureur au Châtelet (Un début dans la vie, 1842), il plaida le procès Simeuse (1806), puis celui des « chauffeurs de Mortagne » (L'Envers de l'histoire contemporaine, 1844).
– Diane d'Uxelles CADIGNAN (duchesse de Maufrigneuse, puis princesse de) : mariée à l'amant de sa mère, le duc de Maufrigneuse, elle usa largement de la liberté qu'il lui laissa avec de nombreux amants, qui vont de Victurnien d'Esgrignon (Le Cabinet des Antiques, 1839), Lucien de Rubempré (Splendeurs et misères des courtisanes, 1844), à Daniel d'Arthez (Les Secrets de la princesse de Cadignan, 1839).
– CHARGEBOEUF : famille noble de Champagne, dont la branche cadette était Cinq-Cygne. L'invention en remonte à Pierrette (1840), où une Chargeboeuf réside à Troyes. Ancien sous-préfet d'Arcis (1815) et père réel de Cécile Beauvisage, le vicomte René-Melchior de Chargeboeuf, muté à Sancerre en 1820 à la demande de Laurence de Cinq-Cygne, y fréquente, en 1823, le salon de Mme de la Baudraye (La Muse du Département, 1841). le chef de la maison, marquis de Chargeboeuf, surnommé « Le Boeuf », protégeait les Cinq-Cygne tout en leur suggérant de se rallier à l'Empire.
– Comtesse Laurence CINQ-CYGNE (puis marquise de) : héritière du nom de la branche cadette des Chargeboeuf, tante des jumeaux de Simeuse, âgée de vingt-trois ans en 1803, elle tiendra à Paris un des salons les plus fermés du faubourg Saint-Germain. Elle rend visite, en 1836, à Mme de la Chanterie, rue Chanoinesse (L'Envers de l'histoire contemporaine, 1844).
– CORENTIN : muscadin-policier formé par Peyrade, dont il est devenu le chef. Omniprésent dans La Comédie humaine, depuis le Dernier Chouan (1829), où il travaille à la perte du Gars et de Mlle de Verneuil, jusqu'au dernier épisode de Splendeurs et misères des courtisanes (1847). Cravaché par Laurence de Cinq-Cygne et décidé à le lui faire payer, il se souvient de Mlle de Verneuil : « J'en ai fait crever une qui la valait bien. »
– Comte Malin de GONDREVILLE : petit-fils d'un maçon de Troyes jadis employé à la construction de Gondreville, et ami d'enfance de Me Grévin. Danton les avait tous deux « placés », avant la Révolution, chez Me Bordin, procureur au Châtelet (Un début dans la vie, 1842). Ancien conventionnel (« Malin de l'Aube »), il prend possession en 1800 de la terre de Gondreville. Son personnage avait été créé, dans La Paix du ménage (1830), « comte de Gondreville », devenu « Malin de Gondreville » dans l'exemplaire corrigé de la Comédie humaine. La « coterie Limonville » (Le Contrat de mariage, 1835) devient dans Furne (1842) la « coterie Gondreville ». le nom de Gondreville remplace dans Sarrasine (Furne, 1844) celui, en pré-originale (Revue de Paris, 1830), du marquis d'Aligre, célèbre financier. Gondreville est enfin présenté comme « un pair constitutionnel qui restait dans la faveur de Louis XVIII » dans une addition du Furne corrigé au Cabinet des Antiques.
– Comte Roger de GRANVILLE (ou GRANDVILLE) : avocat de Michu en 1806, introduit sur épreuves par Balzac pour doubler Bordin, défenseur des jumeaux. Mal marié, il avait mené, avec Caroline Crochard, une « double vie » (Une double famille, 1830). Sa carrière fut brillante : substitut, avocat général et enfin procureur, amené à réhabiliter Birotteau (César Birotteau, 1837). Il tenta de protéger Lucien de Rubembré, après son arrestation, en négociant avec Vautrin (Splendeurs et misères des courtisanes, 1847).
– Robert et Adrien d'HAUTESERRE : Robert, l'aîné, « brutal » et « sans délicatesse », et Adrien, le cadet, d'« âme tendre et douce », inséparables des jumeaux de Simeuse. Robert trouva la mort à la redoute de la Moskowa (7 septembre 1812). Nommé général à la bataille de Dresde (26-27 août 1813), Adrien épousera Laurence de Cinq-Cygne. Il meurt en 1829.
– Comte Henri de MARSAY : fils naturel de lord Dudley et demi-frère de la marquise de San Réal (La Fille aux yeux d'or, 1834). L'« énorme figure » du comte de Marsay est omniprésente dans La Comédie humaine. Nommé premier ministre en 1831, il est, en 1833, président du Conseil lors de son récit, chez la princesse de Cadignan, des dessous d'Une ténébreuse affaire. Il meurt la même année, ou l'année suivante.
– PEYRADE : adjoint de Corentin, après avoir été son maître, et ancien jacobin. C'est le héros d'un roman ébauché en 1842 et finalement absorbé par Splendeurs et misères des courtisanes (Valentine et Valentin, Pl., XII, 351-361).
– Paul-Marie SIMEUSE (premier venu, et Marie-Paul) : fils jumeaux de Jean de Simeuse, nés en 1774, cousins de Laurence de Cinq-Cygne. Jugés en 1806 pour le soi-disant enlèvement de Malin, condamnés à vingt-quatre ans de travaux forcés, puis graciés par Napoléon, ils trouveront la mort à la bataille de Somo-Sierra, le 30 novembre 1808.
Si le roman policier est bien « un récit consacré avant tout à la découverte méthodique et graduelle, par des moyens rationnels, des circonstances exactes d'un événement mystérieux », selon la définition d'un spécialiste (Régis Messac), alors "Une ténébreuse affaire" De Balzac relève bien du genre, dans l'un de ses variants, le roman policier sans meurtre ("a detective novel without a murder"). On peut même dire qu'il l'inaugure.
Ténébreuse, c'est le moins que l'on puisse dire de l'affaire qu'il évoque. Taine prétendait qu'il fallait être magistrat pour lire le roman. le philosophe Alain est plus rassurant : « lorsqu'on le lit d'abord sans comprendre ce qu'il s'y trouve à comprendre, comme il m'est arrivé, eh bien, même alors, la perception de l'ensemble est juste » (Avec Balzac). Il ajoute en avoir parlé avec Paul Valéry qui lui a confié avoir éprouvé à sa lecture, en 1933, "le choc du grand art".
Aujourd'hui, le lecteur investigateur trouvera la pelote démêlée dans l'article de Wikipédia consacré à l'affaire. Reste à savoir ce qui peut encore séduire le lecteur d'aujourd'hui ?
Peut-être une sorte de style cinématographique. Dans la (trop) longue première partie, il y a les portraits. Les uns après les autres, les protagonistes entrent dans le champ, un peu comme dans celui d'une caméra, avec tous les détails de leur costume, qui permet de ne rien ignorer de la mode du temps et de la condition sociale du personnage. Car chez Balzac, l'habit fait le moine, autant que ses rentes. Fasciné par les théories du médecin allemand Franz Joseph Gall et du théologien suisse Johann Caspar Lavater, Balzac est un adepte de la physiognomonie. Certaines de ses notations annoncent Lombroso, comme le portrait de Michu avec sa carabine : " le cou, court et gros, tentait le couperet de la Loi". Ses personnages évoquent autant ceux croqués par son contemporain Daumier, que des acteurs de westerns : à chaque description on entend comme une petite musique lancinante, à la Sergio Leone. C'est que les accessoires, détaillés avec complaisance, dessinent en creux le caractère. Au-delà de l'imbroglio, comme dans les films d'action, il y a les bons et les méchants, chamarrés en conséquence. Laurence, Comtesse de Cinq-Cygne se donne des airs d'héroïne, amazone à cheval, maniant les armes et cravachant le fourbe Corentin. On voit bien, dans le rôle, la Sophie Marceau du film "La fille de Dartagnan" ou de "Chouans !" -d'après le roman du même Balzac-. On retrouve un peu, mais presque un demi-siècle plus tard, l'atmosphère des aventures de Nicolas le Floch, telles qu'aimait les narrer Jean-François Parot. L'étonnant est que le roman n'ait pas inspiré autre chose qu'un téléfilm en 1975.
L'amateur de scrabble se réjouira de collectionner, comme dans tout roman De Balzac, les mots rares, comme les beaux coquillages de la plage : mirliflor, Ménichmes, aîtres, poucettes... qui appellent au secours un bon dictionnaire et démontrent qu'on a jamais fini d'apprendre sa propre langue !
Le bonapartiste s'émerveillera de la rencontre au sommet entre Laurence de Cinq-Cygne et Napoléon, à Iéna. Dans l'instant décisif, en un échange digne de la prose des Antimémoires, le grand homme qui, selon Hegel, "assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine" déclare : « On doit mourir pour les lois de son pays, comme on meurt ici pour sa gloire ». Grandeur ou cynisme ? À chacun d'en juger. Mais pour la mise en scène, la réussite est certaine. Pauvre Fabrice qui n'a rien vu de Waterloo ! le lecteur d'aujourd'hui est là au cinéma, dans une superproduction ! Dans son Journal inédit, le philosophe Alain compare ce roman De Balzac à celui de Joseph Conrad : le frère de la Côte, qui met en scène le capitaine Vincent et l'illustre Nelson, à la manière de la rencontre d'Iéna, avec "cette liaison entre les scènes d'histoire et les passions secrètes".
Le juriste, dont parlait Taine, se régalera de son côté à voir fonctionner la complexe procédure pénale d'avant le code de 1808, mélangeant le tribunal criminel du code de brumaire an IV et la cour spéciale de la loi du 18 pluviôse an IX. Les précautions procédurales n'empêchent pas la corruption des juges, taraudés par l'avancement : Lescheneau, directeur du jury de Troyes est nommé procureur général en Italie, ce qui ne lui portera pas bonheur. le juge de paix Pigoult devient président du tribunal d'Arcis. Pour Balzac, qui n'a jamais été progressiste -c'est peu de le dire-, il y a comme une jubilation à suivre la course folle de la procédure, nostalgique du costume judiciaire, du crucifix en salle d'audience et du huis-clos ! Au passage, on admire le portrait de Fouché "génie purement ministériel, essentiellement gouvernemental".
L'historien admirera l'art de l'auteur pour faire émerger quelques traits saillants de la période : la conquête funambulesque du pouvoir par un Bonaparte en équilibre instable sur le fil fragile de ses victoires militaires. On croit reconnaître, dans l'adulation du vainqueur de Marengo et de tant d'autres inscriptions sur l'Arc de Triomphe, l'enthousiasme des supporters d'une équipe gagnante dans un tournoi international. Mais au premier échec, l'entraineur serait remercié ! le roman fait bien apparaître, en toile de fond, le ressort essentiel de la Révolution français que fut la vente des biens décrétés "nationaux". Malin, qui s'est approprié la terre de Gondreville, est l'illustration du dévoiement d'une opération de redistribution qui se voulait vertueuse. Les Simeuses et les Hauteserre, comme les Chouans, n'y voient qu'une spoliation, justifiant tous les complots. Balzac est toujours à son affaire pour mettre en scène la confrontation des intérêts.
Le curieux trouvera enfin matière à réflexion dans la préface, souvent négligée par les éditions modernes, car un peu longue et embarrassée. Elle dit pourtant beaucoup de la méthode De Balzac, qui consiste à transposer un fait vrai. On dirait aujourd'hui, moins élégamment, qu'il fictionnalise le fait divers. Une littérature en quête d'enquête... Car son roman est l'histoire d'une affaire aujourd'hui oubliée, concernant Clément de Ris. Elle avait fait quelque bruit en 1800, et résonné longtemps après, durant le XIXe siècle. Pour Balzac, cette affaire incroyable méritait une transposition romanesque, précisément parce que "le vrai n'était pas probable". Dans sa préface, Balzac analyse une seule de ses sources, sans les livrer toutes. Une autre, plus tardive, lui a inspiré la figure des jumeaux Marie-Paul et Paul-Marie de Simeuse : c'est la condamnation à mort des frères César et Constantin Faucher, les "jumeaux de la Réole", fusillés sur décision d'un conseil de guerre le 27 septembre 1815, à l'époque de la terreur blanche à Bordeaux. La funeste mésaventure de ces deux inséparables, devenus tous les deux généraux au début de la Révolution, fusillés pour n'avoir pas été assez prompt à acclamer le retour du Roi à la Restauration, vient assaisonner l'affaire Clément de Ris pour mieux brouiller les pistes.
Il y a donc beaucoup d'autres fils à tirer que ceux qui enserrent la ténébreuse affaire et le lecteur curieux trouvera de nombreuses portes dérobées ouvrant sur l'autres aventures...
Lien : https://diacritiques.blogspo..
Ténébreuse, c'est le moins que l'on puisse dire de l'affaire qu'il évoque. Taine prétendait qu'il fallait être magistrat pour lire le roman. le philosophe Alain est plus rassurant : « lorsqu'on le lit d'abord sans comprendre ce qu'il s'y trouve à comprendre, comme il m'est arrivé, eh bien, même alors, la perception de l'ensemble est juste » (Avec Balzac). Il ajoute en avoir parlé avec Paul Valéry qui lui a confié avoir éprouvé à sa lecture, en 1933, "le choc du grand art".
Aujourd'hui, le lecteur investigateur trouvera la pelote démêlée dans l'article de Wikipédia consacré à l'affaire. Reste à savoir ce qui peut encore séduire le lecteur d'aujourd'hui ?
Peut-être une sorte de style cinématographique. Dans la (trop) longue première partie, il y a les portraits. Les uns après les autres, les protagonistes entrent dans le champ, un peu comme dans celui d'une caméra, avec tous les détails de leur costume, qui permet de ne rien ignorer de la mode du temps et de la condition sociale du personnage. Car chez Balzac, l'habit fait le moine, autant que ses rentes. Fasciné par les théories du médecin allemand Franz Joseph Gall et du théologien suisse Johann Caspar Lavater, Balzac est un adepte de la physiognomonie. Certaines de ses notations annoncent Lombroso, comme le portrait de Michu avec sa carabine : " le cou, court et gros, tentait le couperet de la Loi". Ses personnages évoquent autant ceux croqués par son contemporain Daumier, que des acteurs de westerns : à chaque description on entend comme une petite musique lancinante, à la Sergio Leone. C'est que les accessoires, détaillés avec complaisance, dessinent en creux le caractère. Au-delà de l'imbroglio, comme dans les films d'action, il y a les bons et les méchants, chamarrés en conséquence. Laurence, Comtesse de Cinq-Cygne se donne des airs d'héroïne, amazone à cheval, maniant les armes et cravachant le fourbe Corentin. On voit bien, dans le rôle, la Sophie Marceau du film "La fille de Dartagnan" ou de "Chouans !" -d'après le roman du même Balzac-. On retrouve un peu, mais presque un demi-siècle plus tard, l'atmosphère des aventures de Nicolas le Floch, telles qu'aimait les narrer Jean-François Parot. L'étonnant est que le roman n'ait pas inspiré autre chose qu'un téléfilm en 1975.
L'amateur de scrabble se réjouira de collectionner, comme dans tout roman De Balzac, les mots rares, comme les beaux coquillages de la plage : mirliflor, Ménichmes, aîtres, poucettes... qui appellent au secours un bon dictionnaire et démontrent qu'on a jamais fini d'apprendre sa propre langue !
Le bonapartiste s'émerveillera de la rencontre au sommet entre Laurence de Cinq-Cygne et Napoléon, à Iéna. Dans l'instant décisif, en un échange digne de la prose des Antimémoires, le grand homme qui, selon Hegel, "assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine" déclare : « On doit mourir pour les lois de son pays, comme on meurt ici pour sa gloire ». Grandeur ou cynisme ? À chacun d'en juger. Mais pour la mise en scène, la réussite est certaine. Pauvre Fabrice qui n'a rien vu de Waterloo ! le lecteur d'aujourd'hui est là au cinéma, dans une superproduction ! Dans son Journal inédit, le philosophe Alain compare ce roman De Balzac à celui de Joseph Conrad : le frère de la Côte, qui met en scène le capitaine Vincent et l'illustre Nelson, à la manière de la rencontre d'Iéna, avec "cette liaison entre les scènes d'histoire et les passions secrètes".
Le juriste, dont parlait Taine, se régalera de son côté à voir fonctionner la complexe procédure pénale d'avant le code de 1808, mélangeant le tribunal criminel du code de brumaire an IV et la cour spéciale de la loi du 18 pluviôse an IX. Les précautions procédurales n'empêchent pas la corruption des juges, taraudés par l'avancement : Lescheneau, directeur du jury de Troyes est nommé procureur général en Italie, ce qui ne lui portera pas bonheur. le juge de paix Pigoult devient président du tribunal d'Arcis. Pour Balzac, qui n'a jamais été progressiste -c'est peu de le dire-, il y a comme une jubilation à suivre la course folle de la procédure, nostalgique du costume judiciaire, du crucifix en salle d'audience et du huis-clos ! Au passage, on admire le portrait de Fouché "génie purement ministériel, essentiellement gouvernemental".
L'historien admirera l'art de l'auteur pour faire émerger quelques traits saillants de la période : la conquête funambulesque du pouvoir par un Bonaparte en équilibre instable sur le fil fragile de ses victoires militaires. On croit reconnaître, dans l'adulation du vainqueur de Marengo et de tant d'autres inscriptions sur l'Arc de Triomphe, l'enthousiasme des supporters d'une équipe gagnante dans un tournoi international. Mais au premier échec, l'entraineur serait remercié ! le roman fait bien apparaître, en toile de fond, le ressort essentiel de la Révolution français que fut la vente des biens décrétés "nationaux". Malin, qui s'est approprié la terre de Gondreville, est l'illustration du dévoiement d'une opération de redistribution qui se voulait vertueuse. Les Simeuses et les Hauteserre, comme les Chouans, n'y voient qu'une spoliation, justifiant tous les complots. Balzac est toujours à son affaire pour mettre en scène la confrontation des intérêts.
Le curieux trouvera enfin matière à réflexion dans la préface, souvent négligée par les éditions modernes, car un peu longue et embarrassée. Elle dit pourtant beaucoup de la méthode De Balzac, qui consiste à transposer un fait vrai. On dirait aujourd'hui, moins élégamment, qu'il fictionnalise le fait divers. Une littérature en quête d'enquête... Car son roman est l'histoire d'une affaire aujourd'hui oubliée, concernant Clément de Ris. Elle avait fait quelque bruit en 1800, et résonné longtemps après, durant le XIXe siècle. Pour Balzac, cette affaire incroyable méritait une transposition romanesque, précisément parce que "le vrai n'était pas probable". Dans sa préface, Balzac analyse une seule de ses sources, sans les livrer toutes. Une autre, plus tardive, lui a inspiré la figure des jumeaux Marie-Paul et Paul-Marie de Simeuse : c'est la condamnation à mort des frères César et Constantin Faucher, les "jumeaux de la Réole", fusillés sur décision d'un conseil de guerre le 27 septembre 1815, à l'époque de la terreur blanche à Bordeaux. La funeste mésaventure de ces deux inséparables, devenus tous les deux généraux au début de la Révolution, fusillés pour n'avoir pas été assez prompt à acclamer le retour du Roi à la Restauration, vient assaisonner l'affaire Clément de Ris pour mieux brouiller les pistes.
Il y a donc beaucoup d'autres fils à tirer que ceux qui enserrent la ténébreuse affaire et le lecteur curieux trouvera de nombreuses portes dérobées ouvrant sur l'autres aventures...
Lien : https://diacritiques.blogspo..
Nonobstant ma profonde et sincère admiration pour Balzac, je ne m'infligerai pas une seconde lecture de ce roman, qui serait pourtant nécessaire pour dissiper les nuées qui entourent la double intrigue de ce récit : comme dans l'escalier à double révolution de Chambord, j'ai aperçu les innombrables personnages de ce roman sans jamais les rencontrer.
L'éclatement de la temporalité et de l'espace, la multiplication des actions, des personnages secondaires et des figurants, avec en arrière-plan un éventail politique où se côtoient, s'allient, s'affrontent bonapartistes, Jacobins, légitimistes, émigrés, repentis et complotistes, ont eu raison de mon enthousiasme.
L'éclatement de la temporalité et de l'espace, la multiplication des actions, des personnages secondaires et des figurants, avec en arrière-plan un éventail politique où se côtoient, s'allient, s'affrontent bonapartistes, Jacobins, légitimistes, émigrés, repentis et complotistes, ont eu raison de mon enthousiasme.
Je n'ai lu que peu De Balzac à ce jour et il m'intéressait d'aller fouiller dans son oeuvre quelque chose de moins connu, de ne pas forcément aller vers "le grand classique". Une ténébreuse affaire est pourtant vendue comme une "particularité" : on aurait le premier roman policier français. Alors je ne suis pas un grand lecteur de polar (pas du tout en fait) mais ça, ça m'intrigue bien.
N'y allons pas par quatre chemins... Ce fut d'un ennui ! La trame nous invite à suivre un complot entrepris contre Bonaparte avant qu'il ne devienne l'Empereur. Les protagonistes sont ainsi principalement des nobles en fuite et un homme au service de ces derniers. A aucun moment je n'ai été accroché par un quelconque suspense ou une envie de découvrir comment cela se trame : il n'y a pas vraiment "d'affaire", si ce n'est au milieu du livre une sorte de subterfuge que l'on trouvera expliqué à la fin de façon très rapide et donc forcément décevante.
Autre problème les personnages qui ne marchent pas : si Michu ne joue pas trop mal son rôle de serviteur dévoué de la noblesse les autres personnages sont caricaturaux ou montrent des faiblesses d'écriture : Laurence, amenée comme une femme noble à poigne et sorte de contrepied à l'homme républicain fouineur (Corentin) devient dans la deuxième partie du livre une jeune femme complétement assujettie à ses sentiments amoureux. Plus de hargne, cette figure de femme forte qui pouvait être enthousiasmante dans sa haine de Bonaparte devient une princesse convoitée et que l'on enferme désormais dans une histoire d'injustice très conventionnel. Un ratage.
Reste quelques bons passages comme l'arrivée de Laurence au début du livre ou les plaidoiries mais c'est une oeuvre qui reste à mon sens (très) secondaire. Pour une histoire de ce genre là (mais pas tout à fait...) autant se tourner vers 93 d'Hugo, là c'est d'un tout autre niveau.
N'y allons pas par quatre chemins... Ce fut d'un ennui ! La trame nous invite à suivre un complot entrepris contre Bonaparte avant qu'il ne devienne l'Empereur. Les protagonistes sont ainsi principalement des nobles en fuite et un homme au service de ces derniers. A aucun moment je n'ai été accroché par un quelconque suspense ou une envie de découvrir comment cela se trame : il n'y a pas vraiment "d'affaire", si ce n'est au milieu du livre une sorte de subterfuge que l'on trouvera expliqué à la fin de façon très rapide et donc forcément décevante.
Autre problème les personnages qui ne marchent pas : si Michu ne joue pas trop mal son rôle de serviteur dévoué de la noblesse les autres personnages sont caricaturaux ou montrent des faiblesses d'écriture : Laurence, amenée comme une femme noble à poigne et sorte de contrepied à l'homme républicain fouineur (Corentin) devient dans la deuxième partie du livre une jeune femme complétement assujettie à ses sentiments amoureux. Plus de hargne, cette figure de femme forte qui pouvait être enthousiasmante dans sa haine de Bonaparte devient une princesse convoitée et que l'on enferme désormais dans une histoire d'injustice très conventionnel. Un ratage.
Reste quelques bons passages comme l'arrivée de Laurence au début du livre ou les plaidoiries mais c'est une oeuvre qui reste à mon sens (très) secondaire. Pour une histoire de ce genre là (mais pas tout à fait...) autant se tourner vers 93 d'Hugo, là c'est d'un tout autre niveau.
L'affaire est en effet ténébreuse et pas follement palpitante, mais en plus Balzac nous égare avec une multitude de personnages et les nombreuses références à des évènements historiques bien précis, se situant entre la période révolutionnaire et les débuts de l'Empire napoléonien.
On peut donc très vite perdre le fil de l'intrigue sans un effort de concentration, et j'avoue m'être forcé un peu pour finir ce roman heureusement assez court, qui ne devient intéressant que vers la fin. Bref, si vous n'avez jamais lu le moindre Balzac, commencer par celui-ci ne me paraît pas un choix très judicieux !
On peut donc très vite perdre le fil de l'intrigue sans un effort de concentration, et j'avoue m'être forcé un peu pour finir ce roman heureusement assez court, qui ne devient intéressant que vers la fin. Bref, si vous n'avez jamais lu le moindre Balzac, commencer par celui-ci ne me paraît pas un choix très judicieux !
Ii on presque dans un polar un notable averti d'un projet d'enlevement ourdi par Foucher est lui meme enlevé ! Balzac avait ce talent de touche à tout qui lui permettait d'etre à l'aise dans tous les genres ce roman en est la preuve ! Quel talent !
"Ténébreuse" cette affaire, oui. Beaucoup de scènes se jouent de nuit, dans une forêt dense, dans des grottes souterraines, avec des acteurs qui dissimulent leurs visages, se font passer pour d'autres, et surtout, cachent leurs motivations. On ne connaîtra ainsi les véritables coupables que dans les dernières pages.
Une "affaire", oui. Affaire de police, affaire de justice, où les intérêts privés et politiques se mêlent dans cette période politique troublée. Au milieu de toutes ces intrigues, l'idylle amoureuse est peu développée, ce qui tient aussi au caractère effacé des deux - ou trois - amoureux de Laurence. C'est un beau personnage féminin que peint Balzac ici, une femme prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, mais irrésolue pour se décider en amour. Il y a d'ailleurs une inversion de genre, entre la femme intrépide décrite avec un caractère masculin, qui chasse, s'intéresse à la politique, et est prête à l'action violente, et les jeunes hommes qui ne prennent aucune décision par eux-mêmes, dépendent des autres, et sont finalement des princesses à délivrer.
Effectivement, le conte peut-être en partie un élément pour comprendre ce récit, avec ses forêts et ses ogres - même si Michu, malgré son regard ténébreux et sa barbe rousse, se révèle totalement dévoué à ses maîtres. A noter la présence de "l'Ogre de Corse", qui, pour reprendre V. Hugo "jette toujours sur nos tableaux sa grande ombre", si souvent évoqué dans la Comédie Humaine, si rarement actif comme personnage.
Une "affaire", oui. Affaire de police, affaire de justice, où les intérêts privés et politiques se mêlent dans cette période politique troublée. Au milieu de toutes ces intrigues, l'idylle amoureuse est peu développée, ce qui tient aussi au caractère effacé des deux - ou trois - amoureux de Laurence. C'est un beau personnage féminin que peint Balzac ici, une femme prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, mais irrésolue pour se décider en amour. Il y a d'ailleurs une inversion de genre, entre la femme intrépide décrite avec un caractère masculin, qui chasse, s'intéresse à la politique, et est prête à l'action violente, et les jeunes hommes qui ne prennent aucune décision par eux-mêmes, dépendent des autres, et sont finalement des princesses à délivrer.
Effectivement, le conte peut-être en partie un élément pour comprendre ce récit, avec ses forêts et ses ogres - même si Michu, malgré son regard ténébreux et sa barbe rousse, se révèle totalement dévoué à ses maîtres. A noter la présence de "l'Ogre de Corse", qui, pour reprendre V. Hugo "jette toujours sur nos tableaux sa grande ombre", si souvent évoqué dans la Comédie Humaine, si rarement actif comme personnage.
J'ai pu terminer la lecture au prix de certains efforts.
Contrairement aux autres romans de l'autre, celui ci ne se lit pas si aisément.
Les références historiques demandent une culture précise de l'époque pour en apprécier pleinement l'intrigue et les enjeux.
Pourtant j'avais lu il y a peu l'excellente biographie de "Fouché" par Sweig, ce qui m'a donné quelques bases, mais insuffisantes tout de même.
L'histoire et les personnages ne m'ont pas passionné, et j'ai refermé ce livre sans émotion.
Je ne conseillerai pas ce livre, sauf aux férus d'histoire qui y trouveront certainement leur bonheur.
Pour le commun des lecteurs, il y a beaucoup plus accessible et plus universel chez Balzac dans les autres oeuvres.
Contrairement aux autres romans de l'autre, celui ci ne se lit pas si aisément.
Les références historiques demandent une culture précise de l'époque pour en apprécier pleinement l'intrigue et les enjeux.
Pourtant j'avais lu il y a peu l'excellente biographie de "Fouché" par Sweig, ce qui m'a donné quelques bases, mais insuffisantes tout de même.
L'histoire et les personnages ne m'ont pas passionné, et j'ai refermé ce livre sans émotion.
Je ne conseillerai pas ce livre, sauf aux férus d'histoire qui y trouveront certainement leur bonheur.
Pour le commun des lecteurs, il y a beaucoup plus accessible et plus universel chez Balzac dans les autres oeuvres.
Mazette, ça c'est de l'intrigue!
Après avoir lu la biographie de Fouché par Stefan Zweig, qui cite à plusieurs reprises les mots De Balzac sur le bonhomme dans "Une ténébreuse affaire", j'avais envie de voir en situation la rouerie machiavélique que Fouché a la réputation de mettre en oeuvre dans la conduite des affaires de l'Etat.
Le moins qu'on puisse dire est que j'ai été servie ! Doubles rôles, espions, police et contre-police, billard à trois bandes, le fond de l'affaire est si tortueux que je serais bien en peine de la résumer. L'histoire se suit pourtant très bien, et sur un rythme trépidant qui fait que l'on ne s'ennuie pas une seconde malgré sa complexité.
Mais ce qui ressort surtout de ce grand roman historique, c'est le visage brouillé d'une France arrivée à une page déterminante de son histoire où l'on sent, Napoléon n'étant pas encore pleinement assis sur son trône, que tout peut basculer entre royalistes et républicains, et que dans cette instabilité seuls des hommes d'une envergure hors normes pouvaient tenir la barre. Impressionnant!
Après avoir lu la biographie de Fouché par Stefan Zweig, qui cite à plusieurs reprises les mots De Balzac sur le bonhomme dans "Une ténébreuse affaire", j'avais envie de voir en situation la rouerie machiavélique que Fouché a la réputation de mettre en oeuvre dans la conduite des affaires de l'Etat.
Le moins qu'on puisse dire est que j'ai été servie ! Doubles rôles, espions, police et contre-police, billard à trois bandes, le fond de l'affaire est si tortueux que je serais bien en peine de la résumer. L'histoire se suit pourtant très bien, et sur un rythme trépidant qui fait que l'on ne s'ennuie pas une seconde malgré sa complexité.
Mais ce qui ressort surtout de ce grand roman historique, c'est le visage brouillé d'une France arrivée à une page déterminante de son histoire où l'on sent, Napoléon n'étant pas encore pleinement assis sur son trône, que tout peut basculer entre royalistes et républicains, et que dans cette instabilité seuls des hommes d'une envergure hors normes pouvaient tenir la barre. Impressionnant!
Plongez dans le Balzac haletant ! Ici, ce ne sont point tant les petitesses bourgeoises qui sont décortiquées mais précisément les grandeurs d'âme dans la France tourmentée de la Révolution.
Le rythme est soutenu, le style impeccable, le suspens à toutes les pages. Et pourtant, nous sommes déjà plongés dans la Comédie humaine... Excellent !
Le rythme est soutenu, le style impeccable, le suspens à toutes les pages. Et pourtant, nous sommes déjà plongés dans la Comédie humaine... Excellent !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Honoré de Balzac (453)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Connaissez-vous La Peau de Chagrin de Balzac ?
Comment se comme le personnage principal du roman ?
Valentin de Lavallière
Raphaël de Valentin
Raphaël de Vautrin
Ferdinand de Lesseps
10 questions
1322 lecteurs ont répondu
Thème : La Peau de chagrin de
Honoré de BalzacCréer un quiz sur ce livre1322 lecteurs ont répondu