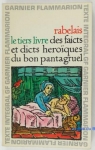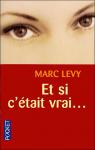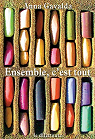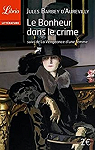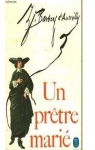Des lettres inédites de la célèbre écrivaine, révélant des échanges inconnus avec de grandes personnalités du XIXe siècle. Un livre exceptionnel !
Lettres réunies et présentées par Thierry Bodin.
Ces 406 nouvelles lettres retrouvées couvrent presque toute la vie de
George Sand, depuis ses quinze ans jusqu'à ses derniers jours. La plupart,
du court billet à la longue missive, sont entièrement inédites et viennent
s'ajouter au corpus de sa volumineuse correspondance. D'autres, dont on
ne connaissait que des extraits, sont ici publiées intégralement pour la
première fois.
Plus de 260 correspondants — dont une cinquantaine de nouveaux — sont
représentés, des moins connus aux plus illustres, comme Barbey d'Aurevilly,
Hector Berlioz, Henri Heine, Nadar, Armand Barbès, Eugène Sue, Victor
Hugo, Louis Blanc, Eugène Fromentin, Jules Favre, Pauline Viardot, la
Taglioni, ainsi que les plus divers : parents, familiers, éditeurs, journalistes
et patrons de presse, acteurs et directeurs de théâtre, écrivains, artistes,
hommes politiques, domestiques, fonctionnaires, commerçants, hommes
d'affaires...
On retrouve dans ces pages toute l'humanité et l'insatiable curiosité de
l'écrivain, que l'on suit jusqu'à ses toutes dernières lettres, en mai 1876,
quelques jours avant sa mort.
Les auteurs :
George Sand (1804-1876) est une romancière, dramaturge et critique littéraire française. Auteure de plus de 70 romans, on lui doit également quelque 25 000 lettres échangées avec toutes les célébrités artistiques de son temps.
Thierry Bodin est libraire-expert en lettres et manuscrits autographes. Ses
travaux sont consacrés au romantisme français, en particulier Honoré de Balzac, Alfred de Vigny et George Sand.

Jules Barbey d'Aurevilly/5
5 notes
Résumé :
" La réimpression d'ouvrages distingués ou supérieurs, méconnus ou tombés dans l'oubli pour toutes ces causes (si souvent incompréhensibles) qui décident de la fortune des livres, ne devient-elle pas la ressource de la Curiosité littéraire, quand la littérature, chaque jour déclinant davantage, est, comme tant de choses, peut-être au moment de périr ? "
Jules Barbey d'Aurevilly
Jules Barbey d'Aurevilly
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Bague d'AnnibalVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Résolument autobiographique, ce texte, scindé en une foule de mini-chapitres ou alors de stances - mais des stances en prose - met un point final à la liaison impossible que Barbey entretint dans sa jeunesse normande avec sa cousine Louise. Les familles, dans leur ensemble, étaient contre l'idée de tout mariage entre ce garçon qui n'avait pas encore une vision bien nette de ce qu'il allait faire dans la vie et cette fille sage, promise dès la naissance à un avenir aussi paisible que bourgeois. Les jeunes gens semblent pourtant avoir osé aller plus loin que l'amour platonique et on prétend même que, alors que Barbey vivait à Caen, Louise se cachait pour se rendre chez lui. Vérité ou fantasme, la fin de l'intrigue fut douloureuse : Louise se maria bien sagement et Jules se retira dans son coin, léchant ses plaies et rêvant de gloire littéraire. Si la première ne fut pas, en définitive, si perturbée qu'on eût pu s'y attendre, le second, en revanche, ne s'en remit jamais tout à fait.
Pour cette incarnation-ci du dandy, l'écrivain, aveuglé par la jeunesse et probablement par ses goûts naturels - il est vrai que, quand on vous baptise Jules-Amédée, on doit se sentir marqué pour la vie - s'est choisi le fabuleux alias d'Aloys de Synarose - non, ce n'est pas une défaillance de votre ordinateur et inutile de prendre rendez-vous chez un ophtalmologue, c'est bien le nom du héros. Louise, pour sa part, s'est muée en une Joséphine assez bêtasse et cependant assez finaude quand ses intérêts sont en jeu, très coquette bien sûr et, pour couronner le tout, ardente admiratrice de Mme de Staël. Dans les parages, attendant l'heure de Vénus, rôde le futur époux en titre, un certain Baudoin d'Artinel, dont la silhouette bedonnante et le crâne semi-chauve n'ont rien de bien romantiques. Fort heureusement, au contraire d'Aloys, ce monsieur a des rentes.
S'ouvre alors un petit ballet, fait de déclarations passionnées et de piques tout aussi furieuses entre Joséphine et Aloys tandis que, en coulisses, Baudoin se répète que cette jeune Joséphine est vraiment bien mignonne - de plus, côté héritage, elle a des espérances. Et ce qui devait arriver arrive : Louise finit par se ranger à l'opinion de sa famille et elle choisit d'Artinel. Barbey se livrant ici à un règlement de comptes dans les formes les plus cruelles, l'héroïne va jusqu'à attirer d'Artinel dans sa chambre en le faisant passer par le balcon : c'est un peu Roméo et Juliette avec la rouerie de Joséphine et les rhumatismes du pauvre Baudoin en plus. Qui pis est, Aloys, tapi dans l'ombre, ne perd rien de l'incroyable ascension de son heureux rival.
Heureux, jusqu'à quand ? ... Car avec une épouse si avisée ...
Oeuvre un peu biscornue, oeuvre que, à sa parution en feuilleton, dévora, dit-on, la bonne société de Caen, pressée de mettre des noms de scandale sur tel ou tel personnage "à clef", "La Bague d'Annibal" est elle aussi un bien joli exercice littéraire, au ton plaisant et caustique, avec une pointe de ténèbres byroniens qui risque de ne guère toucher le lecteur français. A lire. Mais seulement quand vous en aurez le temps. ;o)
Pour cette incarnation-ci du dandy, l'écrivain, aveuglé par la jeunesse et probablement par ses goûts naturels - il est vrai que, quand on vous baptise Jules-Amédée, on doit se sentir marqué pour la vie - s'est choisi le fabuleux alias d'Aloys de Synarose - non, ce n'est pas une défaillance de votre ordinateur et inutile de prendre rendez-vous chez un ophtalmologue, c'est bien le nom du héros. Louise, pour sa part, s'est muée en une Joséphine assez bêtasse et cependant assez finaude quand ses intérêts sont en jeu, très coquette bien sûr et, pour couronner le tout, ardente admiratrice de Mme de Staël. Dans les parages, attendant l'heure de Vénus, rôde le futur époux en titre, un certain Baudoin d'Artinel, dont la silhouette bedonnante et le crâne semi-chauve n'ont rien de bien romantiques. Fort heureusement, au contraire d'Aloys, ce monsieur a des rentes.
S'ouvre alors un petit ballet, fait de déclarations passionnées et de piques tout aussi furieuses entre Joséphine et Aloys tandis que, en coulisses, Baudoin se répète que cette jeune Joséphine est vraiment bien mignonne - de plus, côté héritage, elle a des espérances. Et ce qui devait arriver arrive : Louise finit par se ranger à l'opinion de sa famille et elle choisit d'Artinel. Barbey se livrant ici à un règlement de comptes dans les formes les plus cruelles, l'héroïne va jusqu'à attirer d'Artinel dans sa chambre en le faisant passer par le balcon : c'est un peu Roméo et Juliette avec la rouerie de Joséphine et les rhumatismes du pauvre Baudoin en plus. Qui pis est, Aloys, tapi dans l'ombre, ne perd rien de l'incroyable ascension de son heureux rival.
Heureux, jusqu'à quand ? ... Car avec une épouse si avisée ...
Oeuvre un peu biscornue, oeuvre que, à sa parution en feuilleton, dévora, dit-on, la bonne société de Caen, pressée de mettre des noms de scandale sur tel ou tel personnage "à clef", "La Bague d'Annibal" est elle aussi un bien joli exercice littéraire, au ton plaisant et caustique, avec une pointe de ténèbres byroniens qui risque de ne guère toucher le lecteur français. A lire. Mais seulement quand vous en aurez le temps. ;o)
Etrange récit, que cette bague d'Annibal, avec 150 chapitres répartis sur 70 pages. Nous sommes à mi chemin entre haikus et nouvelle.
C'est joliment écrit, mais le jeu amoureux des protagonistes m'a laissé plutôt de marbre. Méritait-il dans des portraits et de digressions? Si certains s'écoutent parler, il me semble que Barbey se plait à se lire écrire…
C'est joliment écrit, mais le jeu amoureux des protagonistes m'a laissé plutôt de marbre. Méritait-il dans des portraits et de digressions? Si certains s'écoutent parler, il me semble que Barbey se plait à se lire écrire…
Citations et extraits (2)
Ajouter une citation
[...] ... CXXXIV - Je sortis, ce soir-là, un des derniers de chez Mme de Dorff. Elle demeurait rue de Castiglione, et je m'en revenais tout songeant comme un joueur en perte, - car j'avais joué et perdu, - par la rue de Rivoli. Il faisait un clair de lune d'une grande amabilité pour les tuteurs, les maris, les voleurs et les poètes, et autres personnages intéressés par état à l'observation nocturne. C'était une nuit transparente et sonore, quoique silencieuse, - la doublure de celle de la veille.
CXXXV - "Est-ce un voleur ou sommes-nous en Espagne ?" me dis-je, en braquant ma lorgnette sur une espèce de corps épais suspendu entre le ciel et le pavé. Je regardai mieux, - je regardai encore. - Une femme se penchait timidement sur la rampe du balcon, et dessinait la plus gracieuse courbe sur l'azur du ciel. - Ce n'était pas la scène charmante de l'adieu, à la venue du jour, comme tu nous l'as montrée, ô Shakespeare ! mais plutôt celle qui dut la précéder. Et franchement, illusion ou perspective favorable, la femme penchée, ô Shakespeare, était aussi jolie que ta Juliette.
(...)
CXXXVII - Mais Roméo. Etait-ce ton Roméo, ô mon grand Shakespeare ! ou en était-ce une parodie cruelle ? Ah ! le beau Montaigu, c'était vous, M. Baudoin d'Artinel. Je vous reconnus fort bien avec votre dos un peu arrondi - mais Platon avait les épaules hautes, et qui n'est pas, d'ailleurs, un peu bossu ? ... En montant la poétique échelle de soie verte, vous étiez précieux d'élégance, de souplesse, d'agilité, de grâce ! Que votre gravité vous allait bien, ainsi perché dans les airs ! Ah ! pauvres mortels que nous sommes, ayons donc cinquante ans passés et allons juger, après cela !
CXXXVIII - Et il arriva au balcon sans encombre. - Or, - je dois l'avouer ici, Madame, - je n'entendis et je ne vis rien de ce qui dut suivre. - La porte vitrée se referma sur l'heureux couple ... et la lune alla toujours son train dans le ciel tranquille. Elle ne rougit pas, cette lune impudente, et moi, qui m'étais arrêté pour regarder cette scène singulière, je fis comme elle, j'allai me coucher. ... [...]
CXXXV - "Est-ce un voleur ou sommes-nous en Espagne ?" me dis-je, en braquant ma lorgnette sur une espèce de corps épais suspendu entre le ciel et le pavé. Je regardai mieux, - je regardai encore. - Une femme se penchait timidement sur la rampe du balcon, et dessinait la plus gracieuse courbe sur l'azur du ciel. - Ce n'était pas la scène charmante de l'adieu, à la venue du jour, comme tu nous l'as montrée, ô Shakespeare ! mais plutôt celle qui dut la précéder. Et franchement, illusion ou perspective favorable, la femme penchée, ô Shakespeare, était aussi jolie que ta Juliette.
(...)
CXXXVII - Mais Roméo. Etait-ce ton Roméo, ô mon grand Shakespeare ! ou en était-ce une parodie cruelle ? Ah ! le beau Montaigu, c'était vous, M. Baudoin d'Artinel. Je vous reconnus fort bien avec votre dos un peu arrondi - mais Platon avait les épaules hautes, et qui n'est pas, d'ailleurs, un peu bossu ? ... En montant la poétique échelle de soie verte, vous étiez précieux d'élégance, de souplesse, d'agilité, de grâce ! Que votre gravité vous allait bien, ainsi perché dans les airs ! Ah ! pauvres mortels que nous sommes, ayons donc cinquante ans passés et allons juger, après cela !
CXXXVIII - Et il arriva au balcon sans encombre. - Or, - je dois l'avouer ici, Madame, - je n'entendis et je ne vis rien de ce qui dut suivre. - La porte vitrée se referma sur l'heureux couple ... et la lune alla toujours son train dans le ciel tranquille. Elle ne rougit pas, cette lune impudente, et moi, qui m'étais arrêté pour regarder cette scène singulière, je fis comme elle, j'allai me coucher. ... [...]
[...] ... XXV - M. d'Artinel ... Baudoin d'Artinel, je crois, - oui ! c'est Baudoin qu'il s'appelait ... ou d'un nom à peu près pareil et qu'on s'étonnait toujours de voir accolé à un tel personnage, - M. Baudoin d'Artinel était un homme grave et respectable, jouissant au plus haut degré de l'estime publique, conseiller en Cour royale, ou juge, - je ne sais plus trop lequel - ayant passé trente ans de sa vie, au su de tout le monde, à faire trois enfants à sa femme et un nombre illimité de rapports.
XXVI - Il avait donc été marié . mais sa femme était morte. Il l'avait pleurée - convenablement ; car on disait que son mariage avait été autrefois un mariage d'inclination. Mais le temps tue la douleur sur le cadavre qu'elle fait, et d'ailleurs un conseiller en Cour royale ne peut décemment pleurer toujours. Cependant, il n'avait point déposé l'air mélancolique, et souvent il aimait encore à glisser de ces mots qui résonnent si bien dans l'oreille des femmes, quand il voulait faire allusion à des chagrins ineffaçables et à un cruel isolement.
XXVII - Soit que Joséphine l'eût séduit avec son bavardage de robes ou de chiffons, - ou par ses grands mots de vertu ou d'estime publique, de sentiments purs et doux, - le vénérable conseiller recherchait avidement l'inexplicable créature. Peut-être le mariage et les peines qui en avaient été la suite ne l'avaient point assez maltraité pour qu'il ne s'aperçût pas des agréments extérieurs de Mme d'Alcy. C'était une nature double et indécise, moitié vieux fat, moitié sentimental ; et c'est ainsi qu'en louvoyant entre ces deux manières d'être, il avait passé autrefois pour un homme à bonnes fortunes. ... [...]
XXVI - Il avait donc été marié . mais sa femme était morte. Il l'avait pleurée - convenablement ; car on disait que son mariage avait été autrefois un mariage d'inclination. Mais le temps tue la douleur sur le cadavre qu'elle fait, et d'ailleurs un conseiller en Cour royale ne peut décemment pleurer toujours. Cependant, il n'avait point déposé l'air mélancolique, et souvent il aimait encore à glisser de ces mots qui résonnent si bien dans l'oreille des femmes, quand il voulait faire allusion à des chagrins ineffaçables et à un cruel isolement.
XXVII - Soit que Joséphine l'eût séduit avec son bavardage de robes ou de chiffons, - ou par ses grands mots de vertu ou d'estime publique, de sentiments purs et doux, - le vénérable conseiller recherchait avidement l'inexplicable créature. Peut-être le mariage et les peines qui en avaient été la suite ne l'avaient point assez maltraité pour qu'il ne s'aperçût pas des agréments extérieurs de Mme d'Alcy. C'était une nature double et indécise, moitié vieux fat, moitié sentimental ; et c'est ainsi qu'en louvoyant entre ces deux manières d'être, il avait passé autrefois pour un homme à bonnes fortunes. ... [...]
Lire un extrait
Videos de Jules Barbey d'Aurevilly (12)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jules Barbey d'Aurevilly (73)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les titres des œuvres de Jules Barbey d'Aurevilly
Quel est le titre correct ?
Les Ensorcelés
Les Diaboliques
Les Maléfiques
Les Démoniaques
10 questions
46 lecteurs ont répondu
Thème :
Jules Barbey d'AurevillyCréer un quiz sur ce livre46 lecteurs ont répondu