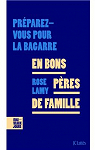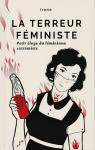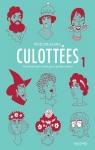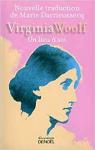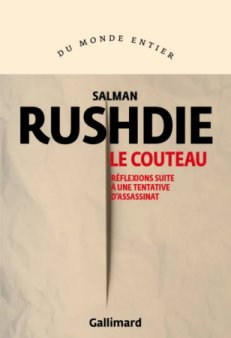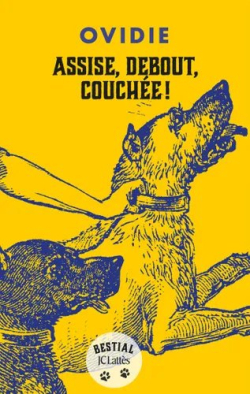Evelyne Bechtold-RognonÉlodie de CosterNina CharlierAnnick Coupé
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Résumé :
Ce livre est à la fois un cadeau, une mémoire et une promesse.
Un cadeau d’abord, parce qu’il fête les vingt ans des Journées intersyndicales femmes. À l’initiative de l’intersyndicale Femmes qui regroupe des militantes de la Confédération générale du travail (CGT), de la Fédération syndicale unitaire (FSU, principal syndicat enseignant) et de l’Union syndicale Solidaires, tous les ans depuis 1997 se réunissent au mois de mars entre 300 et 400 personnes, venu... >Voir plus
Un cadeau d’abord, parce qu’il fête les vingt ans des Journées intersyndicales femmes. À l’initiative de l’intersyndicale Femmes qui regroupe des militantes de la Confédération générale du travail (CGT), de la Fédération syndicale unitaire (FSU, principal syndicat enseignant) et de l’Union syndicale Solidaires, tous les ans depuis 1997 se réunissent au mois de mars entre 300 et 400 personnes, venu... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Toutes à y gagnerVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Dans le monde du travail, les femmes sont tout sauf une « minorité »
Dans son avant-propos, Annick Coupé revient sur vingt ans de Journées féministes intersyndicales, les liens entre inégalités sociales et inégalités de genre, les droits des femmes – « toujours le fruit des mobilisations et des luttes des premières concernées » -, le souci de croiser des analyses « universitaires » avec les réflexions de syndicalistes…
Les textes sont regroupés en sous-parties : Femmes et travail, Domesticité et services à la personne, le temps des femmes, Politiques familiales et politiques publiques, Les enjeux de la mixité, Femmes et santé, Femmes dans la crise, Les femmes et les enjeux européens, Mondialisation et enjeux pour les femmes, Femmes et syndicalisme, Les enjeux d'un langage égalitaire, Femmes et création, Femmes et extrême droite, Lesbophobie et féminisme, le corps des femmes et ses enjeux, La question des violences, Les enjeux féministes.
Je n'aborde que certains thèmes et certains articles. S'il s'agit d'un choix très subjectif, j'indique néanmoins que la critique du travail reste incontournable, non seulement pour des syndicalistes mais aussi pour celles et ceux qui ne se satisfont pas des actuels rapports sociaux.
Travail salarié, temps de travail, temps partiel comme « cas significatif de formes ouvertes et larvées de discriminations professionnelles », mode d'emploi flexible et non aménagement du temps de travail, marquage socioprofessionnel, forme atypique d'emploi, précarités, bas salaires des femmes, secteurs à forte externalisation et à forte main-d'oeuvre féminine, droit et droit individuel, poids des tâches domestiques, modèles familialistes, discriminations directes et indirectes, femmes et hommes dans les fonctions publiques, « La division sexuée des rôles sociaux traverse ainsi les sphères privée, publique et professionnelle ».
Comme l'indique Françoise Milewski « Il faut prendre en compte, ensemble, la participation au marché du travail et l'organisation domestique pour comprendre les obstacles aux déroulements de carrières. Il faut considérer, ensemble, les filières de formation, la façon dont elles sont « choisies », et l'insertion dans le travail. Il faut décrire, ensemble, les stéréotypes des employeurs et des collègues, et les interrogations des femmes sur leur légitimité ». L'auteure propose la mise en oeuvre d'actions positives, « Il s'agit de déroger temporairement à l'égalité de droit pour atteindre l'égalité réelle ».
Dévalorisation des métiers à prédominance féminine, occultation des compétences et des qualifications des femmes, notion de « travail à valeur égale », discrimination indirecte, « un dispositif peut-être non-discriminant en apparence mais discriminant dans ses effets »…
Je souligne l'article de Margaret Maruani et Monique Meron « Un siècle de travail des femmes : 1901-2011 ». Les auteures parlent du compter et du conter de l'activité des femmes, de la visibilité ou de l'invisibilité organisée de cette activité, du choix politique des chiffres, « les contes et codes sociaux qui délimitent les frontières de ce que l'on nomme le travail des femmes », de l'art de fabriquer les statistiques, des soupçons d'inactivité pesant en permanence sur les femmes, de fonction sociale du travail, d'affirmation de soi « comme membre d'une société économique ».
Regarder les statistiques de l'activité professionnelle des femmes, raconter l'histoire de leur statut, « Car le travail féminin est un fil rouge pour lire la place des femmes dans la société, dans toutes les sociétés contemporaines ».
Margaret Maruani et Monique Meron constatent, entre autres, « le poids indiscutable de l'activité professionnelle des femmes dans le fonctionnement économique, sa remarquable constance, en dépit des crises et des récessions, par delà les périodes de guerre et d'après-guerre », l'importance et la permanence du travail des femmes, « L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable », la discontinuité des trajectoires comme « parenthèse », le poids de l'idéologie de la femme au foyer…
Elles abordent aussi le « registre du mensonge social », la porosité des frontières statistiques, la cartographie mouvante du sexe des métiers, le maintien d'« indéracinables bastions masculins et féminins », la panne de mixité dans le salariat d'exécution, la décision politique de reléguer dans l'ombre le travail des femmes…
Le titre de cette note est un emprunt aux auteures.
Je rappelle l'ouvrage de Margaret Maruani et Monique Meron : Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011 et propose en complément possible, au sein d'une riche littérature sur le sujet :
Rachel Silvera : Un quart en moins. Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités salariales
Danielle Kergoat, Se battre disent-elles…
Bas salaires, pénibilité non reconnue (physique – charges lourdes, postures – psychologiques), aides à domicile (à 98% des femmes), éclatement des horaires sur des plages horaires longues, isolement, diplômes obtenus à l'étranger et non reconnus, dévalorisation des compétences, socialisation dans des rôles domestiques sexués… Emplois domestiques, Florence Scrinzi utilise cette expression pour parler d'« emplois où le travail domestique gratuit généralement accompli par les femmes est externalisé et rémunéré ».
Charges émotionnelles et psychiques spécifiques invisibilisées, politiques publiques et représentations, « Les représentations dominantes du travail d'aide aux personnes comme étant un travail non-qualifié qui ne demande pas d'expériences ni de compétences – un travail de femmes… », stéréotypes racistes et sexistes…
Je souligne l'article d'Annie Dussuet, le travail domestique structurant « dans la place que les femmes occupent dans la société en générale », l'impossibilité d'une approche énumérative – et l'oubli de certaines tâches -, la division sexuée des tâches, pas simplement une activité mais « bien autre chose », invisibilité et dévalorisation, « Cette dévalorisation est donc un temps essentiel du processus de domination puisqu'elles contribuent à le reproduire », travail et « préoccupation », élasticité du temps et du travail domestique, tâches d'« autoproduction » perçues/construites comme « facultatives », assignation des femmes… L'auteure met en avant qu'« Il est donc nécessaire d'analyser conjointement travail domestique et travail professionnel, dans la perspective d'une division sexuelle globale du travail, afin de mettre en évidence les enjeux des transformations de l'organisation du travail salarié (qui affectent hommes et femmes différemment), mais aussi ceux des politiques familiales, sociales, fiscales qui, à travers l'assignation des femmes au travail domestique, affectent aussi leur rapport à l'emploi ».
En complément possible, François-Xavier Devetter et Sandrine Rousseau : du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité.
Division du temps, temps social, « La maitrise des temporalités du social est une conquête constante âprement débattue », le fantasme de la neutralité de l'âge et sa valeur sociale, temps masculin et temps féminin, « La mise à disposition permanente avec mobilisation intermittente est le propre du temps féminisé », contraintes formelles et informelles mises sur le compte de « traditions » ou de « ce qui va de soit », imbrication des rythmes et des décalages temporels, « la parcellisation et le caractère répétitif des tâches domestiques a fortement marqué de son empreinte le temps féminin salarié »…
Engagement syndical, sous-représentation des femmes, résistances des hommes, figure du « militant désincarné », « impasse sur le fait que les charges domestiques et parentales incombent largement aux femmes et que les pressions conjugales et familiales s'exercent essentiellement sur elles », nécessité de prendre en compte « la dimension privée du temps syndical »…
Les 35 heures, individualisation de la relation salariale, temps partiel, le subi et l'imposé à l'embauche, le poids des représentations sociales, « la question du travail et du hors travail comme un tout », les nouvelles inégalités, Isabelle Puech souligne que « La réduction collective du temps de travail est une condition nécessaire mais pas suffisante pour aboutir à un meilleur partage des tâches domestiques »…
Nicole Mosconi aborde le rapport aux savoirs et l'égalité des sexes, la mixité et l'école, « l'absence de réflexion politique et pédagogique préalable » à la mixité introduite tardivement dans l'institution scolaire en France, les socialisations très sexuées, la bi-catégorisation et la hiérarchisation des sexes, les différences de relations entre enseignant-e-s et élèves filles et élèves garçons, « Les enseignants ont tendance à percevoir les garçons comme des individualités et les filles comme un groupe indifférencié », le « double standard » lié au sexe, l'occupation différencié de l'espace physique et sonore, l'apprentissage de choses différentes, la division socio-séxuée des savoirs, les contenus et les trajectoires scolaires, les croyances sur le « goût des filles », la forte concentration sexuée des emplois, « Les femmes ne sont jamais considérées comme des travailleuses à part entière », le « curriculum caché » ou ces choses acquises à l'école mais qui ne figurent pas aux programmes. L'auteure appelle à une « transformation radicale des rapports sociaux de sexe ».
Je rappelle un récent ouvrage de l'auteure : Nicole Mosconi : de la croyance à la différence des sexes.
Le bon dos de la crise, les dessous des politiques publiques, « la tolérance sociale » aux inégalités, les mesures familiaristes (contre « la forme individualisée d'accès aux droits sociaux ») et le contrôle social. Comme le rappelle Rachel Silvera : « Les inégalités de genre ne peuvent se déconstruire sans analyse en termes de classes » (J'ajoute, la prise en compte de l'ensemble des rapports sociaux et leur imbrication)…
J'ai été particulièrement intéressé par l'analyse de Christiane Marty sur l'affichage mensonger de l'égalité hommes-femmes dans les institutions européennes, les droits manquants, la différence entre le droit au travail et le droit à l'emploi, la régression par rapport à la « Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848 », le refus d'intégrer l'égalité hommes-femmes au même titre que la liberté et la démocratie, les impacts des politiques néolibérales et du recul des services publics, la survalorisation de l'individu désincarné…
Le genre et la mondialisation, Jules Falquet parle, entre autres, de « femmes de service », de nouvelles « femmes globales », de re-familiarisation de nombreuses tâches en lien avec les plans d'ajustement structurels, des nouveaux emplois féminins et de migrations, de « véritable processus d'internationalisation de la reproduction sociale », de multiplication des « hommes en armes », de la place des complexes militaro-industriels…
En complément possible, Sous la direction de Jules Falquet, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky le Feuvre, Fatou Sow : le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail et Jules Falquet : de gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation, Ce que le genre fait à l'analyse de la mondialisation néolibérale : L'ombre portée des systèmes militaro-industriels sur les « femmes globales, Pax neoliberalia.
Je souligne aussi l'article de Marguerite Rollinde « Genre et conflit ».
Je choisis d'illustrer la partie sur Femmes et syndicalisme par un texte d'Eléni Varikas : Flora Tristan et l'Union ouvrière.
Langage et sexisme, hiérarchie construite au sein de la grammaire, nommer ou invisibiliser, « la codification de l'usage joue un rôle de rempart » contre l'égalité, logique politique plus que linguistique, usage du masculin neutre et conquêtes des femmes, dans les mots l'illégitimité des femmes, s'épargner ou non « l'effort qu'un écrit non sexiste demande », la rédaction épicène, l'accord de proximité…
En complément possible, Josiane Boutet : le pouvoir des mots, Eliane Viennot : L'Académie contre la langue française. le dossier « féminisation », Eliane Viennot : non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin – petite histoire des résistance de la langue française.
Féminisme, lesbianisme, contrainte à l'hétérosexualité, dénigrement du plaisir féminin, érotisation de l'assujettissement des femmes, droit de la personne individuelle et non système de droits liés au couple…
Je souligne l'article de Françoise Collin, les réflexions sur le corps et le désir, « le corps du féminisme est resté suspendu au vestiaire des luttes et des savoirs », sexualité et domination, impunité auto-accordée aux hommes, différence et indifférence des sexes, « une pensée de la praxis, à partir d'un donné déterminé plutôt que de feindre ignorer celui-ci »…
Les violences, les violences conjugales des hommes, la violence comme stratégie et abus de pouvoir, les violences économiques, la tolérance sociale aux violences des hommes, les viols, « 80% des viols sont commis par quelqu'un qu'on connaît, chez soi ou au domicile de l'agresseur », les violences au travail, l'AVFT, le système prostitueur…
La division sexuelle du travail, séparation et hiérarchie, interpénétration constante des formes de la division du travail comme des rapports sociaux, nécessaires interventions dans les deux pôles de l'activité – travail salarié et travail domestique-, ce qui fait apparaître comme naturels des faits résultats de constructions sociales et historiques, la division intériorisé, les « qualités » des femmes et les « qualifications » des hommes, liberté-égalité… Je souligne, entre autres, ce qu'écrit Michèle Riot-Sarcey : « L'égalité réelle n'est pas l'égalité dans la liberté semblable à ceux qui sont libres, mais être en capacité de pouvoir parler à tout individu, quel qu'il soit, quelle que soit son origine et débattre ensemble de ce qu'est le pouvoir d'être citoyen »…
Ce « Vingt ans de féminisme intersyndical » offre un ensemble de textes pour réfléchir et agir. Les contributions choisies soulignent la centralité du travail dans l'imbrication des rapports sociaux, la place incontournable du féminisme pour remettre en cause les dominations. Un chapitre sur féminisme, mouvement syndical et racisation aurait été le bienvenu. Quoiqu'il en soit, un ouvrage pouvant être largement diffusé aux syndiqué-e-s et plus largement à toutes celles et tous ceux qui veulent « étonner la catastrophe » et « dégager la route vers un monde différent, où les femmes et les hommes pourront vivre égaux, plus libres et plus heureux ».
Lien : https://entreleslignesentrel..
Dans son avant-propos, Annick Coupé revient sur vingt ans de Journées féministes intersyndicales, les liens entre inégalités sociales et inégalités de genre, les droits des femmes – « toujours le fruit des mobilisations et des luttes des premières concernées » -, le souci de croiser des analyses « universitaires » avec les réflexions de syndicalistes…
Les textes sont regroupés en sous-parties : Femmes et travail, Domesticité et services à la personne, le temps des femmes, Politiques familiales et politiques publiques, Les enjeux de la mixité, Femmes et santé, Femmes dans la crise, Les femmes et les enjeux européens, Mondialisation et enjeux pour les femmes, Femmes et syndicalisme, Les enjeux d'un langage égalitaire, Femmes et création, Femmes et extrême droite, Lesbophobie et féminisme, le corps des femmes et ses enjeux, La question des violences, Les enjeux féministes.
Je n'aborde que certains thèmes et certains articles. S'il s'agit d'un choix très subjectif, j'indique néanmoins que la critique du travail reste incontournable, non seulement pour des syndicalistes mais aussi pour celles et ceux qui ne se satisfont pas des actuels rapports sociaux.
Travail salarié, temps de travail, temps partiel comme « cas significatif de formes ouvertes et larvées de discriminations professionnelles », mode d'emploi flexible et non aménagement du temps de travail, marquage socioprofessionnel, forme atypique d'emploi, précarités, bas salaires des femmes, secteurs à forte externalisation et à forte main-d'oeuvre féminine, droit et droit individuel, poids des tâches domestiques, modèles familialistes, discriminations directes et indirectes, femmes et hommes dans les fonctions publiques, « La division sexuée des rôles sociaux traverse ainsi les sphères privée, publique et professionnelle ».
Comme l'indique Françoise Milewski « Il faut prendre en compte, ensemble, la participation au marché du travail et l'organisation domestique pour comprendre les obstacles aux déroulements de carrières. Il faut considérer, ensemble, les filières de formation, la façon dont elles sont « choisies », et l'insertion dans le travail. Il faut décrire, ensemble, les stéréotypes des employeurs et des collègues, et les interrogations des femmes sur leur légitimité ». L'auteure propose la mise en oeuvre d'actions positives, « Il s'agit de déroger temporairement à l'égalité de droit pour atteindre l'égalité réelle ».
Dévalorisation des métiers à prédominance féminine, occultation des compétences et des qualifications des femmes, notion de « travail à valeur égale », discrimination indirecte, « un dispositif peut-être non-discriminant en apparence mais discriminant dans ses effets »…
Je souligne l'article de Margaret Maruani et Monique Meron « Un siècle de travail des femmes : 1901-2011 ». Les auteures parlent du compter et du conter de l'activité des femmes, de la visibilité ou de l'invisibilité organisée de cette activité, du choix politique des chiffres, « les contes et codes sociaux qui délimitent les frontières de ce que l'on nomme le travail des femmes », de l'art de fabriquer les statistiques, des soupçons d'inactivité pesant en permanence sur les femmes, de fonction sociale du travail, d'affirmation de soi « comme membre d'une société économique ».
Regarder les statistiques de l'activité professionnelle des femmes, raconter l'histoire de leur statut, « Car le travail féminin est un fil rouge pour lire la place des femmes dans la société, dans toutes les sociétés contemporaines ».
Margaret Maruani et Monique Meron constatent, entre autres, « le poids indiscutable de l'activité professionnelle des femmes dans le fonctionnement économique, sa remarquable constance, en dépit des crises et des récessions, par delà les périodes de guerre et d'après-guerre », l'importance et la permanence du travail des femmes, « L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable », la discontinuité des trajectoires comme « parenthèse », le poids de l'idéologie de la femme au foyer…
Elles abordent aussi le « registre du mensonge social », la porosité des frontières statistiques, la cartographie mouvante du sexe des métiers, le maintien d'« indéracinables bastions masculins et féminins », la panne de mixité dans le salariat d'exécution, la décision politique de reléguer dans l'ombre le travail des femmes…
Le titre de cette note est un emprunt aux auteures.
Je rappelle l'ouvrage de Margaret Maruani et Monique Meron : Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011 et propose en complément possible, au sein d'une riche littérature sur le sujet :
Rachel Silvera : Un quart en moins. Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités salariales
Danielle Kergoat, Se battre disent-elles…
Bas salaires, pénibilité non reconnue (physique – charges lourdes, postures – psychologiques), aides à domicile (à 98% des femmes), éclatement des horaires sur des plages horaires longues, isolement, diplômes obtenus à l'étranger et non reconnus, dévalorisation des compétences, socialisation dans des rôles domestiques sexués… Emplois domestiques, Florence Scrinzi utilise cette expression pour parler d'« emplois où le travail domestique gratuit généralement accompli par les femmes est externalisé et rémunéré ».
Charges émotionnelles et psychiques spécifiques invisibilisées, politiques publiques et représentations, « Les représentations dominantes du travail d'aide aux personnes comme étant un travail non-qualifié qui ne demande pas d'expériences ni de compétences – un travail de femmes… », stéréotypes racistes et sexistes…
Je souligne l'article d'Annie Dussuet, le travail domestique structurant « dans la place que les femmes occupent dans la société en générale », l'impossibilité d'une approche énumérative – et l'oubli de certaines tâches -, la division sexuée des tâches, pas simplement une activité mais « bien autre chose », invisibilité et dévalorisation, « Cette dévalorisation est donc un temps essentiel du processus de domination puisqu'elles contribuent à le reproduire », travail et « préoccupation », élasticité du temps et du travail domestique, tâches d'« autoproduction » perçues/construites comme « facultatives », assignation des femmes… L'auteure met en avant qu'« Il est donc nécessaire d'analyser conjointement travail domestique et travail professionnel, dans la perspective d'une division sexuelle globale du travail, afin de mettre en évidence les enjeux des transformations de l'organisation du travail salarié (qui affectent hommes et femmes différemment), mais aussi ceux des politiques familiales, sociales, fiscales qui, à travers l'assignation des femmes au travail domestique, affectent aussi leur rapport à l'emploi ».
En complément possible, François-Xavier Devetter et Sandrine Rousseau : du balai. Essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité.
Division du temps, temps social, « La maitrise des temporalités du social est une conquête constante âprement débattue », le fantasme de la neutralité de l'âge et sa valeur sociale, temps masculin et temps féminin, « La mise à disposition permanente avec mobilisation intermittente est le propre du temps féminisé », contraintes formelles et informelles mises sur le compte de « traditions » ou de « ce qui va de soit », imbrication des rythmes et des décalages temporels, « la parcellisation et le caractère répétitif des tâches domestiques a fortement marqué de son empreinte le temps féminin salarié »…
Engagement syndical, sous-représentation des femmes, résistances des hommes, figure du « militant désincarné », « impasse sur le fait que les charges domestiques et parentales incombent largement aux femmes et que les pressions conjugales et familiales s'exercent essentiellement sur elles », nécessité de prendre en compte « la dimension privée du temps syndical »…
Les 35 heures, individualisation de la relation salariale, temps partiel, le subi et l'imposé à l'embauche, le poids des représentations sociales, « la question du travail et du hors travail comme un tout », les nouvelles inégalités, Isabelle Puech souligne que « La réduction collective du temps de travail est une condition nécessaire mais pas suffisante pour aboutir à un meilleur partage des tâches domestiques »…
Nicole Mosconi aborde le rapport aux savoirs et l'égalité des sexes, la mixité et l'école, « l'absence de réflexion politique et pédagogique préalable » à la mixité introduite tardivement dans l'institution scolaire en France, les socialisations très sexuées, la bi-catégorisation et la hiérarchisation des sexes, les différences de relations entre enseignant-e-s et élèves filles et élèves garçons, « Les enseignants ont tendance à percevoir les garçons comme des individualités et les filles comme un groupe indifférencié », le « double standard » lié au sexe, l'occupation différencié de l'espace physique et sonore, l'apprentissage de choses différentes, la division socio-séxuée des savoirs, les contenus et les trajectoires scolaires, les croyances sur le « goût des filles », la forte concentration sexuée des emplois, « Les femmes ne sont jamais considérées comme des travailleuses à part entière », le « curriculum caché » ou ces choses acquises à l'école mais qui ne figurent pas aux programmes. L'auteure appelle à une « transformation radicale des rapports sociaux de sexe ».
Je rappelle un récent ouvrage de l'auteure : Nicole Mosconi : de la croyance à la différence des sexes.
Le bon dos de la crise, les dessous des politiques publiques, « la tolérance sociale » aux inégalités, les mesures familiaristes (contre « la forme individualisée d'accès aux droits sociaux ») et le contrôle social. Comme le rappelle Rachel Silvera : « Les inégalités de genre ne peuvent se déconstruire sans analyse en termes de classes » (J'ajoute, la prise en compte de l'ensemble des rapports sociaux et leur imbrication)…
J'ai été particulièrement intéressé par l'analyse de Christiane Marty sur l'affichage mensonger de l'égalité hommes-femmes dans les institutions européennes, les droits manquants, la différence entre le droit au travail et le droit à l'emploi, la régression par rapport à la « Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848 », le refus d'intégrer l'égalité hommes-femmes au même titre que la liberté et la démocratie, les impacts des politiques néolibérales et du recul des services publics, la survalorisation de l'individu désincarné…
Le genre et la mondialisation, Jules Falquet parle, entre autres, de « femmes de service », de nouvelles « femmes globales », de re-familiarisation de nombreuses tâches en lien avec les plans d'ajustement structurels, des nouveaux emplois féminins et de migrations, de « véritable processus d'internationalisation de la reproduction sociale », de multiplication des « hommes en armes », de la place des complexes militaro-industriels…
En complément possible, Sous la direction de Jules Falquet, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky le Feuvre, Fatou Sow : le sexe de la mondialisation. Genre, classe, race et nouvelle division du travail et Jules Falquet : de gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation, Ce que le genre fait à l'analyse de la mondialisation néolibérale : L'ombre portée des systèmes militaro-industriels sur les « femmes globales, Pax neoliberalia.
Je souligne aussi l'article de Marguerite Rollinde « Genre et conflit ».
Je choisis d'illustrer la partie sur Femmes et syndicalisme par un texte d'Eléni Varikas : Flora Tristan et l'Union ouvrière.
Langage et sexisme, hiérarchie construite au sein de la grammaire, nommer ou invisibiliser, « la codification de l'usage joue un rôle de rempart » contre l'égalité, logique politique plus que linguistique, usage du masculin neutre et conquêtes des femmes, dans les mots l'illégitimité des femmes, s'épargner ou non « l'effort qu'un écrit non sexiste demande », la rédaction épicène, l'accord de proximité…
En complément possible, Josiane Boutet : le pouvoir des mots, Eliane Viennot : L'Académie contre la langue française. le dossier « féminisation », Eliane Viennot : non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin – petite histoire des résistance de la langue française.
Féminisme, lesbianisme, contrainte à l'hétérosexualité, dénigrement du plaisir féminin, érotisation de l'assujettissement des femmes, droit de la personne individuelle et non système de droits liés au couple…
Je souligne l'article de Françoise Collin, les réflexions sur le corps et le désir, « le corps du féminisme est resté suspendu au vestiaire des luttes et des savoirs », sexualité et domination, impunité auto-accordée aux hommes, différence et indifférence des sexes, « une pensée de la praxis, à partir d'un donné déterminé plutôt que de feindre ignorer celui-ci »…
Les violences, les violences conjugales des hommes, la violence comme stratégie et abus de pouvoir, les violences économiques, la tolérance sociale aux violences des hommes, les viols, « 80% des viols sont commis par quelqu'un qu'on connaît, chez soi ou au domicile de l'agresseur », les violences au travail, l'AVFT, le système prostitueur…
La division sexuelle du travail, séparation et hiérarchie, interpénétration constante des formes de la division du travail comme des rapports sociaux, nécessaires interventions dans les deux pôles de l'activité – travail salarié et travail domestique-, ce qui fait apparaître comme naturels des faits résultats de constructions sociales et historiques, la division intériorisé, les « qualités » des femmes et les « qualifications » des hommes, liberté-égalité… Je souligne, entre autres, ce qu'écrit Michèle Riot-Sarcey : « L'égalité réelle n'est pas l'égalité dans la liberté semblable à ceux qui sont libres, mais être en capacité de pouvoir parler à tout individu, quel qu'il soit, quelle que soit son origine et débattre ensemble de ce qu'est le pouvoir d'être citoyen »…
Ce « Vingt ans de féminisme intersyndical » offre un ensemble de textes pour réfléchir et agir. Les contributions choisies soulignent la centralité du travail dans l'imbrication des rapports sociaux, la place incontournable du féminisme pour remettre en cause les dominations. Un chapitre sur féminisme, mouvement syndical et racisation aurait été le bienvenu. Quoiqu'il en soit, un ouvrage pouvant être largement diffusé aux syndiqué-e-s et plus largement à toutes celles et tous ceux qui veulent « étonner la catastrophe » et « dégager la route vers un monde différent, où les femmes et les hommes pourront vivre égaux, plus libres et plus heureux ».
Lien : https://entreleslignesentrel..
Citations et extraits (18)
Voir plus
Ajouter une citation
Il est donc nécessaire d’analyser conjointement travail domestique et travail professionnel, dans la perspective d’une division sexuelle globale du travail, afin de mettre en évidence les enjeux des transformations de l’organisation du travail salarié (qui affectent hommes et femmes différemment), mais aussi ceux des politiques familiales, sociales, fiscales qui, à travers l’assignation des femmes au travail domestique, affectent aussi leur rapport à l’emploi
Il faut prendre en compte, ensemble, la participation au marché du travail et l’organisation domestique pour comprendre les obstacles aux déroulements de carrières. Il faut considérer, ensemble, les filières de formation, la façon dont elles sont « choisies », et l’insertion dans le travail. Il faut décrire, ensemble, les stéréotypes des employeurs et des collègues, et les interrogations des femmes sur leur légitimité
L’égalité réelle n’est pas l’égalité dans la liberté semblable à ceux qui sont libres, mais être en capacité de pouvoir parler à tout individu, quel qu’il soit, quelle que soit son origine et débattre ensemble de ce qu’est le pouvoir d’être citoyen
le poids indiscutable de l’activité professionnelle des femmes dans le fonctionnement économique, sa remarquable constance, en dépit des crises et des récessions, par delà les périodes de guerre et d’après-guerre
Les représentations dominantes du travail d’aide aux personnes comme étant un travail non-qualifié qui ne demande pas d’expériences ni de compétences – un travail de femmes…
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Evelyne Bechtold-Rognon (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les emmerdeuses de la littérature
Les femmes écrivains ont souvent rencontré l'hostilité de leurs confrères. Mais il y a une exception parmi eux, un homme qui les a défendues, lequel?
Houellebecq
Flaubert
Edmond de Goncourt
Maupassant
Eric Zemmour
10 questions
570 lecteurs ont répondu
Thèmes :
écriture
, féminisme
, luttes politiquesCréer un quiz sur ce livre570 lecteurs ont répondu