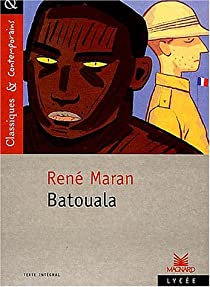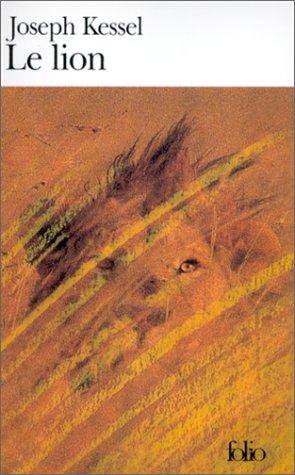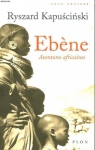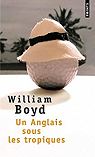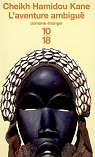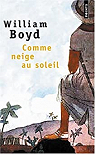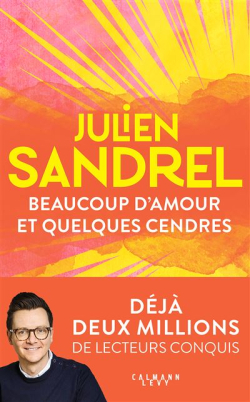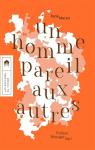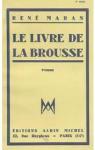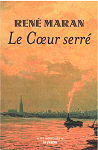René Maran
Josiane Grinfas-Bouchibti (Éditeur scientifique)/5 99 notes
Josiane Grinfas-Bouchibti (Éditeur scientifique)/5 99 notes
Résumé :
Quatrième de couverture:
Le 14 décembre 1921, le jury Goncourt décerne son prix à René Maran, auteur de Batouala. C'est la première fois qu'un écrivain noir est couronné. Quelques semaines plus tôt, dans le figaro, l'écrivain Henri de Régnier exprimait son enthousiasme: "C'est un coin de la mystérieuse Afrique que Monsieur René Maran fait revivre devant nous avec une exactitude vivante et vécue."
René Maran, administrateur au Tchad, raconte la vie d’un... >Voir plus
Le 14 décembre 1921, le jury Goncourt décerne son prix à René Maran, auteur de Batouala. C'est la première fois qu'un écrivain noir est couronné. Quelques semaines plus tôt, dans le figaro, l'écrivain Henri de Régnier exprimait son enthousiasme: "C'est un coin de la mystérieuse Afrique que Monsieur René Maran fait revivre devant nous avec une exactitude vivante et vécue."
René Maran, administrateur au Tchad, raconte la vie d’un... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après BatoualaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (32)
Voir plus
Ajouter une critique
Je n'avais jamais lu de littérature africaine avant "Batouala". Ce livre est une jolie perle. Tout d'abord, le style d'écriture est très particulier, à mi chemin entre prose et poésie. Assez dur de se mettre dedans, mais une fois qu'on y est, on se laisse porter. le sujet, ensuite. Ce livre est une lutte contre le racisme des blancs, contre l'utilisation des tirailleurs sénégalais pendant la première guerre mondiale. Et l'auteur, en nous offrant une vision de la vie des noirs, parvient à nous faire passer cette critique, à nous faire comprendre le pouvoir qu'avait les blancs à l'époque. Un petit bémol pour la scène de l'excision, un peu dure à passer...
Voilà cependant un livre qui donne envie de découvrir plus amplement la littérature africaine.
Voilà cependant un livre qui donne envie de découvrir plus amplement la littérature africaine.
« Que votre voix s'élève !
Vous, les écrivains de France, il faut que vous aidiez « ceux qui disent les choses comme elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent.» clame dans la préface de son livre René Maran.
Batouala, « Véritable roman nègre » a reçu le prix Goncourt il y a juste 100 ans. Ce fut un tollé, d'abord parce que l'auteur n'était pas connu, aussi parce que sa description, par delà la poésie et le lyrisme indéniable, s'attache aux coutumes d'un village d'Oubangui Chari( actuelle Centrafrique)et qu'il y fait, surtout dans sa préface de la première édition (1921) le constat de l' exploitation des « nègres », leur embrigadement dans la guerre de 1914, parce que les « frandjés étaient en palabre avec les zalémans et qu'ils les battaient comme on ne bat pas son chien. ».
Et puis le cours du caoutchouc est tombé, plus de travail.
Goncourt, donc, pour cet auteur antillais, fonctionnaire de préfecture, nommé Administrateur du Ministère des Colonies en Oubangui-Chari, Goncourt qui soulève des vagues : celles de l'Administration française, qui veut bien entendu former une élite « indigène » sachant lire et écrire, mais qui n'admet pas que de l'intérieur, on dénonce les pratiques coloniales ; celles aussi d'écrivains africains, pas très contents que leurs coutumes soient mises à jour comme par un anthropologue les jugeant tels qu'ils sont.
C'est dans son introduction, remaniée en 1937, que René Maran , qui, entre temps, a été doucement poussé à démissionner de l ‘administration, a subi critiques et pamphlets, dénonce les pratiques coloniales, en particulier cet impôt « de capitation », qui pousse souvent les africains à la plus grande pauvreté, jusqu' à vendre même leur femme.
Ce roman est tout objectif, nous dit l'auteur. Il ne tâche même pas d'expliquer. Il constate. Il ne s'indigne pas : il enregistre…. C'est un roman d'observation impersonnelle.
Ses coutumes, le fait qu'une femme doit allaiter 2 ou 3 ans, pendant lesquels elle ne peut faire l'amour, les fluides ne devant pas se mélanger amènent à l'obligation pour l'homme de prendre d'autres femmes.
Les fêtes, pendant lesquelles ont lieu la circoncision et l'excision ( mon professeur d'ethnologie disait que ces pratiques avaient pour but d'éliminer dans chaque sexe ce qui ressemble le plus à l'autre sexe : les membranes chez l'homme, et le clitoris érectile chez la femme.) sont décrites telles qu'elles.
René Maran parle du désir fou, malgré les tabous comme par exemple celui des règles « impures » donc l'impossibilité de faire l'amour ces jours-là.
Il parle aussi des rites funéraires, et de la pensée que la mort ne pouvant être naturelle, il s'agit de chercher et trouver le responsable…. Parfois, cette recherche recoupe une vengeance privée…. Mais bon.
Que votre voix s'élève, vous les écrivains de France!
Dans la reprise de sa préface en 1937, il reconnaît que la prise de conscience de personnes bien placées qui pourtant étaient au courant des horreurs commises : «Après tout, s'ils meurent de faim par milliers, comme des mouches, c'est que l'on met en valeur leur pays »s'est accomplie grâce à André Gide avec son Voyage au Congo en 1927, et Denise Moran qui a écrit Tchad peu après.
Et bien sûr, il en a été le précurseur.
Pour le centenaire du prix Goncourt, la Bibliothèque Nationale de France organisera avec l'académie Goncourt, le 1 · décembre 2021, un événement commémoratif dans son auditorium.
Vous, les écrivains de France, il faut que vous aidiez « ceux qui disent les choses comme elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent.» clame dans la préface de son livre René Maran.
Batouala, « Véritable roman nègre » a reçu le prix Goncourt il y a juste 100 ans. Ce fut un tollé, d'abord parce que l'auteur n'était pas connu, aussi parce que sa description, par delà la poésie et le lyrisme indéniable, s'attache aux coutumes d'un village d'Oubangui Chari( actuelle Centrafrique)et qu'il y fait, surtout dans sa préface de la première édition (1921) le constat de l' exploitation des « nègres », leur embrigadement dans la guerre de 1914, parce que les « frandjés étaient en palabre avec les zalémans et qu'ils les battaient comme on ne bat pas son chien. ».
Et puis le cours du caoutchouc est tombé, plus de travail.
Goncourt, donc, pour cet auteur antillais, fonctionnaire de préfecture, nommé Administrateur du Ministère des Colonies en Oubangui-Chari, Goncourt qui soulève des vagues : celles de l'Administration française, qui veut bien entendu former une élite « indigène » sachant lire et écrire, mais qui n'admet pas que de l'intérieur, on dénonce les pratiques coloniales ; celles aussi d'écrivains africains, pas très contents que leurs coutumes soient mises à jour comme par un anthropologue les jugeant tels qu'ils sont.
C'est dans son introduction, remaniée en 1937, que René Maran , qui, entre temps, a été doucement poussé à démissionner de l ‘administration, a subi critiques et pamphlets, dénonce les pratiques coloniales, en particulier cet impôt « de capitation », qui pousse souvent les africains à la plus grande pauvreté, jusqu' à vendre même leur femme.
Ce roman est tout objectif, nous dit l'auteur. Il ne tâche même pas d'expliquer. Il constate. Il ne s'indigne pas : il enregistre…. C'est un roman d'observation impersonnelle.
Ses coutumes, le fait qu'une femme doit allaiter 2 ou 3 ans, pendant lesquels elle ne peut faire l'amour, les fluides ne devant pas se mélanger amènent à l'obligation pour l'homme de prendre d'autres femmes.
Les fêtes, pendant lesquelles ont lieu la circoncision et l'excision ( mon professeur d'ethnologie disait que ces pratiques avaient pour but d'éliminer dans chaque sexe ce qui ressemble le plus à l'autre sexe : les membranes chez l'homme, et le clitoris érectile chez la femme.) sont décrites telles qu'elles.
René Maran parle du désir fou, malgré les tabous comme par exemple celui des règles « impures » donc l'impossibilité de faire l'amour ces jours-là.
Il parle aussi des rites funéraires, et de la pensée que la mort ne pouvant être naturelle, il s'agit de chercher et trouver le responsable…. Parfois, cette recherche recoupe une vengeance privée…. Mais bon.
Que votre voix s'élève, vous les écrivains de France!
Dans la reprise de sa préface en 1937, il reconnaît que la prise de conscience de personnes bien placées qui pourtant étaient au courant des horreurs commises : «Après tout, s'ils meurent de faim par milliers, comme des mouches, c'est que l'on met en valeur leur pays »s'est accomplie grâce à André Gide avec son Voyage au Congo en 1927, et Denise Moran qui a écrit Tchad peu après.
Et bien sûr, il en a été le précurseur.
Pour le centenaire du prix Goncourt, la Bibliothèque Nationale de France organisera avec l'académie Goncourt, le 1 · décembre 2021, un événement commémoratif dans son auditorium.
Prix Goncourt 1921, précurseur de la littérature de la négritude, censuré et conspué à sa sortie pour sa dénonciation du quotidien du colonialisme.
Étonnant livre, prix Goncourt en 1921, précurseur de la littérature de la négritude, et qui valut à son auteur, administrateur colonial d'origine antillaise, les foudres de la censure, et une carrière brisée.
Cette histoire d'un chef villageois traditionnel de l'Oubangui-Chari (Centrafrique), ébranlé dans ses certitudes, lorsqu'à ses soucis personnels (infidélités supposées ou redoutées de sa première épouse, prestige au sein de la communauté, rivalité avec un chasseur plus jeune et conquérant,...) s'ajoute l'ombre du premier conflit mondial, et de la levée accrue de "tirailleurs sénégalais" (engagés dans toute l'Afrique française), cède certes un peu trop, sans doute, à une tentation de la description exotique...
Il vaut surtout par sa préface, qui explique le dessein descriptif et l'honnêteté de l'auteur, dénonçant en effet les méfaits du colonialisme, d'une manière toutefois suffisamment timide pour que le déchaînement de la censure et du scandale, à l'époque, n'en apparaisse que davantage significatif pour un lecteur contemporain : fallait-il donc que le racisme et l'exploitation soient bien ancrés dans la conscience du colon et de ses soutiens métropolitains pour "punir" ainsi un livre aussi... anodin, en fait (pour notre regard d'aujourd'hui en tout cas).
"Montesquieu a raison, qui écrivait, en une page où, sous la plus froide ironie, vibre une indignation contenue : "Ils sont noirs des pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre."
Après tout, s'ils crèvent de faim par milliers, comme des mouches, c'est que l'on met en valeur leur pays. Ne disparaissent que ceux qui ne s'adaptent pas à la civilisation. (...) Civilisation (...), tu bâtis ton royaume sur des cadavres."
Étonnant livre, prix Goncourt en 1921, précurseur de la littérature de la négritude, et qui valut à son auteur, administrateur colonial d'origine antillaise, les foudres de la censure, et une carrière brisée.
Cette histoire d'un chef villageois traditionnel de l'Oubangui-Chari (Centrafrique), ébranlé dans ses certitudes, lorsqu'à ses soucis personnels (infidélités supposées ou redoutées de sa première épouse, prestige au sein de la communauté, rivalité avec un chasseur plus jeune et conquérant,...) s'ajoute l'ombre du premier conflit mondial, et de la levée accrue de "tirailleurs sénégalais" (engagés dans toute l'Afrique française), cède certes un peu trop, sans doute, à une tentation de la description exotique...
Il vaut surtout par sa préface, qui explique le dessein descriptif et l'honnêteté de l'auteur, dénonçant en effet les méfaits du colonialisme, d'une manière toutefois suffisamment timide pour que le déchaînement de la censure et du scandale, à l'époque, n'en apparaisse que davantage significatif pour un lecteur contemporain : fallait-il donc que le racisme et l'exploitation soient bien ancrés dans la conscience du colon et de ses soutiens métropolitains pour "punir" ainsi un livre aussi... anodin, en fait (pour notre regard d'aujourd'hui en tout cas).
"Montesquieu a raison, qui écrivait, en une page où, sous la plus froide ironie, vibre une indignation contenue : "Ils sont noirs des pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre."
Après tout, s'ils crèvent de faim par milliers, comme des mouches, c'est que l'on met en valeur leur pays. Ne disparaissent que ceux qui ne s'adaptent pas à la civilisation. (...) Civilisation (...), tu bâtis ton royaume sur des cadavres."
"Batouala", de René MARAN est considéré comme le premier roman nègre écrit par un nègre. Point de départ de la "Négritude", mouvement littéraire et artistique qui nourrira l'émergence d'une culture noire et de sa conscience, il a été écrit en 1921. Primé par le Goncourt, son auteur, obligé de démissionner de son poste au Ministère des Colonies, sera vilipendé par tous ceux qui n'étaient pas prêts à imaginer qu'un noir puisse penser et écrire sur sa vie, celle de sa tribu, ses traditions et la sagesse qui était parfois bien plus du côté des "sauvages" que du côté des "Blancs" !
L'histoire est celle de Batouala, patriarche respecté de sa tribu. Pour lui, la vie est simple. Tous les jours, faire de son mieux pour vivre dans le respect des Anciens et des présents. Entre la pipe matinale, la chasse, les honneurs à rendre à son épouse et à ses autres femmes, rivales, Batouala nous conte la vie, son quotidien, les fêtes oniriques de la tribu, les moeurs de passage de l'enfance à l'âge adulte. Il nous conte aussi son interrogation sur ces traditions qui se perdent, les anciens qu'on n'écoute plus de la même façon, leurs expériences et connaissances que les jeunes délaissent et la convoitise de ces derniers. Bref, il nous conte un monde qui change, qui se perd. Il nous entraîne vers sa fin, sa mort.
René MARAN développe une écriture qui est celle des conteurs africains (que l'on connaît maintenant). Mais au-delà de leurs descriptions émerveillées de la nature, de la force et la beauté des êtres, bêtes, hommes et femmes qui y vivent, il nous faut entendre le fond. MARAN nous parle d'un monde en mutation, d'un monde qui disparaît, d'un autre qui doit advenir.
Intéressant de lire ce livre plus de 90 ans après sa première parution et de refléter son histoire dans le miroir de notre temps présent, lui aussi, toujours en mutation.
L'histoire est celle de Batouala, patriarche respecté de sa tribu. Pour lui, la vie est simple. Tous les jours, faire de son mieux pour vivre dans le respect des Anciens et des présents. Entre la pipe matinale, la chasse, les honneurs à rendre à son épouse et à ses autres femmes, rivales, Batouala nous conte la vie, son quotidien, les fêtes oniriques de la tribu, les moeurs de passage de l'enfance à l'âge adulte. Il nous conte aussi son interrogation sur ces traditions qui se perdent, les anciens qu'on n'écoute plus de la même façon, leurs expériences et connaissances que les jeunes délaissent et la convoitise de ces derniers. Bref, il nous conte un monde qui change, qui se perd. Il nous entraîne vers sa fin, sa mort.
René MARAN développe une écriture qui est celle des conteurs africains (que l'on connaît maintenant). Mais au-delà de leurs descriptions émerveillées de la nature, de la force et la beauté des êtres, bêtes, hommes et femmes qui y vivent, il nous faut entendre le fond. MARAN nous parle d'un monde en mutation, d'un monde qui disparaît, d'un autre qui doit advenir.
Intéressant de lire ce livre plus de 90 ans après sa première parution et de refléter son histoire dans le miroir de notre temps présent, lui aussi, toujours en mutation.
Dans ce roman de l'antillais René Maran, prix Goncourt de 1921, nous suivons des évènements autour du chef de tribu Batouala. L'histoire se passe en Afrique équatoriale française, en Oubangui-Chari, aujourd'hui république centrafricaine.
Nous sommes donc dans la brousse, dans la maison du chef, dormant contre l'une de ses 9 femmes, autour d'un foyer éteint. le roman commence doucement, comme tous les matins au fond de la brousse. Les gens n'ont ici pas à se presser, loin de ce capitalisme européen qui les rend pauvres (très légers contacts avec l'administration dans ce roman). René Maran décrit très bien le réveil des hommes, des femmes et du chien, cet animal sur lequel on tape toute la journée (c'est encore le cas aujourd'hui). On ressent pleinement cette douceur de la nuit, se réveille tranquille, puis le commencement des activités féminines autour des cuisines, ainsi que les longues parties de chasse des hommes. Ici, pas de tabou, le sexe est décrit sans problème et les débordements liés à l'alcool et au sexe lors des cérémonies de circoncision et d'excision non plus. Aucun tabou.
Mais le fait de coucher avec n'importe qui lors de ces cérémonies peut avoir aussi quelques problèmes. C'est ainsi que Batouala va mener la chasse à un jeune guerrier, dont toutes les femmes raffolent, dont l'une des siennes qu'il vient visiter dès qu'il a le dos tourné.
C'est donc un roman qui retransmet bien la réalité de la brousse et de ces petits villages où l'on fuit l'européen et ses moeurs étranges. La terreur et l'incompréhension de celui-ci sont bien retransmis. On suit bien le cours des journées tranquille et des fêtes, alors que ce roman ne fait même pas 200 pages. L'auteur fait donc passer énormément de sentiments en très peu de page, rendant le roman très intense et plaisant. A absolument lire.
Nous sommes donc dans la brousse, dans la maison du chef, dormant contre l'une de ses 9 femmes, autour d'un foyer éteint. le roman commence doucement, comme tous les matins au fond de la brousse. Les gens n'ont ici pas à se presser, loin de ce capitalisme européen qui les rend pauvres (très légers contacts avec l'administration dans ce roman). René Maran décrit très bien le réveil des hommes, des femmes et du chien, cet animal sur lequel on tape toute la journée (c'est encore le cas aujourd'hui). On ressent pleinement cette douceur de la nuit, se réveille tranquille, puis le commencement des activités féminines autour des cuisines, ainsi que les longues parties de chasse des hommes. Ici, pas de tabou, le sexe est décrit sans problème et les débordements liés à l'alcool et au sexe lors des cérémonies de circoncision et d'excision non plus. Aucun tabou.
Mais le fait de coucher avec n'importe qui lors de ces cérémonies peut avoir aussi quelques problèmes. C'est ainsi que Batouala va mener la chasse à un jeune guerrier, dont toutes les femmes raffolent, dont l'une des siennes qu'il vient visiter dès qu'il a le dos tourné.
C'est donc un roman qui retransmet bien la réalité de la brousse et de ces petits villages où l'on fuit l'européen et ses moeurs étranges. La terreur et l'incompréhension de celui-ci sont bien retransmis. On suit bien le cours des journées tranquille et des fêtes, alors que ce roman ne fait même pas 200 pages. L'auteur fait donc passer énormément de sentiments en très peu de page, rendant le roman très intense et plaisant. A absolument lire.
Citations et extraits (56)
Voir plus
Ajouter une citation
Un petit poème de son ami Philéas Lebesgue :
Petit village
Petit village au bord des bois,
Petit village au bord des plaines,
Parmi les pommiers, non loin des grands chênes,
Lorsque j’aperçois
Le coq et la croix
De ton clocher d’ardoises grises,
De ton clocher fin,
A travers ormes et sapins,
D’étranges musiques me grisent ;
Je vois des yeux dans le soir étoilé :
Là je suis né...
Petit village au bord des champs,
Petit village entre les haies,
Tour à tour paré de fleurs et de baies,
Lorsque les doux chants
De ton frais printemps,
Quand l’odeur de tes violettes,
De tes blancs muguets
Pénètrent mon cœur inquiet,
J’oublie et tumulte et tempêtes ;
J’entends des voix dans le soir parfumé :
Là j’ai aimé...
Petit village aux courtils verts,
Petit village de silence,
Où la cloche sonne un vieil air de France,
J’aime les éclairs
De tes cieux couverts,
Ton soleil fin entre les arbres,
Les feux de tes nuits,
L’oeil fixe et profond de tes puits,
Ton doux cimetière sans marbres,
Plein d’oiseaux fous et luisant comme pré :
Là je viendrai...
Petit village
Petit village au bord des bois,
Petit village au bord des plaines,
Parmi les pommiers, non loin des grands chênes,
Lorsque j’aperçois
Le coq et la croix
De ton clocher d’ardoises grises,
De ton clocher fin,
A travers ormes et sapins,
D’étranges musiques me grisent ;
Je vois des yeux dans le soir étoilé :
Là je suis né...
Petit village au bord des champs,
Petit village entre les haies,
Tour à tour paré de fleurs et de baies,
Lorsque les doux chants
De ton frais printemps,
Quand l’odeur de tes violettes,
De tes blancs muguets
Pénètrent mon cœur inquiet,
J’oublie et tumulte et tempêtes ;
J’entends des voix dans le soir parfumé :
Là j’ai aimé...
Petit village aux courtils verts,
Petit village de silence,
Où la cloche sonne un vieil air de France,
J’aime les éclairs
De tes cieux couverts,
Ton soleil fin entre les arbres,
Les feux de tes nuits,
L’oeil fixe et profond de tes puits,
Ton doux cimetière sans marbres,
Plein d’oiseaux fous et luisant comme pré :
Là je viendrai...
Guerre et sauvagerie étaient tout un. Or ne voilà-t-il pas qu'on forçait les nègres à participer à la sauvagerie des blancs, à aller se faire tuer pour eux, en des palabres lointaines ! Et ceux qui protestaient, on leur passait la corde au cou, on les chicottait, on les jetait en prison !
Marche, sale nègre ! Marche, et crève !...
Marche, sale nègre ! Marche, et crève !...
Dix-sept ans ont passé depuis que j'ai écrit cette préface. Elle m'a valu bien des injures. Je ne les regrette point. Je leur dois d'avoir appris qu'il faut avoir un singulier courage pour dire simplement ce qui est. Paris ne pouvait pour tant ignorer que « Batouala » n'avait fait qu'effleurer une vérité qu'on n'a jamais tenue à connaître à fond
Routes de brousse, si mouillées au matin et si fraîches ; parfums moites, molles senteurs, frissons d’herbes, murmures et, entre les feuilles, frisselis pressé de la brise ; brouillards en bruine, vapeurs – des collines et des vallons s’élevant vers le pâle soleil ; fumées, bruits vivants, tams-tams, appels, cris, éveil, éveil ! Ah, trop haut sur les arbres chantent les oiseaux ! Trop haut tournoie et tournoie le vol des charognards ! Trop haut est le ciel dont semble l’azur incolore à force de lumière !
Nous n’avions pas fini de bâtir nos cases et de défricher les terrains convenant à nos plantations, que ces maudits blancs étaient déjà sur nous. C’est alors que, la mort dans l’âme, découragés, fatigués, désespérés – nous avions perdu tant de nos frères, au cours de nos migrations belliqueuses – c’est alors que nous restâmes où nous étions et que nous nous efforçâmes de faire aux « boundjous » bonne figure. La lointaine rumeur immense se rapprochait peu à peu. – Notre soumission, reprit Batouala, dont la voix allait s’enfiévrant, notre soumission ne nous a pas mérité leur bienveillance. Et d’abord, non contents de s’appliquer à supprimer nos plus chères coutumes, ils n’ont eu de cesse qu’ils ne nous aient imposé les leurs. Ils n’y ont, à la longue, que trop bien réussi. Résultat : la plus morne tristesse règne, désormais, par tout le pays noir. Les blancs sont ainsi faits, que la joie de vivre disparaît des lieux où ils prennent quartiers.
Videos de René Maran (11)
Voir plusAjouter une vidéo
DOCUMENTAIRE] 📹 Ce dimanche 10 octobre, Martinique la 1ère vous propose un documentaire inédit : "Réné Maran, le premier Goncourt noir".
Diffusé dans la catégorie "Ecrans parallèles" du FIFAC 2021, ce film a pour ambition de redécouvrir cette grande figure de la littérature et sa vie hors du commun. René Maran, d’origine martinico-guyanaise, est aujourd’hui un nom trop oublié. Pourtant, la publication de son roman Batouala a provoqué un scandale énorme en 1921.
"Réné Maran, le premier Goncourt noir", à voir ce dimanche 10 octobre à 09h sur Martinique la 1ère !
Diffusé dans la catégorie "Ecrans parallèles" du FIFAC 2021, ce film a pour ambition de redécouvrir cette grande figure de la littérature et sa vie hors du commun. René Maran, d’origine martinico-guyanaise, est aujourd’hui un nom trop oublié. Pourtant, la publication de son roman Batouala a provoqué un scandale énorme en 1921.
"Réné Maran, le premier Goncourt noir", à voir ce dimanche 10 octobre à 09h sur Martinique la 1ère !
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de René Maran (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3754 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3754 lecteurs ont répondu