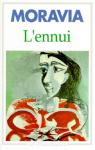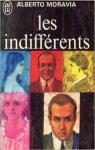Critiques de Alberto Moravia (264)
Difficile de parler du Conformiste de Moravia… après la superbe critique de... Moravia! Mais je devais aux deux Moravia, celui du livre et celui de Babelio, de les remercier pour cette lecture magnifique, étincelante et profonde!
Je n'avais pas eu le bonheur de lire le Conformiste - mais d'autres livres de Moravia, lus dans mon adolescence, avaient laissé leur trace dans ma mémoire "comme un rai de diamant sur une vitre"... et j'avais peur, moi aussi, de revenir à cet engouement ancien et de déchanter cruellement.
Je ne suis pas déçue du voyage!
Quel pur bonheur de lecture: une langue ciselée, aigüe comme un scalpel dans ses analyses, tour à tour sensuelle et détachée, qui sait parler de l'enfer de l'enfance et de l'éteignoir de l'âge adulte avec la même maestria, sans jamais se départir d'une élégance ironique et comme désenchantée...
Un livre construit comme une partition musicale- avec son prologue, son épilogue, et ses "motifs" lancinants : le meurtre et le sexe.
Du saccage des roses au meurtre politique, de l'anormalité effrayée à la normalité effrayante. De la pédophilie prédatrice au saphisme mondain d'une boîte parisienne. De Lino à Lina.
Ravage et Mélancolie : ce sont les deux mots que le père de Marcello, interné dans un asile psychiatrique, écrit indéfiniment et qui semblent contenir toute la problématique de son fils, le sombre héros de ce roman.
Marcello est beau, intelligent, cultivé. Il a un grand sens de la morale et de la probité. Il est philosophe de formation. Il est aussi rongé par une faute originelle qui est la scène fondatrice de toute sa vie, de tous ses choix, de tous ses actes. Pour étouffer sa propre violence, ses propres pulsions, pour ne pas sombrer dans la folie de son père, dans la déréliction de sa mère, il les canalise vers LA violence historique en place, celle qui est partagée par le plus grand nombre et dans laquelle la sienne va se fondre, se discipliner, se justifier : celle du fascisme. Il est fasciste par un immense et raisonné règlement de tous les sens.
L'ordre et la règle vont lui servir, littéralement, de garde-fou. Ravage et Mélancolie.
Deux fois pourtant, comme un héros sartrien, il croit pouvoir reprendre sa vie en main, en modifier impérialement le cours, faire de nouveaux choix.
Mais la première fois l'amour d'une femme va lui manquer : ironiquement, elle lui préférera sa sotte épouse, Giulia - tandis qu'une sombre Rolls Royce s'arrêtant auprès de lui va raviver l'ancienne panique de son anormalité, le rejetant, presque malgré lui, du côté des conformistes du moment.
Et la deuxième fois, brusquement délivré de l'ancienne malédiction, après une rencontre fulminante dans les jardins de la Villa Borghese, c'est le destin de l'Histoire qui, ironie du hasard, se charge de régler ce choix à sa façon… Destin et Ironie.
Ravage et Mélancolie.
Un pur chef d'oeuvre ! Je crois que je vais, méthodiquement, me remettre à lire tout Moravia…
Je n'avais pas eu le bonheur de lire le Conformiste - mais d'autres livres de Moravia, lus dans mon adolescence, avaient laissé leur trace dans ma mémoire "comme un rai de diamant sur une vitre"... et j'avais peur, moi aussi, de revenir à cet engouement ancien et de déchanter cruellement.
Je ne suis pas déçue du voyage!
Quel pur bonheur de lecture: une langue ciselée, aigüe comme un scalpel dans ses analyses, tour à tour sensuelle et détachée, qui sait parler de l'enfer de l'enfance et de l'éteignoir de l'âge adulte avec la même maestria, sans jamais se départir d'une élégance ironique et comme désenchantée...
Un livre construit comme une partition musicale- avec son prologue, son épilogue, et ses "motifs" lancinants : le meurtre et le sexe.
Du saccage des roses au meurtre politique, de l'anormalité effrayée à la normalité effrayante. De la pédophilie prédatrice au saphisme mondain d'une boîte parisienne. De Lino à Lina.
Ravage et Mélancolie : ce sont les deux mots que le père de Marcello, interné dans un asile psychiatrique, écrit indéfiniment et qui semblent contenir toute la problématique de son fils, le sombre héros de ce roman.
Marcello est beau, intelligent, cultivé. Il a un grand sens de la morale et de la probité. Il est philosophe de formation. Il est aussi rongé par une faute originelle qui est la scène fondatrice de toute sa vie, de tous ses choix, de tous ses actes. Pour étouffer sa propre violence, ses propres pulsions, pour ne pas sombrer dans la folie de son père, dans la déréliction de sa mère, il les canalise vers LA violence historique en place, celle qui est partagée par le plus grand nombre et dans laquelle la sienne va se fondre, se discipliner, se justifier : celle du fascisme. Il est fasciste par un immense et raisonné règlement de tous les sens.
L'ordre et la règle vont lui servir, littéralement, de garde-fou. Ravage et Mélancolie.
Deux fois pourtant, comme un héros sartrien, il croit pouvoir reprendre sa vie en main, en modifier impérialement le cours, faire de nouveaux choix.
Mais la première fois l'amour d'une femme va lui manquer : ironiquement, elle lui préférera sa sotte épouse, Giulia - tandis qu'une sombre Rolls Royce s'arrêtant auprès de lui va raviver l'ancienne panique de son anormalité, le rejetant, presque malgré lui, du côté des conformistes du moment.
Et la deuxième fois, brusquement délivré de l'ancienne malédiction, après une rencontre fulminante dans les jardins de la Villa Borghese, c'est le destin de l'Histoire qui, ironie du hasard, se charge de régler ce choix à sa façon… Destin et Ironie.
Ravage et Mélancolie.
Un pur chef d'oeuvre ! Je crois que je vais, méthodiquement, me remettre à lire tout Moravia…
L'oisiveté dans la richesse ne rend pas heureux pour autant. Le diktat des apparences, de la fidélité, de l'illusion du bonheur pèsent leur poids. L'appartenance sociale et l'activité professionnelle placent un individu, et tirer parti de sa compagne paraît indispensable quand on n'a pas soi-même d'activité fixe, surtout quand on provient soi-même de la haute bourgeoisie, où le regard des autres juge un peu plus qu'ailleurs.
C'est ainsi que notre anti-héros passe au peigne fin les activités de sa compagne, s'interroge par le menu, au moindre détail sur ses intentions, leur amour réciproque, et rien d'heureux ne peut pas réellement sortir d'une telle posture. Un cercle vicieux semble donc s'instaurer. L'absence d'occupation rallonge le temps, complique le peu qui existe autour de soi.
Le ton léger qui est employé renforce l'ironie de la trame narrative, fatalement un peu lente.
Ce roman est d'une écriture simple et agréable.
J'ai particulièrement apprécié les passages traitant de la jalousie maladive du personnage principal... Un cas d'école... à méditer.
C'est ainsi que notre anti-héros passe au peigne fin les activités de sa compagne, s'interroge par le menu, au moindre détail sur ses intentions, leur amour réciproque, et rien d'heureux ne peut pas réellement sortir d'une telle posture. Un cercle vicieux semble donc s'instaurer. L'absence d'occupation rallonge le temps, complique le peu qui existe autour de soi.
Le ton léger qui est employé renforce l'ironie de la trame narrative, fatalement un peu lente.
Ce roman est d'une écriture simple et agréable.
J'ai particulièrement apprécié les passages traitant de la jalousie maladive du personnage principal... Un cas d'école... à méditer.
Âgé d'une quinzaine d'années, Luca voit sa vie s'effriter : le monde lui semble soudain rempli d'injonctions arbitraires et absurdes. Les valeurs qui lui tenaient à cœur enfant n'échappent pas à cette impression de fausseté générale. Ainsi quand il découvre que le portrait religieux auquel ses parents l'envoyaient prier cachait le coffre-fort familial, le jeune garçon réalise qu'on l'envoyait vénérer l'argent, et pas Dieu.
Luca décide donc de désobéir. « Il faut » bien travailler à l'école ? Il ne fera plus le moindre effort. « Il faut » respecter la valeur de l'argent ? Il déchirera ses billets de banque. Cette désobéissance sera totale, jusqu'à cesser de se nourrir correctement, même s' « il faut » prendre des forces, et d'espérer voir la mort arriver. Sa renaissance ne viendra qu'avec la découverte de la sexualité, auprès de l'infirmière engagée pour rester à son chevet.
Ce roman initiatique est assez dense, le genre de livre qui demande au lecteur de s'arrêter toutes les dix pages pour réfléchir et assimiler ce qu'il vient de lire. Le récit possède différents niveaux de lecture, du passage d'un enfant à l'âge adulte et les désillusions qui l'accompagnent, au refus politique d'obéir aux ordres de la société. Étant friand des livres qui disent beaucoup en peu de pages, nul doute que je retrouverai prochainement l'auteur sur mon chemin.
Luca décide donc de désobéir. « Il faut » bien travailler à l'école ? Il ne fera plus le moindre effort. « Il faut » respecter la valeur de l'argent ? Il déchirera ses billets de banque. Cette désobéissance sera totale, jusqu'à cesser de se nourrir correctement, même s' « il faut » prendre des forces, et d'espérer voir la mort arriver. Sa renaissance ne viendra qu'avec la découverte de la sexualité, auprès de l'infirmière engagée pour rester à son chevet.
Ce roman initiatique est assez dense, le genre de livre qui demande au lecteur de s'arrêter toutes les dix pages pour réfléchir et assimiler ce qu'il vient de lire. Le récit possède différents niveaux de lecture, du passage d'un enfant à l'âge adulte et les désillusions qui l'accompagnent, au refus politique d'obéir aux ordres de la société. Étant friand des livres qui disent beaucoup en peu de pages, nul doute que je retrouverai prochainement l'auteur sur mon chemin.
L'intrigue est simple. Un jeune homme, peintre raté, issu de la haute bourgeoisie romaine devient l'amant d'une jeune fille, son modèle. Relation qui s'enlisera peu à peu dans une jalousie féroce de la part de l'amant lorsqu'il s'apercevra de l'inconséquence de la jeune fille. Remise en question de ses origines bourgeoises également face aux origines modestes de la fille. Roman très riche. A une époque, le tournant des années 60, où la société de consommation arrive en Italie, où les valeurs traditionnelles laissent la place à une société basée sur l'apparence et la vulgarité, modifiant également l'ensemble des rapports sociaux. Tout cela apparaît plus ou moins directement dans ce roman. La chair et le sexe sont également des thèmes abordés ici par Moravia. Sexe de consommation, sans amour possible, ne suscitant que lassitude et ennui. Malheureusement pour notre peintre, on n'échappe pas à sa condition sociale. Les personnages de second plan comme la mère du peintre et les parents de la jeune fille me semblent aussi rendre compte de toute la dimension sociale déterministe du roman.
Encore une fois, Moravia s'en prend aux valeurs italiennes bourgeoises à travers le personnage de cette mère intransigeante qui ne comprend pas le désarroi de son fils, qui n'a que la transgression pour échappatoire, confinant presque à la folie.
Du très grand art.
Encore une fois, Moravia s'en prend aux valeurs italiennes bourgeoises à travers le personnage de cette mère intransigeante qui ne comprend pas le désarroi de son fils, qui n'a que la transgression pour échappatoire, confinant presque à la folie.
Du très grand art.
Ce court roman, au style élégant, est plein de faux-semblants.
Un narrateur, Silvio, y raconte à la première personne un épisode de sa vie conjugale : sa tentative d'écrire un roman, intitulé "L'amour conjugal". Avec une jubilation sadique, Alberto Moravia va critiquer ce roman avorté en lui adressant les critiques mêmes que son œuvre pourrait parfois recevoir.
Roman sur la création littéraire, "L'amour conjugal" est avant tout un roman sur l'amour, le couple, la trahison, la vérité.
Silvio est confit dans ses convictions. Sa philosophie de l'amour est celle d'une bourgeoisie que Moravia, sa vie durant, n'aura cessé de railler et de combattre. Silvio s'imagine que l'amour est acquis pour toujours, protégé de l'atteinte du temps par la sacralité de l'union conjugale. Comme dans l'amour courtois, cet amour là est séparé de la sexualité : Silvio décide, d'un commun accord avec Léda, de rester chaste le temps que durera la rédaction de son livre. Il découvrira à ses dépens que la sexualité ne se laisse pas si facilement réprimer : sa femme, si belle, si distinguée, est irrépressiblement attirée par Antonio, le barbier, un coureur de jupons, veule et laid.
Alberto Moravia est né en 1907. Il épousa Elsa Morante (née en 1912), la quitta en 1962 - mais n'en divorça jamais - pour vivre avec Dacia Maraini (née en 1937) puis avec Carmen Llera (née en 1953).
Dans ses romans, les hommes sont des benêts et les femmes des idiotes lascives dominées par leurs instincts.
Pas sûr qu'un tel personnage s'attire les louanges des associations féministes.
Il n'en reste pas moins un diablement bon écrivain !
Un narrateur, Silvio, y raconte à la première personne un épisode de sa vie conjugale : sa tentative d'écrire un roman, intitulé "L'amour conjugal". Avec une jubilation sadique, Alberto Moravia va critiquer ce roman avorté en lui adressant les critiques mêmes que son œuvre pourrait parfois recevoir.
Roman sur la création littéraire, "L'amour conjugal" est avant tout un roman sur l'amour, le couple, la trahison, la vérité.
Silvio est confit dans ses convictions. Sa philosophie de l'amour est celle d'une bourgeoisie que Moravia, sa vie durant, n'aura cessé de railler et de combattre. Silvio s'imagine que l'amour est acquis pour toujours, protégé de l'atteinte du temps par la sacralité de l'union conjugale. Comme dans l'amour courtois, cet amour là est séparé de la sexualité : Silvio décide, d'un commun accord avec Léda, de rester chaste le temps que durera la rédaction de son livre. Il découvrira à ses dépens que la sexualité ne se laisse pas si facilement réprimer : sa femme, si belle, si distinguée, est irrépressiblement attirée par Antonio, le barbier, un coureur de jupons, veule et laid.
Alberto Moravia est né en 1907. Il épousa Elsa Morante (née en 1912), la quitta en 1962 - mais n'en divorça jamais - pour vivre avec Dacia Maraini (née en 1937) puis avec Carmen Llera (née en 1953).
Dans ses romans, les hommes sont des benêts et les femmes des idiotes lascives dominées par leurs instincts.
Pas sûr qu'un tel personnage s'attire les louanges des associations féministes.
Il n'en reste pas moins un diablement bon écrivain !
J'adore l'écriture de Moravia, ses talents de conteur, son habileté à construire la tension amoureuse et à la rompre, ses formules gravées en taille douce par l'acide de son intelligence, tout ça. Mais Moravia est aussi un sacré manipulateur. Non ce roman ne parle pas du couple. Ce roman parle de la lutte des classes. Un peintre trentenaire vit aux crochets de sa richissime maman et s'interroge sur son incapacité à peindre et à aimer. L'Ennui, publié en 1960 - décolonisation, révolution cubaine, PCI deuxième parti d'Italie, faut voir le contexte – est un essai de théorie critique marxiste des moeurs, un pamphlet sarcastique et violent contre la bourgeoisie capitaliste, déguisé en histoire d'amour et de jalousie. Car le Marx du Capital évoque peu le coeur et les moeurs. L'Ennui comble ce vide. C'est dans le chapitre IV.3 de « La Sainte Famille, ou Critique de la critique critique » que Marx (sans Engels) esquisse une théorie de l'amour. Les époux ou les amants se rassurent de leur existence mutuelle, même s'ils sont éloignés et même si leur relation est fragile car l'amour est un besoin humain par essence, une clef du matérialisme. En effet, l'amour « plus que toute autre chose apprend à l'homme à croire au monde objectif en dehors de lui, et fait non seulement de l'homme un objet, mais même de l'objet un homme ». L'être aimé manifeste la réalité objective du monde extérieur à notre esprit. C'est le dérèglement de ce mécanisme chez les bourgeois, que Moravia appelle ironiquement « ennui ». L'ennui c'est l'incapacité du bourgeois à rentrer en communication avec le monde, objets animés ou inanimés. L'ennui c'est son incapacité à aimer. En déniant au bourgeois cette faculté, décrite par Marx comme essentiellement humaine, Moravia déshumanise l'ennemi de classe et légitime le mépris, qui sourd à chaque page de l'Ennui. Celui qui a tout, n'a rien. Il ne s'intéresse qu'à ce qu'il ne peut pas avoir. le cocufier c'est lui rendre service. le bourgeois est coupé de « toute donnée vivante, tout immédiat, toute expérience sensible, plus généralement toute expérience réelle, dont on ne peut jamais savoir à l'avance -ni d'où elle vient ni où elle va». L'argent le maintient dans un caisson d'isolation sensorielle. Comme la « Critique critique » décriée dans La Sainte Famille, le bourgeois est condamné à un idéalisme auto-centré, qui aboutit au ridicule de tout ce qu'il entreprend, notamment en matière artistique : coupé du monde, il n'a d'autre choix que l'abstraction, et pour finir, comme l'anti-héros grotesque de l'Ennui, il préfère la toile vierge à tout tableau. On retrouve derrière le ricanement de Moravia sur l'artiste bourgeois, le conflit politique sur l'art contemporain, la guerre froide que se livrent après 1945 le réalisme socialiste promu par le KGB ou les artistes comme Fernand Léger membres du PC et l'expressionnisme abstrait de Pollock et Rothko promu activement comme outil de propagande par la CIA.
Bel article sur le sujet:
https://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html
Bel article sur le sujet:
https://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html
Dans les vieilles ruelles romaines quand la poussière du soleil n’ose pas épouser les ombres des passants, un parfum de néo-réalisme se distille à chaque pas. C’est un retour en arrière, en noir blanc. Nous pourrions nous croire dans « Le voleur de bicyclette » de Vittorio de Sica ou dans "Bellissima" de Luchino Visconti. Les petites histoires d’Alberto Moravia sont des anecdotes que l’on se raconte autour d’un café près de la Piazza Navona. C'est l'après-guerre. La population ouvrière ou chômeuse de Rome et de ses environs essaie de survivre. Chacun sa méthode, chacun son destin et sa chance. En employant le « je » Moravia aboli la distance avec son sujet ; il raconte « il fatti » sans fioriture, sans démonstration littéraire. Un journal intime du proletariat italien. Ils sont tous pauvres, parfois même misérables, souvent un peu ridicules ou carrément grotesques, presque toujours malchanceux, rattrapés par leur maladresse, leur bêtise ou un destin implacable. Moravia décrit ce peuple de Rome oscillant entre la farce et le tragique, orgueilleux, harassé par le quotidien de la vie. Anciens assassins, voleurs, chômeurs au long cours, petits commerçants, petits ouvriers, employés anonymes, les narrateurs d’Alberto Moravia rêvent d’ailleurs. Même si l'ailleurs n'est qu'avoir de quoi nourrir les siens. Dans ces histoires, l’amitié se délite, les femmes ne sont pas des saintes. Souvent inaccessibles, putes ou harpies, le trait est assez cruel. Le portrait des hommes n’est guère plus flatteur. Pourtant, miracle à l’italienne, le sordide ne les habille pas ; une noblesse amère se dégage de l'ensemble. Ce peuple trimant du matin au soir, avide d’amour, de bien-être, de répit, Alberto Moravia ne le juge pas ; il a de la sympathie pour lui, presque de la tendresse. L'environnement, la nature, hostiles, magnifiés, rarement apaisants sont un écrin pour ces tribulations romaines. Tout est laid et tout est beau, comme ces ruelles lépreuses de Venise. Tout est sombre et tout est lumineux comme la lumière dorée sur les murs médiévaux de Bologne.
Ce n’est pas la douceur désespérée de Gorgio Bassani, la belle mécanique humaniste de Primo Lévi, les rêveries philosophiques d’Italo Calvino, la vibrante peinture fantastique, réaliste et métaphysique de Dino Buzzati ; c’est une lucidité parfois un peu cruelle et contemplative de la vie, une ironie mordante et désenchantée sur la nature humaine, tirée vers le haut. Une écriture dépouillée, fluide, combattante et souverainement seule.
Ce n’est pas la douceur désespérée de Gorgio Bassani, la belle mécanique humaniste de Primo Lévi, les rêveries philosophiques d’Italo Calvino, la vibrante peinture fantastique, réaliste et métaphysique de Dino Buzzati ; c’est une lucidité parfois un peu cruelle et contemplative de la vie, une ironie mordante et désenchantée sur la nature humaine, tirée vers le haut. Une écriture dépouillée, fluide, combattante et souverainement seule.
Enfant, Marcel coupait des roses, tuait des lézards et en tirait une grande satisfaction. Il se posait des questions sur son comportement et essayait d'en parler avec ses parents, peu présents et indifférents, et à son petit voisin qui lui renvoyait incompréhension et réprobation. Ce petit voisin, il avait bien envie de le tuer aussi, mais c'est son chat qui mourra.
Un peu plus tard, moqué à l'école du fait de son manque de virilité, il rencontre un chauffeur de maître, ancien prêtre pédophile, qui l'attire dans sa demeure en lui promettant un pistolet. Repoussant ses avances, Marcel le tue accidentellement.
Nous retrouvons Marcel, une vingtaine d'années plus tard, à l'époque de l'Italie fasciste, hanté par ses crimes et rongé par la culpabilité. En proie à ses démons intérieurs et à la crainte de devenir fou, son père étant interné en hôpital psychiatrique, il décide d'accéder à la normalité, et de se fondre dans le collectif. Pour cela il tire un trait sur sa personnalité, tend à se conformer aux normes sociales, et se marie avec une jeune femme simple, qui lui parait correspondre à ses nouvelles aspirations de bien-être matérialiste.
Fonctionnaire dans un ministère, il lui est bientôt proposé de participer à une mission à Paris dont le but est l'élimination d'un ancien professeur, opposant au régime de Mussolini.
Moravia nous offre le portrait d'un homme torturé qui tente de lutter contre ses pulsions, et dont la problématique personnelle épouse parfaitement les valeurs d'un régime dictatorial. Nous ne sommes pas loin de la banalité du mal. L'individu perd ses repères moraux pour viser l'atteinte d'un idéal de pureté qui le laverait de ses pêchés.
Marcel est un être profondément triste, sans affection dans l'enfance, et détaché de lui-même et des autres plus tard. Il tente de prendre en main sa destinée mais il plonge dans le crime pour s'absoudre d'un autre crime qu'il pense avoir commis.
Un beau roman, d'une rare intelligence assortie d'une écriture limpide, dans lequel il faut suivre le raisonnement aux accents philosophiques de Moravia, autour des notions du bien et du mal, de la normalité et de la différence, de la culpabilité, et où apparaissent des éléments autobiographiques, comme l'indifférence et la froideur entre les membres d'une famille dysfonctionnelle.
Ce monde terne et liquéfié qui pourrait paraître sans consistance si ce n’était que la dureté et implacabilité de l’écriture de Moravia.
Une mère, une fille, un fils, un amant : personnages principaux parmi des silhouettes, des ombres – sauf l’amie de la mère ponctuant le récit pour asseoir le propos de l’auteur.
Cette étude de mœurs, de société, que sais-je… cette histoire brève, déroulée sur quelques jours est un étau qui se resserre inexorablement sur la psyché des personnages. Premier livre, éclat brutal et noir, manifeste contre l’ordre social établi, non revendiqué comme tel mais résolument admis comme tel. Le succès de sa publication laisse sans ressort la censure mussolinienne en place mais elle se rattrapera en interdisant plus tard une nouvelle publication. « Les Indifférents » est une peinture cruelle de la société italienne – une classe bourgeoise moyenne – qui ronronne sous l’ère mussolinienne.
MariaGrazia la mère est une femme que l’on aime détester. Moravia la rend grotesque, stupide, égoïste et profondément irritante. D’ailleurs même ses enfants la décrivent ainsi. Femme vieillissante dont la jalousie est le pain quotidien, détestant « le peuple », ruinée, aveugle à elle-même et à ses propres enfants, tourmentée par l’hypothétique abandon de son amant Léo ; son souhait est de marier sa fille à un riche héritier dans la pure tradition bourgeoise.
Sa fille Carla n’aspire qu’à une chose, quitter cette maison, cette vie qu’elle ne supporte plus ; rongée par l’ennui et l’inertie, ayant un désir d’amour fou, de vérité et d’envol, elle se trouve vieille. Elle se sent prisonnière et faible et regarde son frère Michele comme une roche sans aspérité pour s’y raccrocher.
Michele est plus jeune. Ce jeune homme absolu qui donne tout au long du livre l’impression d’être proche d’un acte suicidaire, déteste autant Léo que son environnement, qu’il se déteste lui-même.
Il méprise sa propre faiblesse, son indifférence à tous et à tout. Il se dégoûte, les autres le dégoûte. Son opposition à Léo et à sa mère parfois sont des flammes vite éteintes, des irruptions d’humeur qui s’effondrent aussitôt. A la différence de sa sœur, lui ne veut pas quitter cette maison, il veut que Léo quitte leur vie à tous les trois ; il veut un monde pur, transparent de vérité et de droiture, sans ombres, sans taches, sans failles.
Léo est un homme d’âge mur, affairiste, sûr de lui, convoitant depuis longtemps cette maison bourgeoise qu’il pense racheter à bas prix et convoitant aussi Carla, qu’il compte bien mettre dans son lit rapidement. Pour cela il continue à entretenir une relation distante mais efficace avec MariaGrazia la mère, supportant sa jalousie permanente, tempérant ses ardeurs et mystifiant tout le monde pour arriver à ses fins.
Un autre personnage s’infiltre dans ce magma corrosif, c’est Lisa, une amie de longue date de MariaGrazia et ancienne presque mariée de Léo. Lisa est une veuve un brin masochiste, supportant l’amitié vacharde de MariaGrazia et qui finit par vouer un amour débordant et un peu lamentable à Michele.
Lui, le fils est effrayé par cette femme qui pourrait être sa mère, dégoûté par son manque d’honnêteté à la repousser. Mais il finira bien par succomber.
Carla prend la décision qu’elle doit se donner à Léo, pour que sa vie change. Elle le fait sans dépit, ni réel calcul, elle veut juste secouer ce manteau d’inertie qui la recouvre.
Léo goguenard orchestre tout ce petit monde comme il réglerait une affaire commerciale en pesant toujours les pertes et les profits.
MariaGrazia ne voit rien : que son amant la trompe avec sa fille, qu’il veut la spolier de sa maison, que son amie convoite son fils, que son fils est au bord d’un précipice prêt à s’y jeter. Son monde tourne autour d’elle-même, du quand dira-t-on, d’être conforme à la bonne société pour pouvoir y être reconnue ; Les apparences avant toute chose et surtout garder à tout prix Léo – cet homme plus jeune – qui nourrit son illusion de jeunesse et de désir.
La fin du livre est une mascarade. On peut penser que celle qui s’en sortira le mieux sera Clara. Elle a pris le parti de jouer avec les codes de cette société qui lui offre peu d’avenir et de liberté. Des codes qu’elle pourra contourner, apprivoiser pour asseoir sa nouvelle vie.
Du haut de son écriture Moravia scrute ses personnages et il scrute le monde qui l’entoure, ses lecteurs aussi. Il observe cette société engoncée dans le manteau voluptueux et trompeur du fascisme de Mussolini. Où tout est en ordre, tout est codifié et contrôler pour la sécurité et la plénitude de « tout le monde ». Ces personnages tellement imprégnés de valeurs morales se conduisent de façon immorale. Moravia inverse les valeurs, casse les repaires, les éparpille brutalement. Il n’a pas envie de sauver ses personnages, ou si peu. Ils sont ainsi, peu sympathiques, sans joie, poupées inertes, ballottées par leurs névroses, leur paranoïa, leur consentement, leurs rêves… Car ils rêvent tous. Des rêves, des fantasmes, sur la vie des autres, sur leur vie à venir, sur l’instant d’après. Des rêves de grandeur, de splendeur, des rêves de vieux enfants, des rêves qui se heurtent à la réalité de leur vie.
MariaGrazia a des rêves d’amoureuse adolescente, de richesses inatteignables. Michele rêve d’un monde parfait, véritable où il aurait la force de vivre dans l’intransigeance de son moi profond. Clara rêve d’un amour romanesque, d’un homme idéal dans une vie palpitante. Lisa rêve d’un monde moins brutal, d’une virginité retrouvée à offrir à l’amour de sa vie et Léo rêve de Clara sans idéal ni vraiment d’amour, juste un rêve érotique qu’il pense bientôt assouvir, comme un dû qu’on lui doit, lui qui pense avoir tant donné et si peu reçu.
Les dernières pages montrent MariaGrazia et son amie Lisa ainsi que Carla en route pour une soirée. Elles sont déguisées. Carla porte un masque car c’est ce qu’elle a choisi : d’avancer masquée dans la vie. Et elle dit à son frère qui les attend « n’aie pas peur... »
Moravia pourrait le dire aussi : n’ayez pas peur de ce jeune homme d’une vingtaine d’année qui a écrit ce roman si sombre, si dur, si sec ; qui ne vous apporte aucun soulagement, ni solution ; cette bourgeoisie c’est la mienne, ce vide m’appartient aussi et pour mieux le dompter, pour mieux le comprendre et m’en asservir je dois vous l’exposer.
Une mère, une fille, un fils, un amant : personnages principaux parmi des silhouettes, des ombres – sauf l’amie de la mère ponctuant le récit pour asseoir le propos de l’auteur.
Cette étude de mœurs, de société, que sais-je… cette histoire brève, déroulée sur quelques jours est un étau qui se resserre inexorablement sur la psyché des personnages. Premier livre, éclat brutal et noir, manifeste contre l’ordre social établi, non revendiqué comme tel mais résolument admis comme tel. Le succès de sa publication laisse sans ressort la censure mussolinienne en place mais elle se rattrapera en interdisant plus tard une nouvelle publication. « Les Indifférents » est une peinture cruelle de la société italienne – une classe bourgeoise moyenne – qui ronronne sous l’ère mussolinienne.
MariaGrazia la mère est une femme que l’on aime détester. Moravia la rend grotesque, stupide, égoïste et profondément irritante. D’ailleurs même ses enfants la décrivent ainsi. Femme vieillissante dont la jalousie est le pain quotidien, détestant « le peuple », ruinée, aveugle à elle-même et à ses propres enfants, tourmentée par l’hypothétique abandon de son amant Léo ; son souhait est de marier sa fille à un riche héritier dans la pure tradition bourgeoise.
Sa fille Carla n’aspire qu’à une chose, quitter cette maison, cette vie qu’elle ne supporte plus ; rongée par l’ennui et l’inertie, ayant un désir d’amour fou, de vérité et d’envol, elle se trouve vieille. Elle se sent prisonnière et faible et regarde son frère Michele comme une roche sans aspérité pour s’y raccrocher.
Michele est plus jeune. Ce jeune homme absolu qui donne tout au long du livre l’impression d’être proche d’un acte suicidaire, déteste autant Léo que son environnement, qu’il se déteste lui-même.
Il méprise sa propre faiblesse, son indifférence à tous et à tout. Il se dégoûte, les autres le dégoûte. Son opposition à Léo et à sa mère parfois sont des flammes vite éteintes, des irruptions d’humeur qui s’effondrent aussitôt. A la différence de sa sœur, lui ne veut pas quitter cette maison, il veut que Léo quitte leur vie à tous les trois ; il veut un monde pur, transparent de vérité et de droiture, sans ombres, sans taches, sans failles.
Léo est un homme d’âge mur, affairiste, sûr de lui, convoitant depuis longtemps cette maison bourgeoise qu’il pense racheter à bas prix et convoitant aussi Carla, qu’il compte bien mettre dans son lit rapidement. Pour cela il continue à entretenir une relation distante mais efficace avec MariaGrazia la mère, supportant sa jalousie permanente, tempérant ses ardeurs et mystifiant tout le monde pour arriver à ses fins.
Un autre personnage s’infiltre dans ce magma corrosif, c’est Lisa, une amie de longue date de MariaGrazia et ancienne presque mariée de Léo. Lisa est une veuve un brin masochiste, supportant l’amitié vacharde de MariaGrazia et qui finit par vouer un amour débordant et un peu lamentable à Michele.
Lui, le fils est effrayé par cette femme qui pourrait être sa mère, dégoûté par son manque d’honnêteté à la repousser. Mais il finira bien par succomber.
Carla prend la décision qu’elle doit se donner à Léo, pour que sa vie change. Elle le fait sans dépit, ni réel calcul, elle veut juste secouer ce manteau d’inertie qui la recouvre.
Léo goguenard orchestre tout ce petit monde comme il réglerait une affaire commerciale en pesant toujours les pertes et les profits.
MariaGrazia ne voit rien : que son amant la trompe avec sa fille, qu’il veut la spolier de sa maison, que son amie convoite son fils, que son fils est au bord d’un précipice prêt à s’y jeter. Son monde tourne autour d’elle-même, du quand dira-t-on, d’être conforme à la bonne société pour pouvoir y être reconnue ; Les apparences avant toute chose et surtout garder à tout prix Léo – cet homme plus jeune – qui nourrit son illusion de jeunesse et de désir.
La fin du livre est une mascarade. On peut penser que celle qui s’en sortira le mieux sera Clara. Elle a pris le parti de jouer avec les codes de cette société qui lui offre peu d’avenir et de liberté. Des codes qu’elle pourra contourner, apprivoiser pour asseoir sa nouvelle vie.
Du haut de son écriture Moravia scrute ses personnages et il scrute le monde qui l’entoure, ses lecteurs aussi. Il observe cette société engoncée dans le manteau voluptueux et trompeur du fascisme de Mussolini. Où tout est en ordre, tout est codifié et contrôler pour la sécurité et la plénitude de « tout le monde ». Ces personnages tellement imprégnés de valeurs morales se conduisent de façon immorale. Moravia inverse les valeurs, casse les repaires, les éparpille brutalement. Il n’a pas envie de sauver ses personnages, ou si peu. Ils sont ainsi, peu sympathiques, sans joie, poupées inertes, ballottées par leurs névroses, leur paranoïa, leur consentement, leurs rêves… Car ils rêvent tous. Des rêves, des fantasmes, sur la vie des autres, sur leur vie à venir, sur l’instant d’après. Des rêves de grandeur, de splendeur, des rêves de vieux enfants, des rêves qui se heurtent à la réalité de leur vie.
MariaGrazia a des rêves d’amoureuse adolescente, de richesses inatteignables. Michele rêve d’un monde parfait, véritable où il aurait la force de vivre dans l’intransigeance de son moi profond. Clara rêve d’un amour romanesque, d’un homme idéal dans une vie palpitante. Lisa rêve d’un monde moins brutal, d’une virginité retrouvée à offrir à l’amour de sa vie et Léo rêve de Clara sans idéal ni vraiment d’amour, juste un rêve érotique qu’il pense bientôt assouvir, comme un dû qu’on lui doit, lui qui pense avoir tant donné et si peu reçu.
Les dernières pages montrent MariaGrazia et son amie Lisa ainsi que Carla en route pour une soirée. Elles sont déguisées. Carla porte un masque car c’est ce qu’elle a choisi : d’avancer masquée dans la vie. Et elle dit à son frère qui les attend « n’aie pas peur... »
Moravia pourrait le dire aussi : n’ayez pas peur de ce jeune homme d’une vingtaine d’année qui a écrit ce roman si sombre, si dur, si sec ; qui ne vous apporte aucun soulagement, ni solution ; cette bourgeoisie c’est la mienne, ce vide m’appartient aussi et pour mieux le dompter, pour mieux le comprendre et m’en asservir je dois vous l’exposer.
C'est mon premier Moravia, un des plus célèbres grâce au film de Godard qui en a été tiré.
Un peu sceptique a priori, j'ai peu à peu été séduit par l'écriture de Moravia. C'est une peinture remarquable de justesse sur le délitement d'un couple, vu du côté masculin. Sa description des sentiments intimes, écrite à la première personnes, l'incertitude et l'incompréhension, les malentendus irréparables, tout cela est magnifiquement bien vu, et me fait penser à Zweig ou à Marai. Ce devait donc être un peu démodé dans les années 50. Mais Moravia avait en plus une façon assez directe de parler de sexe dans ses romans, qui était déjà plus moderne. Et puis il inscrit son histoire dans la société italienne contemporaine en lui tendant un miroir peu flatteur.
C'est aussi un roman sur le cinéma et la création. L'enchevêtrement d'ailleurs entre la relation amoureuse et l'orientation professionnelle dans le domaine de la création est remarquable et sent le vécu.
On y parle beaucoup de la manière de représenter l'Odyssée au cinéma et les différentes options présentées sont tellement appauvrissantes qu'elles sonnent comme une satire.
Bref c'est un roman riche et superbement écrit.
Comment expliquer alors que je sois un peu resté sur ma faim, que je ne sois pas enthousiasmé? Je ne sais pas vraiment. Peut-être est-ce la façon d'écrire comme un constat clinique, un peu froid et sans échappatoire, qui m'a paru réductrice. Mais elle est à découvrir, sans aucun doute.
Un peu sceptique a priori, j'ai peu à peu été séduit par l'écriture de Moravia. C'est une peinture remarquable de justesse sur le délitement d'un couple, vu du côté masculin. Sa description des sentiments intimes, écrite à la première personnes, l'incertitude et l'incompréhension, les malentendus irréparables, tout cela est magnifiquement bien vu, et me fait penser à Zweig ou à Marai. Ce devait donc être un peu démodé dans les années 50. Mais Moravia avait en plus une façon assez directe de parler de sexe dans ses romans, qui était déjà plus moderne. Et puis il inscrit son histoire dans la société italienne contemporaine en lui tendant un miroir peu flatteur.
C'est aussi un roman sur le cinéma et la création. L'enchevêtrement d'ailleurs entre la relation amoureuse et l'orientation professionnelle dans le domaine de la création est remarquable et sent le vécu.
On y parle beaucoup de la manière de représenter l'Odyssée au cinéma et les différentes options présentées sont tellement appauvrissantes qu'elles sonnent comme une satire.
Bref c'est un roman riche et superbement écrit.
Comment expliquer alors que je sois un peu resté sur ma faim, que je ne sois pas enthousiasmé? Je ne sais pas vraiment. Peut-être est-ce la façon d'écrire comme un constat clinique, un peu froid et sans échappatoire, qui m'a paru réductrice. Mais elle est à découvrir, sans aucun doute.
J'ai lu ce roman il a quelques années. Les règlements de comptes familiaux sont un des grands thèmes italiens, aussi bien en littérature qu'au cinéma. (cf « I pugni in tasca » de Marco Bellochio).
Histoires bien poussiéreuses bien ancrées dans les campagnes isolées de l'après-guerre. Mais cette fois, c'est du lourd. Moravia, pour son premier roman, y va à la tronçonneuse. Il élague une après l'autre les branches de la généalogie familiale italienne. Comme dans beaucoup de pays méditerranéens, la famille est le dépositaire et la garantie, de l'ordre et de la sécurité, institution quasi confucéenne (voir aussi les premiers films de Marco Ferreri). Ou plutôt biblique, avec le patriarche comme autorité. Et la figure de Dieu omniprésente comme le symbolise souvent le crucifix au dessus du lit nuptial. Et bien, Moravia détruit tout ce bel agencement. Tous les dessous, au propre comme au figuré sont dévoilés, arme au poing, dans ce drame de la famille bourgeoise ordinaire.
Car, c'est bien de la bourgeoisie qu'il s'agit, celle qui porte le pays, celle qui possède, celle qui vote Démocratie Chrétienne. Il y va fort, le jeune Moravia, quelle audace, quelle écriture. Chaque personnage est décrypté et ensuite coupé, isolé de son lien avec les autres, tous englués dans la même fange. Personne n'en sort indemne.
Lu en VO. Une langue claire, précise, sans fioriture. L'auteur décrit page après page l'ignoble forfaiture familiale.
C'est magistral, c'est un des plus grands romans italiens que j'ai lu.
Histoires bien poussiéreuses bien ancrées dans les campagnes isolées de l'après-guerre. Mais cette fois, c'est du lourd. Moravia, pour son premier roman, y va à la tronçonneuse. Il élague une après l'autre les branches de la généalogie familiale italienne. Comme dans beaucoup de pays méditerranéens, la famille est le dépositaire et la garantie, de l'ordre et de la sécurité, institution quasi confucéenne (voir aussi les premiers films de Marco Ferreri). Ou plutôt biblique, avec le patriarche comme autorité. Et la figure de Dieu omniprésente comme le symbolise souvent le crucifix au dessus du lit nuptial. Et bien, Moravia détruit tout ce bel agencement. Tous les dessous, au propre comme au figuré sont dévoilés, arme au poing, dans ce drame de la famille bourgeoise ordinaire.
Car, c'est bien de la bourgeoisie qu'il s'agit, celle qui porte le pays, celle qui possède, celle qui vote Démocratie Chrétienne. Il y va fort, le jeune Moravia, quelle audace, quelle écriture. Chaque personnage est décrypté et ensuite coupé, isolé de son lien avec les autres, tous englués dans la même fange. Personne n'en sort indemne.
Lu en VO. Une langue claire, précise, sans fioriture. L'auteur décrit page après page l'ignoble forfaiture familiale.
C'est magistral, c'est un des plus grands romans italiens que j'ai lu.
Alberto Moravia a voulu créer l'image d'une femme pleine de contradictions et de fautes et, malgré cela, capable de dépasser, par sa vitalité naïve et ses élans d'affection, ses contradictions et remédier à ses fautes, afin d'atteindre à une lucidité et à un équilibre que les plus intelligents et les plus doués ignorent.
La chute d'Adriana, protagoniste du roman, débute avec un sentiment de complicité et d' accord "sensuel" qu'elle éprouve en recevant de l'argent d'un homme, après un acte sexuel extorqué presque par la force.
À ce stade, entre pauvreté, amitiés douteuses et pressions complices de la mère, la chute devient inévitable, surtout après la fin de son rêve d'amour.
La découverte de se plaire dans la prostitution la rend plus forte et consciente de ses capacités.
C'est ainsi que celle qui aurait dû être la chambre de sa première nuit de noces deviendra la pièce où elle recevra ses clients. Il n'y a plus de place pour l'ingénuité mais l'âme d'Adriana reste en quelque sorte pure pendant que le "métier" devient une routine.
Dans une atmosphère dramatique, avec des situations différentes qui s'entrelacent, faisant coucher divers hommes dans le lit d'Adriana dont un seul, le plus indifférent à sa beauté, va conquérir son coeur, Moravia remet tout en cause pour clore son roman douloureusement.
La chute d'Adriana, protagoniste du roman, débute avec un sentiment de complicité et d' accord "sensuel" qu'elle éprouve en recevant de l'argent d'un homme, après un acte sexuel extorqué presque par la force.
À ce stade, entre pauvreté, amitiés douteuses et pressions complices de la mère, la chute devient inévitable, surtout après la fin de son rêve d'amour.
La découverte de se plaire dans la prostitution la rend plus forte et consciente de ses capacités.
C'est ainsi que celle qui aurait dû être la chambre de sa première nuit de noces deviendra la pièce où elle recevra ses clients. Il n'y a plus de place pour l'ingénuité mais l'âme d'Adriana reste en quelque sorte pure pendant que le "métier" devient une routine.
Dans une atmosphère dramatique, avec des situations différentes qui s'entrelacent, faisant coucher divers hommes dans le lit d'Adriana dont un seul, le plus indifférent à sa beauté, va conquérir son coeur, Moravia remet tout en cause pour clore son roman douloureusement.
Dans ce court roman, Alberto Moravia va parler d’amour bien sûr, mais aussi de désir et de création littéraire : l’amour, le désir, éros et l’inspiration de l’artiste, du créateur.
Silvio est le ‘créateur’, ou du moins se voudrait créateur, écrivain. Au début du roman c’est un homme riche, oisif, mondain, critique littéraire à ses heures qui a épousé Léda, une femme très belle qu’il se plaît à nous décrire minutieusement, jusqu’à nous révéler sa laideur lorsqu’elle grimace d’une certaine façon. Est-ce annonciateur d’une des facettes de la personnalité de Léda, c’est la question que le lecteur se pose en début de roman.
Silvio se met en tête d’écrire lui-même un roman, de créer, et pour ce faire, se retire dans une villa en Toscane avec Léda qui l’encourage dans ses vélléités d’écrivain. Silvio décide d’écrire un roman sur l’amour conjugal, belle mise en abyme ! Cependant après quelques semaines il pense que son inspiration, son énergie créatrice est amoindrie, sinon tarie par une vie sexuelle nocturne intense. Ce qui est pour le moins étrange car d’ordinaire la création est souvent alliée à éros, les muses sont plutôt la force d’inspiration des artistes. Il est encouragé par Léda qui voudrait que l’écrivain qui est en lui se révèle, elle accepte donc de pratiquer l’abstinence le temps de la rédaction de son roman. Tout se déroule à merveille et Silvio semble avoir trouvé un rythme et un nouveau souffle littéraire jusqu’à ce que Léda se plaigne des avances sexuelles à peine voilées du barbier qui vient raser Silvio quotidiennement.
C’est un récit introspectif sur la création, l’inspiration, le jugement que l’on porte sur son œuvre. Une belle mise en abyme d’un écrivain qui écrit sur un écrivain qui écrit une œuvre sur l’amour conjugal. Toutefois si l’amour et la création sont au centre du roman, l’infidélité et le pardon font aussi partie de l’Amour Conjugal dans ce récit un peu triste où les illusions de Silvio sur la valeur de son oeuvre tombent en même temps que celles sur la perfection de son mariage.
Silvio est le ‘créateur’, ou du moins se voudrait créateur, écrivain. Au début du roman c’est un homme riche, oisif, mondain, critique littéraire à ses heures qui a épousé Léda, une femme très belle qu’il se plaît à nous décrire minutieusement, jusqu’à nous révéler sa laideur lorsqu’elle grimace d’une certaine façon. Est-ce annonciateur d’une des facettes de la personnalité de Léda, c’est la question que le lecteur se pose en début de roman.
Silvio se met en tête d’écrire lui-même un roman, de créer, et pour ce faire, se retire dans une villa en Toscane avec Léda qui l’encourage dans ses vélléités d’écrivain. Silvio décide d’écrire un roman sur l’amour conjugal, belle mise en abyme ! Cependant après quelques semaines il pense que son inspiration, son énergie créatrice est amoindrie, sinon tarie par une vie sexuelle nocturne intense. Ce qui est pour le moins étrange car d’ordinaire la création est souvent alliée à éros, les muses sont plutôt la force d’inspiration des artistes. Il est encouragé par Léda qui voudrait que l’écrivain qui est en lui se révèle, elle accepte donc de pratiquer l’abstinence le temps de la rédaction de son roman. Tout se déroule à merveille et Silvio semble avoir trouvé un rythme et un nouveau souffle littéraire jusqu’à ce que Léda se plaigne des avances sexuelles à peine voilées du barbier qui vient raser Silvio quotidiennement.
C’est un récit introspectif sur la création, l’inspiration, le jugement que l’on porte sur son œuvre. Une belle mise en abyme d’un écrivain qui écrit sur un écrivain qui écrit une œuvre sur l’amour conjugal. Toutefois si l’amour et la création sont au centre du roman, l’infidélité et le pardon font aussi partie de l’Amour Conjugal dans ce récit un peu triste où les illusions de Silvio sur la valeur de son oeuvre tombent en même temps que celles sur la perfection de son mariage.
Cela fait deux mois que je n’ai rien publié sur ce blog. Je vous rassure, je vais bien et je continue à lire mais la motivation pour écrire se fait de plus en plus rare. Mais bon, je crois que vous commencez à être habitués à mes absences prolongées et injustifiées !
Je reviens aujourd’hui avec un titre d’Alberto Moravia, auteur italien que j’affectionne beaucoup. J’avais déjà lu de lui son célèbre roman « Le Mépris » massacré à l’écran par Godard et ses acteurs pitoyables. Il a d’ailleurs été le sujet d’une de mes toutes premières critiques sur le blog. Et je me souviens avoir été conquise par cette première découverte de l’auteur.
Pendant l’une de mes absences, j’ai lu aussi ( mais donc pas chroniqué) un autre de ses titres « Le conformiste », roman que j’avais beaucoup apprécié et qui traitait principalement de la normalité, de la pression sociale et de son influence sur notre comportement et nos prises de décision. A travers cette deuxième lecture, j’ai pu remarquer à quel point Alberto Moravia détaillait avec minutie les états d’âme de ses personnages, il décortique et analyse brillamment leur psychologie.
Ce troisième roman n’y échappe pas et bien qu’antérieur au « Conformiste » et au « Mépris », Alberto Moravia y fait déjà la démonstration de ses talents.
Dans « La Désobéissance », il met en scène un jeune adolescent, Luca, qui refuse de continuer à obéir à tout le monde et de se soumettre à une quelconque autorité. Rejet de ses parents, rejet de l’institution scolaire, rejet de toute forme d’attachement matérialiste, Luca pousse son délire anarchiste jusqu’à renoncer à la vie.
C’est amusant de faire le parallèle avec Le conformiste dans lequel le personnage principal Marcello prend très tôt conscience de son anormalité. Et là où Luca fait tout pour s’extraire des conventions, Marcello, lui, a le comportement complètement inverse et fait tout comme tout le monde et tout ce qu’on attend de lui afin de se fondre dans la masse. Toutefois, les deux romans restent bien différents puisque La Désobéissance se cantonne vraiment à cette période difficile de l’adolescence or que Le Conformiste retrace la vie entière de son personnage.
En général, je n’aime pas trop les romans traitant de la période adolescente, c’est une période qui est loin derrière moi à présent et les préoccupations qui caractérisent cet âge ne sont plus les miennes et ne m’intéressent absolument plus.
Mais je dois bien reconnaître qu’ici Alberto Moravia m’a bluffée tant il décrit merveilleusement bien la violence qui peut accompagner le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Pour Luca, la transition s’effectuera non sans qu’il ait risqué sa vie. Luca tombe gravement malade. Ses délires sous l’emprise de la fièvre sont l’occasion pour Moravia de nous offrir de magnifiques pages révélatrices de la transformation qui s’opère dans l’esprit du jeune garçon.
Mais c’est justement le fait d’avoir frôlé la mort de si près, d’avoir presque atteint ce but qu’il s’était fixé d’être enfin détaché de ce monde, qui va précipiter sa renaissance. Grâce aux soins zélés d’une infirmière, Luca va découvrir l’amour charnel et ainsi, telle une chrysalide se métamorphosant en papillon, devenir enfin un homme.
La justesse et la précision des sentiments, des pensées, des interrogations et des réflexions de Luca découlent peut-être de l’expérience personnelle de l’auteur qui, jeune garçon, est tombé gravement malade de la tuberculose et aura fréquenté les sanatoriums pendant de longues années.
Outre la qualité du style et de la retranscription des émotions et des idées, je trouve quand même un peu confuse la tentative de faire de l’acte sexuel l’élément déclencheur de la transition garçon/homme. Même dans le texte, je trouve que Moravia n’est pas très clair. Pour moi, faire de la première fois le « rite de passage » est un peu cliché. J’ai l’impression que c’est surtout la maladie de Luca le déclencheur et d’ailleurs le passage dans le texte décrivant le rêve/délire de Luca en est l’illustration. Je n’ai pas compris pourquoi Moravia a brusquement dévié et donné toute l’importance à l’acte sexuel. Et puis personnellement, même si les « rites de passage » existent dans toutes les formes de société, je pense que ce sont surtout les événements de la vie qui font de nous une personne adulte.
Dans l’ensemble, j’ai quand même préféré la première partie consacrée à la désobéissance de Luca , plus forte, plus violente, plutôt que la deuxième lorsqu’il est confié aux bons soins de son infirmière, attendue mais presque décevante par sa banalité.
Alberto Moravia m’aura encore une fois conquise par sa maîtrise et sa capacité à traiter un tel sujet avec tant d’acuité et d’authenticité.
Lien : http://cherrylivres.blogspot..
Je reviens aujourd’hui avec un titre d’Alberto Moravia, auteur italien que j’affectionne beaucoup. J’avais déjà lu de lui son célèbre roman « Le Mépris » massacré à l’écran par Godard et ses acteurs pitoyables. Il a d’ailleurs été le sujet d’une de mes toutes premières critiques sur le blog. Et je me souviens avoir été conquise par cette première découverte de l’auteur.
Pendant l’une de mes absences, j’ai lu aussi ( mais donc pas chroniqué) un autre de ses titres « Le conformiste », roman que j’avais beaucoup apprécié et qui traitait principalement de la normalité, de la pression sociale et de son influence sur notre comportement et nos prises de décision. A travers cette deuxième lecture, j’ai pu remarquer à quel point Alberto Moravia détaillait avec minutie les états d’âme de ses personnages, il décortique et analyse brillamment leur psychologie.
Ce troisième roman n’y échappe pas et bien qu’antérieur au « Conformiste » et au « Mépris », Alberto Moravia y fait déjà la démonstration de ses talents.
Dans « La Désobéissance », il met en scène un jeune adolescent, Luca, qui refuse de continuer à obéir à tout le monde et de se soumettre à une quelconque autorité. Rejet de ses parents, rejet de l’institution scolaire, rejet de toute forme d’attachement matérialiste, Luca pousse son délire anarchiste jusqu’à renoncer à la vie.
C’est amusant de faire le parallèle avec Le conformiste dans lequel le personnage principal Marcello prend très tôt conscience de son anormalité. Et là où Luca fait tout pour s’extraire des conventions, Marcello, lui, a le comportement complètement inverse et fait tout comme tout le monde et tout ce qu’on attend de lui afin de se fondre dans la masse. Toutefois, les deux romans restent bien différents puisque La Désobéissance se cantonne vraiment à cette période difficile de l’adolescence or que Le Conformiste retrace la vie entière de son personnage.
En général, je n’aime pas trop les romans traitant de la période adolescente, c’est une période qui est loin derrière moi à présent et les préoccupations qui caractérisent cet âge ne sont plus les miennes et ne m’intéressent absolument plus.
Mais je dois bien reconnaître qu’ici Alberto Moravia m’a bluffée tant il décrit merveilleusement bien la violence qui peut accompagner le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Pour Luca, la transition s’effectuera non sans qu’il ait risqué sa vie. Luca tombe gravement malade. Ses délires sous l’emprise de la fièvre sont l’occasion pour Moravia de nous offrir de magnifiques pages révélatrices de la transformation qui s’opère dans l’esprit du jeune garçon.
Mais c’est justement le fait d’avoir frôlé la mort de si près, d’avoir presque atteint ce but qu’il s’était fixé d’être enfin détaché de ce monde, qui va précipiter sa renaissance. Grâce aux soins zélés d’une infirmière, Luca va découvrir l’amour charnel et ainsi, telle une chrysalide se métamorphosant en papillon, devenir enfin un homme.
La justesse et la précision des sentiments, des pensées, des interrogations et des réflexions de Luca découlent peut-être de l’expérience personnelle de l’auteur qui, jeune garçon, est tombé gravement malade de la tuberculose et aura fréquenté les sanatoriums pendant de longues années.
Outre la qualité du style et de la retranscription des émotions et des idées, je trouve quand même un peu confuse la tentative de faire de l’acte sexuel l’élément déclencheur de la transition garçon/homme. Même dans le texte, je trouve que Moravia n’est pas très clair. Pour moi, faire de la première fois le « rite de passage » est un peu cliché. J’ai l’impression que c’est surtout la maladie de Luca le déclencheur et d’ailleurs le passage dans le texte décrivant le rêve/délire de Luca en est l’illustration. Je n’ai pas compris pourquoi Moravia a brusquement dévié et donné toute l’importance à l’acte sexuel. Et puis personnellement, même si les « rites de passage » existent dans toutes les formes de société, je pense que ce sont surtout les événements de la vie qui font de nous une personne adulte.
Dans l’ensemble, j’ai quand même préféré la première partie consacrée à la désobéissance de Luca , plus forte, plus violente, plutôt que la deuxième lorsqu’il est confié aux bons soins de son infirmière, attendue mais presque décevante par sa banalité.
Alberto Moravia m’aura encore une fois conquise par sa maîtrise et sa capacité à traiter un tel sujet avec tant d’acuité et d’authenticité.
Lien : http://cherrylivres.blogspot..
« Le mépris« , pour beaucoup de gens, c’est avant tout le célèbre film (1963) de J.L. Godard, avec Brigitte Bardot.
Mais il s’agit avant tout du livre d’Alberto Moravia, auteur italien réputé entre autres pour « L’ennui » et « Le conformiste« .
Si le début du film de Godard demeure célèbre (Bardot demandant lascivement à Michel Piccoli s’il aime chaque partie de son corps), l’incipit du roman n’en n’est pas moins fameux: Durant les deux premières années de mon mariage, mes rapports avec ma femme furent, je puis aujourd’hui l’affirmer, parfaits. L’objet de ce récit est de raconter comment, alors que je continuais à l’aimer et à ne pas la juger, Emilia au contraire découvrit ou cru découvrir certains de mes défauts, me jugea et, en conséquence, cessa de m’aimer.
Ricardo est un jeune homme cultivé et passionné de théâtre. Pour palier aux envies de sa femme, il accepte des scénarios de films et s’éloigne de plus en plus de son idéal littéraire d’indépendance. Pris de compromis en compromis, son intégrité s’étiole au fil du roman, alors que son intention n’en demeure pas moins bonne. Le mépris est l’histoire d’une spirale infernale, d’un labyrinthe sans issue, qui semble faire le jeu de la société moderne.
Roman sur le cinéma, comme le met en exergue Godard, « Le mépris » aborde la question de la modernisation des moeurs et de la société. Le film dont il est question de faire le scenario pour Ricardo n’est rien de moins que la célèbre « Odyssée » d’ Homère. Fresque héroïque par excellence, elle contraste habilement avec les tribulations du scénariste italien. Un défi insurmontable pour le héros mortel?
Car en héros moderne, Ricardo endure mille tourments; la précarité, la peur de perdre un emploi, et l’estime de sa femme, les compromis douloureux avec sa boîte de production…Lui qui était un artiste, Ulysse un roi, tout deux se retrouvent jetés sur les chemins de l’errance par quelques facéties d’un dieu à l’humour cruel. Destin tragique, ou quête identitaire, « psychanalytique »? Moravia dépeint cette époque de la découverte de la psychanalyse, ou tout prend un sens intimiste et freudien.
A son réalisateur allemand qui entend donner un sens tout personnel et individuel à un Ulysse qui a peur de rentrer au foyer, héros civilisé et rusé, face à une Pénélope barbare et pétrie de tradition, Ricardo appelle un héros cathartique, pleinement « ancien », issu d’une époque révolu. Il a le goût du sacrifice sans réaliser que la cause, elle, est morte, ou pire, dépassée, déclassée.
C’est ce monde post-moderne, trop intimiste ou trop spectaculaire que décrit « le Mépris », au milieu duquel le héros flotte comme un individu solitaire, pathétique finalement, dans son incapacité à reprendre sa vie en main ou même à se résigner. Lutte perdu d’avance d’un héros antique en proie à des maux modernes, il souffre du mépris implacable de cet Emilia dont le mystère s’évapore peu à peu. De l’héroïne tragique, farouche nymphe, elle n’incarne que le drame de la petite bourgeoise en quête de stabilité et de protection masculine.
Moravia nous dépeint une société oscillant entre deux extrêmes, du grand cinéma à l’introspection de soi. Ricardo malgré lui incarne ce déséquilibre social. Homme de théâtre, il se « vend » au cinéma et à ses grandes productions pour les besoins bourgeois de sa femme qui le méprise finalement de cette bassesse. Entre ces deux écueils, quel issue reste t-il? C’est bien son impossibilité que Ricardo expérimente, car au bout de chaque chemin se trouve dressé comme un Sphinx moderne l’énigme du mépris contemporain.
Lien : http://madamedub.com/WordPre..
Mais il s’agit avant tout du livre d’Alberto Moravia, auteur italien réputé entre autres pour « L’ennui » et « Le conformiste« .
Si le début du film de Godard demeure célèbre (Bardot demandant lascivement à Michel Piccoli s’il aime chaque partie de son corps), l’incipit du roman n’en n’est pas moins fameux: Durant les deux premières années de mon mariage, mes rapports avec ma femme furent, je puis aujourd’hui l’affirmer, parfaits. L’objet de ce récit est de raconter comment, alors que je continuais à l’aimer et à ne pas la juger, Emilia au contraire découvrit ou cru découvrir certains de mes défauts, me jugea et, en conséquence, cessa de m’aimer.
Ricardo est un jeune homme cultivé et passionné de théâtre. Pour palier aux envies de sa femme, il accepte des scénarios de films et s’éloigne de plus en plus de son idéal littéraire d’indépendance. Pris de compromis en compromis, son intégrité s’étiole au fil du roman, alors que son intention n’en demeure pas moins bonne. Le mépris est l’histoire d’une spirale infernale, d’un labyrinthe sans issue, qui semble faire le jeu de la société moderne.
Roman sur le cinéma, comme le met en exergue Godard, « Le mépris » aborde la question de la modernisation des moeurs et de la société. Le film dont il est question de faire le scenario pour Ricardo n’est rien de moins que la célèbre « Odyssée » d’ Homère. Fresque héroïque par excellence, elle contraste habilement avec les tribulations du scénariste italien. Un défi insurmontable pour le héros mortel?
Car en héros moderne, Ricardo endure mille tourments; la précarité, la peur de perdre un emploi, et l’estime de sa femme, les compromis douloureux avec sa boîte de production…Lui qui était un artiste, Ulysse un roi, tout deux se retrouvent jetés sur les chemins de l’errance par quelques facéties d’un dieu à l’humour cruel. Destin tragique, ou quête identitaire, « psychanalytique »? Moravia dépeint cette époque de la découverte de la psychanalyse, ou tout prend un sens intimiste et freudien.
A son réalisateur allemand qui entend donner un sens tout personnel et individuel à un Ulysse qui a peur de rentrer au foyer, héros civilisé et rusé, face à une Pénélope barbare et pétrie de tradition, Ricardo appelle un héros cathartique, pleinement « ancien », issu d’une époque révolu. Il a le goût du sacrifice sans réaliser que la cause, elle, est morte, ou pire, dépassée, déclassée.
C’est ce monde post-moderne, trop intimiste ou trop spectaculaire que décrit « le Mépris », au milieu duquel le héros flotte comme un individu solitaire, pathétique finalement, dans son incapacité à reprendre sa vie en main ou même à se résigner. Lutte perdu d’avance d’un héros antique en proie à des maux modernes, il souffre du mépris implacable de cet Emilia dont le mystère s’évapore peu à peu. De l’héroïne tragique, farouche nymphe, elle n’incarne que le drame de la petite bourgeoise en quête de stabilité et de protection masculine.
Moravia nous dépeint une société oscillant entre deux extrêmes, du grand cinéma à l’introspection de soi. Ricardo malgré lui incarne ce déséquilibre social. Homme de théâtre, il se « vend » au cinéma et à ses grandes productions pour les besoins bourgeois de sa femme qui le méprise finalement de cette bassesse. Entre ces deux écueils, quel issue reste t-il? C’est bien son impossibilité que Ricardo expérimente, car au bout de chaque chemin se trouve dressé comme un Sphinx moderne l’énigme du mépris contemporain.
Lien : http://madamedub.com/WordPre..
Ce roman a reçu un accueil tiède lors de sa sortie : on lui a reproché son cheminement trop didactique, ainsi qu'une condamnation trop réservée du fascisme. Didactique, il l'est, mais c'est du Moravia, et je le trouve magistral ainsi. Quant au fascisme, l'auteur l'a utilisé parce qu'il aime parler de ce qu'il connaît et qu'il lui a paru propre à illustrer le consensus italien de son époque : et on ne peut certes pas le soupçonner, sans une certaine mauvaise foi, de lui avoir été favorable. Mais il aurait tout aussi bien pu se référer à une autre idéologie totalitaire (la définition du totalitarisme étant la pression horizontale exercée par chacun des membres d'une société sur tous les autres, à la différence de l'autoritarisme qui suppose une pression hiérarchique exercée du haut vers le bas.) C'est le premier mode de fonctionnement qui intéresse Moravia en tant que générant une norme à laquelle tous veulent se conformer, ce qui engendre surveillances réciproques, contention des instincts et mélancolie. Mélancolique, Marcel l'est, puisqu'il se condamne par culpabilité à ne pas vivre sa propre vie, mais celle qu'il s'imagine devoir vivre : sa peur de la liberté le conduit au terrorisme par fidélité envers un régime qui lui déplaît mais qu'il suppose devoir soutenir par allégeance envers le plus grand nombre, détenteur, croit-il, de la normalité. Bien sûr, n'étant au fond ni conformiste, ni fasciste, il échouera, et comprendra juste à temps (pour une possible rédemption ?) qu'être libre n'est pas choisir ce qu'on est, mais croître et grandir en plein accord avec ce qu'on est. Spinoziste, Moravia ? En tous cas il s'inscrit dans le courant existentialiste de son temps, même s'il ne privilégie pas l'action politique comme Sartre. Bien au-delà de tous les "ismes", ce roman est une profonde et subtile méditation sur la liberté, et sur une infinité d'autres sujets.
A ne lire qu'un livre d'Alberto Moravia, il faut lire celui-ci.
A ne lire qu'un livre d'Alberto Moravia, il faut lire celui-ci.
Tout le monde connait le film de Jean Luc Godard, vampirisé par Brigitte Bardot et Michel Piccoli, tout au moins par quelques extraits largement diffusés.
Tout ceci, pour les besoins de l'adaptation cinématographique, a à mon avis sérieusement dénaturé l'impression que l'on pouvait avoir de l'oeuvre d'Alberto Moravia.
On est dans l'Italie des années cinquante, et on va vivre avec des personnages, sans que l'on nous raconte véritablement une histoire. En effet le sujet est relativement minimaliste, et le livre est vraiment centré sur une étonnante étude et description psychologique des personnages qui vont vivre une lente mais inéluctable descente aux enfers sentimentale.
Une jeune femme, au bout de deux ans de vie commune n'aime plus son mari, et s'en détache lentement. Cela peut arriver ! Mais quoi de pire que d'en arriver au mépris ?
C'est une littérature très fine, très ciselée que nous offre Moravia.
Tout ceci, pour les besoins de l'adaptation cinématographique, a à mon avis sérieusement dénaturé l'impression que l'on pouvait avoir de l'oeuvre d'Alberto Moravia.
On est dans l'Italie des années cinquante, et on va vivre avec des personnages, sans que l'on nous raconte véritablement une histoire. En effet le sujet est relativement minimaliste, et le livre est vraiment centré sur une étonnante étude et description psychologique des personnages qui vont vivre une lente mais inéluctable descente aux enfers sentimentale.
Une jeune femme, au bout de deux ans de vie commune n'aime plus son mari, et s'en détache lentement. Cela peut arriver ! Mais quoi de pire que d'en arriver au mépris ?
C'est une littérature très fine, très ciselée que nous offre Moravia.
Luca est un adolescent d’une quinzaine d’année, ayant la sensation d’avoir grandi trop vite, d’être adulte avant l’heure. Cela entraîne chez lui de grandes perturbations psychologiques se traduisant par des colères violentes, contre les êtres humains mais aussi les objets inanimés (« Luca avait le sentiment que le monde lui était hostile et que lui-même était hostile au monde ; et il lui semblait livrer une guerre continuelle et exténuante à tout ce qui l'entourait »).
Pour s’en sortir, il décide de renoncer. Renoncer, simplement, à tout : possession matérielle, vie en société, relations humaines. Cette abdication est pour lui la désobéissance ultime, la lutte la plus efficace qui soit. Dans toutes circonstances de sa vie, il développe une ligne de conduite allant dans ce sens, ce qui le conduit à l’alitement. Jusqu’au jour où une infirmière…
Excellent roman initiatique d’Alberto Moravia, écrit en 1949, où l’on trouve toutes les caractéristiques de cet auteur : une observation clinique des êtres humains et de leur comportement en société, une lutte permanente contre les idéologies dominantes (ces premiers écrits ont été produits à compte d’auteur sous la dictature de Mussolini), sans oublier une bonne dose de sensualité... On rencontre dans ce roman une infirmière assez mémorable...
Pour s’en sortir, il décide de renoncer. Renoncer, simplement, à tout : possession matérielle, vie en société, relations humaines. Cette abdication est pour lui la désobéissance ultime, la lutte la plus efficace qui soit. Dans toutes circonstances de sa vie, il développe une ligne de conduite allant dans ce sens, ce qui le conduit à l’alitement. Jusqu’au jour où une infirmière…
Excellent roman initiatique d’Alberto Moravia, écrit en 1949, où l’on trouve toutes les caractéristiques de cet auteur : une observation clinique des êtres humains et de leur comportement en société, une lutte permanente contre les idéologies dominantes (ces premiers écrits ont été produits à compte d’auteur sous la dictature de Mussolini), sans oublier une bonne dose de sensualité... On rencontre dans ce roman une infirmière assez mémorable...
‘Ciociara’ est le nom donné aux paysannes des montagnes non loin de Rome et c’est de là que vient Cesira. Elle s’est mariée avec un épicier romain et se retrouve veuve quelque temps avant que la guerre n’éclate. Après l’arrestation de Mussolini en 1943, en attendant l’arrivée des alliés et le départ des allemands, Cesira décide de quitter son commerce et de se réfugier à la campagne avec sa fille Rosetta âgée de 18 ans. C’est cet exil à la campagne que raconte Cesira, ces mois passés avec des paysans frustres, plus ou moins honnêtes, souvent assez pauvres et aussi âpres au gain, qui profitent de l’aubaine que représente Cesira et ses économies.
Ce sont des mois d’attente, d’ennui, d’inconfort et de peur aussi car les allemands font des rafles de victuailles, d’hommes valides pour les envoyer au front, ou bien alors tuent sans vraiment de raison alors qu’ils se retirent en débâcle et que les bombardements éclatent. Et il y a aussi la faim à mesure que les vivres se raréfient, que les alliés se font attendre et que le chaos règne. Cesira comprend alors que la guerre a effacé les lois, que ce sera chacun pour soi, que la pitié et la commisération ont disparu ou presque, seule la survie prime.
Au retour sur Rome, ce sont deux femmes qu’on pourrait croire brisées, abîmées par les épreuves terribles qu’elles ont traversées, mais bien qu’elles soient désillusionnées, ce sont aussi des femmes plus fortes bien décidées à construire l’avenir sur les ruines qu’elles traversent.
C’est un beau roman sur cette partie de la guerre en Italie, et plus largement sur ses effets pervers sur les civils toujours pris entre deux feux ; ici ce sont d’abord les fascistes qui profitent et règnent en maîtres, ensuite les allemands et enfin les alliés, pas toujours les sauveurs qu’on attendait, car ils ont été aussi les auteurs d’exactions, en particuliers de viols par milliers. Moravia a lui aussi été se réfugier dans ces montagnes près de Fondi, en 1943, pendant près de neuf mois alors qu’il fuyait les fascistes ce qui donne une impression de vécu au récit. Le roman se déroule de façon linéaire dans un style assez simple sans fioritures, parce que Moravia a choisi Cesira comme narratrice, et que Cesira est une femme simple, une paysanne analphabète. C’est ainsi qu’il donne d’autant plus de force au récit, grâce à cette femme qui comprend obscurément les tenants et les aboutissants du conflit, mais qui en ressent les effets au plus profond de son être et qui n’aspire qu’à protéger sa fille au mieux, de tous les dangers et des privations engendrées par la guerre. Un bien beau roman.
Ce sont des mois d’attente, d’ennui, d’inconfort et de peur aussi car les allemands font des rafles de victuailles, d’hommes valides pour les envoyer au front, ou bien alors tuent sans vraiment de raison alors qu’ils se retirent en débâcle et que les bombardements éclatent. Et il y a aussi la faim à mesure que les vivres se raréfient, que les alliés se font attendre et que le chaos règne. Cesira comprend alors que la guerre a effacé les lois, que ce sera chacun pour soi, que la pitié et la commisération ont disparu ou presque, seule la survie prime.
Au retour sur Rome, ce sont deux femmes qu’on pourrait croire brisées, abîmées par les épreuves terribles qu’elles ont traversées, mais bien qu’elles soient désillusionnées, ce sont aussi des femmes plus fortes bien décidées à construire l’avenir sur les ruines qu’elles traversent.
C’est un beau roman sur cette partie de la guerre en Italie, et plus largement sur ses effets pervers sur les civils toujours pris entre deux feux ; ici ce sont d’abord les fascistes qui profitent et règnent en maîtres, ensuite les allemands et enfin les alliés, pas toujours les sauveurs qu’on attendait, car ils ont été aussi les auteurs d’exactions, en particuliers de viols par milliers. Moravia a lui aussi été se réfugier dans ces montagnes près de Fondi, en 1943, pendant près de neuf mois alors qu’il fuyait les fascistes ce qui donne une impression de vécu au récit. Le roman se déroule de façon linéaire dans un style assez simple sans fioritures, parce que Moravia a choisi Cesira comme narratrice, et que Cesira est une femme simple, une paysanne analphabète. C’est ainsi qu’il donne d’autant plus de force au récit, grâce à cette femme qui comprend obscurément les tenants et les aboutissants du conflit, mais qui en ressent les effets au plus profond de son être et qui n’aspire qu’à protéger sa fille au mieux, de tous les dangers et des privations engendrées par la guerre. Un bien beau roman.
Partie pour écrire une critique sérieuse du livre, je finis par tout effacer. Le Mépris me fatigue, c’est clair non ? C’est quoi : dissection d’un désamour progressif, nerfs extraits à la petite cuillère, allusions à l’histoire d’Homère et de Pénélope, pour ne pas faire croire au lecteur élitiste qu’on lui livre là une vulgaire soupe à l’eau-de-rose. Comme si la création moderne devait forcément faire circuler l’air vicié des œuvres anciennes pour trouver légitimité.
Quiconque cherche trouvera dans ces pages des éléments pour essayer de comprendre son propre merdier. Et pourtant, qui sait si les sentiments et les comportements sont irrationnels. On ne peut que tendre vers leur compréhension mais cet effort, inhumain et inutile, nous renseigne surtout sur les bonnes raisons que nous avons de mépriser le sentiment.
Quiconque cherche trouvera dans ces pages des éléments pour essayer de comprendre son propre merdier. Et pourtant, qui sait si les sentiments et les comportements sont irrationnels. On ne peut que tendre vers leur compréhension mais cet effort, inhumain et inutile, nous renseigne surtout sur les bonnes raisons que nous avons de mépriser le sentiment.
Groupes sur Alberto Moravia
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Alberto Moravia
Lecteurs de Alberto Moravia Voir plus
Quiz
Voir plus
Le Mépris
Pour quel film le producteur a-t-il besoin de l'aide du scénariste ?
Tristan et Ysoelt
L'Ôde Hissée
L'Odyssée
Antigone
Dom Juan
10 questions
21 lecteurs ont répondu
Thème : Le Mépris de
Alberto MoraviaCréer un quiz sur cet auteur21 lecteurs ont répondu