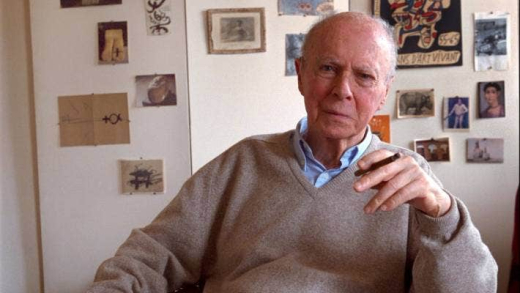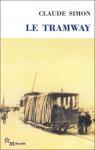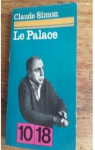Critiques de Claude Simon (123)
Il y a des textes qui se laissent moins facilement appréhender, et Archipel et Nord font pour moi partie de ceux-là. Claude Simon a entretenu une relation particulière avec la Scandinavie, une partie du monde qu’il évoque dans son discours de réception du prix Nobel obtenu en 1985, y ayant donné des conférences et voyagé dès 1963 d’après ce que j’ai pu en lire; quelques recherches m’ont été essentielles pour tenter d’appréhender cet ouvrage. Poésie en prose sans ponctuation et constitués de fragments faits, on dirait, d’enchaînements d’idées, ces deux textes – des commandes de revues finlandaises parues en 1974 et visant à promouvoir le tourisme - partagent le concept de survoler un territoire, plus verticalement dans Archipel, avec ses temporalités multiples, plus horizontalement dans Nord, un texte que j’ai trouvé un peu plus poétique et accessible, et dans lequel on peut lire l’extrait suivant :
« progressivement les eaux du rapide s’assombrirent à la fin elles furent tout à fait noires aussi encre où les crinières les galopants coursiers d’écume étaient maintenant comme de la neige les bouleaux sur l’autre rive de plus en plus pâles sous le ciel noir comme si toute la lumière s’était rassemblée dans ces remous ces bouillonnements les feuillages décolorés soudain la pluie commença à tomber violente sauvage mêlée d’éclairs sur les rives désertes sur les milliers et les milliers de pins gisants et convulsifs »
Si par moments j’ai trouvé belles les envolées de l’auteur, j’ai quand même été déconcertée par un style auquel je ne m’attendais pas, découvrant Claude Simon avec ces deux textes. J’aurais apprécié une préface - le présent livre ayant été publié en 2009 -, qui m’aurait peut-être permis de les comprendre davantage…
« progressivement les eaux du rapide s’assombrirent à la fin elles furent tout à fait noires aussi encre où les crinières les galopants coursiers d’écume étaient maintenant comme de la neige les bouleaux sur l’autre rive de plus en plus pâles sous le ciel noir comme si toute la lumière s’était rassemblée dans ces remous ces bouillonnements les feuillages décolorés soudain la pluie commença à tomber violente sauvage mêlée d’éclairs sur les rives désertes sur les milliers et les milliers de pins gisants et convulsifs »
Si par moments j’ai trouvé belles les envolées de l’auteur, j’ai quand même été déconcertée par un style auquel je ne m’attendais pas, découvrant Claude Simon avec ces deux textes. J’aurais apprécié une préface - le présent livre ayant été publié en 2009 -, qui m’aurait peut-être permis de les comprendre davantage…
Un homme, gravement malade, est hospitalisé : au rythme des crues et décrues de sa fièvre, passent dans sa mémoire des souvenirs, suivant les allers-retours du tramway qui l'emmenait, enfant, à la ville et à l'école, pour revenir le soir vers la plage au bord de laquelle vivaient les riches et anciennes familles dans leurs belles villas.
Oui, ma phrase est longue, mais ça n'est rien à côté de celles de Claude Simon.
Et je n'ai pas ouvert de multiples parenthèses emboîtées, non plus.
Lui, si.
Le résultat est un roman court, mais absolument fascinant, impossible à quitter au risque de perdre le fil - et d'avoir à le repasser dans le chas de l'aiguille. Chas de l'aiguille au travers duquel l'auteur observe les lieux, les gens, les injustices sociales avec un talent absolument unique, une écriture qui ne peut être comparée à aucune autre. Comme c'est beau !
La lecture de Claude Simon m'a été recommandée 3 fois : la première en octobre 1985 par le jury du prix Nobel. La seconde une semaine plus tard par mon aimable belle-mère : "Tu ne connaissais pas Claude Simon ? J'en ai plein, si tu veux je t'en prête... mais je ne suis pas sûre que tu aimes." Et la gagnante est donc Allantvers, dont la critique du Tramway m'a convaincue que l'heure était venue...!
Challenge Nobel
Challenge Départements
Oui, ma phrase est longue, mais ça n'est rien à côté de celles de Claude Simon.
Et je n'ai pas ouvert de multiples parenthèses emboîtées, non plus.
Lui, si.
Le résultat est un roman court, mais absolument fascinant, impossible à quitter au risque de perdre le fil - et d'avoir à le repasser dans le chas de l'aiguille. Chas de l'aiguille au travers duquel l'auteur observe les lieux, les gens, les injustices sociales avec un talent absolument unique, une écriture qui ne peut être comparée à aucune autre. Comme c'est beau !
La lecture de Claude Simon m'a été recommandée 3 fois : la première en octobre 1985 par le jury du prix Nobel. La seconde une semaine plus tard par mon aimable belle-mère : "Tu ne connaissais pas Claude Simon ? J'en ai plein, si tu veux je t'en prête... mais je ne suis pas sûre que tu aimes." Et la gagnante est donc Allantvers, dont la critique du Tramway m'a convaincue que l'heure était venue...!
Challenge Nobel
Challenge Départements
La préface (voyez ma citation) est à lire absolument pour tous les amateurs de Claude Simon ou du nouveau roman ; l'auteur répond à la demande de Gaëtan Picon et nous y éclaire sur son processus créatif. La suite de l'ouvrage remplit le cahier des charges de la collection Les sentiers de la création par l'exemple : elle illustre la méthode décrite dans cette préface par un texte typiquement Simonien et abondamment illustré. le tout est superbement imprimé, beau papier, typographie originale, qualité des images...
J'ai aimé tous les romans de Claude Simon qui me sont passés entre les mains. Celui-ci préfigure non seulement Les corps conducteurs, qui en retravaille le texte et que je n'ai pas lu, mais aussi par exemple Tryptique qui m'avait ébloui. Comme son nom l'indique, Triptyque est fondé sur trois images, dont les descriptions, commentaires et prolongements sont mêlés dans le texte. Orion aveugle se présente comme une suite de phrases qui décrivent des images fixes ou des scènes, de nature diverses et parfois difficiles à identifier. le lecteur est, au moins au début, désorienté par le passage d'une image à un autre à certaines fin de phrase (le texte est monoparagraphique). Les images sont nombreuses. Peuvent-elles être groupées ? Le lecteur, habitué à une certaine continuité narrative, voudrait les associer : par exemple par proximité géographique (les rues d'une ville qui pourrait être New York sont-elles celles où un homme s'assied sur une bouche d'incendie, cet homme est-il celui qui sort d'une consultation médicale...). le lecteur aimerait aussi, en plus de voir dans le texte l'application de la « méthode » d 'écriture décrite au début de la préface, y trouver une réflexion sur le rôle de l'écrivain (sujet d'un congrès décrit par bribes) et sur « l'aventure singulière du narrateur qui ne cesse de chercher, découvrant à tâtons le monde dans et par l'écriture » (fin de la préface). J'ai beaucoup aimé explorer ces pistes, tout en m'émerveillant de la qualité des descriptions, précises, évocatrices, au vocabulaire raffiné.
Voilà de quoi faire un beau texte. Mais le livre contient aussi une vingtaine d'illustrations : oeuvres d'art diverses (reproduction d'un fragment d'un tableau de Poussin d'où vient probablement le titre en couverture, tableau complet vers la fin de l'oeuvre), photos d'objets usuels, de sculptures, de collages, dessins (main écrivant, dessin de l'auteur!!!). Que font-elles là ? Parfois, elles sont complètement décrites, en particulier l'analyse du tableau de Poussin et de son détournement des lois de la perspective est prenante et bluffante, parfois elles évoquent un objet ou un lieu fugitivement décrit dans le texte, parfois elles font un pas de côté, ouvrant une piste parallèle, toujours posant au lecteur des questions non définies mais très riches. Un exemple : à quelques pages de la description d'un gratte-ciel la nuit dont Claude Simon décrit la structure devinée, il insère une photo d'une sculpture de Louise Nevelson, complexe montage, noir bien sûr, d'objets et de morceaux de bois dont la ligne générale est verticale.
Est-ce la porte d'entrée idéale vers l'oeuvre de Claude Simon ? C'est au moins, grâce à cette préface précieuse (et semble-t-il célèbre) une excitante occasion d'essayer de faire jouer des clés de lecture dans l'ensemble de l'œuvre de cet écrivain nobelisé. Je n'ai pas parlé de tous les thèmes qui se mêlent dans le livre, mais j'encourage vivement à les découvrir, en gardant à l'esprit la réflexion sur la nature du Roman, nouveau ou non.
Note 1 : êtes-vous sûrs de savoir conjuguer le verbe saillir?
Note 2 : j'écris cet avis dans l'urgence, loin de chez moi, avec une réflexion un peu courte, c'est dommage
J'ai aimé tous les romans de Claude Simon qui me sont passés entre les mains. Celui-ci préfigure non seulement Les corps conducteurs, qui en retravaille le texte et que je n'ai pas lu, mais aussi par exemple Tryptique qui m'avait ébloui. Comme son nom l'indique, Triptyque est fondé sur trois images, dont les descriptions, commentaires et prolongements sont mêlés dans le texte. Orion aveugle se présente comme une suite de phrases qui décrivent des images fixes ou des scènes, de nature diverses et parfois difficiles à identifier. le lecteur est, au moins au début, désorienté par le passage d'une image à un autre à certaines fin de phrase (le texte est monoparagraphique). Les images sont nombreuses. Peuvent-elles être groupées ? Le lecteur, habitué à une certaine continuité narrative, voudrait les associer : par exemple par proximité géographique (les rues d'une ville qui pourrait être New York sont-elles celles où un homme s'assied sur une bouche d'incendie, cet homme est-il celui qui sort d'une consultation médicale...). le lecteur aimerait aussi, en plus de voir dans le texte l'application de la « méthode » d 'écriture décrite au début de la préface, y trouver une réflexion sur le rôle de l'écrivain (sujet d'un congrès décrit par bribes) et sur « l'aventure singulière du narrateur qui ne cesse de chercher, découvrant à tâtons le monde dans et par l'écriture » (fin de la préface). J'ai beaucoup aimé explorer ces pistes, tout en m'émerveillant de la qualité des descriptions, précises, évocatrices, au vocabulaire raffiné.
Voilà de quoi faire un beau texte. Mais le livre contient aussi une vingtaine d'illustrations : oeuvres d'art diverses (reproduction d'un fragment d'un tableau de Poussin d'où vient probablement le titre en couverture, tableau complet vers la fin de l'oeuvre), photos d'objets usuels, de sculptures, de collages, dessins (main écrivant, dessin de l'auteur!!!). Que font-elles là ? Parfois, elles sont complètement décrites, en particulier l'analyse du tableau de Poussin et de son détournement des lois de la perspective est prenante et bluffante, parfois elles évoquent un objet ou un lieu fugitivement décrit dans le texte, parfois elles font un pas de côté, ouvrant une piste parallèle, toujours posant au lecteur des questions non définies mais très riches. Un exemple : à quelques pages de la description d'un gratte-ciel la nuit dont Claude Simon décrit la structure devinée, il insère une photo d'une sculpture de Louise Nevelson, complexe montage, noir bien sûr, d'objets et de morceaux de bois dont la ligne générale est verticale.
Est-ce la porte d'entrée idéale vers l'oeuvre de Claude Simon ? C'est au moins, grâce à cette préface précieuse (et semble-t-il célèbre) une excitante occasion d'essayer de faire jouer des clés de lecture dans l'ensemble de l'œuvre de cet écrivain nobelisé. Je n'ai pas parlé de tous les thèmes qui se mêlent dans le livre, mais j'encourage vivement à les découvrir, en gardant à l'esprit la réflexion sur la nature du Roman, nouveau ou non.
Note 1 : êtes-vous sûrs de savoir conjuguer le verbe saillir?
Note 2 : j'écris cet avis dans l'urgence, loin de chez moi, avec une réflexion un peu courte, c'est dommage
Lire « L'herbe » de Claude Simon c'est s'immerger dans un monde oublié de sensations, ressentir de la nostalgie pour une époque que l'on n'a pas connue. Il faut, pour jouir pleinement de cette lecture, ouvrir ses sens, consentir à se laisser submerger par des paragraphes sans fin, par de longues phrases à la syntaxe et à la grammaire savantes, savoir régler sa respiration au rythme saccadé d'une chronologie bousculée.
Le drame bourgeois, provincial de Louise, de sa belle-famille et l'agonie sans fin de la tante Marie pourrait sembler d'une absolue banalité. Il en est tout autrement. L'auteur, avec un indéniable souci de réalisme, restitue à la perfection l'expérience sensible et fragmentaire de Louise. Les évènements sont narrés à travers sa conscience. Nous sommes au plus proche d'elle, de ses impressions, de ses réminiscences, de ses perceptions . Les tranches de vie se déploient à tour de rôle sans aucun souci d'ordre et de logique. « … elle ne se souciait même plus d'être entendue et encore moins de ce minimum de cohérence qu'il est obligatoire de donner à ses paroles pour se faire comprendre, c'est-à-dire, en y réfléchissant, pour ne pas se faire comprendre, parce que c'est assez comique et même complètement absurde d'être obligé de s'exprimer de façon cohérente quand ce que l'on éprouve est incohérent … » le temps ici progresse imperceptiblement. Une photo, une lettre, un carnet font ressurgir le passé. Les actions sont transformées en images. le roman est en effet composé d'une succession de tableaux sur lesquels on s'arrête plus ou moins longuement, passant de l'un à l'autre de façon inattendue au gré des discontinuités de la mémoire de Louise. Ces très belles lignes nous renvoient de façon saisissante à notre propre existence, à son rapport à l'histoire et au temps.
L'auteur souvent délaisse les personnages pour se concentrer sur la nature et cela donne aussi de très belles pages. Les plus belles ? La folle végétation, l'envahissant concert des moineaux, l'odeur lancinante des fruits trop murs, la vie des insectes, la nature secrète, terrible font partie intégrante du récit. « L'herbe » est un très, très beau texte qui permet, me semble-t-il, une entrée facile et inoubliable dans l'oeuvre du prix Nobel de littérature.
Le drame bourgeois, provincial de Louise, de sa belle-famille et l'agonie sans fin de la tante Marie pourrait sembler d'une absolue banalité. Il en est tout autrement. L'auteur, avec un indéniable souci de réalisme, restitue à la perfection l'expérience sensible et fragmentaire de Louise. Les évènements sont narrés à travers sa conscience. Nous sommes au plus proche d'elle, de ses impressions, de ses réminiscences, de ses perceptions . Les tranches de vie se déploient à tour de rôle sans aucun souci d'ordre et de logique. « … elle ne se souciait même plus d'être entendue et encore moins de ce minimum de cohérence qu'il est obligatoire de donner à ses paroles pour se faire comprendre, c'est-à-dire, en y réfléchissant, pour ne pas se faire comprendre, parce que c'est assez comique et même complètement absurde d'être obligé de s'exprimer de façon cohérente quand ce que l'on éprouve est incohérent … » le temps ici progresse imperceptiblement. Une photo, une lettre, un carnet font ressurgir le passé. Les actions sont transformées en images. le roman est en effet composé d'une succession de tableaux sur lesquels on s'arrête plus ou moins longuement, passant de l'un à l'autre de façon inattendue au gré des discontinuités de la mémoire de Louise. Ces très belles lignes nous renvoient de façon saisissante à notre propre existence, à son rapport à l'histoire et au temps.
L'auteur souvent délaisse les personnages pour se concentrer sur la nature et cela donne aussi de très belles pages. Les plus belles ? La folle végétation, l'envahissant concert des moineaux, l'odeur lancinante des fruits trop murs, la vie des insectes, la nature secrète, terrible font partie intégrante du récit. « L'herbe » est un très, très beau texte qui permet, me semble-t-il, une entrée facile et inoubliable dans l'oeuvre du prix Nobel de littérature.
Ils ont tout cassé, tout détruit, la structure romanesque, finit... L'intrigue, les personnages, c'était avant. Désormais avec le Nouveau Roman, vous allez vous coltiner un narrateur omniscient qui ne nomme aucun personnage et avec comme seul repère des dates. De plus, un rythme lent qui souhaite capter une forme d'unicité du temps avec un vocabulaire d'une richesse et d'une diversité à couper le souffle. De la branlette intellectuelle, de la vraie... Un amas de pensée, de détails, de micro-récits, d'anecdotes, un foisonnement d'images scrutant avec avidité le monde matériel à la recherche d’un sens qui reste toujours hors de portée.
Cette recherche menée en parallèle de celle du temps, d'un passé fragmentaire, empli de coïncidences bien grandes et d'un hasard puissant, mais qui, dans sa plénitude sensorielle semble revivre. Mais on ne peut non plus dire que cette œuvre est autobiographique pour autant, elle met plutôt tout en place pour montrer l’irréalité d’expériences extrêmes. L'individu est ici écrasé par l'histoire meurtrière du 20eme siècle, celle de deux guerres qui ont vidé du monde, le sens de la vie.
C'est un monde morne, apathique, fatigué, froid, frappé d'hébétude, ou la faillite des idéologies règne en maître: Communisme, christianisme, républicanisme, anarchisme, aristocratie ou bourgeoisie libérale, tous ont failli et ont fait de l'Europe, un gigantesque circuit de trains à bestiaux, ou se sont entassé des millions d'hommes, qui par la suite, ont eu le privilège de voir un chaos sans aucun sens, et peut être eu l'honneur de faire la rencontre bien triste d'un magnifique morceau de métal si bien taillé.
C'est le récit d'une convergence, celle de sa propre histoire et de celle de son père. Tout cela le pousse à considérer sa vie comme la conclusion de celle de son père, le cycle d’anéantissement qui semble en effet vouloir se répéter. Un ouvrage clivant, plutôt ardu à lire, par moment ennuyant, une expérience étrange et très certainement assez unique...
Cette recherche menée en parallèle de celle du temps, d'un passé fragmentaire, empli de coïncidences bien grandes et d'un hasard puissant, mais qui, dans sa plénitude sensorielle semble revivre. Mais on ne peut non plus dire que cette œuvre est autobiographique pour autant, elle met plutôt tout en place pour montrer l’irréalité d’expériences extrêmes. L'individu est ici écrasé par l'histoire meurtrière du 20eme siècle, celle de deux guerres qui ont vidé du monde, le sens de la vie.
C'est un monde morne, apathique, fatigué, froid, frappé d'hébétude, ou la faillite des idéologies règne en maître: Communisme, christianisme, républicanisme, anarchisme, aristocratie ou bourgeoisie libérale, tous ont failli et ont fait de l'Europe, un gigantesque circuit de trains à bestiaux, ou se sont entassé des millions d'hommes, qui par la suite, ont eu le privilège de voir un chaos sans aucun sens, et peut être eu l'honneur de faire la rencontre bien triste d'un magnifique morceau de métal si bien taillé.
C'est le récit d'une convergence, celle de sa propre histoire et de celle de son père. Tout cela le pousse à considérer sa vie comme la conclusion de celle de son père, le cycle d’anéantissement qui semble en effet vouloir se répéter. Un ouvrage clivant, plutôt ardu à lire, par moment ennuyant, une expérience étrange et très certainement assez unique...
Une écriture précise, avec des mots choisis...Des détails qui créent une ambiance. Par contre, une histoire dont il est difficile de suivre le cours, car se passant à des époques différentes selon les chapitres, mais également avec des personnages différents.
Une petite remarque qu'en aux descriptions, souvent très longues, qui alourdissent le récit, si bien que l'on a l'impression que l'histoire racontée est immobile.
Sinon, un bon livre ( si cela a un sens ).
Une petite remarque qu'en aux descriptions, souvent très longues, qui alourdissent le récit, si bien que l'on a l'impression que l'histoire racontée est immobile.
Sinon, un bon livre ( si cela a un sens ).
Simon affine dans ce livre sa technique caléidoscopique, ses thèmes et ses ruptures, sa façon d’approcher le réel jusqu’à l’aveuglement, une écriture qui atteindra son sommet dans les Géorgiques. Dans l’Histoire (ici la guerre d’Espagne) ou l’anecdote (la mince, douloureuse et décevante histoire de ses parents, de l’oncle, d’un cousin et de quelques proches), il ressuscite un destin à partir de cartes postales en vrac dans un tiroir ou construit un personnage au travers d’un cliché, avec la précision captivante d’Antonioni dans Blow-up. Simon est un détecteur sensible, créateur de l’extrême attention, dont la richesse sensorielle rend la lecture fascinante : couleurs, sons, odeurs, mouvements, plaisir, douleur et peur :
« Comment ? Peur ? Si j’avais… Je ne sais pas. Peut-être est-ce comme cela que ça s’appelle : Une sensation de nausée
ou plutôt comme quand on a un étourdissement ou qu’on a trop bu c’est-à-dire quand le monde visible se sépare en quelque sorte de vous perdant ce visage familier et rassurant qu’il a (parce qu’en réalité on ne le regarde pas), prenant soudain un aspect inconnu vaguement effrayant, les objets cessant de s’identifier avec les symboles verbaux par quoi nous les possédons, les faisons nous, pensant Qu’est-ce que c’est ?, pensant Mais qu’est-ce qui m’arrive qu’est-ce qui se passe ? » (p 177).
Pas seulement la tension des sens, aussi des éclats de pensée aussi fortuits en apparence et pénétrants que les sensations :
« l’esprit (ou plutôt : encore l’œil, mais plus seulement l’œil, et pas encore l’esprit : cette partie de notre cerveau où passe l’espèce de couture, le hâtif et grossier faufilage qui relie l’innommable au nommé) non pas disant mais sentant » (p 274).
Pour lire Simon : prendre le rythme dans l’attention soutenue, la prosodie se découvre dans la continuité comme en poésie, comme la houle dans le désordre des vagues.
« Comment ? Peur ? Si j’avais… Je ne sais pas. Peut-être est-ce comme cela que ça s’appelle : Une sensation de nausée
ou plutôt comme quand on a un étourdissement ou qu’on a trop bu c’est-à-dire quand le monde visible se sépare en quelque sorte de vous perdant ce visage familier et rassurant qu’il a (parce qu’en réalité on ne le regarde pas), prenant soudain un aspect inconnu vaguement effrayant, les objets cessant de s’identifier avec les symboles verbaux par quoi nous les possédons, les faisons nous, pensant Qu’est-ce que c’est ?, pensant Mais qu’est-ce qui m’arrive qu’est-ce qui se passe ? » (p 177).
Pas seulement la tension des sens, aussi des éclats de pensée aussi fortuits en apparence et pénétrants que les sensations :
« l’esprit (ou plutôt : encore l’œil, mais plus seulement l’œil, et pas encore l’esprit : cette partie de notre cerveau où passe l’espèce de couture, le hâtif et grossier faufilage qui relie l’innommable au nommé) non pas disant mais sentant » (p 274).
Pour lire Simon : prendre le rythme dans l’attention soutenue, la prosodie se découvre dans la continuité comme en poésie, comme la houle dans le désordre des vagues.
Puisque ce texte est sans couture sa critique se doit de l'être aussi puisque rien n'a moins de sens que ce chaos puisque c'est ce chaos lui-même qui prend forme dans cette écriture décousue "et je me souviens..." les chiens ont mangé la boue quelle image insensée moi non plus je n'avais j'avais entendu l'expression c'est comme ce narrateur qui dit 'je' puis qui disparait et qui dit 'il' enfin puisqu'il est un autre, comme s'il sortait de ce corps, de ce texte en changeant de chapitre quel déséquilibre d'ailleurs il n'y a rien de clair tout est enfoui les images les mots les souvenirs on n'est obligé de creuser nous même dans cette terre souillée par le sang les cadavres les chiens les chevaux puis tout à coup l'image semble s'éclaircir se clarifier se dessiner presque et il nous parle d'une femme qu'il a aimé comme d'une carte postale et tout ça part en fumée ou bien piétiné par ces soldats par leurs bottes dans la boue c'est triste violent sombre sans espoir on se demande quand on pourra reprendre notre souffle et enfin il y a un point. Alors on pense que l'on va finir par comprendre qui il est ce qu'il fait là de qui il parle et pourquoi il est revient obstinément sur la description de chevaux, il y a ce capitaine aussi dont on croit qu'il est l'assassin lui même semble incapable de nous dire qui a tué qui si même quelqu'un est mort si ce n'était pas un cauchemar un mauvais rêve oui c'est un peu le sentiment qu'on a lorsqu'on referme le livre on ne sait plus très bien ce qui nous est arrivé étourdis perdus et pourtant envoûtés nos idées tourbillonnent se mélangent et l'on se dit que finalement ce qu'il faut retenir c'est que la guerre c'est une horreur qu'on ne peut raconter alors qu'on y mette les formes qu'on y mette des points, des virgules des paragraphes des personnages après tout c'est pareil ce qu'il reste ce n'est qu'un tableau criblé qu'un chemin troué boueux avec des chiens, ceux qui ont mangé la boue.
L'histoire se déroule dans une ferme du Midi de la France bien que le livre, dans son intégralité, lui, couvre en réalité plus d'un siècle d'histoire et plus d'un quart de la Planète.
La ferme qui nous intéresse est une vieille demeure qui a vu le suicide d''un ancêtre, le mariage d'une vieille fille qui a fini par épouser, plus par convenance que par un officier qu'elle verra partir pour la guerre de 14-18 avant de voir son propre fils partir pour celle de 39 mais de laquelle il reviendra après le désastre de 1940. Près de la vieille demeure est planté un acacia qui a vu se succéder les générations et continuera encore à en voir passer, a survécu aux deux guerre mondiales et à bien d'autres fléaux encore. Je dirais donc que le protagoniste de ce livre n'est pas le fils, revenu de la guerre, qui décide de se mettre à écrire pour coucher sur papier toutes les horreurs dont il a été le témoin, mais l'acacia lui-même. Le message de l'auteur est que malgré toutes les folies des hommes et leur auto-destruction, la nature, elle, et donc la vie, elles perdurent et finissent toujours par trouver un chemin.
J'ai plus apprécié cet ouvrage que le dernier de Claude Simon que j'avais lu en raison du message et des émotions que l'auteur veut nous transmettre. En revanche, j'ai encore eu autant de mal avec l'écriture qui est composée (pas intégralement heureusement) de phrases terriblement longues et que l'auteur n'allège même pas de temps à autre en incluant des dialogues dans son texte.
La ferme qui nous intéresse est une vieille demeure qui a vu le suicide d''un ancêtre, le mariage d'une vieille fille qui a fini par épouser, plus par convenance que par un officier qu'elle verra partir pour la guerre de 14-18 avant de voir son propre fils partir pour celle de 39 mais de laquelle il reviendra après le désastre de 1940. Près de la vieille demeure est planté un acacia qui a vu se succéder les générations et continuera encore à en voir passer, a survécu aux deux guerre mondiales et à bien d'autres fléaux encore. Je dirais donc que le protagoniste de ce livre n'est pas le fils, revenu de la guerre, qui décide de se mettre à écrire pour coucher sur papier toutes les horreurs dont il a été le témoin, mais l'acacia lui-même. Le message de l'auteur est que malgré toutes les folies des hommes et leur auto-destruction, la nature, elle, et donc la vie, elles perdurent et finissent toujours par trouver un chemin.
J'ai plus apprécié cet ouvrage que le dernier de Claude Simon que j'avais lu en raison du message et des émotions que l'auteur veut nous transmettre. En revanche, j'ai encore eu autant de mal avec l'écriture qui est composée (pas intégralement heureusement) de phrases terriblement longues et que l'auteur n'allège même pas de temps à autre en incluant des dialogues dans son texte.
On se demande bien qu’elles sont les quinze personnes qui ont reçu "L'invitation" et qui forment un groupe pour une visite apparemment diplomatique sans précision sur le lieu.
Ce livre est un exemple typique du Nouveau roman (le genre Littéraire) où il n'y a pas de héros traditionnel mais une image floue des personnages avec une narration assez froide.
Ce texte original est assez intrigant et mérite qu'on s'y attarde pour cette raison même s'il n'est pas facile à lire avec de longues phrases et beaucoup de parenthèses voire de double parenthèses. Mais comme te texte est court on s'y fait aisément.
Il faut donc aller à la pêche aux informations pour comprendre de quoi il retourne car même le résumé des Éditions de minuit donne peu de précisions.
On arrive toutefois à suivre Claude Simon quand on sait qu'il raconte son voyage en URSS en 1986 à l'époque de Gorbatchev qu'il nomme le secrétaire général. Avec quatorze autres invités de marque, ils forment un groupe hétéroclite de nationalités et professions diverses dont un dramaturge américain (second mari de la plus belle femme du monde), deux économistes, un diplomate méditerranéen... Il faut dire que Claude Simon a reçu le prix Nobel de littérature l'année Précédente ce qui justifie son invitation.
Il fait de cette expérience un récit fragmentaire de voyage en se moquant de l'encadrement du groupe saturés d’excursions officielles ou de soirées de prestige et qu’on abasourdit de mots peu signifiants. On a envie de plaindre les interprètes mais aussi de ces citoyens d'honneur qui ont parfois l'air de se demander ce qu’ils font là, dans un monastère ou devant un mausolée qui semble symboliser une période révolue.
Riquiqui 2022
Challenge XXème siècle 2022
Challenge Nobel illimité
Challenge ABC 2022-2023
Ce livre est un exemple typique du Nouveau roman (le genre Littéraire) où il n'y a pas de héros traditionnel mais une image floue des personnages avec une narration assez froide.
Ce texte original est assez intrigant et mérite qu'on s'y attarde pour cette raison même s'il n'est pas facile à lire avec de longues phrases et beaucoup de parenthèses voire de double parenthèses. Mais comme te texte est court on s'y fait aisément.
Il faut donc aller à la pêche aux informations pour comprendre de quoi il retourne car même le résumé des Éditions de minuit donne peu de précisions.
On arrive toutefois à suivre Claude Simon quand on sait qu'il raconte son voyage en URSS en 1986 à l'époque de Gorbatchev qu'il nomme le secrétaire général. Avec quatorze autres invités de marque, ils forment un groupe hétéroclite de nationalités et professions diverses dont un dramaturge américain (second mari de la plus belle femme du monde), deux économistes, un diplomate méditerranéen... Il faut dire que Claude Simon a reçu le prix Nobel de littérature l'année Précédente ce qui justifie son invitation.
Il fait de cette expérience un récit fragmentaire de voyage en se moquant de l'encadrement du groupe saturés d’excursions officielles ou de soirées de prestige et qu’on abasourdit de mots peu signifiants. On a envie de plaindre les interprètes mais aussi de ces citoyens d'honneur qui ont parfois l'air de se demander ce qu’ils font là, dans un monastère ou devant un mausolée qui semble symboliser une période révolue.
Riquiqui 2022
Challenge XXème siècle 2022
Challenge Nobel illimité
Challenge ABC 2022-2023
Comme tout roman de Claude Simon, "Histoire" donne lieu à une infinité de commentaires, de remarques et d'études approfondies, qu'un simple billet de lecteur ne saurait égaler. Tout au plus se bornera-t-on à comparer ce roman incomparable à ceux qui l'ont précédé, "La route des Flandres" et "Le palace". Ces trois romans procèdent chacun de l'histoire familiale du personnage principal, narrateur ou héros. Mais si "La route des Flandres" et "Le palace" s'ouvrent à la grande Histoire, à la défaite de 1940 et à la Guerre d'Espagne, "Histoire", paradoxalement, le fait beaucoup moins et replie le propos, l'enquête (je n'ose pas dire le récit) sur la maison de famille et les archives photographiques, les affaires et les propriétés, des parents du personnage. Ce repli sur les plus modestes documents et sur l'histoire parentale, éclaire tout le paradoxe du titre, "Histoire" : une Histoire où il y en a si peu, et une chronique familiale là où les histoires, les événements, et les choses "dont on fait toute une histoire", sont privés et particuliers, ne concernent en rien l'histoire globale du pays et de la collectivité. Pour écrire son livre, Claude Simon est parti de toutes les significations possibles du mot "histoire" afin de les exploiter à fond dans son ouvrage, qui est une enquête, au sens étymologique d'histoire. Pour se faire une idée de son travail, on pensera à l'étonnement et au scandale produits par "L'enterrement à Ornans" de Courbet : le peintre, représentant une cérémonie de village où chaque villageois pouvait se reconnaître, avait choisi le format du grand tableau d'Histoire héroïque, format réservé jusque-là aux batailles, aux couronnements et aux événements historiques comme on en trouve dans la Galerie des Batailles du château de Versailles.
*
Le style du romancier, toujours proche de l'expérience la plus concrète des sens, s'apparente par sa luxuriance au courant de conscience, où images et mots s'appellent et s'associent d'un paragraphe à l'autre. On est tenté de renoncer à suivre une histoire telle qu'il s'en trouve dans les romans traditionnels, où le récit suit une logique préétablie depuis Aristote sans "s'égarer" dans les sensations, les associations d'idées, les échos de mots et de thèmes. C'est ce qui a donné à Claude Simon cette réputation d'auteur difficile, ce qui le désolait, alors qu'il essaie de reproduire au plus près, le plus fidèlement possible, le fonctionnement de la conscience humaine sans les béquilles de la rhétorique reçue. Comme sa technique kaléidoscopique, au plus près de la sensation, nous empêche de "suivre l'histoire", on peut supposer qu'il y a quelque ironie dans le titre.
*
Le style du romancier, toujours proche de l'expérience la plus concrète des sens, s'apparente par sa luxuriance au courant de conscience, où images et mots s'appellent et s'associent d'un paragraphe à l'autre. On est tenté de renoncer à suivre une histoire telle qu'il s'en trouve dans les romans traditionnels, où le récit suit une logique préétablie depuis Aristote sans "s'égarer" dans les sensations, les associations d'idées, les échos de mots et de thèmes. C'est ce qui a donné à Claude Simon cette réputation d'auteur difficile, ce qui le désolait, alors qu'il essaie de reproduire au plus près, le plus fidèlement possible, le fonctionnement de la conscience humaine sans les béquilles de la rhétorique reçue. Comme sa technique kaléidoscopique, au plus près de la sensation, nous empêche de "suivre l'histoire", on peut supposer qu'il y a quelque ironie dans le titre.
En matière d'expérience de Claude Simon je ne suis qu'un jeune apprenti. Je n'avais lu jusque-là que La Route des Flandres et La Chevelure de Bérénice. Il y a quelques temps CarlmariaB m'avait mis au défi de lire Les Géorgiques. J'avais promis de le faire dès que j'aurais approvisionné la bonne caisse de côtes-du-rhône nécessaire à accompagner cette entreprise périlleuse. Finalement, le budget de l'administration (en dehors des grands corps) étant ce qu'il est, j'ai dû me lancer avec seule bouteille de saint-joseph. Mais une bonne.
C'est parti pour une nouvelle scéance d'hypnose avec Claude Simon.
Me voici donc plongé dans le flot énergétique de Claude Simon, dans son accélérateur de particules littéraires où le choc des images apparemment disparates fait émerger du vide une matière exotique. C'est à dire en particulier (dès lors que la mesure d'un système quantique provoque sa décohérence (Qui m'a traité de cuistre?)) dans une oeuvre dont chaque lecteur fera une expérience différente. Il n'est pas impossible que cela soit un signe de qualité. Évidemment c'est une lecture assez exigeante. Mais nous sommes en démocratie : chacun a droit d'accéder au loisir, au lieu de toujours rester assigné au divertissement. Bienvenue.
Pour un commentaire plus complet, je crois qu'Henri l'Oiseleur a déjà dans Babelio fort bien dit l'essentiel. Je me contenterai donc de notules plus ou moins légères en bas de page, sans chercher la synthèse exhaustive.
En première remarque, je voudrais prévenir que certes la première partie (uniquement la première partie) présente un décor kaléidoscopique qui peut effrayer, en tous cas perdre, mais c'est probablement le but. Les personnages, les temporalités, sont émulsionnés d'une main ferme, et les repères sont minces. Il faut peut-être lâcher en grande partie prise, garder la tête près de la surface pour respirer de temps à autre, mais se laisser emporter par la vague.
Personnellement, dans la position de celui qui a déjà lu La Route des Flandres (beaucoup d'allusions dans Les Géorgiques), l'Hommage à la Catalogne d'Orwell, et qui bénéficie de connaissances relativement bonnes sur les différentes périodes historiques évoquées, dans cette position donc j'ai plutôt été actif dans le jeu de piste, cherchant à bien relier tous les points. Mais était-ce bien la meilleure voie? N'aurais-je pas dû lâcher la rampe raisonneuse? En tout cas un lecteur pour qui les références sont plus floues ne sera pas forcément lésé. Il pourra peut-être expérimenter plus intensément la poésie sensuelle de l'oeuvre, cette joie de l'épaisseur du monde.
À ce titre, je crois que l'auteur donne des clefs essentielles à la page 39 (éd. Minuit poche double).La radio grésille, le soir, en forêt, à côté de la batterie artillerie, pendant débâcle 1940, où est-ce ailleurs ?
Après la première partie donc, le fleuve est plus calme. La lecture est plus aisée.
Toutes les vues sont pénétrantes, mais ce sont encore les passages sur la Drôle de Guerre qui m'ont semblé les plus originaux. Il me semble que ce n'est pour le moins pas un sujet rebattu et le souffle qu'y met Claude Simon en rend les couleurs dans leur plus beau terne.
J'ai plus de mal à comprendre les passages sur Orwell et la Catalogne (en volume assez mince). Je ne crois pas être une groupie hystérisée de cet intellectuel engagé et visionnaire, devenu post-mortem une tarte à la crème transpartisane, cependant je n'ai pas lu dans L'Hommage à la Catalogne ce qu'il me semble que Claude Simon y a vu. Ce n'est pas essentiellement de la part de Simon, une charge contre Orwell, mais je crois qu'on a à la fois l'impression d'une paraphrase du livre (comme s'il était recopié comme les lettres de l'ancêtre LSM de l'auteur) alors que le lecteur d'Orwell voit probablement que certains éléments manquent et que le tableau final est déséquilibré,vers une certaine futilité d'Orwell. Comme si Simon voulait démontrer quelque chose. C'est un choix. Il m'a laissé une impression mitigée. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Je n'ai pas ordinairement l'impression que Claude Simon enfermé son lecteur dans une conclusion trop nette. Quelque chose m'échappe vraiment.
Il me semble bien que dans la première moitié du livre Claude Simon emploie plusieurs fois l'adjectif "cosmique". Est-ce une allusion à Virgile ou un clin d'oeil vers la science-fiction ?
La capacité de Claude Simon à plier et replier le temps et l'espace n'est pas dans mon esprit sans évoquer le mode de transport des navigateurs de la guilde spatiale dans Dune de Frank Herbert. Cependant là où Herbert pose un joli gadget narratif, Simon fabrique la machine en vrai, plie et replie l'espace et le temps. Claude Simon inventé le voyage instantané.
Mais peut-être le roman de Simon est-il aussi un hommage au kouign-amann, plié, replié, tellement riche? Or un kouign-amann de un kilo contient toujours au moins deux kilos de beurre. C'est un mystère de la physique. Avec Claude Simon, on est aussi dans ce que la science ne sait pas expliquer, la littérature, la nourriture la plus riche.
Hypnose, vous dis-je.
À part ça, il va falloir penser à regarnir les haies et à semer de la luzerne dans le pré près de la rivière. Et comment se fait-il que les armoires ne sont pas pleines de linge? C'est agaçant.
C'est parti pour une nouvelle scéance d'hypnose avec Claude Simon.
Me voici donc plongé dans le flot énergétique de Claude Simon, dans son accélérateur de particules littéraires où le choc des images apparemment disparates fait émerger du vide une matière exotique. C'est à dire en particulier (dès lors que la mesure d'un système quantique provoque sa décohérence (Qui m'a traité de cuistre?)) dans une oeuvre dont chaque lecteur fera une expérience différente. Il n'est pas impossible que cela soit un signe de qualité. Évidemment c'est une lecture assez exigeante. Mais nous sommes en démocratie : chacun a droit d'accéder au loisir, au lieu de toujours rester assigné au divertissement. Bienvenue.
Pour un commentaire plus complet, je crois qu'Henri l'Oiseleur a déjà dans Babelio fort bien dit l'essentiel. Je me contenterai donc de notules plus ou moins légères en bas de page, sans chercher la synthèse exhaustive.
En première remarque, je voudrais prévenir que certes la première partie (uniquement la première partie) présente un décor kaléidoscopique qui peut effrayer, en tous cas perdre, mais c'est probablement le but. Les personnages, les temporalités, sont émulsionnés d'une main ferme, et les repères sont minces. Il faut peut-être lâcher en grande partie prise, garder la tête près de la surface pour respirer de temps à autre, mais se laisser emporter par la vague.
Personnellement, dans la position de celui qui a déjà lu La Route des Flandres (beaucoup d'allusions dans Les Géorgiques), l'Hommage à la Catalogne d'Orwell, et qui bénéficie de connaissances relativement bonnes sur les différentes périodes historiques évoquées, dans cette position donc j'ai plutôt été actif dans le jeu de piste, cherchant à bien relier tous les points. Mais était-ce bien la meilleure voie? N'aurais-je pas dû lâcher la rampe raisonneuse? En tout cas un lecteur pour qui les références sont plus floues ne sera pas forcément lésé. Il pourra peut-être expérimenter plus intensément la poésie sensuelle de l'oeuvre, cette joie de l'épaisseur du monde.
À ce titre, je crois que l'auteur donne des clefs essentielles à la page 39 (éd. Minuit poche double).La radio grésille, le soir, en forêt, à côté de la batterie artillerie, pendant débâcle 1940, où est-ce ailleurs ?
Après la première partie donc, le fleuve est plus calme. La lecture est plus aisée.
Toutes les vues sont pénétrantes, mais ce sont encore les passages sur la Drôle de Guerre qui m'ont semblé les plus originaux. Il me semble que ce n'est pour le moins pas un sujet rebattu et le souffle qu'y met Claude Simon en rend les couleurs dans leur plus beau terne.
J'ai plus de mal à comprendre les passages sur Orwell et la Catalogne (en volume assez mince). Je ne crois pas être une groupie hystérisée de cet intellectuel engagé et visionnaire, devenu post-mortem une tarte à la crème transpartisane, cependant je n'ai pas lu dans L'Hommage à la Catalogne ce qu'il me semble que Claude Simon y a vu. Ce n'est pas essentiellement de la part de Simon, une charge contre Orwell, mais je crois qu'on a à la fois l'impression d'une paraphrase du livre (comme s'il était recopié comme les lettres de l'ancêtre LSM de l'auteur) alors que le lecteur d'Orwell voit probablement que certains éléments manquent et que le tableau final est déséquilibré,vers une certaine futilité d'Orwell. Comme si Simon voulait démontrer quelque chose. C'est un choix. Il m'a laissé une impression mitigée. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Je n'ai pas ordinairement l'impression que Claude Simon enfermé son lecteur dans une conclusion trop nette. Quelque chose m'échappe vraiment.
Il me semble bien que dans la première moitié du livre Claude Simon emploie plusieurs fois l'adjectif "cosmique". Est-ce une allusion à Virgile ou un clin d'oeil vers la science-fiction ?
La capacité de Claude Simon à plier et replier le temps et l'espace n'est pas dans mon esprit sans évoquer le mode de transport des navigateurs de la guilde spatiale dans Dune de Frank Herbert. Cependant là où Herbert pose un joli gadget narratif, Simon fabrique la machine en vrai, plie et replie l'espace et le temps. Claude Simon inventé le voyage instantané.
Mais peut-être le roman de Simon est-il aussi un hommage au kouign-amann, plié, replié, tellement riche? Or un kouign-amann de un kilo contient toujours au moins deux kilos de beurre. C'est un mystère de la physique. Avec Claude Simon, on est aussi dans ce que la science ne sait pas expliquer, la littérature, la nourriture la plus riche.
Hypnose, vous dis-je.
À part ça, il va falloir penser à regarnir les haies et à semer de la luzerne dans le pré près de la rivière. Et comment se fait-il que les armoires ne sont pas pleines de linge? C'est agaçant.
Mon premier livre de Claude Simon et je dois dire que j'ai aimée cette manière si particulière de décrire des moments de vie, où tout est là... tout se rejoint...
Une manière de décrire assez extraordinaire....poétique, précise, envoutante...
Je me réjouis de découvrir d'autres oeuvres de ce magnifique écrivain...
Une manière de décrire assez extraordinaire....poétique, précise, envoutante...
Je me réjouis de découvrir d'autres oeuvres de ce magnifique écrivain...
On a besoin de lire doucement la prose poétique de Claude Simon pour s'imprégner de son rythme car il n'y a quasiment pas de ponctuation. Pourtant, quand on arrive à respirer aux bons moments (ce n'est pas toujours facile) on saisit son ressenti face à la géographie et à l'histoire des lieux.
Dans "Archipel et Nord" le lieu évoqué est la Finlande à travers deux textes courts publiés à l'origine en 1974 dans des revues du pays.
On est loin des guides touristiques qui vantent la Scandinavie que l'auteur français lauréat du prix Nobel de littérature 1985, connaît bien.
L'intérêt est poétique, juste pour le plaisir de la langue car les descriptions sont plutôt froides.
Dans "Archipel", il décrit les îles, golfes, baies, criques vues de l'hydravion qui se rapproche des terres. Il y voit la mer où il imagine les voiliers des anciens conquérants barbares mais aussi un sanctuaire franciscain puis les rochers, les champs moissonnés jusqu'aux fleurs sauvages.
Dans "Nord", le texte est moins elliptique et si la mer est omniprésente, il fait vraiment froid sur cette terre où la forêt domine. Les arbres dévastés par les tempêtes ne donnent pas une bonne image du pays où le soleil ne se couche pas. Pourtant, il existe toujours un vieil ermite, des rennes et des lièvres. Heureusement cela se termine par un chant à la guitare malgré le vent et le froid.
Challenge Riquiqui 2023
Challenge XXème siècle 2023
Challenge ABC 2023-2024
Challenge Nobel illimité
Dans "Archipel et Nord" le lieu évoqué est la Finlande à travers deux textes courts publiés à l'origine en 1974 dans des revues du pays.
On est loin des guides touristiques qui vantent la Scandinavie que l'auteur français lauréat du prix Nobel de littérature 1985, connaît bien.
L'intérêt est poétique, juste pour le plaisir de la langue car les descriptions sont plutôt froides.
Dans "Archipel", il décrit les îles, golfes, baies, criques vues de l'hydravion qui se rapproche des terres. Il y voit la mer où il imagine les voiliers des anciens conquérants barbares mais aussi un sanctuaire franciscain puis les rochers, les champs moissonnés jusqu'aux fleurs sauvages.
Dans "Nord", le texte est moins elliptique et si la mer est omniprésente, il fait vraiment froid sur cette terre où la forêt domine. Les arbres dévastés par les tempêtes ne donnent pas une bonne image du pays où le soleil ne se couche pas. Pourtant, il existe toujours un vieil ermite, des rennes et des lièvres. Heureusement cela se termine par un chant à la guitare malgré le vent et le froid.
Challenge Riquiqui 2023
Challenge XXème siècle 2023
Challenge ABC 2023-2024
Challenge Nobel illimité
Sans doute parce qu'il est le premier (parmi les contemporains) à travailler ainsi la mémoire, à la raccommoder ainsi pour en faire une trame littéraire. Aussi parce que c'est l'anti Voyage au bout de la nuit. Là où Céline nous laisse enlisés dans les tranchées de 14/18, C.Simon nous élève en cherchant à s'en libérer. A ceux qui parle de la phrase de Céline, je dis que la phrase n'est rien quand elle ne mène nulle part.
Comme toujours chez C. Simon, ce n'est pas l'histoire qui compte mais le chemin des personnages rendus à leur densité grâce à l'écriture, le quotidien, les souvenirs ou le mouvement de la pensée suivent le passage du tramway. Il s'agit bien d'une succession de micro-évènements ou de micro-rêveries suscités par le passage du tramway. La précision délicate de l'écriture étire langoureusement chaque description ou chaque pensée jusqu'à en faire un tableau parfois abstrait ou surréaliste. La somme des tableaux peint par C. Simon donne une vague impression des personnages et de ce qu'ils sont. Le lecteur a aussi l'impression de passer dans leur vie comme le fait le tramway au milieu de cette cité balnéaire.
"Le Palace" de Claude Simon est un roman publié en 1962 qui s'appuie sur les souvenirs que l'auteur a gardés de sa Guerre d'Espagne. En 1936, il fit un bref passage de quelques semaines par Barcelone. On sait qu'au-delà des faits et des événements, la Guerre d'Espagne est le réservoir inépuisable des mythes de la gauche révolutionnaire bien-pensante au pouvoir : même les Antifas et autres "No pasaran" d'aujourd'hui, qui n'ont pas l'air de grands lecteurs, empruntent leur imagerie à cet épisode historique si mal étudié et si bien célébré. Comment le roman tel que l'auteur l'élabore traite-t-il pareil sujet ?
*
Dès le début, nous sommes prévenus, par la citation du dictionnaire Larousse : "Révolution : Mouvement d'un mobile qui, parcourant une courbe fermée, repasse successivement par les mêmes points." Aragon, ouvrant son exemplaire sur cette définition, s'étrangla d'indignation, comme on pense. Un parti-pris d'objectivité, le parti-pris des choses si l'on préfère, à l'oeuvre dans ce roman, produit un effet de profonde ironie politique, car les proclamations vertueuses auxquelles on s'attend sont dégonflées comme des baudruches, le lecteur de bonne foi ne retrouve ni ses gentils, ni ses méchants, et le texte va le plonger au contraire dans une réalité concrète puissante, minutieusement, fidèlement décrite. L'évocation (par exemple) d'une boîte de cigares vide, de journaux froissés, de funérailles publiques, fait apparaître les choses mêmes dans toute leur matérialité et frappe d'inanité tous les sermons. D'autres romans de l'auteur ridiculisent de même les grands discours patriotiques, il n'y aurait pas eu de raison que les grands discours internationalistes soient épargnés.
*
Des esprits simples seraient tentés de conclure que "Le Palace" est un roman anti-révolutionnaire. Ce serait une erreur de l'enrôler dans une concurrence d'idéologies et dans une guerre de mots, où "chaque adversaire fait la loi de l'autre". C'est à ses propres conditions que le romancier aborde son objet, Barcelone en 1936 : il élimine tous les noms propres (même celui de la ville, ce qui a fait croire aux lecteurs américains de la traduction anglaise que le roman se passait en Amérique du Sud) et articule son propos sur un thème essentiel, qui est l'impossibilité d'établir la vérité dans une jungle de discours, de signes, d'hésitations et de détails qui perdent le lecteur mais aussi son héros, l'Etudiant (qualifié de "petit étourneau"), sorte de Fabrice del Dongo projeté non pas à Waterloo comme dans la Chartreuse de Parme, mais dans une guerre civile de tous contre tous (les deux camps s'entretuent sur le front (paraît-il), mais éliminent aussi, et surtout, amis et alliés) à laquelle il ne comprend rien. Une figure révolutionnaire a été assassinée : personne ne sait par qui, la presse se pose unanimement la question du coupable et les questions restent sans réponse. Il n'est pas de plus impitoyable critique que celle-là : littéralement, un romancier ne peut rien dire de la Guerre d'Espagne, sauf à falsifier et à trahir son art en faisant de la "littérature engagée".
*
"Le Palace" est donc le contraire de "L'Espoir" de Malraux : pas de narrateur omniscient, pas de personnages nommés, repérables, dont l'action évolue dans le temps, pas d'exemplarité des actes ni de morale à transmettre, pas d'appel à l'engagement du lecteur ni aucune certitude. L'école des néo-romanciers fait observer par ailleurs que tous ces éléments qu'elle rejette, sont conventionnels, et elle se propose de créer d'autres conventions. Seulement, les lecteurs de L'Espoir ou des romans de gare ont l'habitude de ces conventions traditionnelles du roman, qu'ils prennent pour sa nature et pour le déroulement propre de la narration. On a beaucoup reproché aux néo-romanciers comme Claude Simon leur abus des descriptions, leur "parti-pris des choses" : dans "Le Palace", on voit à l'oeuvre le dynamitage de la mythologie rouge par la description, qui revêt une fonction critique inattendue.
*
Dès le début, nous sommes prévenus, par la citation du dictionnaire Larousse : "Révolution : Mouvement d'un mobile qui, parcourant une courbe fermée, repasse successivement par les mêmes points." Aragon, ouvrant son exemplaire sur cette définition, s'étrangla d'indignation, comme on pense. Un parti-pris d'objectivité, le parti-pris des choses si l'on préfère, à l'oeuvre dans ce roman, produit un effet de profonde ironie politique, car les proclamations vertueuses auxquelles on s'attend sont dégonflées comme des baudruches, le lecteur de bonne foi ne retrouve ni ses gentils, ni ses méchants, et le texte va le plonger au contraire dans une réalité concrète puissante, minutieusement, fidèlement décrite. L'évocation (par exemple) d'une boîte de cigares vide, de journaux froissés, de funérailles publiques, fait apparaître les choses mêmes dans toute leur matérialité et frappe d'inanité tous les sermons. D'autres romans de l'auteur ridiculisent de même les grands discours patriotiques, il n'y aurait pas eu de raison que les grands discours internationalistes soient épargnés.
*
Des esprits simples seraient tentés de conclure que "Le Palace" est un roman anti-révolutionnaire. Ce serait une erreur de l'enrôler dans une concurrence d'idéologies et dans une guerre de mots, où "chaque adversaire fait la loi de l'autre". C'est à ses propres conditions que le romancier aborde son objet, Barcelone en 1936 : il élimine tous les noms propres (même celui de la ville, ce qui a fait croire aux lecteurs américains de la traduction anglaise que le roman se passait en Amérique du Sud) et articule son propos sur un thème essentiel, qui est l'impossibilité d'établir la vérité dans une jungle de discours, de signes, d'hésitations et de détails qui perdent le lecteur mais aussi son héros, l'Etudiant (qualifié de "petit étourneau"), sorte de Fabrice del Dongo projeté non pas à Waterloo comme dans la Chartreuse de Parme, mais dans une guerre civile de tous contre tous (les deux camps s'entretuent sur le front (paraît-il), mais éliminent aussi, et surtout, amis et alliés) à laquelle il ne comprend rien. Une figure révolutionnaire a été assassinée : personne ne sait par qui, la presse se pose unanimement la question du coupable et les questions restent sans réponse. Il n'est pas de plus impitoyable critique que celle-là : littéralement, un romancier ne peut rien dire de la Guerre d'Espagne, sauf à falsifier et à trahir son art en faisant de la "littérature engagée".
*
"Le Palace" est donc le contraire de "L'Espoir" de Malraux : pas de narrateur omniscient, pas de personnages nommés, repérables, dont l'action évolue dans le temps, pas d'exemplarité des actes ni de morale à transmettre, pas d'appel à l'engagement du lecteur ni aucune certitude. L'école des néo-romanciers fait observer par ailleurs que tous ces éléments qu'elle rejette, sont conventionnels, et elle se propose de créer d'autres conventions. Seulement, les lecteurs de L'Espoir ou des romans de gare ont l'habitude de ces conventions traditionnelles du roman, qu'ils prennent pour sa nature et pour le déroulement propre de la narration. On a beaucoup reproché aux néo-romanciers comme Claude Simon leur abus des descriptions, leur "parti-pris des choses" : dans "Le Palace", on voit à l'oeuvre le dynamitage de la mythologie rouge par la description, qui revêt une fonction critique inattendue.
Bien que s'étant toujours défendu d'appartenir à un courant littéraire, on ne peut cependant pas s'empêcher de penser que Claude Simon est en lien direct avec le Nouveau Roman. Imbrication d'histoires, "style coriace", on a quand même du mal à rentrer dans l'oeuvre.
Une très belle écriture, dont la trame, initialement un peu déroutante, fini par fasciner et interroger. A partir d'une même pièce, dans une maison, se développent quatre histoires parallèles, formant quatre plans différents dans le temps comme dans l'espace. Et l'on glisse de l'un à l'autre par des sutures parfois imperceptibles. La juxtaposition d'images qui, par petites touches, se répondent en écho, fait naitre des émotions d'une grande sensualité, d'un bel érotisme par moments, tout autant que d'une violence contenue, voire parfois d'une douce mélancolie. Une lente tension nait au fil des pages, nous poussant à vouloir savoir où cet exercice littéraire pourra bien nous mener. Et c'est sur un court-circuit final fidèle à tout ce que fut l'ouvrage qu'on referme le livre.
Dans l'apocalypse de la bataille de France, quatre cavaliers rescapés d'un escadron sont les personnages principaux de ce roman. D'abord Georges avec son copain Blum, et puis le capitaine de Reixach (à prononcer « Reichac »), accompagné de son ordonnance Iglésia, qui est également son employé dans le civil. de Reixach, est issu d'une vieille famille de la noblesse (il est aussi un vague cousin de Georges), son attitude est la caricature parfaite de l'aristocrate, droit, élégant, digne, impénétrable et imperturbable, mais « il n'y avait en lui rien de hautain, de méprisant : simplement distant, ou plutôt absent ». Cette dignité, ce calme qui frise la témérité, fait qu'il s'expose et se fait tuer bêtement sous les yeux de Georges lors de la débâcle. Georges soupçonne que cette indifférence face au danger cachait en réalité une indifférence à la vie et va en chercher la cause dans une romanesque histoire d'amour. Il essaye de la reconstituer avec l'aide de Blum et à partir des témoignages d'Iglésia, alors qu'ils sont prisonniers de guerre dans un camp.
Mais ce qui frappe au premier abord, ce n'est pas l'intrigue, pourtant passionnante, c'est le style et la construction chaotiques. Avant La route des Flandres je n'avais lu de Claude Simon que La Bataille de Pharsale, et je ne connais rien d'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a une très forte corrélation entre ces deux romans. Pas seulement dans le thème central de la défaite française, ce même espace atemporel, ces images précises, qu'elles soient fixes ou en mouvement, ce même amour des chevaux (et cette incongruité de voir un escadron de cavalerie confronté à des Panzers ou un cavalier dégainer son sabre devant une mitraillette, ces sortes de failles temporelles), il y a aussi dans le style et dans la construction une grande similitude.
Les deux romans sont divisés en trois parties aux styles sensiblement différents. Ils sont très chaotiques dans la première partie, une succession d'images qui s'enchaînent rapidement, puis le rythme va en s'apaisant dans les deux autres parties, les narrations sont plus longues et ordonnées. Et je note au passage que la troisième partie de la route des Flandres contient un magnifique morceau de littérature, dans lequel l'auteur a mélangé une scène de sexe avec des épisodes de la vie de prisonniers de Georges, en multipliant les analogies et les associations d'idées, vraiment très réussi. Dans tout le roman les analogies sont omniprésentes et les comparaisons récurrentes (« comme » est sans doute le mot le plus utilisé). Elles permettent à Claude Simon de sauter d'image en image, de donner l'impression d'une mémoire préoccupée et lancée à fond de train, où les souvenirs s'enchainent comme dans la réalité et non pas comme dans un roman, c'est-à-dire sans ordre chronologique mais plutôt analogique. Claude Simon a montré quelque chose que je crois inédit dans la littérature (en tout cas jamais porté à ce point), sur le fonctionnement de l'esprit (qu'il rêve, se remémore ou pense).
Ceci dit, à la différence de la bataille de Pharsale, l'intrigue romanesque de la Route des Flandres est captivante, même si Claude Simon la traite avec une distance presque ironique, comme si cette préoccupation du comportement suicidaire de de Reixach, toute cette histoire d'amour, n'était qu'un moyen pour Georges et Blum de s'occuper l'esprit, de rêver et de ne pas songer directement à leur triste sort de prisonniers.
Mais ce qui frappe au premier abord, ce n'est pas l'intrigue, pourtant passionnante, c'est le style et la construction chaotiques. Avant La route des Flandres je n'avais lu de Claude Simon que La Bataille de Pharsale, et je ne connais rien d'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a une très forte corrélation entre ces deux romans. Pas seulement dans le thème central de la défaite française, ce même espace atemporel, ces images précises, qu'elles soient fixes ou en mouvement, ce même amour des chevaux (et cette incongruité de voir un escadron de cavalerie confronté à des Panzers ou un cavalier dégainer son sabre devant une mitraillette, ces sortes de failles temporelles), il y a aussi dans le style et dans la construction une grande similitude.
Les deux romans sont divisés en trois parties aux styles sensiblement différents. Ils sont très chaotiques dans la première partie, une succession d'images qui s'enchaînent rapidement, puis le rythme va en s'apaisant dans les deux autres parties, les narrations sont plus longues et ordonnées. Et je note au passage que la troisième partie de la route des Flandres contient un magnifique morceau de littérature, dans lequel l'auteur a mélangé une scène de sexe avec des épisodes de la vie de prisonniers de Georges, en multipliant les analogies et les associations d'idées, vraiment très réussi. Dans tout le roman les analogies sont omniprésentes et les comparaisons récurrentes (« comme » est sans doute le mot le plus utilisé). Elles permettent à Claude Simon de sauter d'image en image, de donner l'impression d'une mémoire préoccupée et lancée à fond de train, où les souvenirs s'enchainent comme dans la réalité et non pas comme dans un roman, c'est-à-dire sans ordre chronologique mais plutôt analogique. Claude Simon a montré quelque chose que je crois inédit dans la littérature (en tout cas jamais porté à ce point), sur le fonctionnement de l'esprit (qu'il rêve, se remémore ou pense).
Ceci dit, à la différence de la bataille de Pharsale, l'intrigue romanesque de la Route des Flandres est captivante, même si Claude Simon la traite avec une distance presque ironique, comme si cette préoccupation du comportement suicidaire de de Reixach, toute cette histoire d'amour, n'était qu'un moyen pour Georges et Blum de s'occuper l'esprit, de rêver et de ne pas songer directement à leur triste sort de prisonniers.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Prix Nobel de Littérature
NiGrivo
120 livres

Les 100 romans du Monde
Cronos
100 livres
Auteurs proches de Claude Simon
Quiz
Voir plus
Claude Simon
Quel prix littéraire Claude Simon a-t-il reçu en 1985 ?
Prix Nobel de littérature
Prix Goncourt
Prix Femina
Prix Victor-Rossel
10 questions
19 lecteurs ont répondu
Thème :
Claude SimonCréer un quiz sur cet auteur19 lecteurs ont répondu