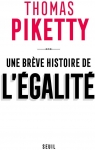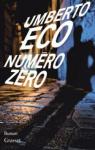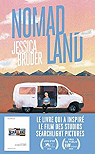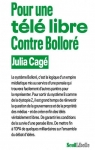Intervenants: Julia CAGÉ, professeure d'économie à Sciences Po Paris et Thomas PIKETTY, directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'école d'économie de Paris
Modération: Philippe ESCANDE, journaliste au Monde
Qui vote pour qui et pourquoi ? Comment la structure sociale des électorats des différents courants politiques en France a-t-elle évolué de 1789 à 2022 ? Dans quelle mesure les coalitions au pouvoir et dans l'opposition ont-elles su rassembler les classes populaires, moyennes ou aisées et fédérer des intérêts divergents, et comment cela a-t-il participé au processus de développement social, économique et politique du pays ? En s'appuyant sur un travail inédit de numérisation des données électorales et socio-économiques couvrant plus de deux siècles, cet ouvrage propose une histoire des comportements électoraux et des inégalités socio-spatiales en France de 1789 à 2022.

Julia CagéBenoît Huet/5
7 notes
Résumé :
Le paysage médiatique n’a jamais été aussi bousculé : du Nouveau magazine littéraire à Sciences et Avenir, de Grazia à Science et Vie, de Libération aux Cahiers du cinéma en passant Konbini, L’Équipe, Le Parisien ou encore BFM TV, au cours des derniers mois, pas une semaine ne s’est écoulée sans qu’une annonce de fermeture, de plan social, de réduction d’effectifs ou de changement de main ne vienne bouleverser les médias, en France comme à l’étranger.
Dans le... >Voir plus
Dans le... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'information est un bien publicVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Ce livre a été un véritable coup de massue pour moi tant il a détruit la confiance que j'accordais à la presse écrite. le propos n'est cependant pas de saper la confiance des citoyens en leurs médias mais bien d'améliorer l'indépendance des journalistes en dressant un état des lieux des liens hiérarchiques et capitalistiques qui limitent leur liberté d'expression à aujourd'hui puis en proposant des pistes d'amélioration. (en clair, voir combien ils sont prisonniers des systèmes actuels et faire des propositions concrètes pour les en libérer et obtenir ainsi des informations plus libres servant le jeu démocratique).
L'indépendance est un idéal qui, pour l'heure, se heurte à des lacunes juridiques abyssales qui laissent le champ libre aux puissances d'argent et à l'État pour infléchir le propos de tous les journaux. Certains achètent des journaux et mettent leurs nez dans les articles éditoriaux pour qu'ils se plient à leurs visions du monde, d'autres menacent de ne plus acheter de pages de publicités dans les journaux pour affaiblir la structure financière du média si son propos leur déplaît, d'autres encore à la tête d'un État peuvent réduire les aides financières accordées à des entreprises d'information qui peinent d'ores et déjà à joindre les deux bouts si leurs propos s'avéraient trop critiques envers un gouvernement en place ou telle ou telle personnalité politique.
Cette situation est à proprement parler intolérable mais perdure et les deux auteurs nous en donnent des exemples historiques documentés, à la fois flagrants et écoeurants.
A travers cet ouvrage relativement court mais plutôt dense et technique, Julia Cagé et Benoît Huet mettent en lumière les réalités juridiques derrière un idéal commun : avoir des médias indépendants de tous bords politiques, capables d'informer la population d'un pays démocratique comme la France.
Le concept est on ne peut plus clair: en démocratie, une personne = un vote (comme expliqué dans le prix de la démocratie (2018) de Julia Cagé).
Mais pour voter, chaque personne a besoin de savoir pour qui elle vote et dans quel contexte son pays et sa société se situent. Or, à l'heure actuelle, cette vision d'ensemble et cette analyse critique du moment et des candidats peuvent être déformées à l'envi par les personnes qui possèdent les médias. Qu'il s'agisse de l'Etat français ou des grandes fortunes (Niel, Pigasse et Krétinsky pour le Monde, Dassault pour Le Figaro, Drahi pour Libération, Pinault pour le Point, Rothschild pour Slate, Arnault pour les Echos, etc.) sont en mesure de tordre le miroir social tendu par les journalistes à la population, le vote est biaisé à l'insu de la population et la démocratie est mise à mal.
Les seules limites que l'on entrevoit à cet ouvrage sont liées à son cadre de pensée. En effet, celui-ci est centré sur la France. Or, en terminant l'ouvrage, chacun aimerait pouvoir avoir une vision de la situation en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Russie, en Arabie Saoudite, en Chine, en Turquie, au Maghreb, etc. On se prend alors à rêver d'un laboratoire de recherche international réunissant les confrères des auteurs dans ces pays et permettant d'obtenir une vision mondiale. (influence de Rupert Murdoch au Royaume-Uni via ses tabloïds, de Jeff Bezos sur le Washington Post et de la cotation du New York Times aux Etats-Unis, etc.)
Aussi, ce livre se limite à la seule presse écrite. Et chacun sait combien les autres médias sont influents, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, des médias sur Internet ou encore des maisons d'éditions qui choisissent que tel ou tel livre puisse paraître. Bref, ce fût pour moi la lecture d'un excellent livre, même si j'aimerais pouvoir en lire les prochains tomes tant cela a pu soulever de questions.
Enfin, n'étant pas un professionnel des médias mais un simple citoyen, je partage également ici la critique publiée par Acrimed: https://www.acrimed.org/Lu-L-Information-est-un-bien-public-de-Julia-Cage
L'indépendance est un idéal qui, pour l'heure, se heurte à des lacunes juridiques abyssales qui laissent le champ libre aux puissances d'argent et à l'État pour infléchir le propos de tous les journaux. Certains achètent des journaux et mettent leurs nez dans les articles éditoriaux pour qu'ils se plient à leurs visions du monde, d'autres menacent de ne plus acheter de pages de publicités dans les journaux pour affaiblir la structure financière du média si son propos leur déplaît, d'autres encore à la tête d'un État peuvent réduire les aides financières accordées à des entreprises d'information qui peinent d'ores et déjà à joindre les deux bouts si leurs propos s'avéraient trop critiques envers un gouvernement en place ou telle ou telle personnalité politique.
Cette situation est à proprement parler intolérable mais perdure et les deux auteurs nous en donnent des exemples historiques documentés, à la fois flagrants et écoeurants.
A travers cet ouvrage relativement court mais plutôt dense et technique, Julia Cagé et Benoît Huet mettent en lumière les réalités juridiques derrière un idéal commun : avoir des médias indépendants de tous bords politiques, capables d'informer la population d'un pays démocratique comme la France.
Le concept est on ne peut plus clair: en démocratie, une personne = un vote (comme expliqué dans le prix de la démocratie (2018) de Julia Cagé).
Mais pour voter, chaque personne a besoin de savoir pour qui elle vote et dans quel contexte son pays et sa société se situent. Or, à l'heure actuelle, cette vision d'ensemble et cette analyse critique du moment et des candidats peuvent être déformées à l'envi par les personnes qui possèdent les médias. Qu'il s'agisse de l'Etat français ou des grandes fortunes (Niel, Pigasse et Krétinsky pour le Monde, Dassault pour Le Figaro, Drahi pour Libération, Pinault pour le Point, Rothschild pour Slate, Arnault pour les Echos, etc.) sont en mesure de tordre le miroir social tendu par les journalistes à la population, le vote est biaisé à l'insu de la population et la démocratie est mise à mal.
Les seules limites que l'on entrevoit à cet ouvrage sont liées à son cadre de pensée. En effet, celui-ci est centré sur la France. Or, en terminant l'ouvrage, chacun aimerait pouvoir avoir une vision de la situation en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Russie, en Arabie Saoudite, en Chine, en Turquie, au Maghreb, etc. On se prend alors à rêver d'un laboratoire de recherche international réunissant les confrères des auteurs dans ces pays et permettant d'obtenir une vision mondiale. (influence de Rupert Murdoch au Royaume-Uni via ses tabloïds, de Jeff Bezos sur le Washington Post et de la cotation du New York Times aux Etats-Unis, etc.)
Aussi, ce livre se limite à la seule presse écrite. Et chacun sait combien les autres médias sont influents, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, des médias sur Internet ou encore des maisons d'éditions qui choisissent que tel ou tel livre puisse paraître. Bref, ce fût pour moi la lecture d'un excellent livre, même si j'aimerais pouvoir en lire les prochains tomes tant cela a pu soulever de questions.
Enfin, n'étant pas un professionnel des médias mais un simple citoyen, je partage également ici la critique publiée par Acrimed: https://www.acrimed.org/Lu-L-Information-est-un-bien-public-de-Julia-Cage
critiques presse (2)
Son opus, L’information est un bien public, qu’elle cosigne avec l’avocat Benoît Huet, est destiné à armer citoyens, journalistes, étudiants, politiques… dans le combat en faveur de l’indépendance de l’information et le pluralisme des médias. Avec des propositions concrètes à la clé.
Lire la critique sur le site : Telerama
Une économiste et un juriste posent un diagnostic sombre et dessinent les principes qui permettraient de mieux protéger ce bien public.
Lire la critique sur le site : LaViedesIdees
Citations et extraits (12)
Voir plus
Ajouter une citation
S’interroger sur les règles concrètes de prise de décision à l’intérieur des journaux, c’est s’interroger sur la façon dont est produite l’information que nous consommons, cette information si indispensable au bon fonctionnement de la démocratie.
Une rédaction n'est pas, en effet, un groupe de salariés comme les autres. Elle contribue par son travail à la diffusion des informations et des idées, notamment sur des questions d'intérêt général, et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la démocratie. Le journaliste est en effet tenu à un double impératif, l'impératif de mener à bien sa mission d'information en faisant connaître au public les faits et les opinions, conformément à sa déontologie professionnelle, et l'impératif de rendre des comptes à son employeur, qui résulte de la simple application de son contrat de travail.
L'actionnaire peut ainsi avoir un intérêt direct à ce que le travail du journaliste ne vienne pas froisser les intérêts des annonceurs, les intérêts de l'administration qui décide de l'octroi des aides à la presse, les intérêts des bailleurs de fonds privés (comme récemment les sociétés Google et Facebook, nous y reviendrons), et bien entendu ses propres intérêts si cet actionnaire mène des activités économiques ou politiques.
Le risque pour le journaliste est alors non seulement de déplaire à l'actionnaire du média qui l'emploie, mais également au principal client de sa régie. Le journal Libération a vu ainsi par exemple ses revenus publicitaires chuter en 2012 après la publication par la rédaction d'un article peu flatteur sur le dirigeant du groupe de luxe LVMH (perte estimée à 700.000 euros).
Dans une société commerciale, les actionnaires sont par défaut dotés de prérogatives étendues, y compris celle de nommer et de révoquer les dirigeants qui exercent eux-mêmes un pouvoir hiérarchique sur des journalistes , tenus par un lien de subordination au titre de leur contrat de travail.
Videos de Julia Cagé (24)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : journalismeVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Julia Cagé (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Histoire et généralités sur la Normandie
TOUS CONNAISSENT LA TAPISSERIE DE BAYEUX, QUI EN EST LE HÉROS ?
RICHARD COEUR DE LION
ROLLON
MATHILDE
GUILLAUME LE CONQUERANT
GUILLAUME LE ROUX
20 questions
70 lecteurs ont répondu
Thèmes :
histoire
, célébrité
, économieCréer un quiz sur ce livre70 lecteurs ont répondu