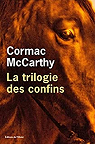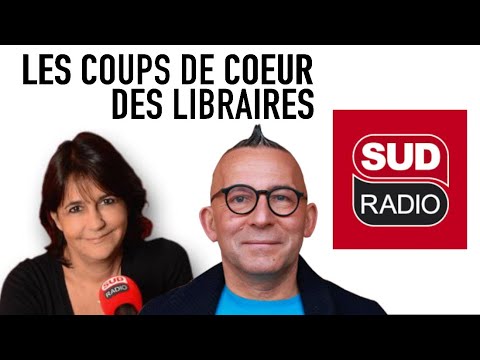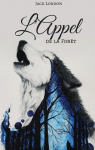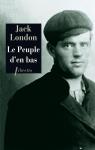Jack London
Louis Postif (Traducteur)Frédéric Klein (Traducteur)Michel Le Bris (Préfacier, etc.)/5 35 notes
Dans ce livre qui mélange allègrement les époques, passant de la préhistoire aux temps futurs, sans oublier le monde contemporain, sept nouvelles d'inspiration variée reflètent à la fois le pessimisme lucide et les convictions révolutionnaires de l'auteur.
A une savoureuse parabole sur la naissance de la lutte de classes chez l'homme des cavernes fait pendant la plaisante anticipation d'une grève générale qui paralysera toute l'Amérique..... >Voir plus
Louis Postif (Traducteur)Frédéric Klein (Traducteur)Michel Le Bris (Préfacier, etc.)/5 35 notes
Résumé :
Dans ce livre qui mélange allègrement les époques, passant de la préhistoire aux temps futurs, sans oublier le monde contemporain, sept nouvelles d'inspiration variée reflètent à la fois le pessimisme lucide et les convictions révolutionnaires de l'auteur.
A une savoureuse parabole sur la naissance de la lutte de classes chez l'homme des cavernes fait pendant la plaisante anticipation d'une grève générale qui paralysera toute l'Amérique..... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Force des fortsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
Cette nouvelle se trouve dans le recueil éponyme datant de 1914 et réédité en 2009 dans cette collection. La Force des forts, écrit en 1911, met en scène une tribu. le vieux Barbe-en-long raconte à ses petits-fils, répondant aux doux prénoms de Courre-Daim, Poil-de-Carotte et Froussard-de-Nuit, comment les hommes se comportaient sans avoir appris les bonnes manières que ce dernier prit le soin d'inculquer à son fils. Lutte avec les Mangeurs-de-viande, regroupement des individus, création de la tribu. le narrateur passe en détail avec force exemples marquants, l'origine de la tribu. Puis vinrent les premières lois et toute la difficulté de les faire appliquer...
Ce texte, commençant par une citation d'un certain Lip-King (serait-ce un hommage à Kipling, poète préféré de London ?) "Les paraboles ne mentent pas mais les menteurs s'en servent". Elle indique donc la nature du texte. Au lecteur de chercher ce que ce texte peut enseigner. Sous une apparence de conte, on pourra y voir comment la société a été créée et, surtout, une certaine dénonciation : les hommes font-ils toujours le bon choix ?
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Ce texte, commençant par une citation d'un certain Lip-King (serait-ce un hommage à Kipling, poète préféré de London ?) "Les paraboles ne mentent pas mais les menteurs s'en servent". Elle indique donc la nature du texte. Au lecteur de chercher ce que ce texte peut enseigner. Sous une apparence de conte, on pourra y voir comment la société a été créée et, surtout, une certaine dénonciation : les hommes font-ils toujours le bon choix ?
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
On découvre véritablement dans ce recueil de nouvelles "from Jack London", que l'auteur était un visionnaire incroyable.
Ce livre est d'actualité, avec peut-être une pointe d'exagération parfois, mais tellement proche de la réalité... (cela concerne la Chine).
J'ai vraiment été surprise, et je trouve qu'on découvre dans ce livre plus que jamais la justesse de ce qu'il prévoyait pour le futur de la Terre (Chine contre tous les pays) ou de certains pays (conflit France-Allemagne).
Le tout donne des nouvelles toujours captivante, qui vous donneront à réfléchir, et intéressantes pour la découverte d'une nouvelle facette de l'auteur!
A LIRE SANS PLUS TARDER!!!!!
Noelle
Ce livre est d'actualité, avec peut-être une pointe d'exagération parfois, mais tellement proche de la réalité... (cela concerne la Chine).
J'ai vraiment été surprise, et je trouve qu'on découvre dans ce livre plus que jamais la justesse de ce qu'il prévoyait pour le futur de la Terre (Chine contre tous les pays) ou de certains pays (conflit France-Allemagne).
Le tout donne des nouvelles toujours captivante, qui vous donneront à réfléchir, et intéressantes pour la découverte d'une nouvelle facette de l'auteur!
A LIRE SANS PLUS TARDER!!!!!
Noelle
Comment un chef, un groupuscule prend-il le pouvoir et s'y maintient-il à coups de mensonges, de slogans et de numéros de prestidigitation ? Cette question est pour le moins d'actualité et pourtant, le romancier Jack London remonte aux temps préhistoriques pour la poser au sein de la première nouvelle du recueil la Force des Forts. Les hommes viennent de découvrir que pour être plus forts et pour vivre mieux, ils devaient descendre des arbres, s'unir et établir des lois et des codes sociaux… Mais tous les codes sociaux et les lois sont objets de manipulation sitôt que des hommes un peu habiles se hissent au pouvoir et en tirent un profit personnel…
Joli recueil de nouvelles. On y retrouve la fine analyse politique de Jack London et son écriture où affleure une ironie bien sentie.
En lisant la première nouvelle, celle qui donne son titre au receuil, j'ai eu l'impression de lire à la fois 'La ferme des animaux' et 'Pourquoi j'ai mangé mon père' (et j'ai aimé !).
En lisant la première nouvelle, celle qui donne son titre au receuil, j'ai eu l'impression de lire à la fois 'La ferme des animaux' et 'Pourquoi j'ai mangé mon père' (et j'ai aimé !).
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
Ce fut l’époque de la Grande trêve. Toutes les nations, solennellement, jurèrent de ne pas se faire la guerre. La première mesure qui fut prise consista à mobiliser progressivement les armées de Russie, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de Grèce et de Turquie. Puis un mouvement vers l’est s’amorça. Tous les trains partant pour l’Asie furent remplis de soldats. Objectif : la Chine, c’est tout ce que l’on savait. Un peu plus tard commença le grand mouvement sur les mers. Des expéditions navales furent lancées par toutes les nations. Les flottes se suivaient, et toutes se dirigeaient vers les côtes chinoises. Tous les pays vidèrent leurs ports. Ils envoyèrent leurs vedettes de la douane, leurs avisos, leurs ravitailleurs de phares, ainsi que leurs plus antiques croiseurs et cuirassés. Ils mobilisèrent même la marine marchande. Les statistiques montrent que 58 640 steamers marchands, équipés de projecteurs et de mitrailleuses, furent envoyés vers la Chine.
La Chine attendit en souriant. Sur ses frontières terrestres se pressaient des millions de soldats venus d’Europe. Elle mobilisa cinq fois plus de miliciens et se prépara à l’invasion. La même chose fut faite sur les côtes. Mais, chose étrange, ces vastes préparatifs ne donnèrent lieu à aucune invasion. La Chine ne comprenait pas. Le long de la grande frontière sibérienne, tout était calme. Le long de ses côtes, ses villes et ses villages n’étaient même pas bombardés. Il n’y avait jamais eu, dans l’histoire du monde, un tel déploiement de navires de guerre. Et pourtant, il ne se passait rien, rien n’était tenté. Pensaient-ils la faire sortir de sa carapace ? La Chine, à cette idée, sourit. Pensaient-ils la lasser ou l’affamer ? À cette idée, une fois encore, la Chine sourit.
Et cependant, si le lecteur avait pu se trouver dans la cité impériale de Pékin, grosse de 11 millions d’habitants, à la date du 1er mai 1976, il aurait été le témoin d’une scène curieuse. Ce qu’il aurait vu, ce sont des rues pleines d’une population jaune et bavarde, la tête rejetée en arrière, l’œil tourné vers le ciel. Et très haut dans la nue, il aurait aperçu un petit point noir, qu’il aurait reconnu comme un aéroplane. De cet aéroplane, qui virevoltait au-dessus de la ville, tombaient des projectiles, d’étranges projectiles, d’allure inoffensive, de fragiles tubes de verre qui se brisaient en mille éclats dans les rues ou sur les toits.
Mais ces tubes de verre n’étaient nullement mortels. Il ne se passait rien. Aucune explosion. Il est vrai que quelques Chinois furent tués en recevant un de ces tubes sur la tête : ils tombaient de si haut ! Mais qu’est-ce que trois Chinois pouvaient bien représenter, au regard de 20 millions de naissances annuelles ?
L’un de ces tubes, qui tomba droit dans un étang à poissons, au fond d’un jardin, demeura intact. Le maître de maison le sortit de l’eau. Il n’osa pas l’ouvrir mais, accompagné de ses amis et entouré d’une foule de plus en plus nombreuse, il porta le mystérieux objet au juge du district. Celui-ci était un homme brave. Sous les regards de tous, il brisa le tube avec sa pipe à fourneau de cuivre. Il ne se passa rien. Parmi ceux qui se tenaient tout près, deux ou trois crurent voir des moustiques s’envoler du tube. Mais c’était tout. La foule éclata d’un grand rire et se dispersa.
En même temps que Pékin, toute la Chine fut ainsi bombardée de tubes de verre. Les petits aéroplanes, qui s’élançaient depuis les navires de guerre, ne comprenaient chacun que deux hommes ; et ils allaient et venaient au-dessus des agglomérations de toute taille, l’un pilotant, l’autre jetant les tubes.
Si le lecteur était retourné à Pékin six semaines plus tard, il aurait cherché en vain ses 11 millions d’habitants. Il en aurait rencontré quelques-uns, quelques centaines de milliers, peut-être, dont les cadavres pourrissaient à l’intérieur des maisons et dans les rues désertes, ou empilés dans des corbillards laissés à l’abandon. Pour le reste, il lui aurait fallu chercher le long des routes et des chemins de l’Empire. Encore ne les aurait-il pas tous trouvés en train de fuir Pékin frappé par la peste. Car derrière eux, des centaines de milliers de cadavres jonchaient les bascôtés, marquant ainsi le trajet de leur exode.
Il en alla de Pékin comme des autres villes et villages de l’Empire : tous furent frappés du fléau – ou plutôt des fléaux, car il y en avait toute une série. Toutes les formes virulentes de maladies infectieuses se répandirent dans le pays. Le gouvernement chinois comprit trop tard la signification des préparatifs colossaux, du rassemblement de toutes les armées du monde, des vols d’aéroplanes, de la pluie de tubes de verre. Et ses proclamations furent inutiles : elles ne purent stopper les 11 millions de malheureux pestiférés qui s’enfuyaient de Pékin pour répandre le fléau dans le reste du pays. Les médecins moururent à leur poste ; et la mort, qui triomphe de tout, passa outre aux décrets de l’empereur et de Li Tang Fwung. Il leur passa également sur le corps, car Li Tang Fwung mourut en deux semaines, et l’empereur, dissimulé dans son palais d’été, mourut à la quatrième.
S’il ne s’était agi que d’un seul fléau, la Chine aurait peut-être pu se tirer d’affaire. Mais aucune créature ne pouvait passer à travers une succession de fléaux. Celui qui échappait à la variole succombait à la scarlatine ; celui qui résistait à la fièvre jaune était emporté par le choléra ; et s’il résistait aussi à cela, la peste noire, c’est-à-dire la peste bubonique, le terrassait. Car c’était en effet tous ces germes, ces microbes, ces bactéries et ces bacilles, cultivés dans les laboratoires d’Occident, qui s’étaient abattus sur la Chine avec la pluie de verre.
Pages 79-82 - L'invasion sans pareil.
Je suis désolé pour ce long extrait. D'ailleurs si le responsable de ce site me demande de réduire ou de retirer, je m'exécuterais.
La Chine attendit en souriant. Sur ses frontières terrestres se pressaient des millions de soldats venus d’Europe. Elle mobilisa cinq fois plus de miliciens et se prépara à l’invasion. La même chose fut faite sur les côtes. Mais, chose étrange, ces vastes préparatifs ne donnèrent lieu à aucune invasion. La Chine ne comprenait pas. Le long de la grande frontière sibérienne, tout était calme. Le long de ses côtes, ses villes et ses villages n’étaient même pas bombardés. Il n’y avait jamais eu, dans l’histoire du monde, un tel déploiement de navires de guerre. Et pourtant, il ne se passait rien, rien n’était tenté. Pensaient-ils la faire sortir de sa carapace ? La Chine, à cette idée, sourit. Pensaient-ils la lasser ou l’affamer ? À cette idée, une fois encore, la Chine sourit.
Et cependant, si le lecteur avait pu se trouver dans la cité impériale de Pékin, grosse de 11 millions d’habitants, à la date du 1er mai 1976, il aurait été le témoin d’une scène curieuse. Ce qu’il aurait vu, ce sont des rues pleines d’une population jaune et bavarde, la tête rejetée en arrière, l’œil tourné vers le ciel. Et très haut dans la nue, il aurait aperçu un petit point noir, qu’il aurait reconnu comme un aéroplane. De cet aéroplane, qui virevoltait au-dessus de la ville, tombaient des projectiles, d’étranges projectiles, d’allure inoffensive, de fragiles tubes de verre qui se brisaient en mille éclats dans les rues ou sur les toits.
Mais ces tubes de verre n’étaient nullement mortels. Il ne se passait rien. Aucune explosion. Il est vrai que quelques Chinois furent tués en recevant un de ces tubes sur la tête : ils tombaient de si haut ! Mais qu’est-ce que trois Chinois pouvaient bien représenter, au regard de 20 millions de naissances annuelles ?
L’un de ces tubes, qui tomba droit dans un étang à poissons, au fond d’un jardin, demeura intact. Le maître de maison le sortit de l’eau. Il n’osa pas l’ouvrir mais, accompagné de ses amis et entouré d’une foule de plus en plus nombreuse, il porta le mystérieux objet au juge du district. Celui-ci était un homme brave. Sous les regards de tous, il brisa le tube avec sa pipe à fourneau de cuivre. Il ne se passa rien. Parmi ceux qui se tenaient tout près, deux ou trois crurent voir des moustiques s’envoler du tube. Mais c’était tout. La foule éclata d’un grand rire et se dispersa.
En même temps que Pékin, toute la Chine fut ainsi bombardée de tubes de verre. Les petits aéroplanes, qui s’élançaient depuis les navires de guerre, ne comprenaient chacun que deux hommes ; et ils allaient et venaient au-dessus des agglomérations de toute taille, l’un pilotant, l’autre jetant les tubes.
Si le lecteur était retourné à Pékin six semaines plus tard, il aurait cherché en vain ses 11 millions d’habitants. Il en aurait rencontré quelques-uns, quelques centaines de milliers, peut-être, dont les cadavres pourrissaient à l’intérieur des maisons et dans les rues désertes, ou empilés dans des corbillards laissés à l’abandon. Pour le reste, il lui aurait fallu chercher le long des routes et des chemins de l’Empire. Encore ne les aurait-il pas tous trouvés en train de fuir Pékin frappé par la peste. Car derrière eux, des centaines de milliers de cadavres jonchaient les bascôtés, marquant ainsi le trajet de leur exode.
Il en alla de Pékin comme des autres villes et villages de l’Empire : tous furent frappés du fléau – ou plutôt des fléaux, car il y en avait toute une série. Toutes les formes virulentes de maladies infectieuses se répandirent dans le pays. Le gouvernement chinois comprit trop tard la signification des préparatifs colossaux, du rassemblement de toutes les armées du monde, des vols d’aéroplanes, de la pluie de tubes de verre. Et ses proclamations furent inutiles : elles ne purent stopper les 11 millions de malheureux pestiférés qui s’enfuyaient de Pékin pour répandre le fléau dans le reste du pays. Les médecins moururent à leur poste ; et la mort, qui triomphe de tout, passa outre aux décrets de l’empereur et de Li Tang Fwung. Il leur passa également sur le corps, car Li Tang Fwung mourut en deux semaines, et l’empereur, dissimulé dans son palais d’été, mourut à la quatrième.
S’il ne s’était agi que d’un seul fléau, la Chine aurait peut-être pu se tirer d’affaire. Mais aucune créature ne pouvait passer à travers une succession de fléaux. Celui qui échappait à la variole succombait à la scarlatine ; celui qui résistait à la fièvre jaune était emporté par le choléra ; et s’il résistait aussi à cela, la peste noire, c’est-à-dire la peste bubonique, le terrassait. Car c’était en effet tous ces germes, ces microbes, ces bactéries et ces bacilles, cultivés dans les laboratoires d’Occident, qui s’étaient abattus sur la Chine avec la pluie de verre.
Pages 79-82 - L'invasion sans pareil.
Je suis désolé pour ce long extrait. D'ailleurs si le responsable de ce site me demande de réduire ou de retirer, je m'exécuterais.
[...] L'une de ses premières expériences se déroula dans la grande conserverie Wilmax, où il trouva du travail aux pièces pour confectionner de petites boîtes d'emballage. Une usine fournissait les pièces en série, et Freddie Drummond n'avait plus qu'à les assembler et à les clouer avec un petit marteau.
Ce travail n'exigeait pas de compétence professionnelle : c'était du travail à la tâche. Les ouvriers ordinaires gagnaient un dollar et demi par jour ; les autres, plus rapides, un dollar soixante-quinze. Au bout de la troisième journée, il put gagner la même somme. Mais il était ambitieux et ne se souciait guère d'aller son petit train-train ; comme il était exceptionnellement doué, le quatrième jour, il reçut deux dollars. Le lendemain, au prix d'une tension nerveuse épuisante, il parvint à deux dollars et demi. Ses camarades le gratifièrent de grimaces et de regards sombres ; ils lui firent des remarques spirituelle, en argot incompréhensible pour lui, où il était question de lécher les bottes au patron, de gâcher le métier et de se mettre à l'eau pour se protéger de l'averse. Il s'offusqua de leur manque d'empressement au travail, fit des généralisations sur la paresse congénitale des ouvriers non qualifiés et trouva moyen, le lendemain, de clouer pour trois dollars de boîtes.
Ce soir-là, en sortant de l'usine, il fut interpellé par ses camarades : ils étaient très remontés contre lui et l'exprimaient dans un argot incohérent. Il ne comprit pas le motif qui les poussait à agir ainsi, mais leur intervention fut énergique. Comme il refusait de ralentir son rythme et poussait des bêlements sur la liberté et la dignité du travail et sur l'indépendance américaine, ils entreprirent de le corriger. Ce fut une rude bataille, car Drummond était un costaud et un athlète, mais, finalement, la bande lui sauta sur les côtes, lui marcha sur la figure et lui écrasa les doigts, si bien qu'il dut garder le lit pendant une semaine avant de pouvoir se lever et chercher un autre emploi.
Pages 47-48 - Au sud de la Fente
Ce travail n'exigeait pas de compétence professionnelle : c'était du travail à la tâche. Les ouvriers ordinaires gagnaient un dollar et demi par jour ; les autres, plus rapides, un dollar soixante-quinze. Au bout de la troisième journée, il put gagner la même somme. Mais il était ambitieux et ne se souciait guère d'aller son petit train-train ; comme il était exceptionnellement doué, le quatrième jour, il reçut deux dollars. Le lendemain, au prix d'une tension nerveuse épuisante, il parvint à deux dollars et demi. Ses camarades le gratifièrent de grimaces et de regards sombres ; ils lui firent des remarques spirituelle, en argot incompréhensible pour lui, où il était question de lécher les bottes au patron, de gâcher le métier et de se mettre à l'eau pour se protéger de l'averse. Il s'offusqua de leur manque d'empressement au travail, fit des généralisations sur la paresse congénitale des ouvriers non qualifiés et trouva moyen, le lendemain, de clouer pour trois dollars de boîtes.
Ce soir-là, en sortant de l'usine, il fut interpellé par ses camarades : ils étaient très remontés contre lui et l'exprimaient dans un argot incohérent. Il ne comprit pas le motif qui les poussait à agir ainsi, mais leur intervention fut énergique. Comme il refusait de ralentir son rythme et poussait des bêlements sur la liberté et la dignité du travail et sur l'indépendance américaine, ils entreprirent de le corriger. Ce fut une rude bataille, car Drummond était un costaud et un athlète, mais, finalement, la bande lui sauta sur les côtes, lui marcha sur la figure et lui écrasa les doigts, si bien qu'il dut garder le lit pendant une semaine avant de pouvoir se lever et chercher un autre emploi.
Pages 47-48 - Au sud de la Fente
En fin de compte, la tribu demeurait sans protection et aveugle. Loin de posséder la force de soixante, nous n’avions plus de force du tout. Réunis en grand conseil, nous établîmes nos premières lois. Je n’étais guère qu’un bambin à l’époque, mais je m’en souviens comme si cela datait d’hier. Pour être forts, disait-on, nous ne devions pas nous battre entre nous. Dorénavant tout homme qui en tuerait un autre serait tué par la tribu. D’après une autre loi, quiconque volerait la femme du voisin serait également mis à mort. Car si le possesseur d’un excédent de force l’employait contre ses frères, ceux-ci vivraient dans la crainte, la tribu se désagrégerait et nous redeviendrions aussi faibles que quand les Mangeurs-de-Viande étaient venus nous envahir et tuer Bou-ouf.
[...] « Vous me rebattez les oreilles avec votre liberté de travailler. Tel est votre leitmotiv depuis des années. Les travailleurs ne commettent aucun crime en organisant cette grève générale. Ils ne violent aucune loi. Cessez de geindre, Hanover. Depuis trop longtemps, vous trompez le peuple. Vous avez opprimé la classe ouvrière en serrant la vis. Maintenant, c’est elle qui vous tient, elle serre à son tour, et vous poussez de grands cris […]. Combien de grèves avez-vous gagnées en réduisant les ouvriers à la famine ? Eh bien, les ouvriers ont trouvé le moyen de vous soumettre à leur tour. Et s’ils ne peuvent y arriver qu’en vous affamant, vous crèverez de faim, voilà tout ! »
Page 115-117 - le rêve de Debs
Page 115-117 - le rêve de Debs
Videos de Jack London (42)
Voir plusAjouter une vidéo
Attention !!! Nouvel horaire pour l'émission "Le coup de coeur des libraires" sur les Ondes de Sud Radio. Valérie Expert et Gérard Collard vous donnent rendez-vous chaque samedi à 14h00 pour vous faire découvrir leurs passions du moment !
•
Retrouvez leurs dernières sélections de livres ici !
•
•
•
Carolyn et John de Stéphanie des Horts aux éditions Albin Michel
https://www.lagriffenoire.com/carolyn-et-john.html
•
Pamela de Stéphanie des Horts aux éditions Livre de Poche
https://www.lagriffenoire.com/pamela.html
•
Les Soeurs Livanos de Stéphanie des Horts aux éditions Livre de Poche
9782253077442
•
Jackie et Lee de Stéphanie Des Horts aux éditions Livre de Poche
https://www.lagriffenoire.com/jackie-et-lee-4.html
•
La Cuisinière des Kennedy de Valérie Paturaud aux éditions Les Escales
https://www.lagriffenoire.com/la-cuisiniere-des-kennedy.html
•
Un animal sauvage de Joël Dicker aux éditions Rosie & Wolfe
https://www.lagriffenoire.com/un-animal-sauvage.html
•
Quelqu'un d'autre - Nouveau roman 2024 de Guillaume Musso aux éditions Calmann-Lévy
https://www.lagriffenoire.com/quelqu-un-d-autre-nouveau-roman-2024.html
•
Art of Skate: Histoire(s) d'une culture urbaine de Sylvie Barco, Philippe Danjean aux éditions Alternatives
https://www.lagriffenoire.com/art-of-skate-histoire-s-d-une-culture-urbaine.html
•
Les joies du surf de Jack London et Fanny Quément aux éditions Rivages Poche
https://www.lagriffenoire.com/la-joie-du-surf.html
•
Mangeuses: Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l'excès de Lauren Malka, Ryoko Sekiguchi aux éditions Les Pérégrines
https://www.lagriffenoire.com/mangeuses-histoire-de-celles-qui-devorent-savourent-ou-se.html
•
Les Vies rêvées de la Baronne d'Oettingen de Thomas Snégaroff aux éditions Albin Michel
https://www.lagriffenoire.com/les-vies-revees-de-la-baronne-d-oettingen.html
•
Putzi le pianiste d'Hitler de Thomas Snégaroff aux éditions Folio
https://www.amazon.fr/dp/2072964326?ref_=ast_author_ofdp
•
Dictionnaire amoureux de la traduction de Josée Kamoun et Alain Bouldouyre aux éditions Plon
https://www.lagriffenoire.com/dictionnaire-amoureux-de-la-traduction.html
•
le Restaurant des recettes oubliées : deuxième service de Hisashi Kashiwai et Alice Hureau aux éditions J'ai Lu
https://www.lagriffenoire.com/le-restaurant-des-recettes-oubliees-1.html
•
On dit merci ! de Émile Jadoul aux éditions École des Loisirs
https://www.lagriffenoire.com/on-dit-merci.html
•
omment faire apparaître
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jack London (203)
Voir plus
Quiz
Voir plus
l'appel de la foret
comment s'appelle le chien ?
holly
Buck
Billy
Rachid
3 questions
231 lecteurs ont répondu
Thème : L'appel sauvage (ou) L'appel de la forêt de
Jack LondonCréer un quiz sur ce livre231 lecteurs ont répondu