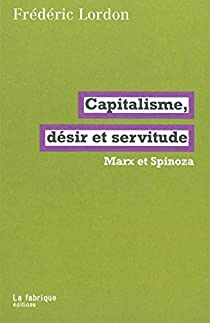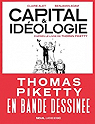Frédéric Lordon/5
80 notes
Résumé :
Comment un certain plaisir s’y prend-il pour impliquer des puissances tierces dans ses entreprises ? C’est le problème qu’on appellera en toute généralité le patronat, conçu comme un rapport social d’enrôlement. Marx a pratiquement tout dit des structures sociales de la forme capitaliste du patronat et de l’enrôlement salarial. Moins de la diversité des régimes d’affects qui pouvaient s’y couler. Car le capital a fait du chemin depuis les affects tristes de la coerc... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Capitalisme, désir et servitudeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (11)
Voir plus
Ajouter une critique
Salut les mecs.
Alors j'ai un peu honte. Je connais pas trop Frédéric Lordon mais j'apprends ici qu'il est à la mode depuis quelques années. Voilà qui commence bien pour moi. J'ai bien regardé quelques émissions de lui en un an (genre une ou deux histoire de remplir mon quota), mais il ne me semblait pas si branchouille que ça. Heureusement, je connais un peu mieux Marx, et un peu plus encore Spinoza, ce qui est la moindre des choses puisque dans ce bouquin, Frédéric se propose de creuser un peu notre compréhension de Marx en l'abordant par le biais de la philosophie de Spino.
J'ai lu de ci de là plusieurs critiques adressées au sieur Lordon en personne. Les critiques, parfois, étaient même adressées au bouquin dont nous proposons de causer ici. En voici quelques-unes :
- Frédéric est un looser. Ce que je réponds : je n'en sais rien, peut-être qu'il passe un peu trop à la télé ces derniers temps c'est vrai.
- Frédéric n'a rien compris à Spinoza. Ce que je réponds : sachant que les plus grands spécialistes de Spino ne s'accordent pas entre eux, on ne va jouer ici à touche-pipi pour savoir qui lance le plus loin. Dans l'ensemble, Frédéric reste cohérent et utilise de manière appropriée les concepts de l'affect, du conatus et de la liberté (même s'il ne distingue peut-être pas assez la liberté philosophique de la liberté politique, entendu que dans cet ouvrage, c'est de la seconde uniquement dont il devrait être question).
- Frédéric veut nous hypnotiser. Genre, il peut nous manipuler en nous faisant croire que si nous n'avons pas le sentiment d'être exploités, c'est justement le signe que nous avons été parfaitement aliénés. C'est un peu comme avec l'inconscient de la psychanalyse. Et du coup, les gens sont tristes de ne pas pouvoir se défendre là-contre. Ce que je réponds : Avec son explication concernant les mécanismes qui nous font accepter l'exploitation, Frédéric n'émet pas de jugement de valeur. Nous n'avons donc pas à nous brusquer et à bouder dans notre coin en disant « non, c'est pas vrai, je m'ai pas fait manipuler ! ». Nous ferions mieux au contraire de vérifier jusqu'à quel point cette théorie est vraie en la confrontant à la pratique quotidienne de nos actes et en nous demandant : suis-je sûr que c'est absolument MOI qui veux cela ? Et si non, quelle est la part d'autre qui me dirige ?
Bien sûr, en racontant que nous sommes peut-être agis par des puissances extérieures que nous ne maîtrisons pas, Frédéric ne se fait pas que des potes. Mais en cela, il se montre fidèle à Spinoza, qu'on a déjà bien maltraité pour avoir affirmé que le libre-arbitre n'existe pas. Alors moi, je m'en fous de savoir qui a raison entre le groupe de ceux qui jouent les gros pleins de libre-arbitre et ceux qui trouvent ça vachement provoc d'affirmer que le libre-arbitre est une illusion. Au niveau des conséquences, on remarque juste que ceux qui reconnaissent la possibilité d'une inexistence du libre-arbitre se montrent un peu plus vigilants et font preuve d'un esprit critique un peu plus acéré que ceux qui croient pouvoir être les seuls maîtres à bord de leur placenta cérébral. Alors les mecs, faut déstresser. le Frédéric, il n'en sait pas plus que nous sur le libre-arbitre et le Spino, même galère. Ils ne sont pas là pour nous prendre la main dans le sac d'une jouissance qui n'est pas la nôtre et pour nous dire que c'est pas bien. Ils sont juste là pour nous demander, au passage : au fait, t'es sûr que c'est bien ton manche que tu astiques, et pas celui de ton chef ? Vaut mieux être sûr de ça tout de suite, hein.
Mon Dieu, si j'utilise cette analogie sexuelle un peu foireuse, c'est parce que Spinoza et Frédéric nous rappellent que nous avons facilement tendance à fermer les yeux sur notre exploitation lorsque celle-ci s'accompagne d'affects joyeux. Quand on est content, on réfléchit rarement pour savoir si la joie provient de sources respectables. C'est tellement rare qu'on la gobe d'un coup, miam. Où est le mal ? C'est que l'entreprise néolibérale, selon Frédéric, elle le fait exprès de produire des « affects joyeux extrinsèques ». Même que pour se la péter il appelle ça « l'épitumogénie néolibérale ». Mouais, ça fait quand même longtemps qu'on est avertis sur le danger des plaisirs consommatoires périssables. Plus insidieux toutefois serait la volonté des dominants de nous faire croire que nous allons au travail pour notre plaisir (exemple de l'entreprise Google ?) ou pour accomplir notre réalisation personnelle (talent, prestige, voyages, putes). Plus seulement désir médiat des biens mais désir intrinsèque de l'activité elle-même. Ouais, ça peut se défendre.
« L'entreprise d'aujourd'hui voudrait idéalement des oranges mécaniques, c'est-à-dire des sujets qui d'eux-mêmes s'efforcent selon ses normes, et comme elle est (néo)libérale, elle les voudrait libres en plus de mécaniques –mécaniques pour la certitude fonctionnelle, et libres à la fois pour la beauté idéologique de la chose mais aussi considérant que le libre-arbitre est en définitive le plus sûr principe de l'action sans réserve, c'est-à-dire de la puissance d'agir livrée entièrement. »
Vous remarquerez que j'ai beaucoup causé de Spinoza. C'est normal, je l'aime bien ce mec. Marx vient après, et dans le bouquin aussi. On l'invoque pour actualiser sa définition de la domination et de la lutte des classes, histoire qu'elles collent un peu mieux avec notre société actuelle. le concept générique n'a pas perdu de sa pertinence, en revanche il doit se fondre dans de nouvelles formes. Ainsi, la domination aujourd'hui ne représente plus seulement l'asservissement au désir d'un maître, elle représente aussi l'enfermement des dominés dans un domaine restreint de jouissance. Aux millionnaires, un champ infini du désirable ; aux smicards un champ restreint au contenu des rayonnages du leader price (sauf à la fin du mois). Les dominants se réservent les désirs majeurs et font croire aux dominés que les désirs mineurs sont ceux qu'il faut rechercher en priorité. Là encore, si on n'aime pas cette idée, il faudra revenir taper sur Michel Foucault (Histoire de la sexualité, Tome 1 : La volonté de savoir : « Ne pas croire qu'en disant oui au sexe, on dit non au pouvoir ; on suit au contraire le fil du dispositif général de sexualité ») ou Pierre Bourdieu (pour une petite extension sur la domination des dominants). Finalement, force est de reconnaître que Frédéric ne propose rien de neuf mais il encourage l'accouplement d'un tas de conceptions qui n'attendaient que son entremise pour se frotter les unes aux autres.
Autre forme de domination induite par la division de la reconnaissance : « Les enrôlés sont […] voués à des contributions parcellaires, dont la totalisation n'est opérée que par le désir-maître ». N'importe qui doit pouvoir comprendre ça. T'as oeuvré comme un chien, mais le mérite est pour le grand manitou.
Frédéric désigne le grand ennemi : aujourd'hui, c'est l'entreprise néolibérale qui peut se permettre de cumuler toutes ces formes de domination à la fois. Elle excelle en faisant croire aux dominés qu'ils servent avant tout leur désir individuel avant de servir celui du maître. Là, d'accord, on se demande pourquoi ce serait tout de la faute à l'entreprise néolibérale. La responsabilité se partage sans doute de façon plus subtile, et le choix de l'ennemi est un peu facile.
Comme ça fait un peu con de parler de politique et de ne rien proposer de concret, Frédéric se croit obligé, pour finir, de lancer l'idée folle d‘une récommune. Déjà, le nom est moche, croisement bâtard entre république et communisme. Ensuite, ça ne marchera que sur le papier. le principe de la récommune consisterait en effet à réunir des associés autour d'une proposition de désir dans lequel ils auraient reconnu le leur. Genre, maintenant nous savons tous que nous devons nous montrer méfiants quant à la possibilité d'être vraiment propriétaire d'un désir en propre, et le Frédéric nous fait croire qu'un désir pur pourrait vraiment exister ? En fait, ce que Frédéric insinue par-là c'est que ce désir ne devra provenir ni des réquisits-menaces de la reproduction matérielle ni de l'induction d'un désir-maître. Mais je ne suis pas sûre que les désirs provenant de l'influence d'autres tendances ne soient pas aussi pourris que ceux-ci. Autre principe : ce qui affecte tous doit être l'objet de tous. Mais quelle peut être la nature de cette égalité qui s'accompagne fatalement d'une inégalité des contributions et des situations ? le plan de la récommune tombe là, Frédéric n'en cause plus. Ouf.
C'est à ce moment-là qu'il nous ressort sa théorie sur l'angle alpha. J'avoue, c'est de la pure violence symbolique : « L'angle α c'est le clinamen du conatus individuel, son désalignement spontané d'avec les finalités de l'entreprise, son hétérogénéité persistante au désir-maître, et son sinus […] la mesure de ce qui ne se laissera pas capturer ». Ça sert à impressionner ceux qui aiment se faire cramer la cervelle pour rien. J'aurais pourtant bien aimé que ma mémé puisse lire et comprendre ça, même si elle a dû arrêter l'école après le brevet de 13 ans. En gros, si on se contente de regarder le schéma, la domination c'est de suivre le désir-maître (le dominé suit le mouvement du dominant : la parallèle) et la sédition c'est de s'opposer au désir-maître (le dominé affirme de nouvelles directions pour le désir : la perpendiculaire). Pas besoin d'en venir aux vecteurs pour ça. C'est vrai qu'il nous emmerde le Frédéric avec ses discours pompeux. C'est comme s'il avait besoin de prouver tout le temps qu'il a fait des études. Sans doute un complexe de classe, encore. Autre exemple, le gros baratin sur le conatus de Spinoza n'était vraiment pas utile quand on remarque qu'il l'utilise seulement pour parler du mouvement incontrôlable qui pousse l'individu à désirer et à agir pour accomplir son désir.
Finalement, on en arrive à un hybride marxo-spinoziste qui permet à la limite de comprendre un peu mieux le premier par le second, et vice-versa. Marx s'était gouré en croyant que l'exploitation pourrait se résoudre, que les classes pourraient disparaître et que la fin de l'histoire sonnerait tonitruante. Spinoza nous a montré que la force des affects engendre la permanente et universelle servitude passionnelle. le pire ennemi est en nous-mêmes, c'est la force incontrôlable du désir et des passions. L'entreprise néolibérale (ou tout autre dominant) ne parviendrait pas à nous faire désirer des trucs absurdes si nous étions des pierres sans âme. La fin de l'histoire n'existe pas baby. Et hop, ni une ni deux, Spinoza se propose carrément de redéfinir le communisme. Nous nageons en plein anachronisme, mais ça dilate les pupilles. Voici donc : le communisme véritable c'est la fin de l'exploitation passionnelle, lorsque les hommes sauront diriger leurs désirs communs et former entreprise vers des objets que chacun peut désirer équitablement. Ce n'est pas du pain ni du vin, cet objet-là, c'est la raison, rien que ça. Et si la raison devient l'objet du désir vers lequel chacun doit se tourner et tendre la main, autant dire qu'on est dans la merde.
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Alors j'ai un peu honte. Je connais pas trop Frédéric Lordon mais j'apprends ici qu'il est à la mode depuis quelques années. Voilà qui commence bien pour moi. J'ai bien regardé quelques émissions de lui en un an (genre une ou deux histoire de remplir mon quota), mais il ne me semblait pas si branchouille que ça. Heureusement, je connais un peu mieux Marx, et un peu plus encore Spinoza, ce qui est la moindre des choses puisque dans ce bouquin, Frédéric se propose de creuser un peu notre compréhension de Marx en l'abordant par le biais de la philosophie de Spino.
J'ai lu de ci de là plusieurs critiques adressées au sieur Lordon en personne. Les critiques, parfois, étaient même adressées au bouquin dont nous proposons de causer ici. En voici quelques-unes :
- Frédéric est un looser. Ce que je réponds : je n'en sais rien, peut-être qu'il passe un peu trop à la télé ces derniers temps c'est vrai.
- Frédéric n'a rien compris à Spinoza. Ce que je réponds : sachant que les plus grands spécialistes de Spino ne s'accordent pas entre eux, on ne va jouer ici à touche-pipi pour savoir qui lance le plus loin. Dans l'ensemble, Frédéric reste cohérent et utilise de manière appropriée les concepts de l'affect, du conatus et de la liberté (même s'il ne distingue peut-être pas assez la liberté philosophique de la liberté politique, entendu que dans cet ouvrage, c'est de la seconde uniquement dont il devrait être question).
- Frédéric veut nous hypnotiser. Genre, il peut nous manipuler en nous faisant croire que si nous n'avons pas le sentiment d'être exploités, c'est justement le signe que nous avons été parfaitement aliénés. C'est un peu comme avec l'inconscient de la psychanalyse. Et du coup, les gens sont tristes de ne pas pouvoir se défendre là-contre. Ce que je réponds : Avec son explication concernant les mécanismes qui nous font accepter l'exploitation, Frédéric n'émet pas de jugement de valeur. Nous n'avons donc pas à nous brusquer et à bouder dans notre coin en disant « non, c'est pas vrai, je m'ai pas fait manipuler ! ». Nous ferions mieux au contraire de vérifier jusqu'à quel point cette théorie est vraie en la confrontant à la pratique quotidienne de nos actes et en nous demandant : suis-je sûr que c'est absolument MOI qui veux cela ? Et si non, quelle est la part d'autre qui me dirige ?
Bien sûr, en racontant que nous sommes peut-être agis par des puissances extérieures que nous ne maîtrisons pas, Frédéric ne se fait pas que des potes. Mais en cela, il se montre fidèle à Spinoza, qu'on a déjà bien maltraité pour avoir affirmé que le libre-arbitre n'existe pas. Alors moi, je m'en fous de savoir qui a raison entre le groupe de ceux qui jouent les gros pleins de libre-arbitre et ceux qui trouvent ça vachement provoc d'affirmer que le libre-arbitre est une illusion. Au niveau des conséquences, on remarque juste que ceux qui reconnaissent la possibilité d'une inexistence du libre-arbitre se montrent un peu plus vigilants et font preuve d'un esprit critique un peu plus acéré que ceux qui croient pouvoir être les seuls maîtres à bord de leur placenta cérébral. Alors les mecs, faut déstresser. le Frédéric, il n'en sait pas plus que nous sur le libre-arbitre et le Spino, même galère. Ils ne sont pas là pour nous prendre la main dans le sac d'une jouissance qui n'est pas la nôtre et pour nous dire que c'est pas bien. Ils sont juste là pour nous demander, au passage : au fait, t'es sûr que c'est bien ton manche que tu astiques, et pas celui de ton chef ? Vaut mieux être sûr de ça tout de suite, hein.
Mon Dieu, si j'utilise cette analogie sexuelle un peu foireuse, c'est parce que Spinoza et Frédéric nous rappellent que nous avons facilement tendance à fermer les yeux sur notre exploitation lorsque celle-ci s'accompagne d'affects joyeux. Quand on est content, on réfléchit rarement pour savoir si la joie provient de sources respectables. C'est tellement rare qu'on la gobe d'un coup, miam. Où est le mal ? C'est que l'entreprise néolibérale, selon Frédéric, elle le fait exprès de produire des « affects joyeux extrinsèques ». Même que pour se la péter il appelle ça « l'épitumogénie néolibérale ». Mouais, ça fait quand même longtemps qu'on est avertis sur le danger des plaisirs consommatoires périssables. Plus insidieux toutefois serait la volonté des dominants de nous faire croire que nous allons au travail pour notre plaisir (exemple de l'entreprise Google ?) ou pour accomplir notre réalisation personnelle (talent, prestige, voyages, putes). Plus seulement désir médiat des biens mais désir intrinsèque de l'activité elle-même. Ouais, ça peut se défendre.
« L'entreprise d'aujourd'hui voudrait idéalement des oranges mécaniques, c'est-à-dire des sujets qui d'eux-mêmes s'efforcent selon ses normes, et comme elle est (néo)libérale, elle les voudrait libres en plus de mécaniques –mécaniques pour la certitude fonctionnelle, et libres à la fois pour la beauté idéologique de la chose mais aussi considérant que le libre-arbitre est en définitive le plus sûr principe de l'action sans réserve, c'est-à-dire de la puissance d'agir livrée entièrement. »
Vous remarquerez que j'ai beaucoup causé de Spinoza. C'est normal, je l'aime bien ce mec. Marx vient après, et dans le bouquin aussi. On l'invoque pour actualiser sa définition de la domination et de la lutte des classes, histoire qu'elles collent un peu mieux avec notre société actuelle. le concept générique n'a pas perdu de sa pertinence, en revanche il doit se fondre dans de nouvelles formes. Ainsi, la domination aujourd'hui ne représente plus seulement l'asservissement au désir d'un maître, elle représente aussi l'enfermement des dominés dans un domaine restreint de jouissance. Aux millionnaires, un champ infini du désirable ; aux smicards un champ restreint au contenu des rayonnages du leader price (sauf à la fin du mois). Les dominants se réservent les désirs majeurs et font croire aux dominés que les désirs mineurs sont ceux qu'il faut rechercher en priorité. Là encore, si on n'aime pas cette idée, il faudra revenir taper sur Michel Foucault (Histoire de la sexualité, Tome 1 : La volonté de savoir : « Ne pas croire qu'en disant oui au sexe, on dit non au pouvoir ; on suit au contraire le fil du dispositif général de sexualité ») ou Pierre Bourdieu (pour une petite extension sur la domination des dominants). Finalement, force est de reconnaître que Frédéric ne propose rien de neuf mais il encourage l'accouplement d'un tas de conceptions qui n'attendaient que son entremise pour se frotter les unes aux autres.
Autre forme de domination induite par la division de la reconnaissance : « Les enrôlés sont […] voués à des contributions parcellaires, dont la totalisation n'est opérée que par le désir-maître ». N'importe qui doit pouvoir comprendre ça. T'as oeuvré comme un chien, mais le mérite est pour le grand manitou.
Frédéric désigne le grand ennemi : aujourd'hui, c'est l'entreprise néolibérale qui peut se permettre de cumuler toutes ces formes de domination à la fois. Elle excelle en faisant croire aux dominés qu'ils servent avant tout leur désir individuel avant de servir celui du maître. Là, d'accord, on se demande pourquoi ce serait tout de la faute à l'entreprise néolibérale. La responsabilité se partage sans doute de façon plus subtile, et le choix de l'ennemi est un peu facile.
Comme ça fait un peu con de parler de politique et de ne rien proposer de concret, Frédéric se croit obligé, pour finir, de lancer l'idée folle d‘une récommune. Déjà, le nom est moche, croisement bâtard entre république et communisme. Ensuite, ça ne marchera que sur le papier. le principe de la récommune consisterait en effet à réunir des associés autour d'une proposition de désir dans lequel ils auraient reconnu le leur. Genre, maintenant nous savons tous que nous devons nous montrer méfiants quant à la possibilité d'être vraiment propriétaire d'un désir en propre, et le Frédéric nous fait croire qu'un désir pur pourrait vraiment exister ? En fait, ce que Frédéric insinue par-là c'est que ce désir ne devra provenir ni des réquisits-menaces de la reproduction matérielle ni de l'induction d'un désir-maître. Mais je ne suis pas sûre que les désirs provenant de l'influence d'autres tendances ne soient pas aussi pourris que ceux-ci. Autre principe : ce qui affecte tous doit être l'objet de tous. Mais quelle peut être la nature de cette égalité qui s'accompagne fatalement d'une inégalité des contributions et des situations ? le plan de la récommune tombe là, Frédéric n'en cause plus. Ouf.
C'est à ce moment-là qu'il nous ressort sa théorie sur l'angle alpha. J'avoue, c'est de la pure violence symbolique : « L'angle α c'est le clinamen du conatus individuel, son désalignement spontané d'avec les finalités de l'entreprise, son hétérogénéité persistante au désir-maître, et son sinus […] la mesure de ce qui ne se laissera pas capturer ». Ça sert à impressionner ceux qui aiment se faire cramer la cervelle pour rien. J'aurais pourtant bien aimé que ma mémé puisse lire et comprendre ça, même si elle a dû arrêter l'école après le brevet de 13 ans. En gros, si on se contente de regarder le schéma, la domination c'est de suivre le désir-maître (le dominé suit le mouvement du dominant : la parallèle) et la sédition c'est de s'opposer au désir-maître (le dominé affirme de nouvelles directions pour le désir : la perpendiculaire). Pas besoin d'en venir aux vecteurs pour ça. C'est vrai qu'il nous emmerde le Frédéric avec ses discours pompeux. C'est comme s'il avait besoin de prouver tout le temps qu'il a fait des études. Sans doute un complexe de classe, encore. Autre exemple, le gros baratin sur le conatus de Spinoza n'était vraiment pas utile quand on remarque qu'il l'utilise seulement pour parler du mouvement incontrôlable qui pousse l'individu à désirer et à agir pour accomplir son désir.
Finalement, on en arrive à un hybride marxo-spinoziste qui permet à la limite de comprendre un peu mieux le premier par le second, et vice-versa. Marx s'était gouré en croyant que l'exploitation pourrait se résoudre, que les classes pourraient disparaître et que la fin de l'histoire sonnerait tonitruante. Spinoza nous a montré que la force des affects engendre la permanente et universelle servitude passionnelle. le pire ennemi est en nous-mêmes, c'est la force incontrôlable du désir et des passions. L'entreprise néolibérale (ou tout autre dominant) ne parviendrait pas à nous faire désirer des trucs absurdes si nous étions des pierres sans âme. La fin de l'histoire n'existe pas baby. Et hop, ni une ni deux, Spinoza se propose carrément de redéfinir le communisme. Nous nageons en plein anachronisme, mais ça dilate les pupilles. Voici donc : le communisme véritable c'est la fin de l'exploitation passionnelle, lorsque les hommes sauront diriger leurs désirs communs et former entreprise vers des objets que chacun peut désirer équitablement. Ce n'est pas du pain ni du vin, cet objet-là, c'est la raison, rien que ça. Et si la raison devient l'objet du désir vers lequel chacun doit se tourner et tendre la main, autant dire qu'on est dans la merde.
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Avec «Capitalisme, désir et servitude » incontestablement des portes et des fenêtres s'ouvrent. Notre vision du monde social après cette lecture n'est plus vraiment la même. Cette expérience est utile, heureuse, bien plus profonde que celle de se cultiver, elle élargi sensiblement notre « espace intérieur ». Certes, des auteurs aussi différents que le bourdieusien Alain Accardo avec « le petit-bourgeois gentilhomme », que le marxiste Moishe Postone avec « Temps, travail et domination sociale » ou bien que l'écologiste Hervé Kempf avec « Comment les riches détruisent la planète», ont déjà souligné les enjeux d'une réappropriation de notre propre subjectivité. Mais ce que Frédéric Lordon met à jour ce sont les mécanismes mêmes de la spoliation.
Il signe un essai précis et d'une grande honnêteté intellectuelle. Il fait preuve de beaucoup de pédagogie. Les chapitres de son livre sont courts et l'exposé de sa pensée progressif. Il aborde, avec le fonctionnement passionnel du capitalisme, l'impensé économique. Il croise pour cela de façon tout à fait convaincante et utile, les pensées de Marx et de Spinoza. La très ardue « Ethique » spinozienne est certes mobilisée mais les concepts utilisés sont toujours très clairement définis par l'auteur. le lecteur ignorant apprendra aussi beaucoup de choses sur cette grande philosophie.
Frédéric Lordon introduit dans la pensée économique marxiste une vision de l'homme, une anthropologie qui lui font partiellement défaut. le capitalisme impose le travail salarié et s'empare indubitablement de la plus-value mais l'échange entre force de travail et salaire n'est pas déterminé en toute connaissance de cause – qu'on consente ou qu'on conteste cette appropriation. La domination n'est pas non plus bipolaire, il existe un gradient continu de la servitude. Il serait possible d'introduire là la pensée de Pierre Bourdieu qui permet de dépasser la dichotomie entre déterminé et agissant et qui introduit le continuum de tous les agents qui sont tour à tour dominants et dominés. Spinoza ne dit pas autre chose. Sans doute notre force de désir, notre puissance d'agir nous appartient elle entièrement. Mais elle doit tout aux interpellations des choses, c'est-à-dire au dehors des rencontres quand il s'agit de savoir où et comment elle se dirige. de cette façon, nous dit Frédéric Lordon, le capitalisme s'approprie l'énergie du désir qui oriente notre force d'exister (Conatus). Les désirs sont déterminés du dehors (affectations). L'affect – triste ou joyeux – n'est que l'effet en soi de faire quelque chose qui s'en suit. L'auteur insiste, il n'y a pas de servitude volontaire, pas d'aliénation au sens classique mais une servitude passionnelle hétérogène. Consentement et contrainte sont déterminés de l'extérieur. le patronat fonctionne au désir. Il fait faire, s'empare de la puissance d'agir des enrôlés (impose son désir maître) et s'approprie ensuite les produits de l'activité commune (capture). Il s'approprie le produit matériel mais aussi le bénéfice symbolique de l'oeuvre collective des enrôlés. Entendons-nous bien, il ne détermine pas chacun de nos gestes. Les affectations et les affects qui en ont résulté laissent en nous des traces remobilisables. Ils peuvent ainsi tout à fait passer d'un objet à un autre, circuler entre les individus qui entre eux s'induisent sans autre intervention. Ce travail, le plus souvent, est inassignable, la société toute entière travaillant par auto affection.
Concrètement et en quelques lignes seulement, comment le capital produit-il ces désirs, cette servitude passionnelle ? Qu'elles sont donc les ingénieries successives (épithumogénies) des affects qu'il a mis en place (obsequium de l'amour et de la peur du maître)? L'affect joyeux de l'espoir (obtenir) qu'il propose est toujours accompagné de l'affect triste de la crainte (manquer). La division du travail et la généralisation du salariat, nous dit Frédéric Lordon, ont imposé, comme premier désir et seul moyen de survivre, l'argent. Cette nécessité absolue de la reproduction a généré chez les salariés des affects intrinsèques tristes tout à fait efficients, incontournables et permanents. le fordisme quant à lui a accentué encore la mobilisation à son profit. Il a permis aux salariés d'acquérir les objets qui réjouissent et qui génèrent des affects extrinsèques joyeux. Enfin, le choc actionnarial des dernières décennies, c'est-à-dire l'exigence de dégager une rentabilité des capitaux sans précédent, a nécessité d'imposer plus encore les désirs maîtres. le régime libéral a pour cela entrepris de produire des affects joyeux et intrinsèques. Totalitarisme confondant la vie de travail et la vie tout court, il a imposé dernièrement à tous la réalisation de soi dans et par le travail. Les exemples de fabrications contemporaines à base d' «enrichissement du travail», de «management participatif », d' «autonomisation des tâches » et autres programmes de « réalisation de soi » choisis par un Frédéric Lordon persifleur sont à ce sujet tout à fait éclairants.
S'il fallait refermer là «Capitalisme, désir et servitude », nous aurions le sentiment un peu triste – comme à la lecture d'un excellent nième article du « Monde Diplomatique » – d'en savoir plus mais d'être ma foi assez désarmé. le désir n'est certes jamais de soi mais il est cependant toujours à soi (le c'est moi qui désir est incontestable). Pour n'être en rien des sujets autonomes, les salariés ne s'en croient pas moins tels. Il s'en suit que dans nos sociétés consuméristes – nous pouvons nous servir nous-même – des conjonctions tout à fait réussies du désir maître et du désir de l'enrôlé sont réalisées . Il est certain aussi que le champ de nos désirs ne cesse de s'élargir et qu'ils s'accompagnent d'affects joyeux (sentiment d'appartenance, gains symboliques et monétaires de l'avancement, reconnaissance et amour). Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes néolibéral possible? Non car il y a dans nos sociétés une division sociale des désirs tout à fait inacceptable. le désir des enrôlés est fixé arbitrairement à un nombre très restreint d'objets à l'exclusion d'autres. La violence symbolique des dominants (concept bourdieusien) consiste à la production d'un imaginaire double : imaginaire du comblement pour faire paraître bien suffisantes les petites joies auxquelles sont assignés les dominés ; imaginaire de l'impuissance pour les faire renoncer aux grandes auxquelles ils pourraient aspirer. Très heureusement, à la fin de son ouvrage, Frédéric Lordon fait des propositions tout à fait passionnantes et raisonnables. Il faut une « dé fixation » du désir. Ce qui affecte tous doit être l'objet de tous. Il faut rompre avec les affects tenaces et permettre aux esprits, remplis de trop peu de choses mais entièrement, de se redéployer. le travail ainsi ne saurait absorber dans une société plus juste toutes les possibilités d'affectations de la puissance d'agir… Mais je vous laisse découvrir tous ces possibles. Une vie humaine, qui suppose des hommes, non sous l'emprise de la passion mais conduits par la raison, n'est-il pas un bel idéal ?
Il signe un essai précis et d'une grande honnêteté intellectuelle. Il fait preuve de beaucoup de pédagogie. Les chapitres de son livre sont courts et l'exposé de sa pensée progressif. Il aborde, avec le fonctionnement passionnel du capitalisme, l'impensé économique. Il croise pour cela de façon tout à fait convaincante et utile, les pensées de Marx et de Spinoza. La très ardue « Ethique » spinozienne est certes mobilisée mais les concepts utilisés sont toujours très clairement définis par l'auteur. le lecteur ignorant apprendra aussi beaucoup de choses sur cette grande philosophie.
Frédéric Lordon introduit dans la pensée économique marxiste une vision de l'homme, une anthropologie qui lui font partiellement défaut. le capitalisme impose le travail salarié et s'empare indubitablement de la plus-value mais l'échange entre force de travail et salaire n'est pas déterminé en toute connaissance de cause – qu'on consente ou qu'on conteste cette appropriation. La domination n'est pas non plus bipolaire, il existe un gradient continu de la servitude. Il serait possible d'introduire là la pensée de Pierre Bourdieu qui permet de dépasser la dichotomie entre déterminé et agissant et qui introduit le continuum de tous les agents qui sont tour à tour dominants et dominés. Spinoza ne dit pas autre chose. Sans doute notre force de désir, notre puissance d'agir nous appartient elle entièrement. Mais elle doit tout aux interpellations des choses, c'est-à-dire au dehors des rencontres quand il s'agit de savoir où et comment elle se dirige. de cette façon, nous dit Frédéric Lordon, le capitalisme s'approprie l'énergie du désir qui oriente notre force d'exister (Conatus). Les désirs sont déterminés du dehors (affectations). L'affect – triste ou joyeux – n'est que l'effet en soi de faire quelque chose qui s'en suit. L'auteur insiste, il n'y a pas de servitude volontaire, pas d'aliénation au sens classique mais une servitude passionnelle hétérogène. Consentement et contrainte sont déterminés de l'extérieur. le patronat fonctionne au désir. Il fait faire, s'empare de la puissance d'agir des enrôlés (impose son désir maître) et s'approprie ensuite les produits de l'activité commune (capture). Il s'approprie le produit matériel mais aussi le bénéfice symbolique de l'oeuvre collective des enrôlés. Entendons-nous bien, il ne détermine pas chacun de nos gestes. Les affectations et les affects qui en ont résulté laissent en nous des traces remobilisables. Ils peuvent ainsi tout à fait passer d'un objet à un autre, circuler entre les individus qui entre eux s'induisent sans autre intervention. Ce travail, le plus souvent, est inassignable, la société toute entière travaillant par auto affection.
Concrètement et en quelques lignes seulement, comment le capital produit-il ces désirs, cette servitude passionnelle ? Qu'elles sont donc les ingénieries successives (épithumogénies) des affects qu'il a mis en place (obsequium de l'amour et de la peur du maître)? L'affect joyeux de l'espoir (obtenir) qu'il propose est toujours accompagné de l'affect triste de la crainte (manquer). La division du travail et la généralisation du salariat, nous dit Frédéric Lordon, ont imposé, comme premier désir et seul moyen de survivre, l'argent. Cette nécessité absolue de la reproduction a généré chez les salariés des affects intrinsèques tristes tout à fait efficients, incontournables et permanents. le fordisme quant à lui a accentué encore la mobilisation à son profit. Il a permis aux salariés d'acquérir les objets qui réjouissent et qui génèrent des affects extrinsèques joyeux. Enfin, le choc actionnarial des dernières décennies, c'est-à-dire l'exigence de dégager une rentabilité des capitaux sans précédent, a nécessité d'imposer plus encore les désirs maîtres. le régime libéral a pour cela entrepris de produire des affects joyeux et intrinsèques. Totalitarisme confondant la vie de travail et la vie tout court, il a imposé dernièrement à tous la réalisation de soi dans et par le travail. Les exemples de fabrications contemporaines à base d' «enrichissement du travail», de «management participatif », d' «autonomisation des tâches » et autres programmes de « réalisation de soi » choisis par un Frédéric Lordon persifleur sont à ce sujet tout à fait éclairants.
S'il fallait refermer là «Capitalisme, désir et servitude », nous aurions le sentiment un peu triste – comme à la lecture d'un excellent nième article du « Monde Diplomatique » – d'en savoir plus mais d'être ma foi assez désarmé. le désir n'est certes jamais de soi mais il est cependant toujours à soi (le c'est moi qui désir est incontestable). Pour n'être en rien des sujets autonomes, les salariés ne s'en croient pas moins tels. Il s'en suit que dans nos sociétés consuméristes – nous pouvons nous servir nous-même – des conjonctions tout à fait réussies du désir maître et du désir de l'enrôlé sont réalisées . Il est certain aussi que le champ de nos désirs ne cesse de s'élargir et qu'ils s'accompagnent d'affects joyeux (sentiment d'appartenance, gains symboliques et monétaires de l'avancement, reconnaissance et amour). Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes néolibéral possible? Non car il y a dans nos sociétés une division sociale des désirs tout à fait inacceptable. le désir des enrôlés est fixé arbitrairement à un nombre très restreint d'objets à l'exclusion d'autres. La violence symbolique des dominants (concept bourdieusien) consiste à la production d'un imaginaire double : imaginaire du comblement pour faire paraître bien suffisantes les petites joies auxquelles sont assignés les dominés ; imaginaire de l'impuissance pour les faire renoncer aux grandes auxquelles ils pourraient aspirer. Très heureusement, à la fin de son ouvrage, Frédéric Lordon fait des propositions tout à fait passionnantes et raisonnables. Il faut une « dé fixation » du désir. Ce qui affecte tous doit être l'objet de tous. Il faut rompre avec les affects tenaces et permettre aux esprits, remplis de trop peu de choses mais entièrement, de se redéployer. le travail ainsi ne saurait absorber dans une société plus juste toutes les possibilités d'affectations de la puissance d'agir… Mais je vous laisse découvrir tous ces possibles. Une vie humaine, qui suppose des hommes, non sous l'emprise de la passion mais conduits par la raison, n'est-il pas un bel idéal ?
Partant de l'observation que les décisions en économie et dans le monde de l'entreprise, comme toute action humaine, sont sous l'emprise des passions humaines, Frédéric Lordon propose ici une nouvelle lecture du capitalisme et de la pensée de Marx en l'éclairant de la théorie des passions.
Et c'est un livre effectivement passionnant même s'il est un peu difficile d'y entrer, car il faut bousculer ses certitudes (si ce n'est pas déjà fait) et s'ajuster au vocabulaire et aux concepts employés par Frédéric Lordon. Si l'on admet, en suivant Spinoza, que l'aliénation est notre condition la plus ordinaire et la plus irrémissible car la servitude passionnelle est universelle, et que la notion de libre arbitre est infondée, cette relecture fascine et questionne, mais (hélas), par sa lucidité, n'est pas source d'optimisme pour l'avenir.
La question fondamentale posée est comment impliquer des puissances tierces dans la réalisation de ses propres désirs, ce que l'auteur nomme le rapport d'enrôlement, analysé ici dans sa déclinaison contemporaine, le travail salarié. L'enrôlement, et la mobilisation de l'énergie des salariés, est affaire d'alignement de leur désir sur le désir-maître, celui de l'employeur.
Depuis le développement de l'économie marchande à travail divisé, où pourvoir à ses besoins passe forcément par le salariat et donc par l'argent pour le plus grand nombre, les salariés ont d'abord accepté le rapport d'enrôlement salarial pour ne pas dépérir (se nourrir, se vêtir, se loger), puis avec le développement du fordisme, pour profiter et être réjoui de la consommation de biens matériels.
Mais dans la période contemporaine néolibérale, ceci ne suffit plus, du fait du changement d'ambition du capitalisme lié au relèvement constant des objectifs de rentabilité financière, lié à des rapports de concurrence, de violence et de puissance entre travail et capital modifiés du tout au tout avec la déréglementation et la globalisation des marchés, et à un développement du secteur tertiaire où les tâches à accomplir ont un contour plus flou, et où l'adhésion et le contrôle des salariés ne peuvent plus se réaliser uniquement par la coercition.
L'objectif du capitalisme est donc maintenant d'obtenir l'alignement parfait du désir et de l'énergie des salariés avec le désir-maître, c'est-à-dire une mobilisation TOTALE des individus au service de l'entreprise : développer un désir intrinsèque de l'activité pour elle-même par l' «épanouissement», la «réalisation de soi» et la «reconnaissance». Cette soumission entière, corps et âme, qui équivaut à remodeler de l'intérieur les désirs des salariés pour qu'ils soient conformes à ceux de l'employeur, est en quelque sorte un refaçonnage des individus - fabriquer un homme nouveau et joyeux de son sort salarial – et elle s'apparente donc à une forme de totalitarisme, d'où la citation de Gilles Deleuze en exergue de ce livre :
"On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde."
Pourquoi cet enrôlement complet est-il donc un problème si les salariés sont joyeux et «épanouis» ? Tout d'abord car très peu se coulent dans cette domination sans la moindre réserve, car le désir et la puissance d'agir du salarié sont réduits à un champ qui est restreint, car la menace, une violence coercitive (de plus en plus libérée) est toujours présente en arrière-plan, et car si tout s'effondre pour le salarié avec son licenciement, puisque la promesse de la vie salariale et de la vie tout court de plus en plus se confondent, la fin du salariat peut conduire à des conséquences extrêmes (dépression et suicide).
"Comme bon nombre de salariés ne cessent de l'expérimenter, tous les "plans" successifs que le rapport salarial capitaliste a su monter pour enrichir son décor, plans des intérêts plus raffinés au travail - avancement, socialisation, "épanouissement", etc. - peuvent à tout instant s'effondrer pour ne laisser seul debout que l'arrière-plan indestructible de la dépendance matérielle, fond brut de menace jetée sur la vie à nouveau nue."
Un livre d'une grande lucidité qui conclut logiquement que le dépassement du capitalisme ne nous libèrerait pas de la servitude passionnelle, puisque le désir et la violence qui l'accompagne sont l'essence même de l'homme. Peut-on se libérer de la captation du désir d'agir et donc de la domination lorsqu'il y a une action collective ? La manière de le faire reste à inventer.
Et c'est un livre effectivement passionnant même s'il est un peu difficile d'y entrer, car il faut bousculer ses certitudes (si ce n'est pas déjà fait) et s'ajuster au vocabulaire et aux concepts employés par Frédéric Lordon. Si l'on admet, en suivant Spinoza, que l'aliénation est notre condition la plus ordinaire et la plus irrémissible car la servitude passionnelle est universelle, et que la notion de libre arbitre est infondée, cette relecture fascine et questionne, mais (hélas), par sa lucidité, n'est pas source d'optimisme pour l'avenir.
La question fondamentale posée est comment impliquer des puissances tierces dans la réalisation de ses propres désirs, ce que l'auteur nomme le rapport d'enrôlement, analysé ici dans sa déclinaison contemporaine, le travail salarié. L'enrôlement, et la mobilisation de l'énergie des salariés, est affaire d'alignement de leur désir sur le désir-maître, celui de l'employeur.
Depuis le développement de l'économie marchande à travail divisé, où pourvoir à ses besoins passe forcément par le salariat et donc par l'argent pour le plus grand nombre, les salariés ont d'abord accepté le rapport d'enrôlement salarial pour ne pas dépérir (se nourrir, se vêtir, se loger), puis avec le développement du fordisme, pour profiter et être réjoui de la consommation de biens matériels.
Mais dans la période contemporaine néolibérale, ceci ne suffit plus, du fait du changement d'ambition du capitalisme lié au relèvement constant des objectifs de rentabilité financière, lié à des rapports de concurrence, de violence et de puissance entre travail et capital modifiés du tout au tout avec la déréglementation et la globalisation des marchés, et à un développement du secteur tertiaire où les tâches à accomplir ont un contour plus flou, et où l'adhésion et le contrôle des salariés ne peuvent plus se réaliser uniquement par la coercition.
L'objectif du capitalisme est donc maintenant d'obtenir l'alignement parfait du désir et de l'énergie des salariés avec le désir-maître, c'est-à-dire une mobilisation TOTALE des individus au service de l'entreprise : développer un désir intrinsèque de l'activité pour elle-même par l' «épanouissement», la «réalisation de soi» et la «reconnaissance». Cette soumission entière, corps et âme, qui équivaut à remodeler de l'intérieur les désirs des salariés pour qu'ils soient conformes à ceux de l'employeur, est en quelque sorte un refaçonnage des individus - fabriquer un homme nouveau et joyeux de son sort salarial – et elle s'apparente donc à une forme de totalitarisme, d'où la citation de Gilles Deleuze en exergue de ce livre :
"On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde."
Pourquoi cet enrôlement complet est-il donc un problème si les salariés sont joyeux et «épanouis» ? Tout d'abord car très peu se coulent dans cette domination sans la moindre réserve, car le désir et la puissance d'agir du salarié sont réduits à un champ qui est restreint, car la menace, une violence coercitive (de plus en plus libérée) est toujours présente en arrière-plan, et car si tout s'effondre pour le salarié avec son licenciement, puisque la promesse de la vie salariale et de la vie tout court de plus en plus se confondent, la fin du salariat peut conduire à des conséquences extrêmes (dépression et suicide).
"Comme bon nombre de salariés ne cessent de l'expérimenter, tous les "plans" successifs que le rapport salarial capitaliste a su monter pour enrichir son décor, plans des intérêts plus raffinés au travail - avancement, socialisation, "épanouissement", etc. - peuvent à tout instant s'effondrer pour ne laisser seul debout que l'arrière-plan indestructible de la dépendance matérielle, fond brut de menace jetée sur la vie à nouveau nue."
Un livre d'une grande lucidité qui conclut logiquement que le dépassement du capitalisme ne nous libèrerait pas de la servitude passionnelle, puisque le désir et la violence qui l'accompagne sont l'essence même de l'homme. Peut-on se libérer de la captation du désir d'agir et donc de la domination lorsqu'il y a une action collective ? La manière de le faire reste à inventer.
Ce fut épique. Ce fut long, laborieux parfois. Des retours en arrière, des lectures à voix haute pour mieux entrer dans l'écrit, ne pas lâcher. Des moments de plaisir aussi lorsque, de l'incompréhension, on accède à l'entendement.
Je ne suis pas un experte en philosophie, encore moins en ce qui concerne Spinoza. Je ne suis pas plus compétente en matière d'économie, et totalement ignorante des écrits de Marx. Alors, paradoxalement peut-être, j'ai voulu lire Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza de Frédéric Lordon.
le coût d'entrée est indéniable mais ce livre fera partie de mes livres de chevet. Parce que je n'en ai pas tiré toute son essence, forcément, au vu ce que j'ai avoué quelques lignes plus tôt, mais surtout parce qu'il a réussi à changer mon angle de vue sur mon rapport au travail et à mon statut de salarié. Rien que ça ;)
La néophyte que je suis ne saurai produire une critique du niveau de l'ouvrage, incapable de vous traduire une pensée et un raisonnement que je n'ai pour l'instant saisi qu'au niveau intuitif. Et pourtant, croyez-le, ce livre ne m'est jamais apparu rébarbatif, repoussant ou décourageant, loin de là. Frédéric Lordon a fait le choix de produire des chapitres courts, où il nous conduit patiemment au fil de sa pensée et en toute pédagogie. Vous n'ignorerez plus rien du « conatus », du « désir-maitre », ou de la « récommune » après une lecture attentive et assidue.
J'avais déjà abordé la notion de servitude volontaire au travers notamment de travaux en psychologie sociale. de l'aborder sous cet angle nouveau pour moi a été incroyablement enrichissant et m'a ouvert tout un nouvel éventail de possibilités d'approfondissement. Un oeil neuf donc, ou plutôt transformé, plus ouvert certainement, pour observer comment (et pourquoi) le « capitalisme » fait marcher les salariés, ses salariés, tout en jouant sur leurs consentements. Comment le capitalisme néolibéral tenterait de jouer sur nos désirs pour pouvoir se reposer sur des salariés contents. « Merci patron ! » ;)
Frédéric Lordon ne cache rien de la violence sociale que ces comportements engendre, de la maltraitance de beaucoup de salariés. J'ai été moi-même surprise de mon propre « aveuglement » et de la force de mon déni sur le sujet. Comment oublier que nous sommes si souvent mus par la peur, celle de perdre notre travail, ou la reconnaissance d'autrui, ou les moyens de subvenir à nos besoins ; et qu'au-delà, notre nature humaine nous fera percevoir le fardeau moins lourd en le vivant joyeusement et comme si ce n'était qu'effort de volonté, la notre, au service de nos désirs propres. Douces illusions…
Me restent le trouble, des interrogations. D'autres lectures viendront certainement pour moi sur ces sujets. Au-delà de Frédéric Lordon…
Je ne suis pas un experte en philosophie, encore moins en ce qui concerne Spinoza. Je ne suis pas plus compétente en matière d'économie, et totalement ignorante des écrits de Marx. Alors, paradoxalement peut-être, j'ai voulu lire Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza de Frédéric Lordon.
le coût d'entrée est indéniable mais ce livre fera partie de mes livres de chevet. Parce que je n'en ai pas tiré toute son essence, forcément, au vu ce que j'ai avoué quelques lignes plus tôt, mais surtout parce qu'il a réussi à changer mon angle de vue sur mon rapport au travail et à mon statut de salarié. Rien que ça ;)
La néophyte que je suis ne saurai produire une critique du niveau de l'ouvrage, incapable de vous traduire une pensée et un raisonnement que je n'ai pour l'instant saisi qu'au niveau intuitif. Et pourtant, croyez-le, ce livre ne m'est jamais apparu rébarbatif, repoussant ou décourageant, loin de là. Frédéric Lordon a fait le choix de produire des chapitres courts, où il nous conduit patiemment au fil de sa pensée et en toute pédagogie. Vous n'ignorerez plus rien du « conatus », du « désir-maitre », ou de la « récommune » après une lecture attentive et assidue.
J'avais déjà abordé la notion de servitude volontaire au travers notamment de travaux en psychologie sociale. de l'aborder sous cet angle nouveau pour moi a été incroyablement enrichissant et m'a ouvert tout un nouvel éventail de possibilités d'approfondissement. Un oeil neuf donc, ou plutôt transformé, plus ouvert certainement, pour observer comment (et pourquoi) le « capitalisme » fait marcher les salariés, ses salariés, tout en jouant sur leurs consentements. Comment le capitalisme néolibéral tenterait de jouer sur nos désirs pour pouvoir se reposer sur des salariés contents. « Merci patron ! » ;)
Frédéric Lordon ne cache rien de la violence sociale que ces comportements engendre, de la maltraitance de beaucoup de salariés. J'ai été moi-même surprise de mon propre « aveuglement » et de la force de mon déni sur le sujet. Comment oublier que nous sommes si souvent mus par la peur, celle de perdre notre travail, ou la reconnaissance d'autrui, ou les moyens de subvenir à nos besoins ; et qu'au-delà, notre nature humaine nous fera percevoir le fardeau moins lourd en le vivant joyeusement et comme si ce n'était qu'effort de volonté, la notre, au service de nos désirs propres. Douces illusions…
Me restent le trouble, des interrogations. D'autres lectures viendront certainement pour moi sur ces sujets. Au-delà de Frédéric Lordon…
Lordon montre à merveille comment Spinoza décrit l'homme comme un automate passionnel, mû tant par l'ordre fortuit des rencontres que par les lois de la vie affective au travers desquelles ces rencontres produisent leurs effets. Cette hétéronomie radicale est à l'inverse de la conception du libre arbitre comme contrôle souverain de soi, décrit par ce que Lordon nomme "la pensée individualiste-subjectiviste". Autrement dit, le mécanisme d'aliénation proposé par Spinoza, à l'encontre de la servitude volontaire de la Boétie, montre que les véritables chaînes sont celles de nos affects et de nos désirs.
La servitude volontaire n'existe pas. Il n'y a que la servitude passionnelle. Mais elle est universelle.
On ne peut qu'être frappé par la distinction que fait Spinoza entre d'une part la connaissance "par expérience vague" i.e. spontanément formée au voisinage des affects et dans l'ignorance des causes véritables, et d'autre part la connaissance des choses du point de vue de l'objectivité génétique.
Lordon illustre la relation subtile du couple consentement/contrainte, faite de similarité (tous deux sont des produits de l'exodétermination) et d'opposition (états de polarités opposées, joyeuse ou triste), par l'exemple de l'utilisation du terme "joug": asservissement tyrannique ("être sous le joug de...") vs. acquiescement enchanté ("être subjugué"). Brillant !
Parmi de nombreuses joliesses langagières qui font de ce bouquin un régal de lecture : "libre investissement axiogénique", "épithumogénies d'institution" c'est-à-dire- constructivismes du désir, procès atélique d'autoaffection collective (autrement dit processus sans but délibéré de réorienter les désirs des individus). En cela Lordon imite son maître, qui se rendit à la nécessité d'inventer une nouvelle langue pour marquer justement la rupture entre les deux types de connaissance décrits ci-dessus. Par exemple, le consentement est une forme de contrainte, car tous deux sont des formes vécues de la détermination. Seulement la contrainte est triste, le consentement est un affect joyeux.
Selon Spinoza, la valeur des choses n'est pas une propriété intrinsèque des objets, antérieure au désir et sur laquelle ce dernier n'aurait plus qu'à se régler, et notre désir n'est pas un simple effort d'orientation dans un monde de désirables objectivement déjà là. La valeur est à l'inverse une production par le désir, dont les investissements sont fondamentalement au principe de la valorisation des choses.
Lordon nous rend limpide la pensée a priori très systémique de Spinoza, laquelle offre en retour un arsenal de méthodes d'analyse où piocher allégrement et en toutes circonstances.
La servitude volontaire n'existe pas. Il n'y a que la servitude passionnelle. Mais elle est universelle.
On ne peut qu'être frappé par la distinction que fait Spinoza entre d'une part la connaissance "par expérience vague" i.e. spontanément formée au voisinage des affects et dans l'ignorance des causes véritables, et d'autre part la connaissance des choses du point de vue de l'objectivité génétique.
Lordon illustre la relation subtile du couple consentement/contrainte, faite de similarité (tous deux sont des produits de l'exodétermination) et d'opposition (états de polarités opposées, joyeuse ou triste), par l'exemple de l'utilisation du terme "joug": asservissement tyrannique ("être sous le joug de...") vs. acquiescement enchanté ("être subjugué"). Brillant !
Parmi de nombreuses joliesses langagières qui font de ce bouquin un régal de lecture : "libre investissement axiogénique", "épithumogénies d'institution" c'est-à-dire- constructivismes du désir, procès atélique d'autoaffection collective (autrement dit processus sans but délibéré de réorienter les désirs des individus). En cela Lordon imite son maître, qui se rendit à la nécessité d'inventer une nouvelle langue pour marquer justement la rupture entre les deux types de connaissance décrits ci-dessus. Par exemple, le consentement est une forme de contrainte, car tous deux sont des formes vécues de la détermination. Seulement la contrainte est triste, le consentement est un affect joyeux.
Selon Spinoza, la valeur des choses n'est pas une propriété intrinsèque des objets, antérieure au désir et sur laquelle ce dernier n'aurait plus qu'à se régler, et notre désir n'est pas un simple effort d'orientation dans un monde de désirables objectivement déjà là. La valeur est à l'inverse une production par le désir, dont les investissements sont fondamentalement au principe de la valorisation des choses.
Lordon nous rend limpide la pensée a priori très systémique de Spinoza, laquelle offre en retour un arsenal de méthodes d'analyse où piocher allégrement et en toutes circonstances.
critiques presse (1)
Un ouvrage qui synthétise les critiques du capitalisme tout en les supplémentant de l'anthropologie philosophique qui leur manquait.
Lire la critique sur le site : NonFiction
Citations et extraits (81)
Voir plus
Ajouter une citation
Il est vrai cependant que, de tous les désirs dont il fait sa gamme, le capitalisme commence par l'argent (...) la dépendance intégrale à la division marchande du travail est sa condition de possibilité. Marx et Polanyi, entre autres, ont abondamment montré comment se sont constituées les conditions de la prolétarisation, notamment par la fermeture des communs (enclosures), ne laissant d'autres possibilités, après avoir organisé le plus complet dénuement des hommes, que la vente de la force de travail sans qualité.
(...)
L'hétéronomie matérielle, à savoir l'incapacité de pourvoir par soi-même aux réquisits de sa reproduction comme force de travail (et tout simplement comme vie) et la nécessité d'en passer par la division du travail marchande rendent l'accès à l'argent impératif, et font de l'argent l'objet de désir cardinal, celui qui conditionne tous les autres ou presque. « L'argent est devenu le condensé de tous les biens », écrit Spinoza dans l'un des rares passages où il évoque la chose économique, « c'est pourquoi d'habitude son image occupe entièrement l'esprit du vulgaire puisqu'on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause ».
Qu'on n'aille pas croire que Spinoza, par le tranchant de sa formule, s'exclue du lot commun : avant de faire sa philosophie, il lui fallait polir des lentilles. Citoyen des Provinces Unies au sommet de leur puissance économique, il est bien placé pour savoir quelles mutations dans le régime des désirs et des affects collectifs induisent l'approfondissement de la division du travail et l'organisation de la reproduction matérielle sur une base marchande : l'argent, en tant que médiation quasi-exclusive des stratégies matérielles, « condensé de tous les biens », est devenu l'objet de métadésir, c'est-à-dire le point de passage obligé de tous les autres désirs (marchands).
(...)
La dépendance à l'objet de désir « argent » est le roc de l'enrôlement salarial, l'arrière-pensée de tous les contrats de travail, le fond de menace connu aussi bien de l'employé que de l'employeur. (pp. 24-30)
(...)
L'hétéronomie matérielle, à savoir l'incapacité de pourvoir par soi-même aux réquisits de sa reproduction comme force de travail (et tout simplement comme vie) et la nécessité d'en passer par la division du travail marchande rendent l'accès à l'argent impératif, et font de l'argent l'objet de désir cardinal, celui qui conditionne tous les autres ou presque. « L'argent est devenu le condensé de tous les biens », écrit Spinoza dans l'un des rares passages où il évoque la chose économique, « c'est pourquoi d'habitude son image occupe entièrement l'esprit du vulgaire puisqu'on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause ».
Qu'on n'aille pas croire que Spinoza, par le tranchant de sa formule, s'exclue du lot commun : avant de faire sa philosophie, il lui fallait polir des lentilles. Citoyen des Provinces Unies au sommet de leur puissance économique, il est bien placé pour savoir quelles mutations dans le régime des désirs et des affects collectifs induisent l'approfondissement de la division du travail et l'organisation de la reproduction matérielle sur une base marchande : l'argent, en tant que médiation quasi-exclusive des stratégies matérielles, « condensé de tous les biens », est devenu l'objet de métadésir, c'est-à-dire le point de passage obligé de tous les autres désirs (marchands).
(...)
La dépendance à l'objet de désir « argent » est le roc de l'enrôlement salarial, l'arrière-pensée de tous les contrats de travail, le fond de menace connu aussi bien de l'employé que de l'employeur. (pp. 24-30)
Il a été déclaré conforme à l’essence même de la liberté que les uns étaient libres d’utiliser les autres, et les autres libres de se laisser utiliser par les uns comme moyens. Cette magnifique rencontre de deux libertés a pour nom salariat.
La Boétie rappelle combien l’habitude de la servitude fait perdre de vue la condition même de la servitude. Non pas que les hommes « oublieraient » d’en être malheureux, mais parce qu’ils endurent ce malheur comme un fatum qu’ils n’auraient pas d’autre choix que de souffrir, voire comme une simple manière de
vivre à laquelle on finit toujours par se faire. Les asservissements réussis sont ceux qui parviennent à couper dans l’imagination des asservis les affects tristes de l’asservissement de l’idée même de l’asservissement – elle toujours susceptible, quand elle se présente clairement à la conscience, de faire renaître des projets de révolte.
La Boétie rappelle combien l’habitude de la servitude fait perdre de vue la condition même de la servitude. Non pas que les hommes « oublieraient » d’en être malheureux, mais parce qu’ils endurent ce malheur comme un fatum qu’ils n’auraient pas d’autre choix que de souffrir, voire comme une simple manière de
vivre à laquelle on finit toujours par se faire. Les asservissements réussis sont ceux qui parviennent à couper dans l’imagination des asservis les affects tristes de l’asservissement de l’idée même de l’asservissement – elle toujours susceptible, quand elle se présente clairement à la conscience, de faire renaître des projets de révolte.
Presque négativement, tant sa condition de possibilité réelle nous semble lointaine, c’est Spinoza encore qui nous donne peut-être la définition du communisme véritable : l’exploitation passionnelle prend fin quand les hommes savent diriger leurs désirs communs – et former entreprise communiste – vers des objets qui ne sont plus matière à captures unilatérales, c'est-à-dire quand ils comprennent que le vrai bien est celui dont il faut souhaiter que les autres le possèdent en même temps que soi. Ainsi, par exemple, de la raison, que tous doivent être le plus nombreux à posséder, puisque « les hommes en tant qu’ils vivent sous la conduite de la raison, sont suprêmement utiles aux autres hommes (1) ». Mais cette redirection du désir et cette compréhension des choses sont l’objet même de «l’Ethique » dont Spinoza ne cache pas combien « la voie est escarpée (2) »…
(1) Eth., IV, 37, première démonstration.
(2) Eth., V, 42, scolie.
(1) Eth., IV, 37, première démonstration.
(2) Eth., V, 42, scolie.
Faire la révolution, c'est secouer le joug : il faut avoir voulu briser ses chaînes, et ce vouloir-là ne peut qu'être un magnifique moment de la « liberté ». Sous ce rapport, les discours d'exaltation du soulèvement anticapitaliste, qui en appellent à l'émancipation comprise comme affranchissement des servitudes de l'ordre social, et potentiellement comme affranchissement de tout, discours de rupture, c'est-à-dire de réaffirmation de la souveraine autonomie des sujets qui commandent à nouveau librement à leurs vies, ces discours méconnaissent la solidarité intellectuelle profonde qui les unit à la pensée libérale qu'ils croient combattre et dont ils sont une expression à peine moins prototypique que les apologies de l'entrepreneur, libre lui aussi, maître de sa réussite, parfois même engagé dans la lutte contre des bastilles des monopoles qui veulent enclore les marchés, les restrictions à la concurrence qui brident l'audace), bref affairé également à « changer le monde » - mais à sa manière.
Les « innovateurs » de toutes sortes, révolutionnaires de l'ordre social ou de l'ordre industriel, n'ont rien de plus fort en partage que leur détestation commune de la pensée du déterminisme, offense faite à leur liberté vécue en dernière analyse comme l'unique pouvoir de transformation du monde - seul différant la nature des transformations que visent ces sujets par ailleurs également libéraux.
Il suffit de voir le mouvement de répulsion que provoque immanquablement et presque universellement l'idée que nous pourrions ne pas être les êtres libres que nous croyons être, dont la formule la plus pure et la plus révulsée de dégoût a peut-être été donnée par Schelling pour qui être conditionné est ce par quoi « quoi que ce soit devient une chose », se trouve ravalé au rang de chose, il suffit donc d'observer ce mouvement de répulsion pour mesurer la profondeur d'enracinement d'un schème de pensée partagé par des agents qui croient différer politiquement en tout alors qu'ils ne diffèrent philosophiquement en rien (en tout cas en rien de fondamental). (pp. 173-174)
Les « innovateurs » de toutes sortes, révolutionnaires de l'ordre social ou de l'ordre industriel, n'ont rien de plus fort en partage que leur détestation commune de la pensée du déterminisme, offense faite à leur liberté vécue en dernière analyse comme l'unique pouvoir de transformation du monde - seul différant la nature des transformations que visent ces sujets par ailleurs également libéraux.
Il suffit de voir le mouvement de répulsion que provoque immanquablement et presque universellement l'idée que nous pourrions ne pas être les êtres libres que nous croyons être, dont la formule la plus pure et la plus révulsée de dégoût a peut-être été donnée par Schelling pour qui être conditionné est ce par quoi « quoi que ce soit devient une chose », se trouve ravalé au rang de chose, il suffit donc d'observer ce mouvement de répulsion pour mesurer la profondeur d'enracinement d'un schème de pensée partagé par des agents qui croient différer politiquement en tout alors qu'ils ne diffèrent philosophiquement en rien (en tout cas en rien de fondamental). (pp. 173-174)
Le choc actionnarial, c'est à dire l'exigence venue d'en haut de dégager une rentabilité des capitaux propres sans comparaison avec les normes antérieures du capitalisme fordien, offre un exemple type de la propagation de violence qui peut résister de la mise sous tension de la chaîne de dépendance salariale au sein de l'organisation.
Le brutal relèvement, simplement quantitatif, des objectifs intermédiaires est à soi seul une cause suffisante d'intensification des rapports d'instrumentalisation et de leur violence intrinsèque.
L'organisation hiérarchique de la division du travail [dans une économie monétaire] véhicule l'impulsion d'un bout à l'autre de la chaîne de dépendance, au long de laquelle l'abstraction économique de la rentabilité se convertit en violence concrète.
(§ Pressions ambiantes et remontée de la violence)
Le brutal relèvement, simplement quantitatif, des objectifs intermédiaires est à soi seul une cause suffisante d'intensification des rapports d'instrumentalisation et de leur violence intrinsèque.
L'organisation hiérarchique de la division du travail [dans une économie monétaire] véhicule l'impulsion d'un bout à l'autre de la chaîne de dépendance, au long de laquelle l'abstraction économique de la rentabilité se convertit en violence concrète.
(§ Pressions ambiantes et remontée de la violence)
Videos de Frédéric Lordon (19)
Voir plusAjouter une vidéo
Explication de texte de ma riposte à Frédéric Lordon : Un palestinisme de pacotille, suivie d'un dialogue.
Le texte de Lordon : https://blog.mondediplo.net/la-fin-de-l-innocence
Ma riposte en ligne (37 pages) : https://open.substack.com/pub/laggg2020/p/un-palestinisme-de-pacotille
Être tenu au courant: https://linktr.ee/laggg
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Frédéric Lordon (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
440 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre440 lecteurs ont répondu