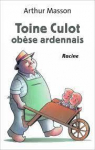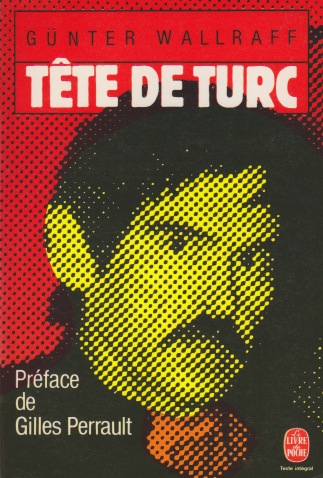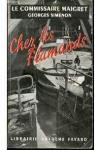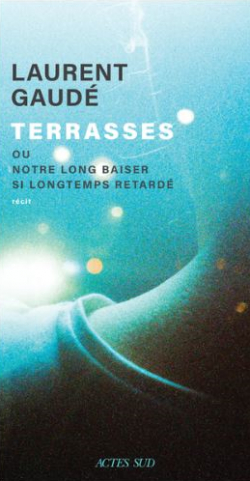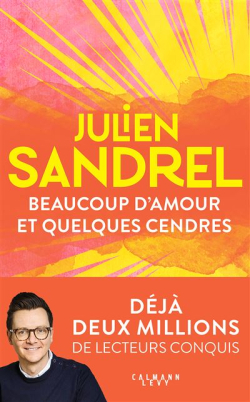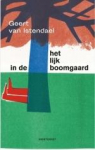8 février 2010 :
Mot de l'éditeur :
Premier volet d'un diptyque, La Jeune Fille et le nègre est une histoire d'amour entre Sophie, une jeune belge, étudiante en économie, et Abou, un demandeur d'asile togolais. Mais, pour une fois, c'est à travers les yeux d'un père et d'une mère que cet amour-là nous est conté.
Le sujet sensible des sans-papiers est abordé ici par le biais d'une chronique familiale. Judith Vanistendael montre comment la méfiance, voire l'hostilité initiale, s'estompe peu à peu pour faire place à d'autres sentiments.
La longue marche d'un demandeur d'asile
Sophie, une jeune femme bruxelloise, tombe amoureuse d'Abou, un demandeur d'asile togolais. le couple aménage dans la maison des parents de la demoiselle, qui réagissent à cette idylle avec une certaine circonspection. Mais quand Abou se trouve menacé d'expulsion, le mariage apparaît comme l'unique moyen légal qui lui permettra de rester en Belgique...
Premier volet d'un diptyque, cet album passionnant, largement autobiographique, relate les événements du point de vue du père de Sophie, un journaliste spécialisé dans les affaires internationales. le deuxième tome, à paraître, reviendra sur les mêmes faits du point de vue de Sophie elle-même.
Un ouvrage qui traite, avec humour et sans complaisance, du drame des sans-papiers et des réfugiés politiques.
Un talent héréditaire
Judith Vanistendael est la fille du célèbre écrivain, poète, essayiste bruxellois Geert van Istendael. Née à Louvain, elle a déménagé à Bruxelles à l'âge de cinq ans.
Après des études à Sint-Lukas dans la classe de Johan de Moor et Nix, elle a fait un début remarqué dans la bande dessinée avec de maagd en de neger (titre original de la Jeune fille et le nègre), paru chez Oog & Blik en 2006. Geert van Istendael s'est, pour sa part, libéré de ses sentiments à l'égard de cette expérience familiale dans la nouvelle Bericht uit de burcht.

Geert Van Istendael
Vincent Marnix (Traducteur)Monique Nagielkopf (Traducteur)/5 3 notes
Vincent Marnix (Traducteur)Monique Nagielkopf (Traducteur)/5 3 notes
Résumé :
Dans cet essai parlé (car l'auteur nous entraîne dans ce qui ressemble aux méandres captivants d'une longue conversation, avec ses contradictions, ses moments de passion et ses hésitations), Geert van Istendael s'efforce de cerner un peu ce phénomène unique, complexe et irréductible qu'est la Belgique. La Belgique et son passé rocambolesque, sa défiance viscérale à l'égard de toute forme d'autorité, ses langues, ses joutes incompréhensibles, ses frontières intérieur... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le labyrinthe belgeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
La Belgique, ce petit pays né en 1830 d'une révolution contre l'occupant hollandais, fêtait en 2005 ses 175 ans. S'est tenue à cette occasion à Bruxelles une exposition impressionnante : « Made in Belgium » qui a exposé tout ce qui fait la « belgitude », depuis l'uniforme porté par Albert Ier durant la première guerre mondiale jusqu'à la raquette de tennis de Justine Hénin en passant par les disques d'or de Jacques Brel, les romans de Simenon et, bien sûr, quelques planches originelles d'Hergé. La tenue même de cette exposition, sans parler de son succès, a bien montré que l'existence même de la Belgique n'allait pas de soi. Imaginerait-on une exposition parisienne ayant la « francitude » pour objet ?
Qu'est-ce qu'être belge ? C'est à cette question que se sont attachés plusieurs ouvrages sortis à l'occasion du jubilé. le plus convivial est celui de Patrick Roegiers publié dans la très agréable collection Découvertes « Roman d'un pays » (Gallimard, 2005, 160 p.). le plus pessimiste est celui du Wallon René Swennen « Belgique requiem » (La Table Ronde, 2005, 154 p.). le plus réussi est probablement celui de Geert van Istendael. Né à Bruxelles en 1947, ce présentateur vedette du journal nééerlandophone de la RTBF a publié en 1989 un essai dont la traduction française refondue a été éditée à cette occasion. Dans « le labyrinthe belge », ce Flamand né à Bruxelles souhaitait présenter aux Néerlandais leurs curieux voisins méridionaux. Mais cette invitation à la « belgitude » vaut aussi pour les voisins français qui considèrent trop souvent la Belgique comme un petit pays pluvieux et ennuyeux ou, au mieux, comme un cocasse « arlequin diplomatique » (Baudelaire).
Il est vrai que l'architecture institutionnelle de la Belgique est déroutante. Ce pays plus petit que l'Aquitaine, peuplé de dix millions d'habitants, compte six gouvernements et sept assemblées. La Belgique, fédérale depuis les accords de la Saint-Michel de 1993, est divisée en trois régions : la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Il faut distinguer les régions qui gèrent tout ce qui est lié au territoire (économie, aménagement, travaux publics …) des communautés liées aux personnes (enseignement, culture, affaires sociales …). Là encore, la Belgique en compte trois : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté allemande à laquelle van Istendael consacre quelques pages croustillantes. La Région et la Communauté flamande ont fusionné et ont toutes deux leur siège à Bruxelles. En revanche, la Région wallonne a conservé son siège à Namur tandis que la Communauté française a le sien à Bruxelles, pour bien montrer que la capitale belge, majoritairement francophone, mais enclavée en terre flamande, entend conserver son statut spécifique.
Car cette complexité constitutionnelle trouve son origine dans le multilinguisme. Une frontière multiséculaire divise ce jeune pays en deux. Geert van Istendael montre combien cette frontière est « tranchante et absolue » (p. 98). Pour autant cette frontière n'est pas seulement territoriale. Longtemps, ce fut une frontière de classe, la noblesse et la bourgeoisie, en Wallonie, mais aussi en Flandre, parlant le français, le néerlandais – ou plutôt l'un des innombrables dialectes flamands pratiqués dans le Limbourg ou le Brabant – étant juste bons à s'adresser « aux animaux et aux domestiques ». C'est seulement à la fin du XXème siècle que ce déséquilibre s'est renversé, avec la crise de l'industrie minière en Wallonie et le dynamisme économique de la Flandre. Les Flamands, depuis toujours majoritaires, sont devenus plus riches que leurs voisins francophones et le « bilinguisme inégalitaire » qui avait longtemps prévalu n'a plus été tenable.
En Belgique aujourd'hui, tout se passe comme si deux peuples cohabitaient sans se parler, sans s'écouter. Un Wallon et un Flamand ne vont pas à la même école, ni même à la même université, ne lisent pas les mêmes livres, ne regardent pas la même télévision, ne s'informent pas dans les mêmes journaux. Même au jour d'aller voter, ils n'élisent pas les mêmes personnes, les modalités de désignation de leurs représentants au Parlement bicaméral étant différentes d'une communauté à l'autre. Dans ces conditions où est « la possession en commun d'un riche legs de souvenirs » sinon dans l'amour de la famille royale malgré le triste passé colonial d'un Léopold II ou les compromissions avec l'occupant nazi de Léopold III ? où est « le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis » ?
Plusieurs scénario ont cours sur l'avenir de la Belgique. Les Flamands les plus radicaux du Vlaams Blok – rebaptisé Vlaams Belang en novembre 2004 après qu'un arrêt de la cour d'appel de Gand en a censuré le caractère raciste et xénophobe – appellent ouvertement à la disparition de la Belgique. « België barst ! » (« La Belgique, qu'elle crève ! ») est leur peu sympathique mot d'ordre. Leur audience en Flandre n'a cessé de croître depuis 1990, atteignant jusqu'au quart des électeurs. Face à eux, le mouvement rattachiste wallon prône le rattachement de la Wallonie à la France. Son audience s'est étiolée, notamment en raison du peu d'empathie du voisin français pour leur cause. Restent ceux, les plus nombreux, qui voient dans les progrès de la construction européenne la solution la plus raisonnable au dilemme belge : la lente disparition de l'Etat national, le transfert de compétences sans cesse plus nombreuses à l'échelon régional ou supra-national conduira insensiblement à la disparition d'une nation que, comme Geert van Istendael, on aime détester et on déteste aimer.
Qu'est-ce qu'être belge ? C'est à cette question que se sont attachés plusieurs ouvrages sortis à l'occasion du jubilé. le plus convivial est celui de Patrick Roegiers publié dans la très agréable collection Découvertes « Roman d'un pays » (Gallimard, 2005, 160 p.). le plus pessimiste est celui du Wallon René Swennen « Belgique requiem » (La Table Ronde, 2005, 154 p.). le plus réussi est probablement celui de Geert van Istendael. Né à Bruxelles en 1947, ce présentateur vedette du journal nééerlandophone de la RTBF a publié en 1989 un essai dont la traduction française refondue a été éditée à cette occasion. Dans « le labyrinthe belge », ce Flamand né à Bruxelles souhaitait présenter aux Néerlandais leurs curieux voisins méridionaux. Mais cette invitation à la « belgitude » vaut aussi pour les voisins français qui considèrent trop souvent la Belgique comme un petit pays pluvieux et ennuyeux ou, au mieux, comme un cocasse « arlequin diplomatique » (Baudelaire).
Il est vrai que l'architecture institutionnelle de la Belgique est déroutante. Ce pays plus petit que l'Aquitaine, peuplé de dix millions d'habitants, compte six gouvernements et sept assemblées. La Belgique, fédérale depuis les accords de la Saint-Michel de 1993, est divisée en trois régions : la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Il faut distinguer les régions qui gèrent tout ce qui est lié au territoire (économie, aménagement, travaux publics …) des communautés liées aux personnes (enseignement, culture, affaires sociales …). Là encore, la Belgique en compte trois : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté allemande à laquelle van Istendael consacre quelques pages croustillantes. La Région et la Communauté flamande ont fusionné et ont toutes deux leur siège à Bruxelles. En revanche, la Région wallonne a conservé son siège à Namur tandis que la Communauté française a le sien à Bruxelles, pour bien montrer que la capitale belge, majoritairement francophone, mais enclavée en terre flamande, entend conserver son statut spécifique.
Car cette complexité constitutionnelle trouve son origine dans le multilinguisme. Une frontière multiséculaire divise ce jeune pays en deux. Geert van Istendael montre combien cette frontière est « tranchante et absolue » (p. 98). Pour autant cette frontière n'est pas seulement territoriale. Longtemps, ce fut une frontière de classe, la noblesse et la bourgeoisie, en Wallonie, mais aussi en Flandre, parlant le français, le néerlandais – ou plutôt l'un des innombrables dialectes flamands pratiqués dans le Limbourg ou le Brabant – étant juste bons à s'adresser « aux animaux et aux domestiques ». C'est seulement à la fin du XXème siècle que ce déséquilibre s'est renversé, avec la crise de l'industrie minière en Wallonie et le dynamisme économique de la Flandre. Les Flamands, depuis toujours majoritaires, sont devenus plus riches que leurs voisins francophones et le « bilinguisme inégalitaire » qui avait longtemps prévalu n'a plus été tenable.
En Belgique aujourd'hui, tout se passe comme si deux peuples cohabitaient sans se parler, sans s'écouter. Un Wallon et un Flamand ne vont pas à la même école, ni même à la même université, ne lisent pas les mêmes livres, ne regardent pas la même télévision, ne s'informent pas dans les mêmes journaux. Même au jour d'aller voter, ils n'élisent pas les mêmes personnes, les modalités de désignation de leurs représentants au Parlement bicaméral étant différentes d'une communauté à l'autre. Dans ces conditions où est « la possession en commun d'un riche legs de souvenirs » sinon dans l'amour de la famille royale malgré le triste passé colonial d'un Léopold II ou les compromissions avec l'occupant nazi de Léopold III ? où est « le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis » ?
Plusieurs scénario ont cours sur l'avenir de la Belgique. Les Flamands les plus radicaux du Vlaams Blok – rebaptisé Vlaams Belang en novembre 2004 après qu'un arrêt de la cour d'appel de Gand en a censuré le caractère raciste et xénophobe – appellent ouvertement à la disparition de la Belgique. « België barst ! » (« La Belgique, qu'elle crève ! ») est leur peu sympathique mot d'ordre. Leur audience en Flandre n'a cessé de croître depuis 1990, atteignant jusqu'au quart des électeurs. Face à eux, le mouvement rattachiste wallon prône le rattachement de la Wallonie à la France. Son audience s'est étiolée, notamment en raison du peu d'empathie du voisin français pour leur cause. Restent ceux, les plus nombreux, qui voient dans les progrès de la construction européenne la solution la plus raisonnable au dilemme belge : la lente disparition de l'Etat national, le transfert de compétences sans cesse plus nombreuses à l'échelon régional ou supra-national conduira insensiblement à la disparition d'une nation que, comme Geert van Istendael, on aime détester et on déteste aimer.
Videos de Geert Van Istendael (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Groupes raciaux, ethniques, nationauxVoir plus
>Sciences sociales : généralités>Groupes sociaux>Groupes raciaux, ethniques, nationaux (234)
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Geert Van Istendael (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3247 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3247 lecteurs ont répondu