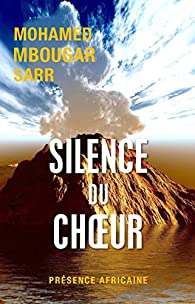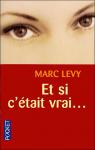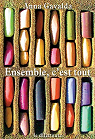Mohamed Mbougar Sarr/5
45 notes
Résumé :
Soixante-douze hommes arrivent dans un bourg de la campagne sicilienne. L'époque les appelle "immigrés", "réfugiés" ou "migrants". A Altino, ils sont surtout les ragazzi, les "gars" que l'association Santa Marta prend en charge. Mais leur présence bouleverse le quotidien de la petite ville. En attendant que leur sort soit fixé, les ragazzi croisent toutes sortes de figures : un curé atypique qui réécrit leurs histoires, une femme engagée à leur offrir l'asile, un ho... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Silence du choeurVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (8)
Voir plus
Ajouter une critique
Un ouvrage qu'il m'est difficile de passer sous silence .
Pour ses qualités littéraires et pour l'importance de son thème : l'épopée des migrants , un regard sur un pan de la tragédie .
Ici , en Sicile , dans un village imaginaire , dès qu'arrivent les migrants accueillis par une association , un face à face d'abord larvé va progressivement diviser les habitants .
C'est un texte allégorique qui , par ses personnages hauts en couleur , campés avec minutie , va servir ce drame dans le souci de comprendre les deux clans en disséquant les arguments , les motivations ou les intérêts des uns ou des autres .
Mais , bien sûr , au devant de la scène reviennent sans cesse les histoires et le vécu de tel ou tel migrant , les causes de leur fuite . C'est dit sans langue de bois , avec une certaine neutralité .
Pour parler de ce roman , je vais manquer de qualificatifs !
Dès le début , j'ai été envoûtée par le style élégant , fluide , riche , ciselé : en un mot , superbe ! J'y ai vu l'ombre des plus grands classiques . Un régal ...
Mais plus loin , la forme revêt aussi l'allure du conte africain qui sait si bien créer un rythme , comme s'il mettait le texte en musique .
Alors , le récit sera parfois fougueux , parfois lent : il va et vient pour mieux ménager le suspense .
Bon , il y a bien ici et là quelques longueurs mais , on devine le souci de perfectionnisme qui semble animer l'auteur .
Si ce roman se veut réaliste , il m'a surtout séduite par sa délicatesse et sa poésie qui ont réussi à atténuer un peu la gravité du sujet.
Mais , ce que j'en retiendrai , c'est l'expression d'une pensée lumineuse et profonde , philosophique et sage , humaniste et engagée .
Un jeune auteur plus que prometteur semble t-il !
Pour ses qualités littéraires et pour l'importance de son thème : l'épopée des migrants , un regard sur un pan de la tragédie .
Ici , en Sicile , dans un village imaginaire , dès qu'arrivent les migrants accueillis par une association , un face à face d'abord larvé va progressivement diviser les habitants .
C'est un texte allégorique qui , par ses personnages hauts en couleur , campés avec minutie , va servir ce drame dans le souci de comprendre les deux clans en disséquant les arguments , les motivations ou les intérêts des uns ou des autres .
Mais , bien sûr , au devant de la scène reviennent sans cesse les histoires et le vécu de tel ou tel migrant , les causes de leur fuite . C'est dit sans langue de bois , avec une certaine neutralité .
Pour parler de ce roman , je vais manquer de qualificatifs !
Dès le début , j'ai été envoûtée par le style élégant , fluide , riche , ciselé : en un mot , superbe ! J'y ai vu l'ombre des plus grands classiques . Un régal ...
Mais plus loin , la forme revêt aussi l'allure du conte africain qui sait si bien créer un rythme , comme s'il mettait le texte en musique .
Alors , le récit sera parfois fougueux , parfois lent : il va et vient pour mieux ménager le suspense .
Bon , il y a bien ici et là quelques longueurs mais , on devine le souci de perfectionnisme qui semble animer l'auteur .
Si ce roman se veut réaliste , il m'a surtout séduite par sa délicatesse et sa poésie qui ont réussi à atténuer un peu la gravité du sujet.
Mais , ce que j'en retiendrai , c'est l'expression d'une pensée lumineuse et profonde , philosophique et sage , humaniste et engagée .
Un jeune auteur plus que prometteur semble t-il !
Silence du choeur
Mohamed Mbougar Sarr
roman, 2017, 413p
Présence africaine
Voici un auteur qui sait parler des migrants, pas d'eux seulement, de ceux qui les accueillent, de ceux qui les rejettent, de ceux qui se posent des questions à leur sujet et sur eux-mêmes. Les migrants donnent lieu à un récit robuste, saisissant, et qui répond à la définition qu'en donne MMS : il relate et relie.
L'accueil des migrants d'Afrique se passe en Sicile, dans une toute petite ville qui n'est pas éloignée de l'Etna, et à notre époque . Paris a connu les attentats.
Mais cette fois, l'accueil est différent : des gens s'opposent manifestement aux migrants et brûlent un mannequin représentant un Noir. Des personnes de l'association qui s'occupe des migrants prennent conscience qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Les migrants apprennent aux Européens que leur continent est fini, ils leur rappellent le mal qu'ils leur ont infligé ; de plus, le fait qu'on peine à nommer un homme, migrant, immigrant, immigré, déplacé, exilé, réfugié, dans le livre ragazzi, est le début du malheur. Les migrants, qui éprouvent la honte de n'avoir pas pu rester au pays, et nourrissent le rêve d'y revenir, s'en rendent compte aussi.
le lecteur sera plongé dans un drame qui interrogera l'humanité. MMS sait donner de l'épaisseur à ses personnages, qu'il nous apprend à connaître avec leur éducation, leurs traditions, leur culture, leur langue, dans leurs actions, dans leur noblesse, leurs doutes, leurs ambitions, leur ignominie, leurs sentiments. Il sait très bien construire son roman, ménage des suspens, jusqu'au bout, on sera surpris, ne laisse rien au hasard, tout est maîtrisé. Il utilise plusieurs registres, le pamphlet parfois, l'épopée, le tragique, le lyrique, la réflexion philosophique. Parfois il a de petits côtés professoraux. Il a recours à la forme du journal, du carnet, du théâtre. On voit qu'il réfléchit à l'écriture, et on entend bien la critique qui dénonce que tout le monde croit pouvoir écrire et être digne de l'écriture. Il aime aussi l'intertextualité. le personnage du poète permet d'introduire Dante et Pasolini. MMS élabore de très puissantes images qui musclent son dire, font voir les situations comme si on y était.
C'est un livre fort, vivant, émouvant, qui nous interpelle. le titre joue un peu sur les sonorités : le roman est polyphonique, centré sur la tragédie de l'impuissance, due en partie à la priorité des intérêts de chacun. Une oeuvre ambitieuse, et aboutie. Et l'auteur est jeune !
Mohamed Mbougar Sarr
roman, 2017, 413p
Présence africaine
Voici un auteur qui sait parler des migrants, pas d'eux seulement, de ceux qui les accueillent, de ceux qui les rejettent, de ceux qui se posent des questions à leur sujet et sur eux-mêmes. Les migrants donnent lieu à un récit robuste, saisissant, et qui répond à la définition qu'en donne MMS : il relate et relie.
L'accueil des migrants d'Afrique se passe en Sicile, dans une toute petite ville qui n'est pas éloignée de l'Etna, et à notre époque . Paris a connu les attentats.
Mais cette fois, l'accueil est différent : des gens s'opposent manifestement aux migrants et brûlent un mannequin représentant un Noir. Des personnes de l'association qui s'occupe des migrants prennent conscience qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux. Les migrants apprennent aux Européens que leur continent est fini, ils leur rappellent le mal qu'ils leur ont infligé ; de plus, le fait qu'on peine à nommer un homme, migrant, immigrant, immigré, déplacé, exilé, réfugié, dans le livre ragazzi, est le début du malheur. Les migrants, qui éprouvent la honte de n'avoir pas pu rester au pays, et nourrissent le rêve d'y revenir, s'en rendent compte aussi.
le lecteur sera plongé dans un drame qui interrogera l'humanité. MMS sait donner de l'épaisseur à ses personnages, qu'il nous apprend à connaître avec leur éducation, leurs traditions, leur culture, leur langue, dans leurs actions, dans leur noblesse, leurs doutes, leurs ambitions, leur ignominie, leurs sentiments. Il sait très bien construire son roman, ménage des suspens, jusqu'au bout, on sera surpris, ne laisse rien au hasard, tout est maîtrisé. Il utilise plusieurs registres, le pamphlet parfois, l'épopée, le tragique, le lyrique, la réflexion philosophique. Parfois il a de petits côtés professoraux. Il a recours à la forme du journal, du carnet, du théâtre. On voit qu'il réfléchit à l'écriture, et on entend bien la critique qui dénonce que tout le monde croit pouvoir écrire et être digne de l'écriture. Il aime aussi l'intertextualité. le personnage du poète permet d'introduire Dante et Pasolini. MMS élabore de très puissantes images qui musclent son dire, font voir les situations comme si on y était.
C'est un livre fort, vivant, émouvant, qui nous interpelle. le titre joue un peu sur les sonorités : le roman est polyphonique, centré sur la tragédie de l'impuissance, due en partie à la priorité des intérêts de chacun. Une oeuvre ambitieuse, et aboutie. Et l'auteur est jeune !
La thématique des migrants et des réactions de la population d'accueil, voilà qui donne des oeuvres multiples mais souvent « attendues », généreuses ou haineuses , par exemple.
Ici l'auteur multiplie les focales et les témoignages dans un récit « complet » qui propose différentes attitudes tout en restant captivant, notamment par sa forme littéraire : la construction fait alterner des récits présents et rétrospectifs, différents genres dont l'épopée, le théâtre, le roman noir, le fantastique : c'est un récit torrentiel écrit par un homme très cultivé, dont on identifie facilement certaines références, comme des souvenirs de Rabelais, Zola ou Proust.
La langue est particulièrement soignée, on y retrouvera toutes les figures de style (rire). Cette virtuosité n'empêche pas l'intérêt du lecteur, même si l'auteur admet lui-même un ton théâtral dans les dialogues.
Quel est le rôle de l'artiste ? L'éventail est proposé : ou faire des oeuvres « gratuites», plus ou moins nombrilistes, ou s'inspirer des réalités de son temps, des misères qui doivent nous interpeller.
L'auteur a choisi « le poète ne peut empêcher le monde de s'effondrer mais lui seul est en mesure de le montrer dans son effondrement. Et peut être de le rebâtir aux endroits où il s'effondre en premier, et le plus lourdement : la parole et la langue. »
Ici l'auteur multiplie les focales et les témoignages dans un récit « complet » qui propose différentes attitudes tout en restant captivant, notamment par sa forme littéraire : la construction fait alterner des récits présents et rétrospectifs, différents genres dont l'épopée, le théâtre, le roman noir, le fantastique : c'est un récit torrentiel écrit par un homme très cultivé, dont on identifie facilement certaines références, comme des souvenirs de Rabelais, Zola ou Proust.
La langue est particulièrement soignée, on y retrouvera toutes les figures de style (rire). Cette virtuosité n'empêche pas l'intérêt du lecteur, même si l'auteur admet lui-même un ton théâtral dans les dialogues.
Quel est le rôle de l'artiste ? L'éventail est proposé : ou faire des oeuvres « gratuites», plus ou moins nombrilistes, ou s'inspirer des réalités de son temps, des misères qui doivent nous interpeller.
L'auteur a choisi « le poète ne peut empêcher le monde de s'effondrer mais lui seul est en mesure de le montrer dans son effondrement. Et peut être de le rebâtir aux endroits où il s'effondre en premier, et le plus lourdement : la parole et la langue. »
J'ai découvert cet auteur avec Terre ceinte, alors qu'il n'avait pas encore reçu le Goncourt et ce roman m'a vraiment séduit. Peu après, La plus secrète mémoire des hommes m'a largement déçu, qu'importe le Goncourt, l'histoire est emberlificotée, l'écriture ampoulée et j'ai sauté des pages pour arriver à la fin. Puis j'ai lu de purs hommes, un chef d'oeuvre et un vrai plaidoyer pour la tolérance. Avec Silence du choeur, c'est encore un plaidoyer, moins touchant parce que trop étalé avec un style un peu trop travaillé (abus de l'imparfait du subjonctif, par exemple !) Des longueurs aussi et un récit interne d'un migrant, certes passionnant, mais redondant et d'un style qui n'est pas, ne peut pas être le sien. Ça, je l'ai trouvé maladroit ! Plus court le roman aurait "percuté" mieux. Mais un livre qu'il vaut la peine de lire !
J'ai emprunté « Silence du choeur » à Marie-Pierre à Méckhé. Je devais le lire rapidement pour le lui rendre, mais c'est finalement dans l'avion que je l'ai terminé. Au début, j'avoue m'être demandé ce que Marie a autant aimé dans ce livre. J'avais vu de bonnes critiques en général sur « Terre ceinte », le premier roman de Mbougar Sarr. Mais j'avais du mal à entrer dans « Silence du choeur ». J'ai sûrement déjà dit ici que je ne suis pas une grande fan des descriptions. Mbougar lui, a le don de faire de grandes phrases, pleines de métaphores, pour dire des choses très simples. Ça séduirait sans doute des amateurs de poésie mais pour moi ça alourdissait le texte. J'ai commencé à accrocher lorsque j'ai perçu les différents angles de vue utilisés par Mbougar Sarr pour aborder le sujet de l'immigration.
Avec «Silence du choeur », on se met dans les bottes de différentes personnes affectées par le phénomène de l'immigration clandestine. Il serait sans doute impossible de savoir exactement comment se sentent ceux qui traversent mers et déserts pour survivre, mais Mbougar propose un champ de réflexion. On peut s'interroger et essayer de comprendre, non seulement les immigrants, mais aussi ceux qui leur refusent souvent un refuge.
La plupart des romans que j'ai lus sur l'immigration, ne mettent pas l'accent sur les raisons pour lesquelles certains occidentaux s'y opposent. Même si on serait prompts à les traiter d'inhumains, je me suis rendu compte avec « Silence du choeur » que ces personnes ont souvent peur des autres qu'ils ne connaissent pas. Ils craignent qu'ils ne leur ravissent ce qu'ils possèdent et cette peur se transforme parfois en haine. Ce n'est pas une excuse, mais les médias et quelques fauteurs de troubles comme Mauricio ici, sont en grande partie responsables de l'image négative que la plupart des occidentaux se font des immigrés. Malheureusement, toute cette hostilité peut produire l'irréparable si rien n'est fait.
Lien : http://leschroniquesdetchont..
Avec «Silence du choeur », on se met dans les bottes de différentes personnes affectées par le phénomène de l'immigration clandestine. Il serait sans doute impossible de savoir exactement comment se sentent ceux qui traversent mers et déserts pour survivre, mais Mbougar propose un champ de réflexion. On peut s'interroger et essayer de comprendre, non seulement les immigrants, mais aussi ceux qui leur refusent souvent un refuge.
La plupart des romans que j'ai lus sur l'immigration, ne mettent pas l'accent sur les raisons pour lesquelles certains occidentaux s'y opposent. Même si on serait prompts à les traiter d'inhumains, je me suis rendu compte avec « Silence du choeur » que ces personnes ont souvent peur des autres qu'ils ne connaissent pas. Ils craignent qu'ils ne leur ravissent ce qu'ils possèdent et cette peur se transforme parfois en haine. Ce n'est pas une excuse, mais les médias et quelques fauteurs de troubles comme Mauricio ici, sont en grande partie responsables de l'image négative que la plupart des occidentaux se font des immigrés. Malheureusement, toute cette hostilité peut produire l'irréparable si rien n'est fait.
Lien : http://leschroniquesdetchont..
Citations et extraits (29)
Voir plus
Ajouter une citation
Une fois de plus, l’Europe sans force n’est pas à la hauteur. Ce continent n’est pas prêt à accueillir ces hommes. Vitalement, il n’est pas prêt. Il n’a rien à leur proposer qui les grandisse essentiellement, je veux dire, en tant qu’hommes. L’Europe est pauvre, spirituellement pauvre et vidée. On accueille ces gens grêce à notre richesse. Mais aucune de nos propositions humaines – si on en fait ! - ne sera retenue. L’Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, oui, c’est vrai, mais j’ajoute : parce qu’elle est elle-même misérable. La valeur de la vie humaine même lui échappe, l’effraie… Nous sommes les premiers à prêcher la morale aux autres, nous sommes les premiers à parler des Droits de l’Homme, mais regardons-nous ! Humanisme dégénéré. Phare brisé d’une civilisation en pleine tempête… Et l’Église… La Sainte-Église même… Elle se trompe… Elle accueille pour la grâce de Dieu là où il faudrait accueillir pour le salut des Hommes… Sa charité est un dogme, pas un élan du cœur. Et ça, les ragazzi le sentent, le savent. Ça les tue. Depuis le temps que je fréquente et écoute ces hommes, j’ai appris que ce qui les attristait le plus, Giuseppe, c’est le vide de notre continent. Ils sont déçus par les conditions de vie, qui sont certes moins éclatantes que dans leurs illusions mortelles d’un continent économiquement surpuissant. Mais je sens qu’ils sont surtout déçus par les hommes européens… Ce continent est fini, voilà ce qu’ils nous apprennent.
....C'est comme çà que nous sommes arrivés jusqu'à Niamey. On a attendu quelques jours là-bas avant que le passeur vienne nous chercher.
En l'attendant, nous étions rassemblés dans un quartier pas très propre, pas très sûr. Ca puait, c'était pauvre, sale. Des tas d'ordures entouraient d'autres déchets, les déchets humains : nous. Nous étions cinquante comme ça, tous jeunes ou presque. Des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais, des Nigérians, des Libériens, des Nigériens, des Camerounais, des Ivoiriens aussi.
Au début, on ne se parlait pas trop. Ce n'était pas de la timidité ou de la méfiance. C'était la peur de ne pas se comprendre. La peur de ne pas parler la même langue. Pourtant, après quelques heures, on savait qu'on parlait la même langue : la langue de la honte.
En l'attendant, nous étions rassemblés dans un quartier pas très propre, pas très sûr. Ca puait, c'était pauvre, sale. Des tas d'ordures entouraient d'autres déchets, les déchets humains : nous. Nous étions cinquante comme ça, tous jeunes ou presque. Des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais, des Nigérians, des Libériens, des Nigériens, des Camerounais, des Ivoiriens aussi.
Au début, on ne se parlait pas trop. Ce n'était pas de la timidité ou de la méfiance. C'était la peur de ne pas se comprendre. La peur de ne pas parler la même langue. Pourtant, après quelques heures, on savait qu'on parlait la même langue : la langue de la honte.
Au début, on ne se parlait pas trop. Ce n’était pas de la timidité ou de la méfiance. C’était la peur de ne pas se comprendre. La peur de ne pas parler la même langue. Pourtant, après quelques heures, on savait qu’on parlait la même langue : la langue de la honte. Alors, on a commencé à parler, à construire notre fraternité comme une case autour de la honte. Quand un Libérien ou un Nigérian parlait en anglais, tous les autres comprenaient. Pourquoi ? Parce que ce Nigérian ou ce Libérien était avant tout un homme honteux qui s’adressait à d’autres hommes honteux. Ce n’est pas la honte de partir, c’est la honte de ne pas avoir pu rester, de ne pas avoir pu trouver sa place dans son pays. On ne part pas pour les mêmes raisons, mais chacun de nous a une raison qui est liée à ça, à la honte que la société lui a fait subir. Mais nous avons quand même parlé. Et plus nous parlions, plus la honte disparaissait. Comme si nos hontes se réconfortaient et se consolaient les unes les autres. Alors petit à petit la honte a laisser la place au Rêve. Parce que ça aussi, ça nous liait, le Rêve.
Un jour des policiers nous ont trouvés. Ils sont arrivés et ont crié pour nous faire peur. Leur chef a dit qu’il allait nous renvoyer dans nos pays. Il a aussi dit que nous devions avoir honte d’abandonner l’Afrique. Qu’on était lâches, et qu’on fuyait le continent au lieu de la bâtir. Il a dit qu’il y avait la pauvreté, la corruption, l’absence d’emploi, mais que si tous les enfants du continent partaient, plus personne ne resterait pour le développer. Il nous a parlés comme si nous étions des enfants coupables d’une faute. Il nous ramenait à notre honte. On a appelé notre passeur. Il est venu et a discuté avec le policier à l’écart quelques minutes. J’ai vu notre passeur glisser des billets dans la main du policier. Après ça, le policier est parti sans rien nous dire avec ses hommes. Des hommes vraiment intègres, ces policiers, prêts à développer l’Afrique, à lutter contre la corruption.
Tiens, voilà le musée d’Altino. J’y étais il y a quelques jours/ On nous a montré les tableaux des deux artistes fous-là. Je n’ai rien compris à leurs dessins ! Il y en avait même un où il n’y avait rien, aucun dessin. Lucia m’a dit qu’il coûtait très cher ! Mais qu’est-ce qui coûte cher ? C’est ça que je lui demandais. Qu’est-ce qui coûte cher puisqu’il n’y a rien ? Elle a beaucoup ri. Elle me disait que c’est ce rien qui coûte cher. Vraiment, il n’y a que les Blancs pour acheter rien, et l’acheter très cher. Ils veulent posséder, toujours posséder. Et comme ils ont déjà tout, il leur manque rien. Donc ils l’achètent aussi.
Videos de Mohamed Mbougar Sarr (34)
Voir plusAjouter une vidéo
Ils écrivent sur la disparition pour imaginer de meilleurs lendemains. Annabelle Perrin, coordinatrice du livre "Tout doit disparaître", et Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, qui y a contribué, sont nos invités.
#culture #disparition #litterature ________ Écoutez d'autres personnalités qui font l'actualité de la culture dans Bienvenue au club https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqYh8kUxa2lt9m1vxzCac7X ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-club
Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
#culture #disparition #litterature ________ Écoutez d'autres personnalités qui font l'actualité de la culture dans Bienvenue au club https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqYh8kUxa2lt9m1vxzCac7X ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-club
Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Mohamed Mbougar Sarr (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Afrique dans la littérature
Dans quel pays d'Afrique se passe une aventure de Tintin ?
Le Congo
Le Mozambique
Le Kenya
La Mauritanie
10 questions
289 lecteurs ont répondu
Thèmes :
afriqueCréer un quiz sur ce livre289 lecteurs ont répondu