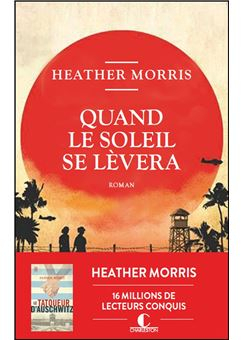Ricardo Menéndez Salmón/5
6 notes
Résumé :
Le 11 mars 2004, à Madrid, des bombes explosent dans quatre trains de banlieue.
Il y aura cent quatre-vingt-onze morts et un grand nombre de blessés. Lorsque Vladimir, écrivain raté devenu correcteur, apprend la nouvelle, il est en train de travailler sur une traduction des Démons de Dostoïevski, et alors que toute l'Espagne, y compris le gouvernement, voit dans l'attentat la main de l'ETA, lui comprend immédiatement que ce n'est pas possible. Non qu'il en sa... >Voir plus
Il y aura cent quatre-vingt-onze morts et un grand nombre de blessés. Lorsque Vladimir, écrivain raté devenu correcteur, apprend la nouvelle, il est en train de travailler sur une traduction des Démons de Dostoïevski, et alors que toute l'Espagne, y compris le gouvernement, voit dans l'attentat la main de l'ETA, lui comprend immédiatement que ce n'est pas possible. Non qu'il en sa... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le CorrecteurVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (2)
Ajouter une critique
Le Correcteur, de l'auteur espagnol Ricardo Menéndez Salmon, est un roman captivant qui explore les thèmes de la vérité, de l'identité et de la culpabilité dans le contexte des attentats terroristes de Madrid en 2004.
Le roman suit Vladimir, un écrivain raté devenu correcteur, qui se retrouve confronté à la tragédie des attentats alors qu'il travaille sur une traduction des Démons de Dostoïevski. Alors que l'Espagne entière, y compris le gouvernement, attribue l'attentat à l'ETA, Vladimir est convaincu du contraire.
Cette conviction le pousse à s'interroger sur sa propre vie et les secrets qu'il cache, en particulier l'existence d'un fils qu'il a eu avec une femme autre que sa conjointe actuelle.
Menéndez Salmon utilise une prose élégante et incisive pour tisser une histoire captivante qui explore les profondeurs de l'âme humaine. le roman est à la fois drôle et poignant, et il offre une réflexion nuancée sur les événements tragiques qui ont marqué l'Espagne.
En conclusion, le Correcteur est un roman puissant et émouvant qui mérite d'être lu par tous ceux qui s'intéressent à la littérature espagnole, aux questions sociales et à l'exploration de l'âme humaine.
Le roman suit Vladimir, un écrivain raté devenu correcteur, qui se retrouve confronté à la tragédie des attentats alors qu'il travaille sur une traduction des Démons de Dostoïevski. Alors que l'Espagne entière, y compris le gouvernement, attribue l'attentat à l'ETA, Vladimir est convaincu du contraire.
Cette conviction le pousse à s'interroger sur sa propre vie et les secrets qu'il cache, en particulier l'existence d'un fils qu'il a eu avec une femme autre que sa conjointe actuelle.
Menéndez Salmon utilise une prose élégante et incisive pour tisser une histoire captivante qui explore les profondeurs de l'âme humaine. le roman est à la fois drôle et poignant, et il offre une réflexion nuancée sur les événements tragiques qui ont marqué l'Espagne.
En conclusion, le Correcteur est un roman puissant et émouvant qui mérite d'être lu par tous ceux qui s'intéressent à la littérature espagnole, aux questions sociales et à l'exploration de l'âme humaine.
Y a-t-il encore des frères à appeler lorsque l'horreur terroriste se double de son exploitation cynique par le politique corrompu ? La lame aiguisée de Ricardo Menéndez Salmón.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2022/04/16/note-de-lecture-le-correcteur-ricardo-menendez-salmon/
Le 11 mars 2004, dix bombes explosent entre 7 h 32 et 7 h 39 dans plusieurs gares et trains de banlieue de l'agglomération madrilène, provoquant 192 morts et 1 858 blessés. Tandis que la nouvelle se répand instantanément – et que le très néo-libéral et conservateur chef de gouvernement de l'époque, José Maria Aznar, avec la complicité brûlante de son ministre de l'Intérieur, Ángel Acebes, accuse immédiatement avec force l'ETA basque, avant que les attentats ne soient quelques jours plus tard attribués à Al-Qaida -, un écrivain devenu « uniquement » correcteur, spécialiste notamment de Dostoïevski, assiste impuissant à la sidération générale, au choc et à l'effroi, et à l'envahissement, très logique ou pleinement irrationnel, de l'intime par le politique.
Juste après la publication du petit chef-d'oeuvre qu'était déjà sa « Nuit féroce » en 2006, Ricardo Menéndez Salmón se lançait dans une trilogie de courts romans consacrés à l'horreur du monde contemporain, que conclut en 2009 ce « Correcteur », traduit en français en 2011 chez Jacqueline Chambon par Delphine Valentin.
Face à l'horreur des attentats de Madrid de 2004, le grand romancier des Asturies s'intéresse pourtant moins aux phénomènes directs de sidération qui l'entourent (comme le fait avec une immense justesse le Pierre Demarty éruptif et songeur de « Manhattan Volcano »), mais plus profondément à ce qu'elle provoque plus insidieusement en nous, sur des terrains intimes souvent minés au préalable par des storytellings délétères, agencés intentionnellement ou non, et par une habitude du mensonge politique bien trop enracinée désormais, en Espagne comme ailleurs.
Ainsi, à travers ce narrateur inattendu, écrivain ayant volontairement renoncé à l'écriture, correcteur vivant en prise avec le contemporain mais plus encore avec Dostoïevski, Onetti, Kawabata ou Cheever en guise de véritable vademecum, Ricardo Menéndez Salmón réintroduit subrepticement du complexe là où la simplification voudrait tant régner, des ruses de la raison là où la pulsion brute cherche à prédominer, du cerveau qui pense un peu plutôt que de la moelle épinière qui agit par réflexe, et de la résonance intime – même joyeusement trafiquée vers un plus haut indice d'octane – plutôt que du salmigondis géopolitique.
Pour cette autre « Anatomie d'un instant » (le roi d'Espagne s'adressera à cette occasion pour la première fois directement à son peuple depuis le coup d'État avorté en 1981 qu'analyse si brillamment Javier Cercas), les échos construits par l'auteur se porteront ainsi plutôt, avec un brio et une ruse rares, vers les effondrements éthiques qui hantent le Mathieu Larnaudie des « Effondrés » et de « Acharnement », et davantage encore vers l'étude poétique de cas paranoïaque conduite, en Suède, par le Jonas Hassen Khemiri de « J'appelle mes frères » (2012). Lorsque le terrorisme parvient à conquérir les coeurs et les esprits avec la complicité de certains gouvernants apprentis sorciers, il a de facto déjà gagné – et souvent bien au-delà de ses attentes.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2022/04/16/note-de-lecture-le-correcteur-ricardo-menendez-salmon/
Le 11 mars 2004, dix bombes explosent entre 7 h 32 et 7 h 39 dans plusieurs gares et trains de banlieue de l'agglomération madrilène, provoquant 192 morts et 1 858 blessés. Tandis que la nouvelle se répand instantanément – et que le très néo-libéral et conservateur chef de gouvernement de l'époque, José Maria Aznar, avec la complicité brûlante de son ministre de l'Intérieur, Ángel Acebes, accuse immédiatement avec force l'ETA basque, avant que les attentats ne soient quelques jours plus tard attribués à Al-Qaida -, un écrivain devenu « uniquement » correcteur, spécialiste notamment de Dostoïevski, assiste impuissant à la sidération générale, au choc et à l'effroi, et à l'envahissement, très logique ou pleinement irrationnel, de l'intime par le politique.
Juste après la publication du petit chef-d'oeuvre qu'était déjà sa « Nuit féroce » en 2006, Ricardo Menéndez Salmón se lançait dans une trilogie de courts romans consacrés à l'horreur du monde contemporain, que conclut en 2009 ce « Correcteur », traduit en français en 2011 chez Jacqueline Chambon par Delphine Valentin.
Face à l'horreur des attentats de Madrid de 2004, le grand romancier des Asturies s'intéresse pourtant moins aux phénomènes directs de sidération qui l'entourent (comme le fait avec une immense justesse le Pierre Demarty éruptif et songeur de « Manhattan Volcano »), mais plus profondément à ce qu'elle provoque plus insidieusement en nous, sur des terrains intimes souvent minés au préalable par des storytellings délétères, agencés intentionnellement ou non, et par une habitude du mensonge politique bien trop enracinée désormais, en Espagne comme ailleurs.
Ainsi, à travers ce narrateur inattendu, écrivain ayant volontairement renoncé à l'écriture, correcteur vivant en prise avec le contemporain mais plus encore avec Dostoïevski, Onetti, Kawabata ou Cheever en guise de véritable vademecum, Ricardo Menéndez Salmón réintroduit subrepticement du complexe là où la simplification voudrait tant régner, des ruses de la raison là où la pulsion brute cherche à prédominer, du cerveau qui pense un peu plutôt que de la moelle épinière qui agit par réflexe, et de la résonance intime – même joyeusement trafiquée vers un plus haut indice d'octane – plutôt que du salmigondis géopolitique.
Pour cette autre « Anatomie d'un instant » (le roi d'Espagne s'adressera à cette occasion pour la première fois directement à son peuple depuis le coup d'État avorté en 1981 qu'analyse si brillamment Javier Cercas), les échos construits par l'auteur se porteront ainsi plutôt, avec un brio et une ruse rares, vers les effondrements éthiques qui hantent le Mathieu Larnaudie des « Effondrés » et de « Acharnement », et davantage encore vers l'étude poétique de cas paranoïaque conduite, en Suède, par le Jonas Hassen Khemiri de « J'appelle mes frères » (2012). Lorsque le terrorisme parvient à conquérir les coeurs et les esprits avec la complicité de certains gouvernants apprentis sorciers, il a de facto déjà gagné – et souvent bien au-delà de ses attentes.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
Ce matin-là, cependant, même le téléviseur n'a pas pu servir de palliatif à l'horreur
La politique devient ainsi l'art de déguiser le mensonge.
Parfois, les mots ne servent à rien.
Quand le premier train a explosé, déversant sur nos petites vies courageuses un flot de sang, de colère et de peur, j’étais assis devant ma vieille table en frêne d’Australie et je corrigeais un jeu d’épreuves des Démons de Fedor Dostoïevski.
Je m’appelle Vladimir – jeune, mon père était passionné par la révolution russe – et je suis correcteur. Et j’oserai affirmer que Fedor Dostoïevski est mon écrivain préféré. (Peut-être que dix ans plus tôt, quand j’avais vingt-cinq ans, j’aurais affirmé que mon écrivain préféré était Albert Camus, et probablement que dans dix ans, quand j’en aurai quarante-cinq, je pencherai plutôt pour Stendhal ou Platon.)
À 7 h 37 le jeudi 11 mars 2004, je me trouvais donc, tout frais, après avoir pris mon petit-déjeuner, une belle lumière d’hiver pénétrant par la fenêtre comme un trait de givre, en train de lire un jeu d’épreuves composées en caractère typographique bembo, corps 12, au moment où Alexeï Kirilov avoue à Piotr Verhovenski que « la peur est la malédiction de l’homme », quand le premier train a explosé et que soudain nos compteurs ont été remis à zéro.
Aujourd’hui, évidemment, alors que tant de choses sont arrivées depuis et que les émotions ont été passées au tamis de la réflexion, tout apparaît de façon moins confuse, plus aisée à comprendre, mais, durant les heures que décrit cette chronique, nous tous qui étions là (et je crois que tout le monde, d’une façon ou d’une autre, était là) avons senti que les temps heureux avaient touché à leur fin.
Bien sûr, les temps heureux s’approchaient de leur fin depuis déjà pas mal de printemps, et périodiquement, comme si nous avions besoin de corroborer l’idée subtile qu’Alexeï Kirilov exposait à Piotr Verhovenski pendant que les premières bombes transformaient l’acier des trains en lave brûlante et les os des victimes en poussière ; périodiquement, donc, bien sûr, nous sentons la nécessité de nous infliger les uns aux autres de quoi nous rappeler, sans laisser de place au doute, que, un beau jour, tout foutra le camp, tout simplement.
Nous les hommes, sans exception, noirs et blancs, heureux et tristes, intelligents et idiots, nous sommes ainsi : nous arborons des drapeaux que d’autres détestent, nous adorons des dieux qui offensent nos voisins, nous nous entourons de lois qui insultent ceux qui nous entourent. La conséquence est facile à déduire : de temps en temps, sous le soleil ou sous la neige, en démocratie ou sous l’égide de quelque fasciste déguisé en inspecteur des finances, nous venons écraser des avions sur des gratte-ciel, nous bombardons des pays déjà dénués de toute richesse et nous nous embarquons dans des croisades aussi atroces qu’injustes.
Quand le téléphone a sonné, aux environs de 8 h 50, j’avais mis de côté les pages lumineuses, fascinantes dans lesquelles Alexeï Kirilov expose les raisons de son suicide imminent, et j’étais sur le point d’allumer la première cigarette de la journée. À ce moment-là, évidemment, je ne savais encore rien, et c’est seulement a posteriori, aidé par mon bagage littéraire et mon inclination pour la fiction, que j’ai pu donner une forme artistique à cette première impression, que je n’eus en réalité que soixante-dix ou quatre-vingts minutes après cet instant où le premier train a imprégné l’air de Madrid d’une odeur de viscères.
« Tu es au courant ? »
Je m’appelle Vladimir – jeune, mon père était passionné par la révolution russe – et je suis correcteur. Et j’oserai affirmer que Fedor Dostoïevski est mon écrivain préféré. (Peut-être que dix ans plus tôt, quand j’avais vingt-cinq ans, j’aurais affirmé que mon écrivain préféré était Albert Camus, et probablement que dans dix ans, quand j’en aurai quarante-cinq, je pencherai plutôt pour Stendhal ou Platon.)
À 7 h 37 le jeudi 11 mars 2004, je me trouvais donc, tout frais, après avoir pris mon petit-déjeuner, une belle lumière d’hiver pénétrant par la fenêtre comme un trait de givre, en train de lire un jeu d’épreuves composées en caractère typographique bembo, corps 12, au moment où Alexeï Kirilov avoue à Piotr Verhovenski que « la peur est la malédiction de l’homme », quand le premier train a explosé et que soudain nos compteurs ont été remis à zéro.
Aujourd’hui, évidemment, alors que tant de choses sont arrivées depuis et que les émotions ont été passées au tamis de la réflexion, tout apparaît de façon moins confuse, plus aisée à comprendre, mais, durant les heures que décrit cette chronique, nous tous qui étions là (et je crois que tout le monde, d’une façon ou d’une autre, était là) avons senti que les temps heureux avaient touché à leur fin.
Bien sûr, les temps heureux s’approchaient de leur fin depuis déjà pas mal de printemps, et périodiquement, comme si nous avions besoin de corroborer l’idée subtile qu’Alexeï Kirilov exposait à Piotr Verhovenski pendant que les premières bombes transformaient l’acier des trains en lave brûlante et les os des victimes en poussière ; périodiquement, donc, bien sûr, nous sentons la nécessité de nous infliger les uns aux autres de quoi nous rappeler, sans laisser de place au doute, que, un beau jour, tout foutra le camp, tout simplement.
Nous les hommes, sans exception, noirs et blancs, heureux et tristes, intelligents et idiots, nous sommes ainsi : nous arborons des drapeaux que d’autres détestent, nous adorons des dieux qui offensent nos voisins, nous nous entourons de lois qui insultent ceux qui nous entourent. La conséquence est facile à déduire : de temps en temps, sous le soleil ou sous la neige, en démocratie ou sous l’égide de quelque fasciste déguisé en inspecteur des finances, nous venons écraser des avions sur des gratte-ciel, nous bombardons des pays déjà dénués de toute richesse et nous nous embarquons dans des croisades aussi atroces qu’injustes.
Quand le téléphone a sonné, aux environs de 8 h 50, j’avais mis de côté les pages lumineuses, fascinantes dans lesquelles Alexeï Kirilov expose les raisons de son suicide imminent, et j’étais sur le point d’allumer la première cigarette de la journée. À ce moment-là, évidemment, je ne savais encore rien, et c’est seulement a posteriori, aidé par mon bagage littéraire et mon inclination pour la fiction, que j’ai pu donner une forme artistique à cette première impression, que je n’eus en réalité que soixante-dix ou quatre-vingts minutes après cet instant où le premier train a imprégné l’air de Madrid d’une odeur de viscères.
« Tu es au courant ? »
Ce qui éloigne de façon décisive l’homme politique de l’écrivain, c’est leur relation inverse aux détails. La politique, par définition, est le règne de la négation du détail. George Walker Bush dit dans un micro ouvert : « Il faut en finir avec cette merde », et « cette merde », c’est le Liban, c’est le Hezbollah, la Syrie, c’est Israël, c’est la Palestine, c’est une histoire millénaire fondée sur l’intolérance religieuse et nourrie par des intérêts économiques qui portent préjudice à des millions de personnes.
La littérature, quant à elle, est par définition la fraternité du détail, une pratique déjà millénaire qui se nourrit du détail, un exercice exigeant qui trouve dans le détail sa récompense et sa raison profonde d’exister. Car l’écrivain, dans ce cas précis, doit plonger dans le détail et expliquer ce que diable incarne « cette merde », pourquoi cela sent si mauvais, qui l’a générée, qui la tolère et la permet, qui en a fait son mode de vie. L’écrivain est l’individu qui analyse « cette merde » abstraite que l’homme politique répand sur les cartes. Et c’est dans cette leçon d’eschatologie méticuleuse et parfois déplaisante, dans ce délicat processus d’exploration des détails qui font que « cette merde » est ce qu’elle est et pas autre chose, que l’écrivain trouve sa récompense essentielle : la dignité.
Pervertir la réalité au moyen du langage, parvenir à faire en sorte que le langage dise ce que la réalité nie, voilà l’une des conquêtes majeures du pouvoir. La politique devient ainsi l’art de déguiser le mensonge.
La littérature, quant à elle, est par définition la fraternité du détail, une pratique déjà millénaire qui se nourrit du détail, un exercice exigeant qui trouve dans le détail sa récompense et sa raison profonde d’exister. Car l’écrivain, dans ce cas précis, doit plonger dans le détail et expliquer ce que diable incarne « cette merde », pourquoi cela sent si mauvais, qui l’a générée, qui la tolère et la permet, qui en a fait son mode de vie. L’écrivain est l’individu qui analyse « cette merde » abstraite que l’homme politique répand sur les cartes. Et c’est dans cette leçon d’eschatologie méticuleuse et parfois déplaisante, dans ce délicat processus d’exploration des détails qui font que « cette merde » est ce qu’elle est et pas autre chose, que l’écrivain trouve sa récompense essentielle : la dignité.
Pervertir la réalité au moyen du langage, parvenir à faire en sorte que le langage dise ce que la réalité nie, voilà l’une des conquêtes majeures du pouvoir. La politique devient ainsi l’art de déguiser le mensonge.
Lire un extrait
Videos de Ricardo Menéndez Salmón (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ricardo Menéndez Salmón (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3674 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3674 lecteurs ont répondu