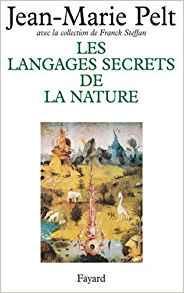Jean-Marie PeltFranck Steffan
Franck Steffan (Collaborateur)/5 63 notes
Franck Steffan (Collaborateur)/5 63 notes
Résumé :
Si les vertus médicinales des plantes sont depuis longtemps connues de l'homme, l'idée d'une communication entre elles et nous - la fameuse « main verte » - passe encore bien souvent pour un mythe ou une superstition. Et pourtant, les plus récentes avancées de la biologie végétale le confirment : les plantes ont bel et bien une sensibilité, un langage, une mémoire.
Jean-Marie Pelt expose ici des faits prouvés, démontrant par exemple comment des arbres... >Voir plus
Jean-Marie Pelt expose ici des faits prouvés, démontrant par exemple comment des arbres... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les Langages secrets de la natureVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
C'est le magnifique livre de Didier van Cauwelaert (Les émotions cachées des plantes) qui m'a menée à cette lecture. Quel mal m'en a prise ? Cela fait des jours et des jours que je savoure goulûment (non ce n'est pas antagoniste ici) cet ouvrage et que je ne peux m'en extraire, comment en sortir ? Ce n'est pas une lecture, c'est comme si je m'étais inscrite à un cours de biologie végétale pour deux ans, avec qui plus est un professeur merveilleux, d'une immense générosité, et que la prétention me viendrait d'en faire une synthèse à la fin de la première semaine.
Je capitule, et, pour en finir, lâchement, je vais me résoudre à me contenter à en dire ceci : que cet ouvrage renferme toutes les beautés, toutes les merveilles mais aussi toutes les cruautés de la nature ; et à en résumer le coeur, et surtout l'enseignement que j'en dire personnellement, à cet extrait, qui clôture le chapitre 10 «Où chacun est mis au parfum» :
« Dans la vision globale qu'elle propose et l'éthique nouvelle qui la sous-tend, l'écologie tente aujourd'hui de redonner un sens à la vie et au monde. Cette démarche passe par la redécouverte des « sens oubliés » que le monde mécanisé et technicisé a négligés au profit de la machine et du robot, certes plus performants, mais étrangers à notre corps, et de l'audiovisuel, qui encombre l'oeil et l'oreille jusqu'à plus soif, mais néglige totalement l'odorat. Car le malaise des âmes est l'expression confuse d'un certain malaise des corps, et l'on ne réconciliera l'homme avec la nature que dans la mesure où l'on saura aussi le réconcilier avec lui-même et ses semblables.
Les déséquilibres sexuels, si fréquemment observés aujourd'hui dans nos univers de métal, de verre et de béton, ne sont peut-être, après tout, qu'une maladroite tentative de revanche des corps marqués par cette profonde rupture qui s'est consommée en moins d'une génération entre l'homme et la nature, et brusquement amputés de leur environnement naturel et culturel. Cas si l'homme se crée des environnements nouveaux entièrement artificiels, ceux-ci le marquent à leur tour. L'environnement n'est pas neutre : support de notre existence, il doit rester le cordon ombilical qui nous lie à cette nature dont nous sommes et qui nous porte ?. L'oublier serait s'exposer aux plus graves périls. Entre l'ordinateur et le marronnier, s'il fallait choisir, c'est le marronnier qu'il faudrait garder. »
« J'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin … » mais rien n'y sera jamais pareil désormais.
Je capitule, et, pour en finir, lâchement, je vais me résoudre à me contenter à en dire ceci : que cet ouvrage renferme toutes les beautés, toutes les merveilles mais aussi toutes les cruautés de la nature ; et à en résumer le coeur, et surtout l'enseignement que j'en dire personnellement, à cet extrait, qui clôture le chapitre 10 «Où chacun est mis au parfum» :
« Dans la vision globale qu'elle propose et l'éthique nouvelle qui la sous-tend, l'écologie tente aujourd'hui de redonner un sens à la vie et au monde. Cette démarche passe par la redécouverte des « sens oubliés » que le monde mécanisé et technicisé a négligés au profit de la machine et du robot, certes plus performants, mais étrangers à notre corps, et de l'audiovisuel, qui encombre l'oeil et l'oreille jusqu'à plus soif, mais néglige totalement l'odorat. Car le malaise des âmes est l'expression confuse d'un certain malaise des corps, et l'on ne réconciliera l'homme avec la nature que dans la mesure où l'on saura aussi le réconcilier avec lui-même et ses semblables.
Les déséquilibres sexuels, si fréquemment observés aujourd'hui dans nos univers de métal, de verre et de béton, ne sont peut-être, après tout, qu'une maladroite tentative de revanche des corps marqués par cette profonde rupture qui s'est consommée en moins d'une génération entre l'homme et la nature, et brusquement amputés de leur environnement naturel et culturel. Cas si l'homme se crée des environnements nouveaux entièrement artificiels, ceux-ci le marquent à leur tour. L'environnement n'est pas neutre : support de notre existence, il doit rester le cordon ombilical qui nous lie à cette nature dont nous sommes et qui nous porte ?. L'oublier serait s'exposer aux plus graves périls. Entre l'ordinateur et le marronnier, s'il fallait choisir, c'est le marronnier qu'il faudrait garder. »
« J'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin … » mais rien n'y sera jamais pareil désormais.
Toujours aussi captivant, où comment les plantes et les animaux, s'aident parfois à survivre, à se développer...Des liens existent que nous croisons tous les jours mais dont nous n'avons aucune idée...à lire!!
Ce livre n'est pas un roman, mais il se lit comme un roman : il est tout simplement passionnant. On ne peut qu'être émerveillé par la complexité des interactions entre les plantes elles mêmes et leur environnement. L'auteur nous ouvre les yeux sur le monde végétal qui nous est proche, mais dont nous ignorons tout ou presque ! Après avoir lu cet ouvrage, vous ne regarderez certainement plus les plantes de la même manière !
De façon poétique, Jean Marie Pelt nous enseigne les particularités étranges des plantes et leurs influences sur les humains et comme les contes étiologiques il nous explique les noms vulgaires qu'on a pu leur donner . Un peu de botanique nous fait voir autrement la végétation qui nous entoure et qui peut nous aider par leur pouvoir curatif ou autres mais qui peut aussi nous soigner mentalement dans nos moments de faiblesses. Une leçon de choses et de philosophie.
Un regard transversal sur le langage de la nature : le début du livre est un peu lent mais les chapitres nous emportent finalement vers un voyage haut en couleur nous offrant une vue sur cette réalité incroyable qui nous échappe.
Citations et extraits (16)
Voir plus
Ajouter une citation
En Inde, une tradition rapporte que le dieu Krishna faisait jouer de la musique afin que la végétation de ses jardins devînt de plus en plus luxuriante. Dans les années 60, le Dr Singh, botaniste de l'université d'Annamalaï, féru d'histoire ancienne de l'Inde, fit écouter de la musique à ses plantes et constata une croissance plus rapide et une plus grande robustesse que chez des plantes témoins. De surcroît, il semblerait même que des plantes à fleurs soient en avance lors de leur floraison par le simple fait d'une exposition prolongée à la musique. Le Dr Singh affirme également et démontre par quelques essais que les récoltes sont plus riches si l'on utilise un fond musical. Il pratique même des expériences à grande échelle, émettant de la musique par haut-parleurs sur des champs cultivés et compare les résultats à ceux de champs témoins dont la croissance se révèle plus lente. On discerne d'emblée un effet pervers de ce genre d'expérimentation : qu'adviendrait-il demain si de la musique tonitruait dans nos campagnes ?
C'est à la fin des années 60 que Dorothy Retallack, biologiste et mélomane, entreprit des travaux, d'ailleurs fort controversés, sur les effets de la musique sur les plantes. Elle fit des révélations surprenantes qui suscitèrent dans le monde scientifique des réactions plutôt hostiles, mais que les médias reprirent à grand fracas. Selon D. Retallack, la musique préférée des plantes serait la musique orientale, qui pourrait aller jusqu'à doubler le rythme de leur croissance, notamment les « raga » joués par des instruments à cordes. Au second rang, on trouve la musique classique, avec une prédilection pour Jean-Sébastien Bach, suivie de très près par le jazz, à condition de supprimer les percussions. Quant au rock et autres musiques dites « hard » ou « acide », elles provoquent à court ou long terme des lésions irréversibles. Il serait donc fortement déconseillé de « sortir » les plantes en discothèque sous prétexte de leur faire changer d'atmosphère ! (pp. 218-219)
C'est à la fin des années 60 que Dorothy Retallack, biologiste et mélomane, entreprit des travaux, d'ailleurs fort controversés, sur les effets de la musique sur les plantes. Elle fit des révélations surprenantes qui suscitèrent dans le monde scientifique des réactions plutôt hostiles, mais que les médias reprirent à grand fracas. Selon D. Retallack, la musique préférée des plantes serait la musique orientale, qui pourrait aller jusqu'à doubler le rythme de leur croissance, notamment les « raga » joués par des instruments à cordes. Au second rang, on trouve la musique classique, avec une prédilection pour Jean-Sébastien Bach, suivie de très près par le jazz, à condition de supprimer les percussions. Quant au rock et autres musiques dites « hard » ou « acide », elles provoquent à court ou long terme des lésions irréversibles. Il serait donc fortement déconseillé de « sortir » les plantes en discothèque sous prétexte de leur faire changer d'atmosphère ! (pp. 218-219)
« Si l’on pouvait attribuer un quotient intellectuel aux végétaux, les plantes grimpantes viendraient en tête, et ce prix d’intelligence se doublerait d’un prix de gymnastique » Pierre Rossion (journaliste scientifique)
qui ajoute : « les lecteurs qui auront planché sur les nœuds marins au cours d’un stage de voile ou de leur service dans la Royale, seront surpris d’apprendre qu’une plante grimpante comme la passiflore utilise les variantes du nœud de vache, de chaise, ou du nœud simple…. Pour se fixer sur ses supports » !
qui ajoute : « les lecteurs qui auront planché sur les nœuds marins au cours d’un stage de voile ou de leur service dans la Royale, seront surpris d’apprendre qu’une plante grimpante comme la passiflore utilise les variantes du nœud de vache, de chaise, ou du nœud simple…. Pour se fixer sur ses supports » !
Si l'on interroge les personnes aux "mains vertes", elles affirment que l'humeur du jardinier ou de l'horticulteur se répercute sur l'aspect des plantes : l'état de santé et l'esthétique des végétaux refléteraient l'état d'âme de la personne qui s'en occupe. Si cette intuition devait se confirmer, il suffirait de voir comment les hommes traitent la planète pour nous représenter leur état d'âme !
"Courante était l'utilisation des fameux balais qui emportaient les sorcières au sabbat et n'étaient somme toute que de simples balais dont le manche avait été enduit d'onguents riches en substances toxiques. L'introduction de l'extrémité du manche dans le vagin entrainait une rapide pénétration des poisons dans le sang. Ces substances provoquent des délires accompagnés notamment d'une sensation d'envol ou de chute, d'où les comptes rendus émanant des intéressées et parlant de fantastiques chevauchées au-dessus des plaines et des montagnes..."
"Nombreux sont les arbres ou les herbes qui protègent leur territoire par des sécrétions ou des excrétions toxiques pour les autres plantes, voire pour les insectes. De tels végétaux qui font ainsi souffrir les autres sont qualifiés d'allélopathiques. Aucune graine ne parvient à germer dans ces ambiances délétères. C'en est à tel point que de petites herbes finissent par se contrarier mutuellement et en viennent à s'empoisonner les unes les autres par excès de leur sécrétion: c'est la version végétale du suicide."
Videos de Jean-Marie Pelt (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Rencontre avec Jean-Marie Pelt à l'occasion de la sortie de son livre "L"évolution vue par un botaniste".
autres livres classés : Communication animaleVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Marie Pelt (68)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3205 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3205 lecteurs ont répondu