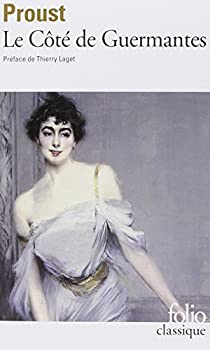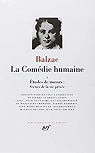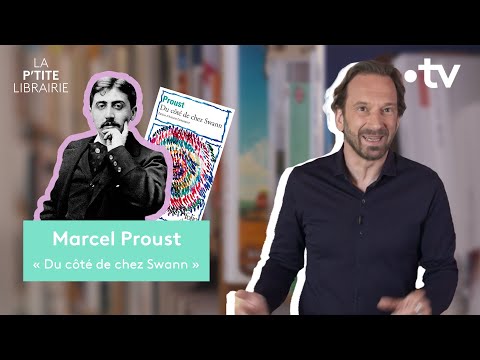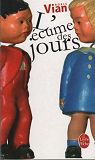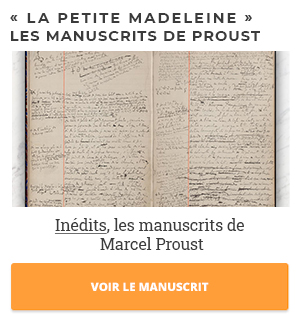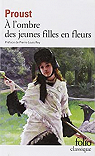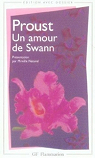Marcel ProustA la recherche du temps perdu - ... tome 3 sur 7
Thierry Laget (Éditeur scientifique)Brian G. Rogers (Éditeur scientifique)/5 771 notes
Thierry Laget (Éditeur scientifique)Brian G. Rogers (Éditeur scientifique)/5 771 notes
Résumé :
Ce troisième volet de la Recherche est marqué par l'installation du narrateur et de sa famille dans un nouveau foyer, près de la demeure des Guermantes. Le quotidien de notre héros se trouve rythmé par la vie de ses prestigieux voisins, qu'il ne tarde pas à côtoyer grâce à la bienveillance de Saint-Loup.
L'entrée dans le "jeu de la vie mondaine" s'accompagne chez le narrateur d'un éveil à la sensualité. Entre idéalisation et fantasme, il voit renaître... >Voir plus
L'entrée dans le "jeu de la vie mondaine" s'accompagne chez le narrateur d'un éveil à la sensualité. Entre idéalisation et fantasme, il voit renaître... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après À la recherche du temps perdu, tome 3 : Le côté de GuermantesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (57)
Voir plus
Ajouter une critique
Marcel Proust fait partie de cette famille d'écrivains convaincus que l'on écrit toujours et invariablement le même livre. «Ce livre essentiel – déclare-t-il dans «Contre Sainte-Beuve» - que l'écrivain n'a pas, dans le sens courant, à inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous».
Et nous, en tant que lecteurs, lirions-nous, malgré leur apparente diversité, toujours un même livre préexistant en chacun de nous et que nous aurions néanmoins omis d'écrire? Et puis, dans quelle mesure, après les avoir parcourus, n'en écririons-nous peut-être toujours une seule et même chronique de lecture? Personnellement, j'aime penser que cette hypothèse serait plausible.
Ce drôle de sentiment, qu'on aura par intermittence (ah, ces intermittences du coeur...!) éprouvé ou pas dans nos vies de lecteurs et/ou chroniqueurs, qu'il peut en revanche sembler évident quand il s'agit de «À la Recherche du Temps Perdu» et des impressions de lecture qu'on se proposerait éventuellement d'écrire à la fin de chaque volume parcouru! (Si bien que je me demande si finalement je n'aurais mieux fait d'avoir terminé le cycle romanesque complet avant de me mettre à rédiger ma [seule, unique et même] chronique!!)
D'emblée déjà, à mon avis, se pose à tout chroniqueur téméraire s'aventurant à vouloir «saucissonner» l'oeuvre, le défi herculéen de pouvoir trancher dans le tas d'un tel enchevêtrement d'instants qui ont chacun l'air de s'étirer indéfiniment, formant une suite de tableaux à la temporalité gigogne qu'on n'arrête pas de remboîter les uns dans les autres, habillés en même temps dans un luxe de détails parmi lesquels il arrive assez régulièrement qu'on égare momentanément son stylet aiguisé de lecteur : comment dès lors procéder à une «coupe» quelconque, «transversale» (ou même longitudinale, d'ailleurs…) analytique et critique, à la fin de chaque volume du cycle, sans avoir l'impression que cette dernière se révélerait non seulement arbitraire, réductrice, mais fondamentalement partielle et artificielle?
D'autre part - en tout cas au point où j'en suis de ma lecture, à la fin de ce troisième «volume»-, je me demande comment positionner le curseur des réminiscences du Narrateur sans revenir sur celui des précédents tomes, dans lesquels, certains souvenirs fondateurs qu'il revisite en ce moment, il se les remémorait plus jeune, mais aussi sur celui des réminiscences encore à venir dont la couleur est d'ores et déjà annoncée, suffisamment en filigrane en tout cas pour que le lecteur finisse à un moment ou un autre par soupçonner que ce temps de l'imparfait du subjonctif qui règne en apparence dans « La Recherche » servirait en réalité à dissimuler un futur du passé, insaisissable et furtif, mais néanmoins souverain, seul véritable ciment grammatical soutenant son édification.
Avec la publication et la renommée mondiale acquise par l'oeuvre, Proust aura en quelque sorte préparé le terrain à l'éclosion de ce fantasme souvent caressé par la littérature contemporaine (voire «expérimenté» parfois, avec plus ou moins de succès, par certains auteurs post-modernes), celui d'écrire une roman composé d'une seule et unique phrase!
Un roman dans lequel, en somme, les heures fugitives de notre existence, qui sont la plupart du temps affadies, déjà éparpillées au moment même où elles sonnent à nos sens accaparés par une foule de stimuli à décrypter, par le travail immatériel d'orchestration de l'écriture, par la beauté de la langue susceptible de les rassembler enfin en une harmonie tant rêvée, deviendraient les notes de cette partition unique, en un seul acte, qu'on souhaiterait tous pouvoir jouer devant nous au moins une fois avant de quitter définitivement la scène.
«Est-ce parce que nous ne revivons pas nos années dans leur suite continue, jour par jour, mais dans le souvenir figé dans la fraîcheur ou l'insolation d'une matinée ou d'un soir, recevant l'ombre de tel site isolé, enclos, immobile, arrêté et perdu, loin de tout le reste (…) [que] si nous revivons un autre souvenir prélevé sur une année différente, nous trouvons entre eux, dues à des lacunes, à d'immenses pans d'oubli, comme l'abîme d'une différence d'altitude, comme l'incompatibilité de deux qualités incomparables d'atmosphère respirée et de colorations ambiantes?»
Enfin, last but not least, après en avoir parcouru plus de deux mille pages comme moi, le lecteur pourra éventuellement, comme c'est mon cas aussi, garder toujours cette sensation diffuse que, paradoxalement, depuis l'enfance du narrateur à Combray, jusqu'aux salons les plus prestigieux du «faubourg St Germain» dont la mécanique sera, comme pour le reste, encore une fois minutieusement disséquée dans le présent volume, rien ne s'est passé en définitive, très peu en tout cas, dans un cycle romanesque qui serait comme dépourvu «d'intrigue romanesque» dans le sens premier du mot ; dans lequel, extérieurement, aucun fait, en dehors d'évènements banals et contingents, aucune action ou péripétie exceptionnelles ne peuvent être véritablement mises en avant, et intérieurement, en revanche, comme si aucun «abîme» ou «différence d'altitude» n'avait séparé une époque de l'autre…
L'histoire n'existe en tant que telle, a-t-on alors le sentiment, que parce que le Narrateur se souvient de lui-même devant cette «old same story» qui, indépendamment des époques et des milieux, est la même pour tous, l'apanage de tous les humains, qu'ils soient nobles ou bourgeois, paysans ou ouvriers.
La réminiscence en soi, sans aucune hiérarchie narrative classique ou prédéterminée, avec les pensées et les sensations qu'elle fait émerger, serait le vrai objet du récit, plutôt que des faits vécus dans une succession chronologique raisonnée, ou dans une rapport d'importance ou de grandeur purement rationnels (c'est ainsi par exemple, qu'à cette époque «du côté de Guermantes» on ne saura pas grand-chose sur les véritables motivations ou difficultés à écrire que rencontrait alors notre jeune Narrateur basculant dans l'âge adulte, thème occupant, concrètement, une place infinitésimale à côté de celle, immense, de deux réunions mondaines dont la description détaillée remplit plus d'un tiers du roman !!)
(Et en relisant ce que je viens d'écrire, je me sens de mon côté de plus en plus incapable d'en extraire et déterminer avec certitude ce qui y serait fondamental par rapport au provisoire, subsidiaire et accessoire par rapport à l'essentiel, ou simple surface par rapport au fond !!)
«Nous ne profitons guère de notre vie, nous laissons inachevées dans les crépuscules d'été ou les nuits précoces de l'hiver les heures où il nous avait semblé qu'eût pu pourtant être enfermé un peu de paix ou de plaisir.»
Et n'entendons-nous pas, nous aussi, nous exclamer quelquefois : «Le temps est passé et je n'ai rien vu arriver»... !
Aussi, quand par moments nous revient-il, ce n'est pas parfois sans un certain étonnement qu'au gré de nos associations, tombant, par exemple, sur l'image des chaussettes dépareillées d'un des pianistes les plus virtuoses de son temps que, des années auparavant, l'on avait entraperçues sous son instrument lorsque nous avions eu la chance d'assister à l'un des derniers concerts qu'il avait donnés de son vivant, image remontant soudain dans notre esprit avec une netteté parfaite, nous devrons ensuite faire un effort considérable, avec plus au moins de succès, pour ne retrouver en fin de compte que quelques titres des sublimes morceaux choisis qu'il avait exécutés ce soir-là…
C'est en fin de compte dans cette puissance mystérieusement aléatoire d'évocation, servie par la divine beauté suspensive dont la langue de Proust sait se parer, que résiderait essentiellement, à mon avis, la fascination intense que l'oeuvre peut exercer sur nous, mais qui, cependant, chez d'autres lecteurs, l'ayant recherchée au contraire, et à tort me semble-t-il, dans une intrigue quelconque, quasiment inexistante en l'occurrence, se sera vu muée en rejet pur et simple.
C'est elle, par exemple, qui permet au Narrateur la possibilité de revivre enfin pleinement les sensations qui, à une autre époque, cette autre langue, la sienne propre, effleurant alors concrètement pour la première fois la joue d'une Albertine enfin consentante, n'avait pu y goûter aucune saveur particulière, obstruée sur le champ, et privée qu'elle était en même temps d'une aide supplémentaire de l'odorat, par un nez écrasé contre l'épiderme, ainsi que de ses yeux obnubilés de leur côté par la vision trop rapprochée de son grain ; ou encore de faire remonter depuis ses émotions engourdies et dans l'absence de larmes au moment de l'agonie et du décès de sa grand-mère, cette image sublime, inaltérable face à la mort, (et en même temps peut-être curieusement familière et proche pour un certain nombre d'entre nous, ses lecteurs), celle d'un «visage redevenu jeune, d'où avait disparu les rides, les contractions, les empâtements, les tensions, les fléchissements que depuis tant d'années, lui avait ajoutés la souffrance (…) les traits délicatement tracés par la pureté et la soumission, les joues brillantes d'une chaste espérance, d'un rêve de bonheur, même d'une innocente gaité, que les années avaient peu à peu détruits. La vie se retirant venait d'emporter les désillusions de la vie. Un sourire semblait posé sur les lèvres de ma grand-mère. Sur ce lit funèbre, la mort comme le sculpteur du Moyen-Âge, l'avait couchée sous l'apparence d'une jeune fille.»
À partir d'une temporalité toujours relative, décomposée en une infinitude de particules éparses dans l'esprit de son créateur, à partir de son histoire et de son expérience propre, de l'observation de la société de son époque, d'une quantité incalculable de notes de lecture, embrassant de très nombreux sujets sociétaux, domaines de connaissance et disciplines artistiques, l'auteur bâtit à coup d'une infinité de cahiers et de «paperoles» disséminées un peu partout dans ses brouillons (et qui feraient apparemment toujours tirer les cheveux à ses éditeurs posthumes !), de chapitres composés dans le désordre, de révisions interminables du contenu et de l'ordonnancement de ses manuscrits, un univers littéraire unique, extrêmement complexe à cerner, un hybride entre mémoire et imagination, monde fictionnel et réel, entre personnages de roman et figures historiques, entre fiction et autobiographie. Univers dont la reconstitution par le lecteur, au gré des réminiscences de son Narrateur, déclinées sur plusieurs milliers de pages et en sept volumes, pourrait à la limite se faire aussi dans le désordre, et sa lecture être entamée par n'importe laquelle de ses subdivisions ou chapitres, car l'artiste fragile et immense ne nous inviterait-il justement à abattre les cloisons entre ces mondes parallèles qui coexistent en chacun de nous, à effacer la distance entre ce qui fut et ce qui est, entre ce qui aurait dû être marquant et ce qui le fût vraiment, entre celui qu'on a oublié et celui qui s'en souvient ?
Si la «Recherche» ne fut pas écrite d'une seule et stratosphérique phrase, cette «vocation invisible» semble la traverser entièrement, aussi bien dans ses grands motifs narratifs parcourant en surface ses successifs tomes, que dans les moindres détours de ses innombrables digressions à l'intérieur de chacun : une seul et unique bloc temporel, ouvragé comme un sculpture de soi où l'artiste, travaillant la matière brute du souvenir, au fur à mesure de ses coups plus ou moins guidés, mais surtout au hasard des affleurements qu'il y provoquerait accidentellement, découvre ce qui ayant été toujours en lui et préexistant à son apprentissage du monde et à son intelligence des choses, il méconnaissait cependant jusque lors ...
Je me rends compte qu'au vu du format conseillé, je m'étends trop ici, et que je m'y égare (Proust, sortez de ce corps!)… Et que je n'ai même pas réussi à aborder l'univers de ce faubourg St-Germain qui pourtant semble accaparer quasi exclusivement l'intérêt de notre Narrateur dans ce volume, jeune adulte désormais, ni à évoquer les motifs de sa passion pour ce dernier, déclenchée au départ et incarnée longtemps par celle vouée à la Duchesse de Guermantes, ni surtout cet éternel renouvellement de sa fascination pour les noms de son enfance, la seule qui, en toutes circonstances, continue à faire fidèlement battre son coeur.
D'Oriane de Guermantes non plus, dont «l'esprit» plus que l'intelligence règne ici au coeur d'une aristocratie parisienne «fin de siècle» vivant sans le savoir encore ses derniers jours de gloire, et dont les portes des salons s'ouvrent et se referment sur des sésames distribués essentiellement à partir du rang de naissance, donnés exceptionnellement, sous certaines conditions, à quelques personnalités "sans naissance", souvent interchangeables, autorisées à intégrer provisoirement les différentes «coteries» qui la constituent. Je n'ai pas pu, enfin et enfin, évoquer toute la complexité et l'ambiguïté des sentiments du Narrateur (en parfaite symétrie, d'ailleurs, avec ceux de Proust, lui-même féru chroniqueur mondain dans Le Figaro à cette époque ), à la fois séduit par tout ce qui recèlerait potentiellement un monde dont (et peut-être aussi parce que) il se sent au départ exclu, et déçu par l'impression de médiocrité et de vacuité dégagée par les êtres en chair et en os qui l'habitent, et qu'il comparera entre autres à celle «de plate vulgarité que peut donner l'entrée dans le port danois d'Elseneur à tout lecteur enfiévré de Hamlet».
Mais qu'importe, n'est-ce pas ? J'aurais après tout probablement écrit dans le fond exactement la même chronique.
À suivre..?
S'il fut parfois dit que Proust écrivit invariablement le même livre, il eût été peut-être porté à votre connaissance qu'un certain lecteur ordinaire, amateur d'écritures facétieuses, rédigea peut-être huit cents fois la même chronique en comptant celle-ci.
La même chronique parlant d'humanité, de vie, d'amour, de blessures forcément, un peu de soi aussi en espérant ne jamais oublier les autres...
Faut-il saucissonner l'oeuvre d'À la recherche du temps perdu qui est censé se poser d'un seul tenant ? La question a été souvent exprimée, notamment lorsque Proust reçut le prix Goncourt en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, précisément le second volume.
Cette question a été maintes fois posée, aussi vous délivrer comme cela un billet dédié sur ce troisième volume pourrait paraître incongru.
Mais je garde une image proustienne d'un voyage donnant une description de la vision de clochers au fur et à mesure que le narrateur s'en rapprochait dans le véhicule où il se trouvait, tandis que la perspective du point de vue s'en trouvait modifiée alors que le véhicule avançait.
Voir des clochers se déplacer selon le point de vue du narrateur, alors que c'est le narrateur qui se déplace dans un véhicule, cette approche m'a parue originale pour dire mon ressenti sur cet immense texte. Dans ce changement de perspective c'est le paysage qui bouge, c'est une inversion de la relativité des mouvements, le monde entier ressemble brusquement au théâtre d'une lanterne magique.
C'est tout simple pourtant, nous pouvons l'éprouver chaque jour, chaque fois que nous voyageons dans un mode de transport qui nous déplace. Nous voyons les perspectives se modifier lorsque nous voyageons dans un train, ou une voiture... J'ai ressenti cela, voyageant, me déplaçant dans l'univers d'À la recherche du temps perdu...
Voilà ce que nous montre Proust. Voilà ce que j'ai ressenti à l'approche de ces textes qu'on dira découpés...
Je mesure la difficulté pour ne pas dire l'aberration d'un tel exercice, mais me saisissant de cette image très riche qu'il m'est arrivé de vivre moi-même, je me demande, ne pourrait-on pas dire que nous voyageons dans cette oeuvre toujours autour du même sujet, ce fameux temps, mais en nous déplaçant chaque fois d'un texte à l'autre, peut-être que l'angle d'approche s'en trouve modifié. Nous changeons légèrement de point de vue à chaque fois comme un voyageur qui se déplace d'un endroit à un autre.
Et puis le chemin d'À la recherche du temps perdu est long, deux mille quatre cents pages dans la version Quarto de chez Gallimard que je possède. On ne sait jamais ce qui peut arriver de malheur à un lecteur parvenu à l'âge sage... Aussi voulant donner mon ressenti sans attendre, fragmenter me semble le mode opératoire idéal.
Le côté de Guermantes, c'est donc le troisième volet d'À la recherche du temps perdu, marqué par l'installation du narrateur et de sa famille dans un nouveau foyer, près de la demeure des Guermantes.
Le quotidien de notre héros se trouve rythmé par la vie de ses prestigieux voisins, qu'il ne tarde pas à côtoyer grâce à la bienveillance d'un certain Saint-Loup.
Je retrouve avec plaisir ce narrateur omniscient que je commence à connaître, -à force nous allons finir par devenir amis je le sais mais il faut encore être patient nous apprivoiser.
Mais ici j'avance forcément aux premières pages avec une forme de méfiance, le monde aristocratique, la vie mondaine, tout ceci n'étant pas du tout mon genre.
Je découvre que l'entrée dans le jeu de la vie mondaine s'accompagne chez le narrateur d'un éveil à la sensualité. Alors forcément c'est pour moi aussi un éveil, un rapprochement vers l'auteur.
Comme son titre l'indique, cet opus est centré sur la famille Guermantes. Les choses sont facilitées par le fait que la famille du narrateur emménage dans un appartement dépendant de l'hôtel où le duc et la duchesse de Guermantes résident une bonne partie de l'année. Fort du prestige que la duchesse de Guermantes revêt aux yeux du narrateur, celle-ci va nourrir une forme d'idéalisation et de fantasme chez celui-ci, dont tout le récit va se nourrir et s'enrichir. Il éprouve le désir de pénétrer dans cet univers pour mieux en saisir l'essence exceptionnelle.
Ici la femme, dans l'image de la duchesse de Guermantes devient source d'attirance, de mystère et d'admiration.
Il la voit, la croise, donnant une nouvelle matière à sa rêverie. À force de rêver sur le nom de Guermantes, le narrateur en vient à devenir amoureux de la duchesse. Il organise ses promenades, pour se trouver toujours sur son chemin. Mais tout ne se passe jamais tout à fait comme prévu, le narrateur ne se privant pas lors de multiples passages d'égratigner ce monde vain, sa futilité...
Dire que ce volume parle d'aristocratie n'est pas faux, mais n'est pas non plus tout à fait exact. Disons que l'essentiel n'est pas à cet endroit.
Amour de tête sans doute, il n'en demeure pas moins que le narrateur est vraiment épris de la duchesse. Il va solliciter son nouvel ami Sant-Loup pour lui demander d'intervenir en sa faveur, étant donné qu'il est neveu du duc.
Le prétexte est trouvé : la volonté de voir les tableaux d'Elstir que possèdent les Guermantes. Chouette !
Ici, peut-être plus que jamais j'ai senti qu'entrer dans l'univers de Proust, c'était entrer dans un espace-temps. Bien sûr chez Proust, comme dans nos vies, il y a toujours une distance, reste à voir à quel endroit on la pose. Distance dans l'espace ? Dans le temps ?
Est-ce là la seule dichotomie d'ailleurs, ce désaccord entre nos impressions et nos expressions habituelles ?
La distance est la source de toute souffrance, distance entre l'enfant et la mère que ne cesse de raconter le narrateur, c'est une malédiction, une béance infinie, la compréhension de notre finitude, celle qui dit que nous sommes mortels, que le temps a beau être élastique, un jour l'élastique finit par casser... Forcément, j'ai pensé à mon enfance, j'ai pensé à ce temps où j'étais déjà un jeune adulte et où ma mère devint veuve lorsque mon père vint à mourir et lorsque ma mère me happa dans sa souffrance, m'invitant, me convoquant presque à redevenir l'enfant que je n'étais plus mais qu'elle voulait que je redevienne... Proust me dit cela, ma souffrance, celle de ma mère aussi. Il me dit cela lorsqu'il évoque sa grand-mère qui va mourir...
L'éclipse de la perspective fait que le lointain devient proche, mais l'inverse aussi et c'est douloureux car l'instant est déjà un futur en construction, un souvenir arrimé à la barque qui s'apprête à aller d'un rivage à un autre, d'un versant à un autre, le passé c'est peut-être déjà un oubli en partance pour qu'il ne revienne jamais....
La distance temporelle est un arrachement à soi-même.
La réponse pourrait être l'art, nous dit Proust, nous invitant ici à revenir vers l'atelier de chez Elstir.
L'art nous permet de goûter à l'éternité, ici et maintenant. L'ennui est lové à l'intérieur du temps, protégé du malheur.
L'espace, le temps, ici les deux lieux se rejoignent comme dans un kaléidoscope magique.
La joie, c'est d'accéder à l'éternité, mais il y a une autre joie qui consiste à se tenir à l'état pur dans l'immanence de l'instant.
Retenir le temps encore un peu dans nos doigts, c'est vouloir faire un seul noeud entre le passé et le présent, un seul lieu entre le lointain et le proche, c'est alors que l'artiste survient, l'écrivain, le peintre, le musicien, le lecteur par-dessus tout qui entre dans ce spectacle comme on entre dans un symphonie, c'est le triomphe, la joie consolatrice qui nous rassure de la séparation de l'enfant et de la mère tandis que le vide et la distance vont continuer à se creuser inexorablement...
Le temps serait-il plus docile que l'espace ? Proust s'en soucie guère ne voulant surtout pas dissocier l'un de l'autre et j'en ai pris conscience ici.
Proust renverse la table où gît le temps et l'espace, mélangeant l'un à l'autre dans ce désordre voulu.
Selon Proust, l'espace et le temps c'est la même chose, c'est une lumière qui varie dans un même prisme.
Il s'agit toujours d'un espace-temps, tout n'est qu'espace-temps, pour moi c'est une image qui me parle, très prégnante comme l'effet presque d'une hallucination, ne sachant pas ce que c'est vraiment une hallucination, mais l'imaginant quand même un peu.
L'art c'est le triomphe de la rencontre du temps et de l'espace dans cette béance, le triomphe sur cette béance angoissante.
À chaque instant, le temps retrouvé redevient réel, ce qui était distant devient proche.
Le texte semble venir en mouvement alors que c'est nous lecteur qui venons au texte en tournant les pages.
Tout tourne, toute est renversé. Tout revient.
La même chronique parlant d'humanité, de vie, d'amour, de blessures forcément, un peu de soi aussi en espérant ne jamais oublier les autres...
Faut-il saucissonner l'oeuvre d'À la recherche du temps perdu qui est censé se poser d'un seul tenant ? La question a été souvent exprimée, notamment lorsque Proust reçut le prix Goncourt en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, précisément le second volume.
Cette question a été maintes fois posée, aussi vous délivrer comme cela un billet dédié sur ce troisième volume pourrait paraître incongru.
Mais je garde une image proustienne d'un voyage donnant une description de la vision de clochers au fur et à mesure que le narrateur s'en rapprochait dans le véhicule où il se trouvait, tandis que la perspective du point de vue s'en trouvait modifiée alors que le véhicule avançait.
Voir des clochers se déplacer selon le point de vue du narrateur, alors que c'est le narrateur qui se déplace dans un véhicule, cette approche m'a parue originale pour dire mon ressenti sur cet immense texte. Dans ce changement de perspective c'est le paysage qui bouge, c'est une inversion de la relativité des mouvements, le monde entier ressemble brusquement au théâtre d'une lanterne magique.
C'est tout simple pourtant, nous pouvons l'éprouver chaque jour, chaque fois que nous voyageons dans un mode de transport qui nous déplace. Nous voyons les perspectives se modifier lorsque nous voyageons dans un train, ou une voiture... J'ai ressenti cela, voyageant, me déplaçant dans l'univers d'À la recherche du temps perdu...
Voilà ce que nous montre Proust. Voilà ce que j'ai ressenti à l'approche de ces textes qu'on dira découpés...
Je mesure la difficulté pour ne pas dire l'aberration d'un tel exercice, mais me saisissant de cette image très riche qu'il m'est arrivé de vivre moi-même, je me demande, ne pourrait-on pas dire que nous voyageons dans cette oeuvre toujours autour du même sujet, ce fameux temps, mais en nous déplaçant chaque fois d'un texte à l'autre, peut-être que l'angle d'approche s'en trouve modifié. Nous changeons légèrement de point de vue à chaque fois comme un voyageur qui se déplace d'un endroit à un autre.
Et puis le chemin d'À la recherche du temps perdu est long, deux mille quatre cents pages dans la version Quarto de chez Gallimard que je possède. On ne sait jamais ce qui peut arriver de malheur à un lecteur parvenu à l'âge sage... Aussi voulant donner mon ressenti sans attendre, fragmenter me semble le mode opératoire idéal.
Le côté de Guermantes, c'est donc le troisième volet d'À la recherche du temps perdu, marqué par l'installation du narrateur et de sa famille dans un nouveau foyer, près de la demeure des Guermantes.
Le quotidien de notre héros se trouve rythmé par la vie de ses prestigieux voisins, qu'il ne tarde pas à côtoyer grâce à la bienveillance d'un certain Saint-Loup.
Je retrouve avec plaisir ce narrateur omniscient que je commence à connaître, -à force nous allons finir par devenir amis je le sais mais il faut encore être patient nous apprivoiser.
Mais ici j'avance forcément aux premières pages avec une forme de méfiance, le monde aristocratique, la vie mondaine, tout ceci n'étant pas du tout mon genre.
Je découvre que l'entrée dans le jeu de la vie mondaine s'accompagne chez le narrateur d'un éveil à la sensualité. Alors forcément c'est pour moi aussi un éveil, un rapprochement vers l'auteur.
Comme son titre l'indique, cet opus est centré sur la famille Guermantes. Les choses sont facilitées par le fait que la famille du narrateur emménage dans un appartement dépendant de l'hôtel où le duc et la duchesse de Guermantes résident une bonne partie de l'année. Fort du prestige que la duchesse de Guermantes revêt aux yeux du narrateur, celle-ci va nourrir une forme d'idéalisation et de fantasme chez celui-ci, dont tout le récit va se nourrir et s'enrichir. Il éprouve le désir de pénétrer dans cet univers pour mieux en saisir l'essence exceptionnelle.
Ici la femme, dans l'image de la duchesse de Guermantes devient source d'attirance, de mystère et d'admiration.
Il la voit, la croise, donnant une nouvelle matière à sa rêverie. À force de rêver sur le nom de Guermantes, le narrateur en vient à devenir amoureux de la duchesse. Il organise ses promenades, pour se trouver toujours sur son chemin. Mais tout ne se passe jamais tout à fait comme prévu, le narrateur ne se privant pas lors de multiples passages d'égratigner ce monde vain, sa futilité...
Dire que ce volume parle d'aristocratie n'est pas faux, mais n'est pas non plus tout à fait exact. Disons que l'essentiel n'est pas à cet endroit.
Amour de tête sans doute, il n'en demeure pas moins que le narrateur est vraiment épris de la duchesse. Il va solliciter son nouvel ami Sant-Loup pour lui demander d'intervenir en sa faveur, étant donné qu'il est neveu du duc.
Le prétexte est trouvé : la volonté de voir les tableaux d'Elstir que possèdent les Guermantes. Chouette !
Ici, peut-être plus que jamais j'ai senti qu'entrer dans l'univers de Proust, c'était entrer dans un espace-temps. Bien sûr chez Proust, comme dans nos vies, il y a toujours une distance, reste à voir à quel endroit on la pose. Distance dans l'espace ? Dans le temps ?
Est-ce là la seule dichotomie d'ailleurs, ce désaccord entre nos impressions et nos expressions habituelles ?
La distance est la source de toute souffrance, distance entre l'enfant et la mère que ne cesse de raconter le narrateur, c'est une malédiction, une béance infinie, la compréhension de notre finitude, celle qui dit que nous sommes mortels, que le temps a beau être élastique, un jour l'élastique finit par casser... Forcément, j'ai pensé à mon enfance, j'ai pensé à ce temps où j'étais déjà un jeune adulte et où ma mère devint veuve lorsque mon père vint à mourir et lorsque ma mère me happa dans sa souffrance, m'invitant, me convoquant presque à redevenir l'enfant que je n'étais plus mais qu'elle voulait que je redevienne... Proust me dit cela, ma souffrance, celle de ma mère aussi. Il me dit cela lorsqu'il évoque sa grand-mère qui va mourir...
L'éclipse de la perspective fait que le lointain devient proche, mais l'inverse aussi et c'est douloureux car l'instant est déjà un futur en construction, un souvenir arrimé à la barque qui s'apprête à aller d'un rivage à un autre, d'un versant à un autre, le passé c'est peut-être déjà un oubli en partance pour qu'il ne revienne jamais....
La distance temporelle est un arrachement à soi-même.
La réponse pourrait être l'art, nous dit Proust, nous invitant ici à revenir vers l'atelier de chez Elstir.
L'art nous permet de goûter à l'éternité, ici et maintenant. L'ennui est lové à l'intérieur du temps, protégé du malheur.
L'espace, le temps, ici les deux lieux se rejoignent comme dans un kaléidoscope magique.
La joie, c'est d'accéder à l'éternité, mais il y a une autre joie qui consiste à se tenir à l'état pur dans l'immanence de l'instant.
Retenir le temps encore un peu dans nos doigts, c'est vouloir faire un seul noeud entre le passé et le présent, un seul lieu entre le lointain et le proche, c'est alors que l'artiste survient, l'écrivain, le peintre, le musicien, le lecteur par-dessus tout qui entre dans ce spectacle comme on entre dans un symphonie, c'est le triomphe, la joie consolatrice qui nous rassure de la séparation de l'enfant et de la mère tandis que le vide et la distance vont continuer à se creuser inexorablement...
Le temps serait-il plus docile que l'espace ? Proust s'en soucie guère ne voulant surtout pas dissocier l'un de l'autre et j'en ai pris conscience ici.
Proust renverse la table où gît le temps et l'espace, mélangeant l'un à l'autre dans ce désordre voulu.
Selon Proust, l'espace et le temps c'est la même chose, c'est une lumière qui varie dans un même prisme.
Il s'agit toujours d'un espace-temps, tout n'est qu'espace-temps, pour moi c'est une image qui me parle, très prégnante comme l'effet presque d'une hallucination, ne sachant pas ce que c'est vraiment une hallucination, mais l'imaginant quand même un peu.
L'art c'est le triomphe de la rencontre du temps et de l'espace dans cette béance, le triomphe sur cette béance angoissante.
À chaque instant, le temps retrouvé redevient réel, ce qui était distant devient proche.
Le texte semble venir en mouvement alors que c'est nous lecteur qui venons au texte en tournant les pages.
Tout tourne, toute est renversé. Tout revient.
Le narrateur vit avec ses parents dans un appartement de l'hôtel particulier des Guermantes, dans le faubourg Saint Germain à Paris. Il tombe amoureux de la duchesse Oriane de Guermantes et recherche un moyen pour attirer son attention en la suivant tout comme il l'avait fait avec Gilberte dans « à l'ombre des jeunes filles en fleur ». Il rejoint son ami Robert de St Loup à Doncières où ce dernier est en poste dans une garnison. Il lui demande d'intervenir auprès de sa tante pour qu'il lui soit présenté. Il apprend que sa grand-mère est souffrante et rentre précipitamment à Paris où il retrouve Albertine qui cède à ses avances et s'offre à lui. St Loup qui l'avait accompagné, lui présente sa maîtresse qui n'est autre que Rachel, une cocotte qu'avait connu le narrateur. Il rencontre enfin la duchesse de Guermantes lors d'un salon que donne Mme de Villeparisis mais le charme n'opère plus. Sa grand-mère meurt d'une crises d'urémie. Il est invité par Palamède de Guermantes, baron de Charlus, frère du duc de Guermantes à passer le voir un soir. Il s'y rend après avoir passé la soirée chez les Guermantes. Charlus a une attitude déconcertante et ambigu envers le narrateur. de retour, il rencontre Swann dont il apprend qu'il est malade et condamné.
Des femmes, Proust à travers le narrateur les place haut dans la hiérarchie de ses personnages, de la plus humble à la plus noble, étrangère aperçue ou de sa propre famille. Elles ont le pouvoir de faire ou défaire les alliances, les réputations. Il leur voue un amour immatériel, désincarné en presque les divinisant. Il leur ôte tout aspect charnel pour en faire des êtres de lumière et d'ombre. Elles lui sont inaccessibles même quand elles finissent par s'offrir (Albertine) car il n'envisage pas d'avoir de relation sardanapalesque avec, et d'ailleurs, il entend la fréquentation d'un bordel comme un acte médical et non ludique. On ne peut imaginer l'auteur et son oeuvre sans elles.
Des salons, Proust en fait les lieux incontournables de la vie parisienne. C'est l'endroit où il faut être, où le paraître et le néant se propagent, se multiplient, se répandent, les égos coulent.
« Il savait que Mme de Guermantes avait, apanage précieux des femmes vraiment supérieures, ce qu'on appelle un « salon », c'est-à-dire ajoutait parfois aux gens de son monde quelque notabilité que venait de mettre en vue la découverte d'un remède ou la production d'un chef-d'oeuvre. le faubourg Saint-Germain restait encore sous l'impression d'avoir appris qu'à la réception pour le roi et la reine d'Angleterre, la duchesse n'avait pas craint de convier M. Detaille. Les femmes d'esprit du Faubourg se consolaient malaisément de n'avoir pas été invitées tant elles eussent été délicieusement intéressées d'approcher le génie étrange. »
Le voyage à travers « la recherche du temps perdu » n'est pas une simple lecture, c'est une exploration, car lire Proust c'est s'attarder sur tel ou tel passage, autrement l'oeuvre se rebelle, s'échappe.
Editions Gallimard, 546 pages.
Des femmes, Proust à travers le narrateur les place haut dans la hiérarchie de ses personnages, de la plus humble à la plus noble, étrangère aperçue ou de sa propre famille. Elles ont le pouvoir de faire ou défaire les alliances, les réputations. Il leur voue un amour immatériel, désincarné en presque les divinisant. Il leur ôte tout aspect charnel pour en faire des êtres de lumière et d'ombre. Elles lui sont inaccessibles même quand elles finissent par s'offrir (Albertine) car il n'envisage pas d'avoir de relation sardanapalesque avec, et d'ailleurs, il entend la fréquentation d'un bordel comme un acte médical et non ludique. On ne peut imaginer l'auteur et son oeuvre sans elles.
Des salons, Proust en fait les lieux incontournables de la vie parisienne. C'est l'endroit où il faut être, où le paraître et le néant se propagent, se multiplient, se répandent, les égos coulent.
« Il savait que Mme de Guermantes avait, apanage précieux des femmes vraiment supérieures, ce qu'on appelle un « salon », c'est-à-dire ajoutait parfois aux gens de son monde quelque notabilité que venait de mettre en vue la découverte d'un remède ou la production d'un chef-d'oeuvre. le faubourg Saint-Germain restait encore sous l'impression d'avoir appris qu'à la réception pour le roi et la reine d'Angleterre, la duchesse n'avait pas craint de convier M. Detaille. Les femmes d'esprit du Faubourg se consolaient malaisément de n'avoir pas été invitées tant elles eussent été délicieusement intéressées d'approcher le génie étrange. »
Le voyage à travers « la recherche du temps perdu » n'est pas une simple lecture, c'est une exploration, car lire Proust c'est s'attarder sur tel ou tel passage, autrement l'oeuvre se rebelle, s'échappe.
Editions Gallimard, 546 pages.
Il y a trois ans j'ai entrepris la lecture de la "Recherche", et malgré toute ma volonté, jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi à en lire plus d'un tome par an. Et quelles ne furent pas mes craintes au moment d'ouvrir ce troisième volet, le plus volumineux !
Si dans les précédents, le narrateur se complaisait à décrire avec minutie les moeurs bourgeoises, tant à la ville qu'à la campagne ou encore à la plage, avec "Le Côté de Guermantes", c'est à l'aristocratie du faubourg Saint-Germain qu'il s'attache, avec le même souci du détail.
Si Marcel Proust est connu pour la longueur de ses phrases - réputation très méritée -, je lui reconnais également un don pour multiplier les chapitres sur un même événement. Ainsi, ce sont plus d'une demi-douzaine qui lui sont nécessaires pour décrire une simple visite mondaine, de quoi laisser aux conversations le temps de s'étendre, qu'elles touchent les loisirs comme l'opéra, ou la politique avec l'Affaire Dreyfus, ou encore la généalogie alambiquée des familles plus ou moins régnantes de l'Europe de la Belle-Epoque.
Alors, oui, certes, on apprend beaucoup sur l'atmosphère très "beau monde" de ces luxueux appartements bourrés jusqu'à la gueule d'oeuvres et d'objets d'art mais trop de minutie tue la minutie, voilà mon sentiment. La préciosité du style de Marcel Proust et le dandysme de son narrateur m'ont souvent porté sur les nerfs, tout comme les opinions rapportées de ces dilettantes et autres altesses qui ne peuvent que paraître surannées à un lecteur d'aujourd'hui ; au mieux peut-on considérer cet héritage littéraire comme un patrimoine vivant nous permettant de toucher du doigt ce qu'on pourrait qualifier d'"art de vivre à la française" mais cette visite de musée tire en longueur.
Quant aux susdits personnages, aucun n'est réellement attachant. le snobisme, la vanité, l'orgueil de caste, le langage de dupes, la fatuité des codes et, de façon générale, la suffisance méprisante manifestée par cette classe sociale - qui finira d'être balayée au cours du XXème siècle -, sont assez indigestes.
Jamais deux sans trois, a-t-on coutume de dire, et bien, après la lecture du "Côté de Guermantes", j'affirme qu'il faut vraiment de la volonté pour lire Proust aujourd'hui. "Volonté" me semble vraiment le terme approprié ; le plaisir vient ensuite, s'il vient jamais. Un peu comme un régime où il faut d'abord s'astreindre à une certaine discipline avant d'en percevoir les effets bénéfiques, il faut se lancer dans Proust en ne quittant pas du regard son objectif afin d'espérer pouvoir en savourer, à l'arrivée, les charmes discrets.
Challenge MULTI-DÉFIS 2018
Challenge PAVES 2018
Challenge 1914 - 1989 - Edition 2018
Si dans les précédents, le narrateur se complaisait à décrire avec minutie les moeurs bourgeoises, tant à la ville qu'à la campagne ou encore à la plage, avec "Le Côté de Guermantes", c'est à l'aristocratie du faubourg Saint-Germain qu'il s'attache, avec le même souci du détail.
Si Marcel Proust est connu pour la longueur de ses phrases - réputation très méritée -, je lui reconnais également un don pour multiplier les chapitres sur un même événement. Ainsi, ce sont plus d'une demi-douzaine qui lui sont nécessaires pour décrire une simple visite mondaine, de quoi laisser aux conversations le temps de s'étendre, qu'elles touchent les loisirs comme l'opéra, ou la politique avec l'Affaire Dreyfus, ou encore la généalogie alambiquée des familles plus ou moins régnantes de l'Europe de la Belle-Epoque.
Alors, oui, certes, on apprend beaucoup sur l'atmosphère très "beau monde" de ces luxueux appartements bourrés jusqu'à la gueule d'oeuvres et d'objets d'art mais trop de minutie tue la minutie, voilà mon sentiment. La préciosité du style de Marcel Proust et le dandysme de son narrateur m'ont souvent porté sur les nerfs, tout comme les opinions rapportées de ces dilettantes et autres altesses qui ne peuvent que paraître surannées à un lecteur d'aujourd'hui ; au mieux peut-on considérer cet héritage littéraire comme un patrimoine vivant nous permettant de toucher du doigt ce qu'on pourrait qualifier d'"art de vivre à la française" mais cette visite de musée tire en longueur.
Quant aux susdits personnages, aucun n'est réellement attachant. le snobisme, la vanité, l'orgueil de caste, le langage de dupes, la fatuité des codes et, de façon générale, la suffisance méprisante manifestée par cette classe sociale - qui finira d'être balayée au cours du XXème siècle -, sont assez indigestes.
Jamais deux sans trois, a-t-on coutume de dire, et bien, après la lecture du "Côté de Guermantes", j'affirme qu'il faut vraiment de la volonté pour lire Proust aujourd'hui. "Volonté" me semble vraiment le terme approprié ; le plaisir vient ensuite, s'il vient jamais. Un peu comme un régime où il faut d'abord s'astreindre à une certaine discipline avant d'en percevoir les effets bénéfiques, il faut se lancer dans Proust en ne quittant pas du regard son objectif afin d'espérer pouvoir en savourer, à l'arrivée, les charmes discrets.
Challenge MULTI-DÉFIS 2018
Challenge PAVES 2018
Challenge 1914 - 1989 - Edition 2018
UN ETE AVEC MARCEL #3
Bien que la rentrée littéraire avec son lot de livres alléchants pointe le bout de son nez, je continue mon été avec Marcel.
La Recherche, c'est un marathon ! On se demande parfois ce que l'on fait là, mais on tient bon et on aura sa médaille de finisher !
Que dire du troisième opus ? La première chose, c'est que pour moi l'intérêt était assez inégal. Autant je me suis ennuyée sur la première partie, que j'ai adoré la seconde.
Le côté de Guermantes, ca raconte quoi ?
Notre jeune Marcel, franchement béta et niais, vient de déménager et emménage à côté de la demeure de la Duchesse de Guermantes.
Il en tombe en amour comme une jeune fille tombe amoureuse de sa rock star préférée. Il lui prête toutes les qualités morales et intellectuelles et fait de ses pieds et de ses mains pour se la faire présenter et entrer dans son salon. C'est là que Marcel va faire son entrée dans le Monde. Marcel aime les titres, et le bas peuple ne l'intéresse pas, c'est peu dire. pauvre Albertine, pas assez bien née, et qui est tellement bête de ne pas utiliser le bon adjectif...
Dans le grand monde, Marcel augmente ses liens sociaux d'une belle tripotée d'inutiles futiles. On cause et on cause et l'on va chez l'un et chez l'autre, on fait de petites vacheries, on parle sur le dos de l'un l'autre, on astique sa généalogie dans le sens du poil. Tout ce beau monde est tiraillé par la grande affaire d'époque : l'affaire Dreyfus. La plupart sont antidreyfusards.. non pas parce qu'ils connaissent l'histoire, mais parce qu'ils sont franchement antisémites. certains sont Dreyfusards, Zwann et Bloch... normal ils sont juifs. Zola en prend pour son grade. Marcel est langue de pute parfois.
Dans le seconde partie, qui commence par le décès de la grand-mère de Marcel de ce que je peux penser être un AVC (soigné avec des sangsues), Marcel sera moins niais, enfin un peu. Il commence à se rendre compte de la vraie nature hypocrite de la société dans laquelle il erre. Sa belle duchesse de Guermantes, tout sourire et amabilitén ne lèverait pas le mignon petit doigt pour l'aider. Elle n'en a d'ailleurs strictement rien à foutre quand on lui annonce un décès prochain, elle préfère ses souliers rouges. Bien entendu, tant qu'elle est à égratigner les domestiques ou à dénigrer d'autres dames de sa coterie, ça va à Marcel... Mais quand on n'aide pas Saint-Loup, là on ouvre les yeux.
A mon humble avis, un volume un peu plus marrant que les autres sur le dernier quart. je commence à me prendre au jeu et à me poser des questions du niveau "amour, gloire et beauté" du genre, "Est-ce que Charlus va enfin se le faire ?", "Quelle est donc la mystérieuse maladie de Swann ?"
PS : pour les Belges, c'est assez comique de voir la petite gueguerre sur le titre du duché de Brabant :-)
Bien que la rentrée littéraire avec son lot de livres alléchants pointe le bout de son nez, je continue mon été avec Marcel.
La Recherche, c'est un marathon ! On se demande parfois ce que l'on fait là, mais on tient bon et on aura sa médaille de finisher !
Que dire du troisième opus ? La première chose, c'est que pour moi l'intérêt était assez inégal. Autant je me suis ennuyée sur la première partie, que j'ai adoré la seconde.
Le côté de Guermantes, ca raconte quoi ?
Notre jeune Marcel, franchement béta et niais, vient de déménager et emménage à côté de la demeure de la Duchesse de Guermantes.
Il en tombe en amour comme une jeune fille tombe amoureuse de sa rock star préférée. Il lui prête toutes les qualités morales et intellectuelles et fait de ses pieds et de ses mains pour se la faire présenter et entrer dans son salon. C'est là que Marcel va faire son entrée dans le Monde. Marcel aime les titres, et le bas peuple ne l'intéresse pas, c'est peu dire. pauvre Albertine, pas assez bien née, et qui est tellement bête de ne pas utiliser le bon adjectif...
Dans le grand monde, Marcel augmente ses liens sociaux d'une belle tripotée d'inutiles futiles. On cause et on cause et l'on va chez l'un et chez l'autre, on fait de petites vacheries, on parle sur le dos de l'un l'autre, on astique sa généalogie dans le sens du poil. Tout ce beau monde est tiraillé par la grande affaire d'époque : l'affaire Dreyfus. La plupart sont antidreyfusards.. non pas parce qu'ils connaissent l'histoire, mais parce qu'ils sont franchement antisémites. certains sont Dreyfusards, Zwann et Bloch... normal ils sont juifs. Zola en prend pour son grade. Marcel est langue de pute parfois.
Dans le seconde partie, qui commence par le décès de la grand-mère de Marcel de ce que je peux penser être un AVC (soigné avec des sangsues), Marcel sera moins niais, enfin un peu. Il commence à se rendre compte de la vraie nature hypocrite de la société dans laquelle il erre. Sa belle duchesse de Guermantes, tout sourire et amabilitén ne lèverait pas le mignon petit doigt pour l'aider. Elle n'en a d'ailleurs strictement rien à foutre quand on lui annonce un décès prochain, elle préfère ses souliers rouges. Bien entendu, tant qu'elle est à égratigner les domestiques ou à dénigrer d'autres dames de sa coterie, ça va à Marcel... Mais quand on n'aide pas Saint-Loup, là on ouvre les yeux.
A mon humble avis, un volume un peu plus marrant que les autres sur le dernier quart. je commence à me prendre au jeu et à me poser des questions du niveau "amour, gloire et beauté" du genre, "Est-ce que Charlus va enfin se le faire ?", "Quelle est donc la mystérieuse maladie de Swann ?"
PS : pour les Belges, c'est assez comique de voir la petite gueguerre sur le titre du duché de Brabant :-)
Citations et extraits (280)
Voir plus
Ajouter une citation
« Enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres, pendant le cours de notre existence, ne sont pas bien nombreux, peut-être pourrai-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j'avais choisi entre tous, je l'aurai amené dans ce plan nouveau, où j'aurai enfin de lui la connaissance par les lèvres. » Je me disais cela parce que je croyais qu'il est une connaissance par les lèvres ; je me disais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle, parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels, et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. À cet organe absent il supplée par les lèvres, et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de corne. Mais les lèvres, faites pour amener au palais la saveur de ce qui les tente, doivent se contenter, sans comprendre leur erreur et sans avouer leur déception, de vaguer à la surface et de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir, car dans cette zone désolée où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules, le regard, puis l'odorat les ont abandonnées depuis longtemps. D'abord au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d'embrasser, ceux-ci se déplaçant virent des joues nouvelles ; le cou, aperçu de plus près et comme à la loupe, montra, dans ses gros grains, une robustesse qui modifia le caractère de la figure.
Nous disons bien que l’heure de la mort est incertaine, mais quand nous disons cela, nous nous représentons cette heure comme située dans un espace vague et lointain, nous ne pensons pas qu’elle ait un rapport quelconque avec la journée déjà commencée et puisse signifier que la mort—ou sa première prise de possession partielle de nous, après laquelle elle ne nous lâchera plus—pourra se produire dans cet après-midi même, si peu incertain, cet après-midi où l’emploi de toutes les heures est réglé d’avance. On tient à sa promenade pour avoir dans un mois le total de bon air nécessaire, on a hésité sur le choix d’un manteau à emporter, du cocher à appeler, on est en fiacre, la journée est tout entière devant vous, courte, parce qu’on veut être rentré à temps pour recevoir une amie; on voudrait qu’il fît aussi beau le lendemain; et on ne se doute pas que la mort, qui cheminait en vous dans un autre plan, au milieu d’une impénétrable obscurité, a choisi précisément ce jour-là pour entrer en scène, dans quelques minutes, à peu près à l’instant où la voiture atteindra les Champs-Élysées.
À cause de toutes les apparitions successives de visages différents qu’offrait Mme de Guermantes, visages occupant une étendue relative et variée, tantôt étroite, tantôt vaste, dans l’ensemble de sa toilette, mon amour n’était pas attaché à telle ou telle de ces parties changeantes de chair et d’étoffe qui prenaient, selon les jours, la place des autres et qu’elle pouvait modifier et renouveler presque entièrement sans altérer mon trouble parce qu’à travers elles, à travers le nouveau collet et la joue inconnue, je sentais que c’était toujours Mme de Guermantes. Ce que j’aimais, c’était la personne invisible qui mettait en mouvement tout cela, c’était elle, dont l’hostilité me chagrinait, dont l’approche me bouleversait, dont j’eusse voulu capter la vie et chasser les amis. Elle pouvait arborer une plume bleue ou montrer un teint de feu, sans que ses actions perdissent pour moi de leur importance.
Elle était surtout exaspérée par les biscottes de pain grillé que mangeait mon père. Elle était persuadée qu’il en usait pour faire des manières et la faire "valser". "Je peux dire, approuvait le jeune valet de pied, que j’ai jamais vu ça !" Il le disait comme s’il avait tout vu et si en lui les enseignements d’une expérience millénaire s’étendaient à tous les pays et à leurs usages parmi lesquels ne figurait nulle part celui du pain grillé. "Oui, oui, grommelait le maître d’hôtel, mais tout cela pourrait bien changer, les ouvriers doivent faire une grève au Canada et le ministre a dit l’autre soir à Monsieur qu’il a touché pour ça deux cent mille francs." Le maître d’hôtel était loin de l’en blâmer, non qu’il ne fût lui-même parfaitement honnête, mais croyant tous les hommes politiques véreux, le crime de concussion lui paraissait moins grave que le plus léger délit de vol. Il ne se demandait même pas s’il avait bien entendu cette parole historique et il n’était pas frappé de l’invraisemblance qu’elle eût été dite par le coupable lui-même à mon père, sans que celui-ci l’eût mis dehors.
"Tant que le monde sera monde, voyez-vous, disait-elle, il y aura des maîtres pour nous faire trotter et des domestiques pour faire leurs caprices." En dépit de la théorie de cette trotte perpétuelle, déjà depuis un quart d'heure ma mère, qui n'usait probablement pas des mêmes mesures que Françoise pour apprécier la longueur du déjeuner de celle-ci, disait : "Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, voilà plus de deux heures qu'ils sont à table." Et elle sonnait timidement trois ou quatre fois. Françoise, son valet de pied, le maître d'hôtel entendaient les coups de sonnette non comme un appel et sans songer à venir, mais pourtant comme les premiers sons des instruments qui s'accordent quand un concert va bientôt recommencer et qu'on sent qu'il n'y aura plus que quelques minutes d'entracte. Aussi quand les coups commençaient à se répéter et à devenir plus insistants, nos domestiques se mettaient à y prendre garde et, estimant qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps devant eux et que la reprise du travail était proche, à un tintement de la sonnette un peu plus sonore que les autres, ils poussaient un soupir et, prenant leur parti, le valet de pied descendait fumer une cigarette devant la porte, Françoise, après quelques réflexions sur nous, telles que "ils ont sûrement la bougeotte", montait ranger ses affaires dans son sixième, et le maître d'hôtel ayant été chercher du papier à lettres dans ma chambre, expédiait rapidement sa correspondance privée.
Videos de Marcel Proust (189)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marcel Proust (188)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Que savez-vous de Proust ? (niveau assez difficile)
De combien de tomes est composé le roman "A la recherche du temps perdu" ?
5
6
7
8
8 questions
533 lecteurs ont répondu
Thème :
Marcel ProustCréer un quiz sur ce livre533 lecteurs ont répondu