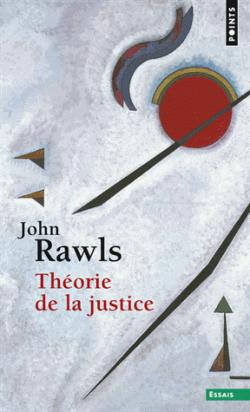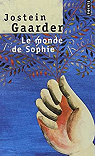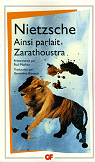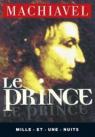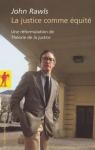John Rawls/5
36 notes
Résumé :
Comment donner, dans une perspective libérale, un fondement légitime aux politiques de redistribution des richesses ? C'est ce que démontre John Rawls, professeur de philosophie à l'université d'Harvard, dans "Théorie de la justice". D'après lui, le but de la justice sociale n'est pas l'égalisation des conditions, mais la promotion d'une plus grande mobilité sociale. Cet objectif exige la correction des inégalités qui se transmettent et se cumulent au fil des généra... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Théorie de la justiceVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
Ce qui a été le plus marquant est la méthode que Rawls se propose d'appliquer pour mettre au point sa justice comme équité. Il s'agit de prétendre que réunir des personnes sans corps, sans peau, sans psychologie, sans âge, sans émotions ni sentiments, en un mot sans connaissance d'eux-mêmes, ni des autres, mais ayant les connaissances nécessaire en justice et économie, sachent s'accorder (car chacune aboutit au même résultat que les autres) par un raisonnement en quelque sorte "pur" (à la façon d'un ordinateur sans doute), sur la valeur première des prémisses proposées (et qui ne sont donc pas autrement justifiées). Il s'agit donc pour les lecteurs de s'accorder à penser que si un tel panel était réuni (dont il est dit qu'il est douteux que cela se puisse), celui-ci sélectionnerait les prémisses de Rawls parmi une liste proposée par lui. Cela ressemble à un choix imposé et à la méthode Coué : les lecteurs admettant la plausibilité de la fiction de Rawls justifiant la validité de ses thèses. Ce faisant, ni le lecteur ni Rawls n'ont à justifier leurs positions puisque ce sont des personnages imaginaires dont ils supposent ensemble qu'ils les justifient. Je n'ai pas saisi pourquoi Rawls ne proposait pas de faire lui-même l'expérience et pourquoi il ne revendiquait pas lui-même de la faire, sinon que cela l'exonère de justifier ses conclusions, bien arbitrairement énoncées. Dans l'ensemble, pour la première partie, il n'y a rien de bien fantastique, sinon que l'on reprend des phrases quotidiennes ou des pensées de tous les jours selon lesquels il faut que les riches et les puissants partagent et aident les pauvres et démunis (où il n'est pas indiqué ce qu'est un "don" de naissance ou en quoi les "défavorisés" se reconnaissent, ces données étant sans doute présentes dans l'imaginaire commun mais engageant une conception de la société bien tranchée - où il est également présupposé que l'on puisse mesure la quantité globale de satisfaction de la société puisqu'elle s'organise dans ce sens - sans que l'on ait de notions d'interactions avec l'extérieur ou les autres sociétés qui doivent bien en faire autant....). La "moralité" est elle aussi présupposée, sur des poncifs jamais remis en cause ni fondés mais énoncés comme des évidences indépassables - c'est pourtant là que se tient la difficulté justificatrice de principes de loi qui prétendent être justes tout en mêlant des considérations de l'ordre du "c'est bien", "c'est pas bien". Je n'ai donc pas du tout estimé le texte convaincant en quoi que ce soit qui reprend l'argumentaire de tant d'ouvrages matérialistes (il s'agit de distribuer les richesses et les biens primaires entre individus, les lignes sont bien rares sur le bien commun et ce qu'il pourrait être puisque tout ce à quoi la justice s'applique doit être par évidence partageable) qui reposent sur le "il me semble", "apparemment", "selon moi", "je ne vais pas détailler ce point", "il se pourrait que, mais je ne le prouverai pas", etc. ou encore les raisonnements par métaphores et images, les pseudo-expériences de pensée qui sont toujours des affabulations visant à rendre plausible par la création d'un scénario fictif ce que l'on ne se résout pas à démontrer. Très peu à extraire de ce texte sinon qu'il est sans doute écrit dans un contexte singulier dont il essaie de s'affranchir, puisqu'il est répété continûment qu'il faut s'opposer à l'utilitarisme. L'ouvrage en ce sens, se présente comme très progressif, ce qui laisse imaginer le type d'ouvrages auxquels il répond, mais justifie pour cela certainement, dans un contexte culturel donné, qu'on s'y intéresse.
L'expérience de pensée de Rawls (« le voile d'ignorance ») entend soustraire l'élaboration du « droit positif » à la sphère des intérêts. Elle fait comme si les individus étaient des tables rases dotées d'une volonté bonne et de rationalité pure. Or ceci ne pourrait être le cas qu'au terme d'un processus approfondi de remise en question individuelle et collective des couches culturelles et des intérêts personnels et sociaux qui affectent le jugement et la sensibilité. Une véritable révolution des subjectivités permettant de réunir la raison et la sensibilité dans leur réalité originelle. C'est ce processus émancipé de toute idéologie économique, juridique et politique qui permettrait de renouer avec le « droit naturel » comme émanation d'une sensibilité ajustée à la justice. Ce processus resterait ouvert et évolutif, de sorte que le « droit positif » qui en découlerait serait non pas un code autonome contraignant mais resterait lui-même ouvert et évolutif. Finalement, une société avec suffisamment d'individus rationnels sensiblement ajustés à l'effort de justice (essayer d'être juste est juste, prétendre l'être ne l'est pas) verrait se dissoudre le « droit positif » dans le même mouvement d'émancipation/réappropriation des décisions individuelles et collectives où se dissout l'Etat.
Voila un livre qui m'a pris plus d'un mois de lecture et qui a mis mes nerfs à dur épreuve plus d'une fois. Il a le mérite de figurer avec Ulysse de Joyce aux deux seuls livres avec lesquels l'abandon de la lecture m'a traversé l'esprit. Pour l'anecdote, c'est au cours de cette lecture portant sur la justice, le droit naturel et le contrat social que je me suis souvenu d'un des droits du lecteur donné par Daniel Pennac dans Comme un roman à savoir de ne jamais être obligé de finir un livre en entier. Mais j'en suis venu à bout, et ce n'était pas une chose si facile que cela, l'ouvrage fait tout de même 665 pages dans mon édition !
L'ouvrage en lui même est destiné avant tout à des personnes s'intéressant au droit et à la philosophie. Pour comprendre l'ouvrage, il est nécessaire de connaitre au moins les grandes lignes des théories du droits social et plus spécialement du contrat social notamment Rousseau (Du contrat social) , Hobbes (Léviathan), Locke (Traité du gouvernement civil) ainsi qu'une grande partie des travaux de Kant. Autant dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Dans cet ouvrage Rawls tente d'expliquer comment et pourquoi les hommes (les citoyens) sont amenés à obéir aux lois faites par l'État. Il justifie les raisons qui l'amène a rejeter les thèses utilitaristes de Bentham. Un livre donc très compliqué qui est vraiment destiné à un public de connaisseurs ou de passionnés de philosophie et de justice sociale, qui appréciera sans doute la profondeur de réflexion de cet ouvrage.
Un livre d'une très grande rigueur et austérité qui permet de bien comprendre les fondements même de la justice, fondée sur les postulats les plus profonds qui nous habitent, et leurs conséquences sociétales.
critiques presse (1)
Thierry Pech s’attache en effet à expliquer l’étendue du phénomène, à en comprendre les mécanismes et surtout à en montrer l’absurdité tant du point de vue économique que du point de vue politique puisqu’il met à mal les promesses de notre pacte républicain. Il le fait avec méthode et pédagogie en posant quelques questions-clés qui structurent son ouvrage.
Lire la critique sur le site : NonFiction
Citations et extraits (77)
Voir plus
Ajouter une citation
Une des raisons de cette procédure est que l’envie tend à détériorer la situation de chacun. En ce sens, elle est collectivement désavantageuse. Supposer son absence rient à supposer que, dans le choix des principes, les hommes pensent seulement à leur propre projet de vie qui se suffit à lui-même. Ils ont un sens solide de leur propre valeur si bien qu’ils n’ont aucun désir de renoncer à l’un de leurs objectifs dans l’espoir que les autres en aient par là même moins de possibilités pour réaliser les leurs. J’élaborerai une conception de la justice sur cette base pour en voir les conséquences. Ensuite, j’essaierai de monter que, lorsque les principes choisis sont mis en pratique, ils conduisent à de systèmes sociaux dans lesquels il est peu probable que l'envie ou d’autres sentiments destructeurs soient forts. La conception de la justice élimine les conditions qui donnent naissance à des attitudes perturbatrices. C’est pourquoi elle est stable en elle-même.
[...] Dans une société juste, les libertés de base sont considérées comme irréversible et les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à des marchandages politiques ni aux calculs d'intérêts sociaux
Nous devons, d’une façon ou d’une autre, invalider les effets des contingences particulières qui opposent les hommes les uns aux autres et leur inspirent la tentation d’utiliser les circonstances sociales et naturelles à leur avantage personnel. C’est pourquoi je pose que les partenaires sont situées derrière un voile d’ignorance. Ils ne savent pas comment les différentes possibilités affecteront leur propre cas particulier et ils sont obligés de juger les principes sur la seule base de considérations générales.
[...] la justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être justifiée par l'obtention, par d'autres, d'un plus grand bien.
Je pose ensuite que les partenaires [du voile d'ignorance] ignorent certaines types de faits particuliers. Tout d’abord, personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social ; personne ne connaît non plus ce qui lui échoit ans la répartition des atouts naturels et des capacités, c’est-à-dire son intelligence et sa force, et ainsi de suite. Chacun ignore sa propre conception du bien, les particularités de son projet rationnel de vie, ou même les traits particuliers de sa psychologie comme son aversion pour le risque ou sa propension à l’optimisme ou au pessimisme. En outre, je pose que les partenaires ne connaissent pas ce qui constitue le contexte particulier de leur propre société. C’est-à-dire qu’ils ignorent sa situation économique ou politique, ainsi que le niveau de civilisation et de culture qu’elle a pu atteindre. Les personnes dans la position originelle n’ont pas d’information qui leur permette de savoir à quelle génération elles appartiennent. Ces restrictions assez larges de l’information sont justifiées en partir par le fait que les questions de justice sociale se posent entre les générations autant que dans leur cadre, ainsi, par exemple, la question du juste taux d’épargne et celle de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. Il y a aussi, en théorie du moins, la question d’une politique génétique raisonnable Dans ces cas-là aussi, afin de mener à bien l’idée de la position originelle, les partenaires doivent ignorer les contingences qui les mettent en conflit. En choisissant des principes, ils doivent être prêts à vivre avec leurs conséquences, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent.
Videos de John Rawls (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Une conversation présentée par Raphael Zagury-Orly
Avec
Sandra Laugier
Guillaume le Blanc
Judith Revel
Patrick Savidan
En collaboration avec les organisations à vocation sociale et solidaire : Amade, Fight Aids Monaco, Licra, Peace & Sport. Avec la participation des élèves et des professeurs de philosophie de l'Institution François d'Assise – Nicolas Barré et du Lycée Albert 1er de Monaco.
Comme la liberté, la fraternité a davantage un pouvoir incantatoire qu'un sens rigoureux - autre que celui de lien crée par l'appartenance à une même famille biologique. de plus, le terme s'impose et est élevé en drapeau moral, qui enferme dans ses plis et phagocyte celui, tout aussi digne, de sororité. A strictement parler, la fraternité échappe au champ opératoire de la politique et fuit toute juridiction: aucune «mesure» ne la crée, aucune loi ne la façonne, aucun décret ne l'oblige. Dans la Constitution française, le mot n'est cité que trois fois, une fois comme devise nationale (liberté, égalité, fraternité), une fois comme «idéal commun». Puisqu'elle n'exprime «aucune exigence précise» (John Rawls), les chartes constitutionnelles internationales l'ignorent. Elles préfèrent convoquer la solidarité. Pourquoi en effet conserver cette référence, certes délavée, estompée, aux liens de sang? Il est vrai que la solidarité a une étrange histoire. Le solidum désignait à l'origine une monnaie (on l'entend davantage dans l'italien soldo que dans le français sou, mais assez bien dans solde, ou soldat), mais en droit romain «in solidum obligari» signifiait que divers débiteurs s'engageaient à payer les uns pour les autres et chacun pour tous la somme à rembourser. C'est la Révolution française qui extirpe la solidarité du champ juridique et économique, et l'applique à l'attitude de secours, de soutien mutuel entre citoyens et citoyennes. Désormais, elle ne désigne plus qu'un rapport de «fraternité» justement, mais ou être frères et soeurs n'a pas de sens, puisque la solidarité ne pousse pas à aider une personne parce qu'elle est membre de ma famille, mais suscite une entraide qui implique tous les membres d'une collectivité unis dans un sentiment de commune appartenance au groupe, à la communauté, à la société, à l'humanité toute entière. Ce qu'active la solidarité, c'est la priorité, sur le souci de soi, de la cohésion sociale, la «responsabilisation» de tous pour ce qui peut arriver à chacun et l'engagement à porter secours si ce qui arrive provoque une perte - de liberté, de justice, de ressources, de dignité, de respect. Dès lors, «Liberté, Egalité, Solidarité» serait une belle devise.
#philomonaco
En collaboration avec les organisations à vocation sociale et solidaire : Amade, Fight Aids Monaco, Licra, Peace & Sport. Avec la participation des élèves et des professeurs de philosophie de l'Institution François d'Assise – Nicolas Barré et du Lycée Albert 1er de Monaco.
Comme la liberté, la fraternité a davantage un pouvoir incantatoire qu'un sens rigoureux - autre que celui de lien crée par l'appartenance à une même famille biologique. de plus, le terme s'impose et est élevé en drapeau moral, qui enferme dans ses plis et phagocyte celui, tout aussi digne, de sororité. A strictement parler, la fraternité échappe au champ opératoire de la politique et fuit toute juridiction: aucune «mesure» ne la crée, aucune loi ne la façonne, aucun décret ne l'oblige. Dans la Constitution française, le mot n'est cité que trois fois, une fois comme devise nationale (liberté, égalité, fraternité), une fois comme «idéal commun». Puisqu'elle n'exprime «aucune exigence précise» (John Rawls), les chartes constitutionnelles internationales l'ignorent. Elles préfèrent convoquer la solidarité. Pourquoi en effet conserver cette référence, certes délavée, estompée, aux liens de sang? Il est vrai que la solidarité a une étrange histoire. Le solidum désignait à l'origine une monnaie (on l'entend davantage dans l'italien soldo que dans le français sou, mais assez bien dans solde, ou soldat), mais en droit romain «in solidum obligari» signifiait que divers débiteurs s'engageaient à payer les uns pour les autres et chacun pour tous la somme à rembourser. C'est la Révolution française qui extirpe la solidarité du champ juridique et économique, et l'applique à l'attitude de secours, de soutien mutuel entre citoyens et citoyennes. Désormais, elle ne désigne plus qu'un rapport de «fraternité» justement, mais ou être frères et soeurs n'a pas de sens, puisque la solidarité ne pousse pas à aider une personne parce qu'elle est membre de ma famille, mais suscite une entraide qui implique tous les membres d'une collectivité unis dans un sentiment de commune appartenance au groupe, à la communauté, à la société, à l'humanité toute entière. Ce qu'active la solidarité, c'est la priorité, sur le souci de soi, de la cohésion sociale, la «responsabilisation» de tous pour ce qui peut arriver à chacun et l'engagement à porter secours si ce qui arrive provoque une perte - de liberté, de justice, de ressources, de dignité, de respect. Dès lors, «Liberté, Egalité, Solidarité» serait une belle devise.
#philomonaco
+ Lire la suite
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de John Rawls (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
438 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu