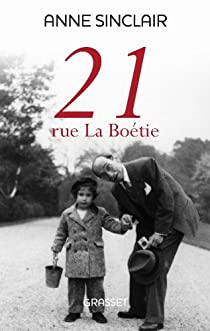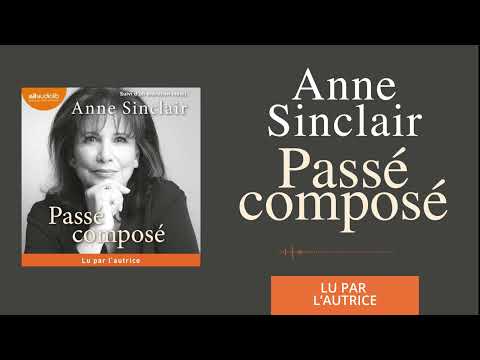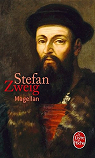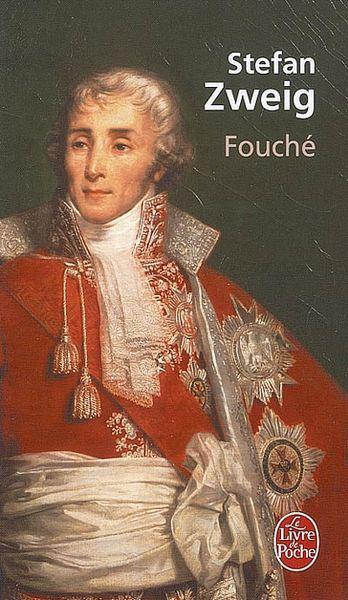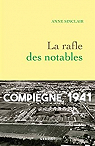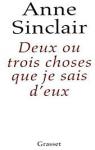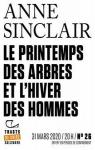Anne Sinclair/5
127 notes
Résumé :
"Vos quatre grands parents sont-ils français ?" me demanda le-monsieur-de-derrière-le-comptoir.
Cette question, on l'avait posée pour la dernière fois à des gens qui devaient bientôt monter dans un train, venant de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande ou du Vel d'Hiv... et cela suffit à raviver en moi le souvenir de mon grand-père, Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie se trouvait 21 rue La Boétie.
Attirée, malgré ... >Voir plus
Cette question, on l'avait posée pour la dernière fois à des gens qui devaient bientôt monter dans un train, venant de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande ou du Vel d'Hiv... et cela suffit à raviver en moi le souvenir de mon grand-père, Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie se trouvait 21 rue La Boétie.
Attirée, malgré ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après 21 rue La BoétieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (26)
Voir plus
Ajouter une critique
Reconnaissons volontiers à Anne Sinclair bien du courage pour avoir écrit ce livre dans une période particulièrement douloureuse de sa vie de femme.
Cet hommage à ses grands-parents vénérés lui a sans doute servi de catharsis pendant la tourmente qui la consigna à New York dans les circonstances que tout un chacun a pu suivre au jour le jour. Ceci étant, Anne Sinclair est journaliste et pas biographe. C'est en lisant rapidement son livre – en moins d'une journée – que je me suis souvenue à quel point j'avais apprécié LA biographie d'un autre grand marchand d'art, je veux parler du livre de Pierre Assouline, L'Homme de l'Art : D-H Kahnweiler, paru en 1989, et qui figure dans la bibliographie.
Anne Sinclair est ma contemporaine à deux ans près. Simplement, quand elle publie une photographie d'elle à 20 ans, elle est en compagnie de Pablo Picasso, qui la couve d'un regard attentif. Elle est née à New York dans une famille très riche qui a eu la possibilité de fuir la barbarie nazie, et en a payé le prix. Pas le prix du sang, certes, et personne ne saurait le leur reprocher, mais celui du courage puisque son père s'est engagé dans la 2ème DB du Général Leclerc, et celui de la spoliation des oeuvres d'art que son grand-père Paul Rosenberg avait choisies et acquises auprès de peintres majeurs du XXème siècle : Matisse, Braque, Léger et surtout Picasso, artistes auxquels il offrait de larges émoluments.
Ce livre est un hommage à Paul Rosenberg, homme nerveux, visionnaire, expert, anxieux, obstiné. Mécène aussi, qui fit don de splendides tableaux aux Musées de France et de cette Amérique qui l'avait accueilli. Elle eut bien de la chance d'avoir en partage le privilège d'être la petite-fille adorée d'un tel homme. Elle le raconte avec passion et humilité, en parcourant les archives familiales, les correspondances entretenues pendant de nombreuses années entre Paul et Picasso, son presque jumeau. C'est son patrimoine à elle, nul ne pourra le lui contester. Ce livre est aussi le manifeste d'une journaliste de talent, qui reprend sa carrière à zéro, à 63 ans.
La partie la plus intéressante du livre se trouve à la fin, lorsqu'elle décrit les patientesrecherchent de son grand-père pour retrouver partout en Europe ses tableaux volés par les Allemands, revendus par des marchands peu regardants sur leur origine, les procès qu'il intenta pour les récupérer – en très faible partie – son rebond professionnel à New York après la guerre.
C'est aussi, pour l'auteur, un pèlerinage aux sources de sa parentèle maternelle, avec toutes les surprises que l'on découvre souvent dans les histoires de familles. Une illustration de l'attitude lamentable de certains français pendant l'occupation vis-à-vis de leurs compatriotes, voisins, patrons – je pense au couple de concierges de l'immeuble sis au 21 rue La Boétie - qui se trouvaient être juifs.
Cet hommage à ses grands-parents vénérés lui a sans doute servi de catharsis pendant la tourmente qui la consigna à New York dans les circonstances que tout un chacun a pu suivre au jour le jour. Ceci étant, Anne Sinclair est journaliste et pas biographe. C'est en lisant rapidement son livre – en moins d'une journée – que je me suis souvenue à quel point j'avais apprécié LA biographie d'un autre grand marchand d'art, je veux parler du livre de Pierre Assouline, L'Homme de l'Art : D-H Kahnweiler, paru en 1989, et qui figure dans la bibliographie.
Anne Sinclair est ma contemporaine à deux ans près. Simplement, quand elle publie une photographie d'elle à 20 ans, elle est en compagnie de Pablo Picasso, qui la couve d'un regard attentif. Elle est née à New York dans une famille très riche qui a eu la possibilité de fuir la barbarie nazie, et en a payé le prix. Pas le prix du sang, certes, et personne ne saurait le leur reprocher, mais celui du courage puisque son père s'est engagé dans la 2ème DB du Général Leclerc, et celui de la spoliation des oeuvres d'art que son grand-père Paul Rosenberg avait choisies et acquises auprès de peintres majeurs du XXème siècle : Matisse, Braque, Léger et surtout Picasso, artistes auxquels il offrait de larges émoluments.
Ce livre est un hommage à Paul Rosenberg, homme nerveux, visionnaire, expert, anxieux, obstiné. Mécène aussi, qui fit don de splendides tableaux aux Musées de France et de cette Amérique qui l'avait accueilli. Elle eut bien de la chance d'avoir en partage le privilège d'être la petite-fille adorée d'un tel homme. Elle le raconte avec passion et humilité, en parcourant les archives familiales, les correspondances entretenues pendant de nombreuses années entre Paul et Picasso, son presque jumeau. C'est son patrimoine à elle, nul ne pourra le lui contester. Ce livre est aussi le manifeste d'une journaliste de talent, qui reprend sa carrière à zéro, à 63 ans.
La partie la plus intéressante du livre se trouve à la fin, lorsqu'elle décrit les patientesrecherchent de son grand-père pour retrouver partout en Europe ses tableaux volés par les Allemands, revendus par des marchands peu regardants sur leur origine, les procès qu'il intenta pour les récupérer – en très faible partie – son rebond professionnel à New York après la guerre.
C'est aussi, pour l'auteur, un pèlerinage aux sources de sa parentèle maternelle, avec toutes les surprises que l'on découvre souvent dans les histoires de familles. Une illustration de l'attitude lamentable de certains français pendant l'occupation vis-à-vis de leurs compatriotes, voisins, patrons – je pense au couple de concierges de l'immeuble sis au 21 rue La Boétie - qui se trouvaient être juifs.
J'ai énormément aimé ce livre. J'ai d'abord vu l'exposition à Paris qui m'avait beaucoup séduite : sensation d'intimité avec Paul Rosenberg et ses peintres. La scénographie était particulièrement bien étudiée afin d'aborder aussi la spoliation des biens appartenant à ces familles françaises juives et aussi le thème vu par les nazis de l'art dit "dégénéré". Mais le livre m'a touchée particulièrement. La soixantaine, les parents qui nous quittent, et ce besoin de connaître "d'où je viens, qui je suis, où je vais". Anne Sinclair se livre, elle fait un beau cadeau au lecteur, c'est bien écrit, j'ai ressenti son besoin de mener cette quête, rassembler les morceaux de son puzzle familial. Elle s'était toujours reconnue comme la fille de son père, héros de la résistance, et avait délaissé sa branche maternelle, considérant cette dernière, peut-être, moins noble que son héros. Bien sur nous découvrons, sous sa plume, le monde d'un marchand d'art mais c'est surtout son émotion que j'ai ressentie dans son écriture, son questionnement aussi, qui donne beaucoup de profondeur à ce livre. J'ai été interpellée par le fait que ses grands-parents ont dû fuir la France alors que les Etats-Unis les ont recueillis et qu'Anne Sinclair a dû quitter les Etats-Unis après des évènements douloureux pour revenir en France. La boucle est bouclée!
C'est après avoir lu et apprécié La rafle des notables, évoquant un aspect méconnu de la traque des juifs de France (nuit du 12 décembre 1941) et en particulier l'histoire de son grand-père paternel Léonce Schwartz, que j'ai décidé de lire également ce 21, rue de la Boétie, évoquant cette fois son grand-père maternel, Paul Rosenberg (1881-1959), grand marchand d'Art et galeriste parisien avant d'être, en raison des circonstances (la guerre et la traque des juifs) forcé de devenir new-yorkais.
J'ai apprécié ce second livre d'Anne Sinclair qui a mis ici en oeuvre tout son talent de journaliste (non d'intervieweuse mais d'investigation cette fois) pour aller à la pêche aux informations documentées et fiables, disséminées ici ou là, sur ce grand-père, certes connu et aimé d'elle en sa qualité de petite-fille, mais néanmoins méconnu dans son rôle de chef de famille auprès des siens et de grande figure de l'Art en France et aux Etats-Unis, en sa qualité de conseil, mécène, galeriste et marchand de très grands peintres : Braque, Matisse, Léger, et surtout Picasso, et ce, dans un contexte particulier.
Pourquoi une telle démarche ?
A la base, car il a fallu à Anne Sinclair renouveler sa carte d'identité française et elle s'est trouvée confrontée à un vrai obstacle : faire la preuve que ses grands-parents à la fois paternels et maternels et ses parents étaient bien Français en fournissant les documents ad hoc.
En fouillant les archives familiales, elle a découvert toute une somme de documents précieux sur sa famille, mais aussi sur l'histoire de l'Art au cours du XXe siècle, documents qu'elle a donc envisagé d'exploiter pour sa famille en premier lieu, mais aussi pour le plus grand nombre considérant leur portée historique.
Bien sûr, par ce livre, elle avait à coeur de rendre hommage en premier lieu à ce grand homme que l'Histoire d'aujourd'hui à quelque peu oublié (sauf sans doute les spécialistes de l'Art), mais aussi de laisser traces à des fins de transmission aux descendants de sa famille et à des fins d'utile information pour les autres.
Laisser traces de son parcours personnel et initiatique dans le domaine de l'Art aux côtés de son père (et arrière-grand-père d'Anne Sinclair) Alexandre Rosenberg - antiquaire de son état - et de son frère Léonce et cheminer avec elle à la découverte de sa vie intime avec sa famille, de son parcours, de ses compétences spécifiques, de son côté ambitieux et novateur, de sa démarche d'accompagnement auprès des peintres qu'il a eu à protéger et à promouvoir.
Laisser traces d'un contexte spécifique en matière d'Art. Dans ce domaine, les courants artistiques sont très nombreux et le XXe siècle est, en cela, particulièrement parlant. Mais, certains peintres évoluent parfois plus vite dans leur peinture que les personnes (et les institutions de type musées) susceptibles de les apprécier à leur juste mesure. Aussi, toute la subtilité et le savoir-faire d'un marchand d'Art qui se respecte est de faire en sorte que les goûts parviennent à évoluer progressivement pour, à un instant T et alors que les stocks de nouvelles oeuvres ont été savamment constitués, faire en sorte de générer la demande et les vendre aux meilleures conditions ! Paul Rosenberg avait du nez pour détecter l'usure des acheteurs potentiels, pousser ses protégés à innover et à évoluer, favoriser l'envie des potentiels collectionneurs.
Laisser traces aussi de l'histoire d'un lieu spécifique : le 21 rue de la Boétie qui a servi de galerie à Paul Rosenberg, mais aussi de lieu d'habitation jusqu'à son départ aux Etats-Unis (automne 1940). de nombreuses descriptions des lieux, mais aussi de la décoration et des oeuvres qui ont pu y être exposées font de ce lieu vivant un personnage de l'histoire à part entière. Ce lieu aura tout un autre destin au cours de l'occupation par les Allemands : suite à réquisition, il hébergera en mai 1941 les locaux de l'Institut d'étude des Questions juives (sic !) devenu en 1943 l'Institut d'étude des Questions juives et ethno-raciales (IEQJER). Entre ces deux périodes, Anne Sinclair évoque la façon dont les oeuvres, les meubles, la vaisselle, la décoration, etc. ont été littéralement pillées par les Allemands avec la complicité du concierge de l'endroit, qui n'a pas hésité à se servir au passage (cf. le procès qui s'est tenu).
D'autres lieux sont également évoqués tout au long du livre, les lieux de vacances, le Castel aux environs de Bordeaux où un temps la famille a trouvé refuge, la galerie de New-York (1941-1953), d'autres adresses où Paul Rosenberg a logé après son retour en France, mais aussi des endroits où certains peintres avaient leurs habitudes de vie (on entre ainsi, un peu, dans leur intimité de vie) en région parisienne ou sur leurs lieux de villégiature.
Laisser traces des circonstances qui ont conduit la famille Rosenberg a émigré aux Etats-Unis, de la façon dont ils ont été accueillis, de leur implication certes limitée mais néanmoins importante pour financer certains projets et maintenir vivace l'intérêt pour l'Art français, de l'implication des autres membres de la famille en temps de guerre (Alexandre qui suivra la 2e DB du Général Leclerc ; Les frères et soeur de Paul) et leur devenir après-guerre.
Laisser traces du contexte dans lequel évoluaient les peintres et les marchands de l'époque, dans un Paris et dans une France occupée. On verra ainsi, ceux qui auront eu l'indécence de collaborer avec l'ennemi sans doute pour continuer d'exister et de s'enrichir et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, faisaient tout pour résister à l'occupant).
laisser traces des liens amicaux particuliers qu'ont entretenu Paul Rosenberg et Pablo Picasso et de la teneur de leurs échanges (verbaux ou écrits) avant, pendant, et après-guerre.
Laisser traces de l'incroyable spoliation de leurs biens dont les juifs ont été les victimes (trop souvent avec la complicité de Vichy et de la police française), mais aussi du pillage systématique des oeuvres (et pas seulement les peintures) dans les musées nationaux (Hitler a ainsi fourni aux musées allemands des oeuvres qu'ils n'auraient jamais pu acquérir et Goering, grand amateur d'Art devant l'Eternel n'a pas manqué de constituer sa grande collection privée). Certaines seront malgré tout sauvées grâce au courage de Français (travaillant dans des musées) impliqués au péril de leur vie.
Enfin, le livre se termine sur les actions menées par Paul Rosenberg (et plus tard par ses héritiers) pour tenter de retrouver, en France, en Europe (Allemagne, Suisse) ou dans d'autres pays, chez des particuliers, dans des musées, ou chez des marchands ayant encore pignon sur rue, et le plus souvent par voie de justice, les oeuvres qui ont été volées à sa famille.
Mais aussi, sur la culpabilité ressentie par Paul Rosenberg d'avoir survécu après avoir fui pour sauver sa famille.
C'est un livre vraiment passionnant, mais je dois reconnaître qu'il faut toutefois s'accrocher tant il fourmille de va-et-vient et de détails (personnels, professionnels, contextuels, historiques) qui renseignent certes mais qui en font une matière particulièrement dense.
Je croyais lire une biographie et en fait, j'ai eu à lire, une enquête particulièrement fouillée et documentée (mêlant l'histoire d'une famille, l'histoire de certains peintres, l'histoire des courants artistiques au XXe l'Histoire de France...) évoquant beaucoup (trop ?) le domaine de l'Art et notamment les relations entre Paul Rosenberg et les peintres qu'il a suivis. Pour pouvoir aller au bout, j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort : si je connais bien la littérature et les écrivains, je ne connais pas grand-chose à la peinture et à ses nombreux courants (donc, de nombreuses informations ne me parlaient pas vraiment). de même, je ne visualisais pas une grande partie des oeuvres (magistrales ou pas) dont il était question ici.
Mais, je ne doute pas qu'un lecteur ou une lectrice avertie des choses de l'Art appréciera cette plongée dans l'univers de la peinture du XXe siècle.
J'ai apprécié ce second livre d'Anne Sinclair qui a mis ici en oeuvre tout son talent de journaliste (non d'intervieweuse mais d'investigation cette fois) pour aller à la pêche aux informations documentées et fiables, disséminées ici ou là, sur ce grand-père, certes connu et aimé d'elle en sa qualité de petite-fille, mais néanmoins méconnu dans son rôle de chef de famille auprès des siens et de grande figure de l'Art en France et aux Etats-Unis, en sa qualité de conseil, mécène, galeriste et marchand de très grands peintres : Braque, Matisse, Léger, et surtout Picasso, et ce, dans un contexte particulier.
Pourquoi une telle démarche ?
A la base, car il a fallu à Anne Sinclair renouveler sa carte d'identité française et elle s'est trouvée confrontée à un vrai obstacle : faire la preuve que ses grands-parents à la fois paternels et maternels et ses parents étaient bien Français en fournissant les documents ad hoc.
En fouillant les archives familiales, elle a découvert toute une somme de documents précieux sur sa famille, mais aussi sur l'histoire de l'Art au cours du XXe siècle, documents qu'elle a donc envisagé d'exploiter pour sa famille en premier lieu, mais aussi pour le plus grand nombre considérant leur portée historique.
Bien sûr, par ce livre, elle avait à coeur de rendre hommage en premier lieu à ce grand homme que l'Histoire d'aujourd'hui à quelque peu oublié (sauf sans doute les spécialistes de l'Art), mais aussi de laisser traces à des fins de transmission aux descendants de sa famille et à des fins d'utile information pour les autres.
Laisser traces de son parcours personnel et initiatique dans le domaine de l'Art aux côtés de son père (et arrière-grand-père d'Anne Sinclair) Alexandre Rosenberg - antiquaire de son état - et de son frère Léonce et cheminer avec elle à la découverte de sa vie intime avec sa famille, de son parcours, de ses compétences spécifiques, de son côté ambitieux et novateur, de sa démarche d'accompagnement auprès des peintres qu'il a eu à protéger et à promouvoir.
Laisser traces d'un contexte spécifique en matière d'Art. Dans ce domaine, les courants artistiques sont très nombreux et le XXe siècle est, en cela, particulièrement parlant. Mais, certains peintres évoluent parfois plus vite dans leur peinture que les personnes (et les institutions de type musées) susceptibles de les apprécier à leur juste mesure. Aussi, toute la subtilité et le savoir-faire d'un marchand d'Art qui se respecte est de faire en sorte que les goûts parviennent à évoluer progressivement pour, à un instant T et alors que les stocks de nouvelles oeuvres ont été savamment constitués, faire en sorte de générer la demande et les vendre aux meilleures conditions ! Paul Rosenberg avait du nez pour détecter l'usure des acheteurs potentiels, pousser ses protégés à innover et à évoluer, favoriser l'envie des potentiels collectionneurs.
Laisser traces aussi de l'histoire d'un lieu spécifique : le 21 rue de la Boétie qui a servi de galerie à Paul Rosenberg, mais aussi de lieu d'habitation jusqu'à son départ aux Etats-Unis (automne 1940). de nombreuses descriptions des lieux, mais aussi de la décoration et des oeuvres qui ont pu y être exposées font de ce lieu vivant un personnage de l'histoire à part entière. Ce lieu aura tout un autre destin au cours de l'occupation par les Allemands : suite à réquisition, il hébergera en mai 1941 les locaux de l'Institut d'étude des Questions juives (sic !) devenu en 1943 l'Institut d'étude des Questions juives et ethno-raciales (IEQJER). Entre ces deux périodes, Anne Sinclair évoque la façon dont les oeuvres, les meubles, la vaisselle, la décoration, etc. ont été littéralement pillées par les Allemands avec la complicité du concierge de l'endroit, qui n'a pas hésité à se servir au passage (cf. le procès qui s'est tenu).
D'autres lieux sont également évoqués tout au long du livre, les lieux de vacances, le Castel aux environs de Bordeaux où un temps la famille a trouvé refuge, la galerie de New-York (1941-1953), d'autres adresses où Paul Rosenberg a logé après son retour en France, mais aussi des endroits où certains peintres avaient leurs habitudes de vie (on entre ainsi, un peu, dans leur intimité de vie) en région parisienne ou sur leurs lieux de villégiature.
Laisser traces des circonstances qui ont conduit la famille Rosenberg a émigré aux Etats-Unis, de la façon dont ils ont été accueillis, de leur implication certes limitée mais néanmoins importante pour financer certains projets et maintenir vivace l'intérêt pour l'Art français, de l'implication des autres membres de la famille en temps de guerre (Alexandre qui suivra la 2e DB du Général Leclerc ; Les frères et soeur de Paul) et leur devenir après-guerre.
Laisser traces du contexte dans lequel évoluaient les peintres et les marchands de l'époque, dans un Paris et dans une France occupée. On verra ainsi, ceux qui auront eu l'indécence de collaborer avec l'ennemi sans doute pour continuer d'exister et de s'enrichir et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, faisaient tout pour résister à l'occupant).
laisser traces des liens amicaux particuliers qu'ont entretenu Paul Rosenberg et Pablo Picasso et de la teneur de leurs échanges (verbaux ou écrits) avant, pendant, et après-guerre.
Laisser traces de l'incroyable spoliation de leurs biens dont les juifs ont été les victimes (trop souvent avec la complicité de Vichy et de la police française), mais aussi du pillage systématique des oeuvres (et pas seulement les peintures) dans les musées nationaux (Hitler a ainsi fourni aux musées allemands des oeuvres qu'ils n'auraient jamais pu acquérir et Goering, grand amateur d'Art devant l'Eternel n'a pas manqué de constituer sa grande collection privée). Certaines seront malgré tout sauvées grâce au courage de Français (travaillant dans des musées) impliqués au péril de leur vie.
Enfin, le livre se termine sur les actions menées par Paul Rosenberg (et plus tard par ses héritiers) pour tenter de retrouver, en France, en Europe (Allemagne, Suisse) ou dans d'autres pays, chez des particuliers, dans des musées, ou chez des marchands ayant encore pignon sur rue, et le plus souvent par voie de justice, les oeuvres qui ont été volées à sa famille.
Mais aussi, sur la culpabilité ressentie par Paul Rosenberg d'avoir survécu après avoir fui pour sauver sa famille.
C'est un livre vraiment passionnant, mais je dois reconnaître qu'il faut toutefois s'accrocher tant il fourmille de va-et-vient et de détails (personnels, professionnels, contextuels, historiques) qui renseignent certes mais qui en font une matière particulièrement dense.
Je croyais lire une biographie et en fait, j'ai eu à lire, une enquête particulièrement fouillée et documentée (mêlant l'histoire d'une famille, l'histoire de certains peintres, l'histoire des courants artistiques au XXe l'Histoire de France...) évoquant beaucoup (trop ?) le domaine de l'Art et notamment les relations entre Paul Rosenberg et les peintres qu'il a suivis. Pour pouvoir aller au bout, j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort : si je connais bien la littérature et les écrivains, je ne connais pas grand-chose à la peinture et à ses nombreux courants (donc, de nombreuses informations ne me parlaient pas vraiment). de même, je ne visualisais pas une grande partie des oeuvres (magistrales ou pas) dont il était question ici.
Mais, je ne doute pas qu'un lecteur ou une lectrice avertie des choses de l'Art appréciera cette plongée dans l'univers de la peinture du XXe siècle.
J'ai effectué le chemin contraire à celui pris par L'une, auteure d'une critique de ce livre : je l'ai lu après avoir visité la très belle exposition de Liège, et je ne le regrette pas. Je ne suis pas certain que mon intérêt se serait manifesté de la même manière.
Sa lecture me permettait de me replonger dans le circuit de cette exposition qui, en fin de compte, m'a paru plus passionnante que le livre.
L'histoire pourtant ne manque pas d'intérêt, celle d'un marchand d'art éclairé, Paul Rosenberg, qui sût déceler les talents de Picasso, Braque, Léger, Marie Laurencin, les faire connaître en Europe et aux Etas-Unis. Un marchand d'art juif, et dont nombre de tableaux furent dérobés par les Nazis et qui s'attachera dès la fin de la guerre, à les retrouver et à se les faire restituer non sans peine.
Les souvenirs et l'idée de rechercher l'histoire de son grand-père maternel trouvent leur origine dans une entrevue en 2010 qu'elle eût avec un fonctionnaire : " Vos quatre grands-parents, ils sont nés en France, oui ou non ?". Nous la sentons révoltée à ce moment-là et à beaucoup d'autres lorsqu'elle évoque plusieurs collaborateurs notoires, les lâchetés, les vols.
Une lecture facile, intéressante mais qui ne me laisse pas un souvenir inoubliable.
Sa lecture me permettait de me replonger dans le circuit de cette exposition qui, en fin de compte, m'a paru plus passionnante que le livre.
L'histoire pourtant ne manque pas d'intérêt, celle d'un marchand d'art éclairé, Paul Rosenberg, qui sût déceler les talents de Picasso, Braque, Léger, Marie Laurencin, les faire connaître en Europe et aux Etas-Unis. Un marchand d'art juif, et dont nombre de tableaux furent dérobés par les Nazis et qui s'attachera dès la fin de la guerre, à les retrouver et à se les faire restituer non sans peine.
Les souvenirs et l'idée de rechercher l'histoire de son grand-père maternel trouvent leur origine dans une entrevue en 2010 qu'elle eût avec un fonctionnaire : " Vos quatre grands-parents, ils sont nés en France, oui ou non ?". Nous la sentons révoltée à ce moment-là et à beaucoup d'autres lorsqu'elle évoque plusieurs collaborateurs notoires, les lâchetés, les vols.
Une lecture facile, intéressante mais qui ne me laisse pas un souvenir inoubliable.
« On oublie d'interroger les grands quand on est jeune. »
Après une période difficile de sa propre vie (affaire DSK en 2011), Anne Sinclair se recentre sur ses racines et met en scène son ascendance maternelle Rosenberg, notables juifs parisiens, avec son grand-père Paul , mythique marchand et collectionneur d'art. Une aventure familiale bousculée par la Grande Histoire avec la fuite vers les États Unis en 1940 et la spoliation des biens en France.
Entre ses recherches dans les archives personnelles et la documentation sur une époque, Anne Sinclair ressuscite les disparus avec ses propres souvenirs d'enfance et cette nostalgie de les suivre dans les lieux qui les ont vus vivre ou passer.
Le 21 rue La Boétie devient une entité vivante dans les pas d'un marchand visionnaire sur l'art moderne, croisant la fine fleur de la création artistique de l'entre-deux-guerres. Si le destin des Rosenberg a été plutôt clément en miroir de la Shoah, il convient de mesurer les conséquences de ce bouleversement avec l'installation définitive de la famille aux États Unis et le parcours chaotique de récupération des biens spoliés.
Un livre passionnant écrit avec brio et une distance affectueuse, évoquant les aléas de la fortune, le sentiment d'exclusion et l'exil.
Après une période difficile de sa propre vie (affaire DSK en 2011), Anne Sinclair se recentre sur ses racines et met en scène son ascendance maternelle Rosenberg, notables juifs parisiens, avec son grand-père Paul , mythique marchand et collectionneur d'art. Une aventure familiale bousculée par la Grande Histoire avec la fuite vers les États Unis en 1940 et la spoliation des biens en France.
Entre ses recherches dans les archives personnelles et la documentation sur une époque, Anne Sinclair ressuscite les disparus avec ses propres souvenirs d'enfance et cette nostalgie de les suivre dans les lieux qui les ont vus vivre ou passer.
Le 21 rue La Boétie devient une entité vivante dans les pas d'un marchand visionnaire sur l'art moderne, croisant la fine fleur de la création artistique de l'entre-deux-guerres. Si le destin des Rosenberg a été plutôt clément en miroir de la Shoah, il convient de mesurer les conséquences de ce bouleversement avec l'installation définitive de la famille aux États Unis et le parcours chaotique de récupération des biens spoliés.
Un livre passionnant écrit avec brio et une distance affectueuse, évoquant les aléas de la fortune, le sentiment d'exclusion et l'exil.
critiques presse (3)
Renouant avec son métier de journaliste, Anne Sinclair a l’art de susciter l’intérêt pour un homme et une époque à travers une écriture claire, rapide, parfois répétitive mais toujours directe.
Lire la critique sur le site : LaLibreBelgique
Le pillage de sa collection à Paris et Libourne, la déchéance de la nationalité française en 1942, la bataille pour obtenir restitution de ses biens après 1945 : autant de faits qu'Anne Sinclair détaille tantôt avec ironie, tantôt avec indignation.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Le grand marchand d'art Paul Rosenberg, intime de Picasso, connut la gloire et l'exil. Sa petite-fille Anne Sinclair lui rend un hommage attendri mêlé d'introspection.
Lire la critique sur le site : Lexpress
Citations et extraits (12)
Voir plus
Ajouter une citation
Picasso augmente d'ailleurs ses prix de plus de 100% et acquiert, lui aussi, le sens des affaires. Paul le raconte en 1941 dans un article de Newsweek : "Dans l'atelier de Picasso, je choisis les peintures que je souhaite acheter, et quand nous discussions du prix, c'est là que l'amusement commence. On échange des arguments terribles, mais toujours amicaux. Je lui ai dit un jour que j'aimerais mordre une de ses joues et embrasser l'autre !"
Paul Rosenberg était installé dans une existence très confortable, et n'a certes pas navigué de la bohème à la bourgeoisie, puis de celle-ci au Parti communiste, comme son ami Picasso. Pourtant il ne jugeait pas des affaires publiques uniquement en fonction de son appartenance au milieu dans lequel il vivait. "Gauche caviar", dirait-on aujourd'hui pour moquer qui ne se coule pas obligatoirement dans les opinions politiques de son milieu social. Comme si le déterminisme du compte en banque était plus fort que les convictions, et que les gens qui "ont du bien", comme on disait autrefois, ne pouvaient que voter dans l'intérêt de leur classe sociale.
Le 23 février 1942, un décret prononce la "dénationalisation" de Paul Rosenberg et de sa famille.
[...]
Mon grand Paul refusera tout contact avec Vichy pour "plaider sa cause". A quelqu'un qui s'était proposé de s'entremettre, il écrit le 24 avril 1942 :
"Les récents événements en France sont tels que je ne voudrais pas avoir quelque communication que ce soit avec un gouvernement dirigé par un homme comme Laval. Je préférerais perdre tout ce que je possède."
C'est ce qui arriva pour ses tableaux, comme pour ses illusions.
[...]
Mon grand Paul refusera tout contact avec Vichy pour "plaider sa cause". A quelqu'un qui s'était proposé de s'entremettre, il écrit le 24 avril 1942 :
"Les récents événements en France sont tels que je ne voudrais pas avoir quelque communication que ce soit avec un gouvernement dirigé par un homme comme Laval. Je préférerais perdre tout ce que je possède."
C'est ce qui arriva pour ses tableaux, comme pour ses illusions.
Paul retourna aux Collettes deux semaines plus tard pour assister aux obsèques de Renoir, mort le 3 décembre.
[...]
L'office commença, simple, sans paroles, sans musique, sans apparat, comme Renoir lui même l'aurait voulu.
[...]
Je pensais qu'en d'autres temps, à d'autres époques, il aurait eu des obsèques nationales.
[...]
L'office commença, simple, sans paroles, sans musique, sans apparat, comme Renoir lui même l'aurait voulu.
[...]
Je pensais qu'en d'autres temps, à d'autres époques, il aurait eu des obsèques nationales.
Comme dans tout régime totalitaire qui prétend définir un "homme nouveau", l'art était une priorité pour les apôtres du national-socialisme, et l'obsession des nazis fut de faire de l'art un instrument de propagande.
Videos de Anne Sinclair (5)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : biographieVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Anne Sinclair (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1722 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1722 lecteurs ont répondu