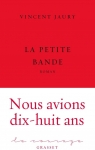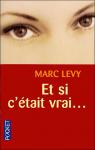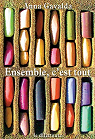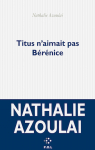Rencontre avec Nathalie Azoulai à l'occasion de la parution de Python aux éditions P.O.L.
Nathalie Azoulai est née en région parisienne. École Normale Supérieure et agrégation de lettres. Vit et travaille à Paris. Elle a notamment publié chez P.O.L La fille parfaite (2022), Clic-clac (2019), En découdre (2019), Les spectateurs (2018) et Titus n'aimait pas Bérénice (2015, prix Médicis).
--
05/03/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite (https://ausha.co/politique-de-confidentialite) pour plus d'informations.

Nathalie Azoulai/5
213 notes
Résumé :
Elle a dit, c'est génial finalement, considère qu'on est les deux filles d'une seule et même famille : l'une fera des maths, l'autre des lettres. Nos parents auront le sentiment d'avoir accompli une progéniture parfaite, qui couvre tout le spectre. Tu te rends compte, où qu'ils tournent la tête, nos parents, il y a toujours une de leurs deux filles pour savoir. Ce doit être extrêmement satisfaisant pour des parents, tu ne crois pas, d'atteindre ces extrémités, des c... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La fille parfaiteVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (44)
Voir plus
Ajouter une critique
Deux grandes amies, lycéennes brillantissimes, Rachel Deville et Adèle Prinker, prennent des voies opposées : la première fait des études de lettres et la seconde de mathématiques. Cette orientation est en grande partie déterminée par leurs familles, les Deville étant une dynastie de grands bourgeois littéraires et les seconds, d'extraction plus modeste, ne jurant que par la science. Nous allons suivre leur parcours à la fois professionnel et d'amitié, celle-ci connaissant des moments de « fusion » et aussi de longs moments de silence complet. ● Je crois que je n'ai absolument pas compris où Nathalie Azoulai voulait nous emmener : à déterminer qui des deux en compétition est cette « fille parfaite » ? A faire l'histoire d'une amitié en dents de scie ? A s'interroger sur le suicide ? Sur la prédominance de la science dans le monde contemporain ? Sur la perfection qui n'est pas de ce monde ? Tout cela à la fois ? ● Je n'avais déjà pas aimé son roman le plus connu, Titus n'aimait pas Bérénice, prix Médicis 2015, j'ai voulu récidiver avec celui-ci dont la thématique, une amitié entre deux jeunes filles opposées, me paraissait à première vue intéressante. ● Mais Nathalie Azoulai a une façon d'opposer les sciences et les lettres qui sonne très années quatre-vingt ; il me semble qu'aujourd'hui on a dépassé ce genre d'oppositions stériles sur lesquelles on pouvait à l'époque demander aux lycéens de disserter. ● du coup, la chronique analytique de cette amitié m'a semblé vaine, creuse et lourde, et surtout très ennuyeuse. ● L'alternance aujourd'hui (Adèle Prinker s'est pendue à 46 ans – je ne divulgâche rien, c'est dans les toutes premières pages) et hier (la vie des deux étudiantes) ne suffit pas à dynamiser un récit d'une grande platitude, dans lequel des analyses spécieuses succèdent à la narration de micro-événements sans aucun intérêt. ● Je ne me suis attaché à aucun des personnages, les familles Deville et Prinker réussissent l'exploit d'apparaître à la fois caricaturales et superficiellement caractérisées. ● On peut cependant sauver le style, et quelques moments de grâce : « On ne se pend pas sans penser à l'image qu'on va produire, la stupeur, le face à face des deux corps à la verticale, le vivant et le mort, l'effet du poids qui pend, l'effroi pantois du premier témoin, la misère crue de la dépouille. » ● « [Q]uand je lis de la philosophie, j'ai l'impression de mâcher du vide. » ● « J'adorais Darwin, je trouvais qu'il expliquait notre existence mieux que tous les romans du monde. Mais les littéraires n'aiment pas Darwin et n'aiment pas qu'on aime Darwin, ils trouvent que c'est une vision du monde qui manque de douceur et de vertu. » ● Ou encore : « le problème, c'est que je me méfiais de mes nouveaux pairs, les écrivains. Leur sentiment d'importance, leurs poses, leurs pétitions et leurs cascades de vertu m'incommodaient et me rappelaient le salon de ma mère. Plus je les côtoyais, plus je remarquais qu'ils inventaient toutes sortes de mythes et de figures pour pourfendre, incriminer, s'indigner, sans la moindre connaissance ni en économie, ni en géopolitique, ni en rien de ce qui faisait réellement tourner le monde. Au réel, ils préféraient leurs cosmogonies où des dieux vils et sanguinaires se déchaînaient invariablement contre des peuples sans ressources. Ça leur donnait une position, une chaire depuis laquelle juger, pérorer, proclamer l'existence du Bien et, par la même occasion, la leur. »
“Adèle pendue comme un homme”. Ainsi s'ouvre le roman de Nathalie Azoulai. A quarante-six ans, la brillante mathématicienne était au sommet de sa gloire. Celle qui choisissait depuis toujours la voie la plus difficile, avait su conquérir un monde d'hommes tout en se réalisant en tant que femme. Elle laisse derrière elle un mari aimant et un adorable garçon tout juste âgé de dix ans. Pour Rachel, sa meilleure amie, celle qui était sa jumelle, son double littéraire, c'est inconcevable, ou presque… Pour comprendre comment elles ont pu en arriver là, cette dernière, devenue une autrice de renom, va enquêter, revenir sur leur passé, sur ce qui les a construites, leurs moments de fusions transcendantales comme leur jalousie destructrice... Un portrait sulfureux et sans concession d'une amitié indéfectible.
A travers le récit de cette amitié fusionnelle, Nathalie Azoulai va tenter de faire cohabiter, tout au long de son roman, deux mondes qui semblent, a priori, antinomiques et irréconciliables. D'un côté les lettres et l'art avec leur abstraction, leur fantaisie et leur créativité et de l'autre, les sciences, avec leur rigueur, leur précision, leurs certitudes. Les mathématiques étant considérées, bien évidemment, comme le savoir noble. “La fille parfaite” c'est elle, cette combinaison entre Rachel et Adèle, une entité bicéphale qui, à elle seule, balaie tout le spectre du savoir.
J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir comment s'était construite cette amitié, le poids de l'environnement ainsi que l'influence des deux jeunes filles l'une sur l'autre. Car, si l'alchimie est intellectuelle, la ressemblance touche aussi le physique entre les deux amies “à la blondeur abrasive”, Rachel recherchant à tout prix la symétrie dans sa quête obsessionnelle des mathématiques.
Le roman est très bien écrit, truffé de références intellectuelles, qu'elles soient artistiques ou scientifiques, tout en restant accessible. C'est intelligent, bien mené et on se laisse aisément prendre au jeu du “je t'aime, moi non plus”. Par ailleurs, j'ai trouvé les personnages fouillés et attachants. Certes, Nathalie Azoulai n'évite pas certains clichés et cette opposition incessante de l'art et des sciences peut paraître répétitive à la longue, néanmoins, je ne me suis pas ennuyée une seconde et j'ai passé un très bon moment de lecture!
A travers le récit de cette amitié fusionnelle, Nathalie Azoulai va tenter de faire cohabiter, tout au long de son roman, deux mondes qui semblent, a priori, antinomiques et irréconciliables. D'un côté les lettres et l'art avec leur abstraction, leur fantaisie et leur créativité et de l'autre, les sciences, avec leur rigueur, leur précision, leurs certitudes. Les mathématiques étant considérées, bien évidemment, comme le savoir noble. “La fille parfaite” c'est elle, cette combinaison entre Rachel et Adèle, une entité bicéphale qui, à elle seule, balaie tout le spectre du savoir.
J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir comment s'était construite cette amitié, le poids de l'environnement ainsi que l'influence des deux jeunes filles l'une sur l'autre. Car, si l'alchimie est intellectuelle, la ressemblance touche aussi le physique entre les deux amies “à la blondeur abrasive”, Rachel recherchant à tout prix la symétrie dans sa quête obsessionnelle des mathématiques.
Le roman est très bien écrit, truffé de références intellectuelles, qu'elles soient artistiques ou scientifiques, tout en restant accessible. C'est intelligent, bien mené et on se laisse aisément prendre au jeu du “je t'aime, moi non plus”. Par ailleurs, j'ai trouvé les personnages fouillés et attachants. Certes, Nathalie Azoulai n'évite pas certains clichés et cette opposition incessante de l'art et des sciences peut paraître répétitive à la longue, néanmoins, je ne me suis pas ennuyée une seconde et j'ai passé un très bon moment de lecture!
Adèle et Rachel, ce sont deux faces d'un même Louis d'or, c'est un peu réducteur mais l'idée est presque cernée, un côté pile littéraire et un côté face scientifique, ou l'inverse. Deux filles pour un titre qui reste au singulier. En cela, elles suivent l'héritage familial, sauf au bac qui sera un choix risqué : une rébellion ? ou un challenge encore pour se démarquer du contexte familial ? Elles sont amies, soeurs, complétudes, unies-vers la recherche de l'excellence. Elles ne sont pas en concurrence, même si la frontière entre deux "jumelles", est toujours floues. Elles sont exigeantes l'une envers l'autre : se persuadant d'être hors la compétition, l'arrogance pour carapace mais l'ego fragile. Et, en effet, Adèle en arrive à se suicider, enfin ça c'est le début du roman... Ce roman réclame de la concentration, et confirme une belle plume française, pas toujours aisée, hautement riche d'informations et de réflexions. Mon bémol quand même : une fin heureusement atteinte parce qu'un peu plus de cette guéguerre littérature/mathématiques et ça aurait été l'indigestion.
Adèle, l'amie d'enfance de Rachel, la narratrice, se suicide, sans lui laisser de mot d'explication. Bouleversée, Rachel se remémore leur amitié, pour essayer de comprendre comment Adèle a pu aboutir à ce geste.
C'est une amitié étrange qui lie Adèle et Rachel, a la limite de la toxicité, basée depuis toujours sur la concurrence et une certaine dose de dévalorisation de la part de la narratrice.
Tout oppose Adèle et Rachel : la première, fille d'une famille qui a réussi à se hisser vers la classe moyenne par le travail, est un pur esprit scientifique, tandis que la seconde vient d'une famille aisée baignant dans une culture toute littéraire. Cette différence entre les deux filles, malgré leur blondeur et leur ressemblance, a été comblée par leur vive intelligence, peut être plus marquée chez Adèle, et surtout par l'admiration ambiguë de Rachel pour Adèle. Des sentiments vifs mâtinés d'orgueil blessé qui ont longtemps attiré Rachel vers son amie, tout en la poussant à rompre leur relation, en vain.
En effet, l'admiration que ressent Rachel pour Adèle corrompt tout ce qu'elle aime, comme si cette dernière était un trou noir qui gâte les choses par sa seule présence. Ainsi, même si Rachel aime profondément la littérature au point de devenir écrivaine, elle est tellement influencée par le mépris de son amie pour cet art et tellement pénétrée par son sentiment d'infériorité à son égard, qu'elle se persuadera que les lettres sont pour les intelligences moyennes, ce qui le fera souffrir toute sa vie. Tout est en effet matière chez Rachel à se comparer, se dévaloriser, sans voir qu'Adèle doit certainement ressentir des sentiments du même ordre, car Rachel au final est plus libre : libre de faire des maths au lycée, pour être dans la même classe qu'Adèle, au lieu de se lancer dans la littérature, alors qu'Adèle a été dressée par son père pour faire des maths ; libre de rester célibataire et sans enfants, alors qu'Adèle s'est mariée jeune et a eu un enfant, contrainte supplémentaire dans une carrière.
Une amitié toxique est un sujet habituellement traité de manière chaude et émotionnelle, puisque la confusion des sentiments est à l'oeuvre dans ce type d'attachement. Or, que ce roman est froid et distant ! A l'image d'ailleurs d'Adèle et de Rachel, cette dernière décrivant ses sentiments comme des Mister Freeze placés près du coeur (c'est dire). Cette mise à distance de tout sentiment et émotion m'ont empêchée de développer une quelconque empathie à leur égard. C'est particulièrement bien écrit, mais l'érudition et les références dispensées un peu partout dans le texte m'ont mise un peu plus à l'écart encore, étant loin de les saisir (étant « littéraire », j'en ai pris pour mon grade…). Cette binarité d'ailleurs entre les sciences et cet art presque vulgaire qu'est la littérature m'ont interrogée : pourquoi les éloigner à ce point ?
Bref un ouvrage qui, malgré ses qualités littéraires justement, ne m'a pas emportée du tout. Vite, un peu de chaleur !
C'est une amitié étrange qui lie Adèle et Rachel, a la limite de la toxicité, basée depuis toujours sur la concurrence et une certaine dose de dévalorisation de la part de la narratrice.
Tout oppose Adèle et Rachel : la première, fille d'une famille qui a réussi à se hisser vers la classe moyenne par le travail, est un pur esprit scientifique, tandis que la seconde vient d'une famille aisée baignant dans une culture toute littéraire. Cette différence entre les deux filles, malgré leur blondeur et leur ressemblance, a été comblée par leur vive intelligence, peut être plus marquée chez Adèle, et surtout par l'admiration ambiguë de Rachel pour Adèle. Des sentiments vifs mâtinés d'orgueil blessé qui ont longtemps attiré Rachel vers son amie, tout en la poussant à rompre leur relation, en vain.
En effet, l'admiration que ressent Rachel pour Adèle corrompt tout ce qu'elle aime, comme si cette dernière était un trou noir qui gâte les choses par sa seule présence. Ainsi, même si Rachel aime profondément la littérature au point de devenir écrivaine, elle est tellement influencée par le mépris de son amie pour cet art et tellement pénétrée par son sentiment d'infériorité à son égard, qu'elle se persuadera que les lettres sont pour les intelligences moyennes, ce qui le fera souffrir toute sa vie. Tout est en effet matière chez Rachel à se comparer, se dévaloriser, sans voir qu'Adèle doit certainement ressentir des sentiments du même ordre, car Rachel au final est plus libre : libre de faire des maths au lycée, pour être dans la même classe qu'Adèle, au lieu de se lancer dans la littérature, alors qu'Adèle a été dressée par son père pour faire des maths ; libre de rester célibataire et sans enfants, alors qu'Adèle s'est mariée jeune et a eu un enfant, contrainte supplémentaire dans une carrière.
Une amitié toxique est un sujet habituellement traité de manière chaude et émotionnelle, puisque la confusion des sentiments est à l'oeuvre dans ce type d'attachement. Or, que ce roman est froid et distant ! A l'image d'ailleurs d'Adèle et de Rachel, cette dernière décrivant ses sentiments comme des Mister Freeze placés près du coeur (c'est dire). Cette mise à distance de tout sentiment et émotion m'ont empêchée de développer une quelconque empathie à leur égard. C'est particulièrement bien écrit, mais l'érudition et les références dispensées un peu partout dans le texte m'ont mise un peu plus à l'écart encore, étant loin de les saisir (étant « littéraire », j'en ai pris pour mon grade…). Cette binarité d'ailleurs entre les sciences et cet art presque vulgaire qu'est la littérature m'ont interrogée : pourquoi les éloigner à ce point ?
Bref un ouvrage qui, malgré ses qualités littéraires justement, ne m'a pas emportée du tout. Vite, un peu de chaleur !
J'ai bien aimé lire ce livre. Je ne connais pas Nathalie Azoulai ni aucun de ses livres. J'y découvre une plume qui joue avec les mots, dissèque les émotions et les relations.
C'est le roman des oppositions : les sciences /la littérature, la rigueur /la liberté, la vie/la mort. C'est dans ces oppositions que Rachel et Adèle deviennent amies entre proximité, confidences et entraide mais aussi éloignement, silences et jalousies
Il y a certains passages plutôt noirs. Si vous êtes déprimé passez votre chemin et revenez quand vous serez bien dans vos baskets.
Je me suis demandée s'il y avait une part de réalité dans ce livre. Rachel a-t-elle quelque chose de Nathalie ? Qui est Adèle ?
Ce livre me donne envie de découvrir d'autres romans de l'autrice.
C'est le roman des oppositions : les sciences /la littérature, la rigueur /la liberté, la vie/la mort. C'est dans ces oppositions que Rachel et Adèle deviennent amies entre proximité, confidences et entraide mais aussi éloignement, silences et jalousies
Il y a certains passages plutôt noirs. Si vous êtes déprimé passez votre chemin et revenez quand vous serez bien dans vos baskets.
Je me suis demandée s'il y avait une part de réalité dans ce livre. Rachel a-t-elle quelque chose de Nathalie ? Qui est Adèle ?
Ce livre me donne envie de découvrir d'autres romans de l'autrice.
critiques presse (7)
Dans « La Fille parfaite », Nathalie Azoulai retrace l’amitié faite de fusion et de ruptures entre une littéraire et une scientifique. Une puissante aventure cérébrale.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
C’est une histoire d’amitié. De choix existentiels, aussi, puisque La Fille parfaite, de Nathalie Azoulai, raconte les parcours opposés de deux jeunes femmes qui ont choisi des voies différentes vers ce qu’on appelle la réussite.
Lire la critique sur le site : LaPresse
Si La fille parfaite porte une réflexion intéressante sur le rapport des filles à la science, le récit de la narratrice, où affleure bien peu d’émotion, demeure au bout du compte une tentative faible de comprendre le geste définitif de son amie. Un long récit qui donne aussi peu à voir qu’à éprouver.
Lire la critique sur le site : LeDevoir
Avec « La Fille parfaite », l’écrivaine signe son onzième roman en vingt ans. Autant d’occasions d’explorer les thèmes qui lui tiennent à cœur, dans une recherche constante de formes et de registres différents.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Une bouleversante histoire d’amitié qui est aussi une confrontation entre deux mondes, littéraire et scientifique.
Lire la critique sur le site : LaLibreBelgique
La romancière retrace avec une grâce infinie l’amitié de deux femmes, l’une écrivaine, l’autre mathématicienne. Un récit d’apprentissage et une confrontation entre l’art et les sciences.
Lire la critique sur le site : SudOuestPresse
Au-delà du roman d'apprentissage, peut-être aux accents autobiographiques, la plume alerte et inspirée de Nathalie Azoulai, érudite sans être pontifiante (une gageure), nous emporte comme une lame de fond : impossible de lâcher cette reconstitution dense, intelligente, entre l'enquête et l'introspection.
Lire la critique sur le site : Lexpress
Citations et extraits (40)
Voir plus
Ajouter une citation
Sa mort a déclenché en moi un vrai siège à l’intérieur duquel le chagrin sinuait à peine. J’ai pensé que c’était l’affairement, toutes ces choses à organiser sous le choc, les membres gourds, l’œil perpétuellement rivé sur tout ce qui avait pu m’échapper : je bougeais, je parlais, mais tout était ralenti, mes pieds étaient pris dans la glace, ça ramait, ça n’avançait pas.
Primo, dans ma classe, il y avait trop de filles, des filles partout, des filles tout le temps. Avec leurs drames permanents, leurs dialogues maniaques, il m’a dit, je lui ai dit – pourquoi les filles restituent-elles les échanges avec un tel détail quand les garçons les résument ? – leurs allures de grappes sur les marches, les bancs dans la rue, leurs voix aiguës.
C’était sérieux, elle disait, mon rêve,
ce serait de faire des maths la journée et le soir, de
fendre les eaux turquoise comme une sirène. Et ce
n’était pas un vœu pieux, elle s’entraînait. Elle allait
plusieurs fois par semaine à la piscine et dirigeait
son corps comme un cylindre emmené par l’énergie
de ses bras qui crawlaient, crawlaient, jusqu’à sentir
ses jambes se joindre et onduler ensemble, depuis
la taille jusqu’au bout des orteils, et sans faire de
mousse. Elle me racontait ses séances, détaillait ses
sensations. La mousse, c’est l’échec, disait-elle gravement. Elle mettait des briques en caoutchouc entre
ses cuisses pour les tenir collées-collées, suturer ses
jambes de haut en bas, les zipper, c’était son mot.
Et sentir les deux plantes de ses pieds battre comme
une nageoire. Elle progressait, mais elle continuait
à pester : dans l’eau, ça se voyait, elle avait toujours
deux jambes distinctes, elle, elle pouvait l’oublier,
mais c’était évident, les autres ne voyaient que ça. Et
puis ses bras qui crawlaient, comme si une sirène, ça
crawlait !
ce serait de faire des maths la journée et le soir, de
fendre les eaux turquoise comme une sirène. Et ce
n’était pas un vœu pieux, elle s’entraînait. Elle allait
plusieurs fois par semaine à la piscine et dirigeait
son corps comme un cylindre emmené par l’énergie
de ses bras qui crawlaient, crawlaient, jusqu’à sentir
ses jambes se joindre et onduler ensemble, depuis
la taille jusqu’au bout des orteils, et sans faire de
mousse. Elle me racontait ses séances, détaillait ses
sensations. La mousse, c’est l’échec, disait-elle gravement. Elle mettait des briques en caoutchouc entre
ses cuisses pour les tenir collées-collées, suturer ses
jambes de haut en bas, les zipper, c’était son mot.
Et sentir les deux plantes de ses pieds battre comme
une nageoire. Elle progressait, mais elle continuait
à pester : dans l’eau, ça se voyait, elle avait toujours
deux jambes distinctes, elle, elle pouvait l’oublier,
mais c’était évident, les autres ne voyaient que ça. Et
puis ses bras qui crawlaient, comme si une sirène, ça
crawlait !
Sa mort me laisse donc la possibilité de ne plus me comparer, de me réjouir de l'avoir connue elle et, grâce à elle, d'avoir fait entrer tous ces affluents du savoir dans ma bulle d'écriture à l'instar de Flaubert qui voulait faire aussi bien que le scalpel de son père, mais les Mister Freeze fondent et se reforment aussi sec, comme des stalagmites. Dans un film d'épouvante, quand on croit le démon terrassé, in extremis, on voit sa main qui sort de terre.
P112-113: "je me suis demandée si j'avais bien fait de la rappeler car, en quelques minutes, j'ai reconnu cette sensation mitigée, ce courant glacée et cette question simple : m'étiat il agréable ou non de passer un moment avec Adèle ? Autrement dit, mon déplaisir entamait-il le charme ou l'amitié ? Je n'ai que des réponses compliquées parmi lesquelles ce choix qu'on fait parfois dans la vie d'avoir des compagnons, des partenaires mêmes, qui nous élèvent quoi qu'il arrive, dont on accepte qu'ils nous malmènent pourvu qu'ils nous surclassent, qui nous surclassent parce qu'ils nous malmènent".
P201-2020 : "mon père disait que j'étais l'héritière croisée de Kafka et de James, c'était flatteur, mais les compliments ne m'arrivaient jamais pleinement. Il semblaient toujours entamés, mités, car Adèle, de là où elle était, regardait encore par-dessus mon épaule. Comparés à ses équations différentielles, mes énoncés à moi restaient simples".
P264 (discours d'Adèle) "Bref, ce que je veux dire, c'est que Nicolas, mon fils, je l'adore, je l'aime tellement qure je pourrais tout abandonner pour lui, les maths, la recherche, les prix, toute ma vie. C'est l'ennemi juré de mon ambition alors je dois arbitrer en permanence parce que j'ai le choix entre cet amour et le travail".
P270 : "Arrêter de penser qu'il y a d'un côté les maths, de l'autre le monde, c'est le contraire,. Si vous choisisissez de ne plus faire de maths, vous parlerez la lange des humains mais vous ne parlerez jamais plus la langue du monde".
P201-2020 : "mon père disait que j'étais l'héritière croisée de Kafka et de James, c'était flatteur, mais les compliments ne m'arrivaient jamais pleinement. Il semblaient toujours entamés, mités, car Adèle, de là où elle était, regardait encore par-dessus mon épaule. Comparés à ses équations différentielles, mes énoncés à moi restaient simples".
P264 (discours d'Adèle) "Bref, ce que je veux dire, c'est que Nicolas, mon fils, je l'adore, je l'aime tellement qure je pourrais tout abandonner pour lui, les maths, la recherche, les prix, toute ma vie. C'est l'ennemi juré de mon ambition alors je dois arbitrer en permanence parce que j'ai le choix entre cet amour et le travail".
P270 : "Arrêter de penser qu'il y a d'un côté les maths, de l'autre le monde, c'est le contraire,. Si vous choisisissez de ne plus faire de maths, vous parlerez la lange des humains mais vous ne parlerez jamais plus la langue du monde".
Videos de Nathalie Azoulai (46)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Nathalie Azoulai (22)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Pas de sciences sans savoir (quiz complètement loufoque)
Présent - 1ère personne du pluriel :
Nous savons.
Nous savonnons (surtout à Marseille).
10 questions
412 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science
, savoir
, conjugaison
, humourCréer un quiz sur ce livre412 lecteurs ont répondu