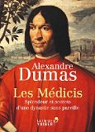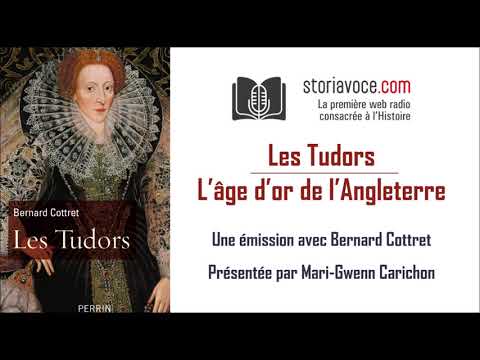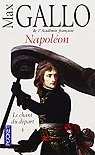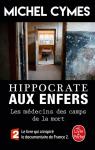Storia Voce - 12 février 2020
Les Tudors: l'âge d'or de l'Angleterre ?
En 1845, la couronne du souverain d’Angleterre Richard III est retrouvée dans la plaine boueuse d’un champ de bataille, sinistre symbole de la chute d’un roi. Les armées du dernier monarque de la maison d’York sont écrasées par celle d’Henri, comte de Richmond. Bosworth signe la fin de la guerre des Deux-Roses, ouvre l’ère d’une nouvelle dynastie. Richard III meurt laissant le trône d’Angleterre à son rival : Henri VII, dit Henri Tudor. Le conflit dynastique s’est conclu dans le sang, après 30 ans de rivalités entre les deux maisons. Mais d’où viennent les Tudors ? Certains voient dans cet évènement, la fin du Moyen-Age anglais et le début de la modernité. Quel crédit accorder alors à cette conception du passé ? Comment expliquer la postérité des Tudors notamment grâce aux films, aux œuvre littéraires, à tous ces arts qui créent la légende et qui nous incitent aujourd’hui à démêler le vrai du faux. Bernard Cottret vient nous parler de cette "dynastie qui a fait l'Angleterre".
L’invité: Bernard Cottret est professeur émérite de civilisation des îles Britanniques et de l’Amérique coloniale de l’Université de Versailles-Saint-Quentin. Membre honoraire senior de l’Institut universitaire de France, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux mondes anglo-saxons: Calvin, Henry VIII, Cromwell. Publié en 2015, La Révolution anglaise, une rébellion britannique 1603-1660 (Perrin, 2015). Il vient de publier l'histoire de "la dynastie qui a fait l'Angleterre": Les Tudors (Perrin, 2019).

Bernard Cottret/5
9 notes
Résumé :
En effet, après s’être opposé en 1507 à Henry VII dont il dénonce les exactions, Thomas More connaît une carrière politique brillante grâce à Henry VIII et devient ambassadeur puis grand chancelier. Il écrira d’ailleurs sa première grande oeuvre, Utopia, en 1516 lors d’une mission diplomatique. Catholique fervent (il a longuement hésité entre la vie politique et ecclésiastique), il combat les idées luthériennes et le protestantisme. Il perd d’ailleurs l’amitié du ro... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Thomas More : La face cachée des TudorsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Réaliser une biographie de cet homme si prolifique relevait de la gageure. Bernard Cottret a osé le faire. Perso je n'arriverai jamais à être exhaustif dans le cadre d'une chronique. Je vais oublier des trucs. Ca va ressembler à un tableau réalisé par petites touches tapées presque au hasard. D'autant qu'il faut parler de l'homme mais aussi de la façon dont il est évoqué dans ce livre, et parler de son ressenti.
Oulaaaa ! Trop dur !
…
Bon. Courage.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la bipolarité de More. Cet homme n'a cessé tout au long de sa vie d'être attiré par deux pôles proprement antagonistes : d'un côté il souhaitait s'appliquer une attitude de vie monastique. Il était fan du Livre qui faisait fureur à l'époque (et toujours de nos jours car c'est l'un des ouvrages les plus publiés au monde) « de l'Imitation de Jésus-Christ ». Il a partagé dans sa jeunesse la vie des Chartreux. Passer son existence entre prière, méditation, stoïcisme, bienséance chrétienne. Quel régal, pour lui. La fin de sa vie, emprisonné attendant son procès puis son exécution, lui permettra de renouer avec ce pôle, et il en tirera grand plaisir alors qu'il allait mourir à coup sûr.
De l'autre côté, il ne pouvait résister à être un homme qui agit dans le siècle. Il appliqua avec bonheur ses talents de juriste au commerce international de l'Angleterre, puis plus loin à la politique même. More fut par exemple signataire de la « Paix des Dames » orchestrée par Louise de Savoie, mère de François 1er, et Marguerite d'Autriche tante de Charles Quint, qui mit un point final (ou presque) aux engagements français en Italie. Et il fut avant tout chancelier d'Angleterre, probablement le deuxième poste de pouvoir après le Roi. Je place son action d'humaniste, son intérêt pour les sciences ou pour les écrits antiques, ses propres écrits progressistes tels que l'Utopie, de ce côté.
On ne peut évoquer son oeuvre humaniste sans parler de sa relation presque symbiotique avec Érasme. Ses deux-là furent les plus grands intellectuels de leur temps, et les meilleurs amis. La présente biographie réserve justement une large place à Érasme et à son oeuvre : « l'Éloge de la Folie » bien sûr, mais aussi la traduction de la Bible depuis le Grec, deux ouvrages qui, tel « l'Utopie », égratignent le pouvoir et les excès de l'Église Catholique. Érasme dédicaça astucieusement l'Éloge de la Folie à More, en notant que Folie s'écrit « moria » en grec (J.R.R. Tolkien a probablement lu le livre) : « J'ai pensé d'abord à ton propre nom de Morus » écrit-il « lequel est aussi voisin de celui de la folie, moria, que ta personne est éloignée d'elle ».
Mais le labeur le plus important de More fut dans le domaine religieux, et ce bien qu'il restât profondément laïc. More est contemporain de la naissance de la Réforme Protestante. Si au début de sa carrière il n'hésita pas à s'en prendre aux privilèges des prêtres, il devint le plus ardent défenseur du catholicisme en Angleterre. La majeure part de ses écrits consiste en attaques des thèses réformées et défenses de la hiérarchie catholique. Il s'en prit à Luther et à ses sbires. D'abord il fut triomphant, surtout en tant que chancelier où il n'hésita pas à griller des hérétiques – cette action constitue d'ailleurs la part d'ombre du personnage, difficilement « justifiée » par Cottret. Il était alors soutenu par le Roi Henri VIII. Mais vint le temps où Henri se brouilla à l'Église et le Pape qui refusait de lui accorder le divorce d'avec Catherine d'Aragon afin d'épouser la délicieuse Anne Boleyn . Et Henri coupa les ponts avec Rome et se proposa de devenir lui-même le chef de l'Église d'Angleterre. Et Henri réussit (qui souhaitait s'opposer à lui voyait sa tête détachée de son corps, au mieux). More resta droit dans ses bottes et ses convictions. On se méfia de lui, puis on l'accusa de haute trahison. Il resta droit. Il s'opposa avec tout son savoir juridique aux accusations. Il mit ses accusateurs en mauvaise posture. En pure perte il le savait. Jamais il ne se renia. Il accepta la mort avec joie car en paix avec Dieu et avec lui-même. Cette attitude si digne des plus grands héros tragiques comme Antigone lui valut la sainteté des siècles plus tard.
La décortication de ses écrits religieux occupe une large part de cette biographie. C'est peut-être la partie la plus répétitive, la plus ennuyeuse en fin de compte. Mais c'est aussi ici que j'ai appris le plus en ce qui concerne les points de discorde entre les thèses de Luther et celles de l'Église Catholique.
Pour finir, je rappellerai qu'une série TV a porté récemment sur les Tudors. Thomas More y occupe une large place. Et je me rend compte à présent à quel point les réalisateurs ont tenu à rester fidèle à l'image de la personnalité (des personnalités ?) hors du commun de cet homme. Cette série est géniale, et historiquement très correcte.
Oulaaaa ! Trop dur !
…
Bon. Courage.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la bipolarité de More. Cet homme n'a cessé tout au long de sa vie d'être attiré par deux pôles proprement antagonistes : d'un côté il souhaitait s'appliquer une attitude de vie monastique. Il était fan du Livre qui faisait fureur à l'époque (et toujours de nos jours car c'est l'un des ouvrages les plus publiés au monde) « de l'Imitation de Jésus-Christ ». Il a partagé dans sa jeunesse la vie des Chartreux. Passer son existence entre prière, méditation, stoïcisme, bienséance chrétienne. Quel régal, pour lui. La fin de sa vie, emprisonné attendant son procès puis son exécution, lui permettra de renouer avec ce pôle, et il en tirera grand plaisir alors qu'il allait mourir à coup sûr.
De l'autre côté, il ne pouvait résister à être un homme qui agit dans le siècle. Il appliqua avec bonheur ses talents de juriste au commerce international de l'Angleterre, puis plus loin à la politique même. More fut par exemple signataire de la « Paix des Dames » orchestrée par Louise de Savoie, mère de François 1er, et Marguerite d'Autriche tante de Charles Quint, qui mit un point final (ou presque) aux engagements français en Italie. Et il fut avant tout chancelier d'Angleterre, probablement le deuxième poste de pouvoir après le Roi. Je place son action d'humaniste, son intérêt pour les sciences ou pour les écrits antiques, ses propres écrits progressistes tels que l'Utopie, de ce côté.
On ne peut évoquer son oeuvre humaniste sans parler de sa relation presque symbiotique avec Érasme. Ses deux-là furent les plus grands intellectuels de leur temps, et les meilleurs amis. La présente biographie réserve justement une large place à Érasme et à son oeuvre : « l'Éloge de la Folie » bien sûr, mais aussi la traduction de la Bible depuis le Grec, deux ouvrages qui, tel « l'Utopie », égratignent le pouvoir et les excès de l'Église Catholique. Érasme dédicaça astucieusement l'Éloge de la Folie à More, en notant que Folie s'écrit « moria » en grec (J.R.R. Tolkien a probablement lu le livre) : « J'ai pensé d'abord à ton propre nom de Morus » écrit-il « lequel est aussi voisin de celui de la folie, moria, que ta personne est éloignée d'elle ».
Mais le labeur le plus important de More fut dans le domaine religieux, et ce bien qu'il restât profondément laïc. More est contemporain de la naissance de la Réforme Protestante. Si au début de sa carrière il n'hésita pas à s'en prendre aux privilèges des prêtres, il devint le plus ardent défenseur du catholicisme en Angleterre. La majeure part de ses écrits consiste en attaques des thèses réformées et défenses de la hiérarchie catholique. Il s'en prit à Luther et à ses sbires. D'abord il fut triomphant, surtout en tant que chancelier où il n'hésita pas à griller des hérétiques – cette action constitue d'ailleurs la part d'ombre du personnage, difficilement « justifiée » par Cottret. Il était alors soutenu par le Roi Henri VIII. Mais vint le temps où Henri se brouilla à l'Église et le Pape qui refusait de lui accorder le divorce d'avec Catherine d'Aragon afin d'épouser la délicieuse Anne Boleyn . Et Henri coupa les ponts avec Rome et se proposa de devenir lui-même le chef de l'Église d'Angleterre. Et Henri réussit (qui souhaitait s'opposer à lui voyait sa tête détachée de son corps, au mieux). More resta droit dans ses bottes et ses convictions. On se méfia de lui, puis on l'accusa de haute trahison. Il resta droit. Il s'opposa avec tout son savoir juridique aux accusations. Il mit ses accusateurs en mauvaise posture. En pure perte il le savait. Jamais il ne se renia. Il accepta la mort avec joie car en paix avec Dieu et avec lui-même. Cette attitude si digne des plus grands héros tragiques comme Antigone lui valut la sainteté des siècles plus tard.
La décortication de ses écrits religieux occupe une large part de cette biographie. C'est peut-être la partie la plus répétitive, la plus ennuyeuse en fin de compte. Mais c'est aussi ici que j'ai appris le plus en ce qui concerne les points de discorde entre les thèses de Luther et celles de l'Église Catholique.
Pour finir, je rappellerai qu'une série TV a porté récemment sur les Tudors. Thomas More y occupe une large place. Et je me rend compte à présent à quel point les réalisateurs ont tenu à rester fidèle à l'image de la personnalité (des personnalités ?) hors du commun de cet homme. Cette série est géniale, et historiquement très correcte.
Deux portraits de Thomas More : Celui peint par Holbein le jeune à la cour d'Angleterre en 1527. More a 49 ans. Juriste réputé, il a été appelé au conseil du Roi qui l'envoie volontiers en ambassade où il fait merveille. Il a été trésorier de la Couronne (1521), speaker du Parlement (1523). En 1525, il est chancelier du duché de Lancaster, propriété privée du Roi, fort rémunératrice pour le maître comme pour le serviteur. Bientôt Chancelier du Royaume en 1529, au sommet de sa gloire. le portrait révèle un menton volontaire, une bouche bien dessinée aux lèvres serrées, un nez fort, un regard attentif qui dit la réflexion, l'inquiétude ou la fatigue, comme le suggèrent quelques plis au coin des sourcils. La coiffe retient les cheveux et dégage le front, large, affichant la détermination, comme peut-être l'appréhension d'un avenir funeste. L'érudit de la Renaissance sait les relations de proximité du Capitole avec la roche Tarpéienne.
C'est pourtant un autre portrait qu'a choisi Bernard Cottret, l'excellent biographe de Thomas More, pour la couverture de son livre. Il s'agit d'une copie du premier tableau de Holbein, réalisé par un auteur inconnu, bien postérieur, de la fin du XVIe siècle. L'économie du portait est la même : le chapeau noir, le collier d'apparat sur la chasuble fourrée, la main serrant un parchemin d'un geste nerveux. La tenture verte donne la solennité au cadre. Mais le visage est différent. Il y a bien un air de ressemblance. Mais les traits sont plus fins, le nez droit, le visage plus serein, rajeuni. Et surtout un regard différent qui exprime vivacité et sensibilité, sans doute à cause d'un léger strabisme.
C'est un autre Thomas More qui apparait,celui que décrit bien son biographe dans la première partie de sa vie. Celui de l'auteur de "L'Utopie", écrite pendant un négociation diplomatique qui l'ennuyait. En complicité potache avec l'ami de toujours, Erasme : "les inséparables de l'aventure humaniste" (p. 39) unis pour une amitié de 35 ans jusqu'à leur mort presque concomitante. Érasme participe avec enthousiasme au livre de son ami et lui répond par un canular dédié à son cher "Morus le fou": c'est "L'Éloge de la folie". Avec "L' Utopie" ces livres connaitront la même fortune littéraire. Si l'on y ajoute "Le Prince" de Machiavel, écrit à la même époque, on a le brelan d'as de la pensée de la Renaissance. Peu de siècles commençant peuvent se parer d'un tel blason !
C'est une vie en trois temps que déroule Bernard Cottret. A l'insouciance et à la grâce de la jeunesse succèdent la gravité et l'engagement de l'homme d'État et enfin la disgrâce, vécue avec une détermination fidèle et une noblesse de caractère lui vaudront la plus haute reconnaissance de son église.
C'est la phase enjouée et dynamique de la jeunesse qui est la plus instructive. More traduit Pic de la Mirandole, qu'il admire. Avec Érasme, il traduisent Lucien de Samosate, auxquel ils empruntent le goût de l'éloge paradoxal et l'esprit farceur. Mais cela va plus loin : à la "Déclamation sur le tyrannicide" de Lucien, variations sur la question de la mise à mort des tyrans, More ajoute son mot et Érasme le sien, un demi siècle avant Étienne de la Boétie. Quel est la part de l'exercice de style et de la conviction profonde ? Celle du sophiste et celle du philosophe ?
Thomas More, comme son père est un juriste. Il s'inscrit au Barreau. Il devient l'avocat-conseil de la puissante corporation des merciers qui commerce avec la Flandre. Il est nommé juge de paix du comté de Middlesex. le voila magistrat, comme son père, appelé, comme tel, à siéger au premier Parlement en 1504, ou il obtient le refus de subsides pour le mariage de la fille du roi Henri VII. La mort du roi lui évite les sanctions du roi avaricieux. Puis le voici "undersheriff "au Guildhall de Londres : magistrat des affaires civiles pendant 15 ans. Sa réputation lui vaut d'être appelé par le nouveau roi dans une négociation en Flandre. Il s'y ennuie un peu et se distrait en écrivant son Utopie.
Le voici ferraillant auprès de son roi très catholique contre Luther, comme les meilleur des clercs, qu'il n'est pas. La disgrâce de Wolsey en fait le chancelier d'Angleterre. Henri VIII le fantasque, décidé à divorcer, quitte l'Eglise qui l'empêche d'épouse Anne Boleyn. Déchiré entre la fidélité à son roi et l'obéissance au Pape, voici More dans la zone de turbulences, bientôt enfermé à la tour de Londres au printemps 1534. C'est là qu'il écrit les lettres à sa fille, si touchantes. En faveur de sa cause, sa dialectique fait merveille, jusque dans son refus de prêter le serment de succession. Les actes de son procès en témoignent : il démonte tranquillement toutes les accusations : "Le devoir du bon sujet, à moins qu'il ne se révèle mauvais chrétien, ne saurait être d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu" (p. 299). Un Antigone catholique et apostolique, en somme.
Mais la justice est celle du roi. Douze jurés, en un quart d'heure, le déclarent coupable. More doit rappeler la procédure pour avoir la parole en dernier, au risque d'exaspérer. Il sera "pendu, puis découpé vif, castré, éventré pour que l'on pût commodément lui brûler les entrailles avant de déposer les quatre parties de son corps aux principales entrées de la ville en réservant sa tête pour le London bridge." (p. 302). Mais il va bénéficier, sur ce point, d'une grâce royale, allégeant le programme des festivités et transformant le supplice en simple exécution à la hache. "Que dieu permette que le roi n'ait pas à faire preuve d'autant de clémence pour aucun de mes amis, et qu'il délivre ma postérité d'une telle grâce" commentera simplement Thomas More.
Il monte courageusement à l'échafaud. "Je remercie Sa Majesté de m'avoir tenu reclus dans cet endroit où j'ai pu amplement méditer sur la fin. Je lui sais gré de me libérer des misères de ce pauvre monde" (p. 305).
Lien : https://diacritiques.blogspo..
C'est pourtant un autre portrait qu'a choisi Bernard Cottret, l'excellent biographe de Thomas More, pour la couverture de son livre. Il s'agit d'une copie du premier tableau de Holbein, réalisé par un auteur inconnu, bien postérieur, de la fin du XVIe siècle. L'économie du portait est la même : le chapeau noir, le collier d'apparat sur la chasuble fourrée, la main serrant un parchemin d'un geste nerveux. La tenture verte donne la solennité au cadre. Mais le visage est différent. Il y a bien un air de ressemblance. Mais les traits sont plus fins, le nez droit, le visage plus serein, rajeuni. Et surtout un regard différent qui exprime vivacité et sensibilité, sans doute à cause d'un léger strabisme.
C'est un autre Thomas More qui apparait,celui que décrit bien son biographe dans la première partie de sa vie. Celui de l'auteur de "L'Utopie", écrite pendant un négociation diplomatique qui l'ennuyait. En complicité potache avec l'ami de toujours, Erasme : "les inséparables de l'aventure humaniste" (p. 39) unis pour une amitié de 35 ans jusqu'à leur mort presque concomitante. Érasme participe avec enthousiasme au livre de son ami et lui répond par un canular dédié à son cher "Morus le fou": c'est "L'Éloge de la folie". Avec "L' Utopie" ces livres connaitront la même fortune littéraire. Si l'on y ajoute "Le Prince" de Machiavel, écrit à la même époque, on a le brelan d'as de la pensée de la Renaissance. Peu de siècles commençant peuvent se parer d'un tel blason !
C'est une vie en trois temps que déroule Bernard Cottret. A l'insouciance et à la grâce de la jeunesse succèdent la gravité et l'engagement de l'homme d'État et enfin la disgrâce, vécue avec une détermination fidèle et une noblesse de caractère lui vaudront la plus haute reconnaissance de son église.
C'est la phase enjouée et dynamique de la jeunesse qui est la plus instructive. More traduit Pic de la Mirandole, qu'il admire. Avec Érasme, il traduisent Lucien de Samosate, auxquel ils empruntent le goût de l'éloge paradoxal et l'esprit farceur. Mais cela va plus loin : à la "Déclamation sur le tyrannicide" de Lucien, variations sur la question de la mise à mort des tyrans, More ajoute son mot et Érasme le sien, un demi siècle avant Étienne de la Boétie. Quel est la part de l'exercice de style et de la conviction profonde ? Celle du sophiste et celle du philosophe ?
Thomas More, comme son père est un juriste. Il s'inscrit au Barreau. Il devient l'avocat-conseil de la puissante corporation des merciers qui commerce avec la Flandre. Il est nommé juge de paix du comté de Middlesex. le voila magistrat, comme son père, appelé, comme tel, à siéger au premier Parlement en 1504, ou il obtient le refus de subsides pour le mariage de la fille du roi Henri VII. La mort du roi lui évite les sanctions du roi avaricieux. Puis le voici "undersheriff "au Guildhall de Londres : magistrat des affaires civiles pendant 15 ans. Sa réputation lui vaut d'être appelé par le nouveau roi dans une négociation en Flandre. Il s'y ennuie un peu et se distrait en écrivant son Utopie.
Le voici ferraillant auprès de son roi très catholique contre Luther, comme les meilleur des clercs, qu'il n'est pas. La disgrâce de Wolsey en fait le chancelier d'Angleterre. Henri VIII le fantasque, décidé à divorcer, quitte l'Eglise qui l'empêche d'épouse Anne Boleyn. Déchiré entre la fidélité à son roi et l'obéissance au Pape, voici More dans la zone de turbulences, bientôt enfermé à la tour de Londres au printemps 1534. C'est là qu'il écrit les lettres à sa fille, si touchantes. En faveur de sa cause, sa dialectique fait merveille, jusque dans son refus de prêter le serment de succession. Les actes de son procès en témoignent : il démonte tranquillement toutes les accusations : "Le devoir du bon sujet, à moins qu'il ne se révèle mauvais chrétien, ne saurait être d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu" (p. 299). Un Antigone catholique et apostolique, en somme.
Mais la justice est celle du roi. Douze jurés, en un quart d'heure, le déclarent coupable. More doit rappeler la procédure pour avoir la parole en dernier, au risque d'exaspérer. Il sera "pendu, puis découpé vif, castré, éventré pour que l'on pût commodément lui brûler les entrailles avant de déposer les quatre parties de son corps aux principales entrées de la ville en réservant sa tête pour le London bridge." (p. 302). Mais il va bénéficier, sur ce point, d'une grâce royale, allégeant le programme des festivités et transformant le supplice en simple exécution à la hache. "Que dieu permette que le roi n'ait pas à faire preuve d'autant de clémence pour aucun de mes amis, et qu'il délivre ma postérité d'une telle grâce" commentera simplement Thomas More.
Il monte courageusement à l'échafaud. "Je remercie Sa Majesté de m'avoir tenu reclus dans cet endroit où j'ai pu amplement méditer sur la fin. Je lui sais gré de me libérer des misères de ce pauvre monde" (p. 305).
Lien : https://diacritiques.blogspo..
Humaniste, précurseur des lumières, ami d'Érasme, auteur de l'Utopie, on peut se faire à priori une certaine Idée de Thomas More, c'est un personnage ambivalent et complexe que j'ai découvert dans cette biographie.
Avocat brillant et humaniste convaincu, More est un homme ambitieux.
Fervent catholique dans un monde en plein bouleversement ou les idées réformistes progressent à travers le royaume. Adversaire acharné de Luther, il fera une chasse impitoyable aux hérétiques et n'hésitera pas à en envoyer quelques-uns sur le bucher.
Mais les idées réformistes se fraieront un chemin jusqu'au Roi (par l'intermédiaire d'Anne Boleyn), qui finira par remettre en question la primauté du Pape et se déclarera chef de l'église, chaque sujet devant prêter serment en reconnaissant la descendance d'Anne Boleyn comme légitime héritière du trône d'une part, et devant également renier la primauté du Pape d'autre part. Thomas, fidèle à ces convictions religieuses, refusera concernant la primauté par crainte de la damnation. Ne faisant aucun effort pour ce concilier les faveurs du Roi, alors qu'il avait déjà refusé de se prononcer au sujet de son divorce d'avec Catherine d'Aragon, ce nouveau refus d'avaliser les lubies de son Roi lui vaudra d'être enfermé à la tour de Londres, espérant que ça le ferait changer d'avis.
L'ironie de l'histoire fera que ces idées humaniste, son amitié avec Érasme, son Utopie deviendront difficile à assumer intellectuellement car « l'humanisme n'a-t-il pas posé à son insu les fondements d'une critique de l'église dont on ne mesurait pas au départ toute la portée ? »
Toujours est-il qu'il n'en démordra pas malgré l'insistance de ces proches. Au bout d'une année et demie d'incarcération il sera donc condamné à être « pendu, découpé vif, castré, éventré pour que l'on pût commodément lui brûler les entrailles avant de déposer les quatre quartiers de son corps aux principales entrées de la ville, en réservant sa tête pour le London Bridge ». Ce programme festif tourna court, le Roi prit de pitié pour son ex chancelier, commua sa peine en simple décollation.
Thomas More le fanatique (rien d'extraordinaire à l'époque), vivra ces épreuves comme le Christ sa passion, allant jusqu'à comparer sa fille (qui l'incitait à sauver sa vie) à Eve (incarnation du mal) lui proposant le fruit défendu.
Il deviendra un des premiers martyrs Catholiques de la réforme et sera béatifié puis canonisé quelques siècles plus tard.
Avocat brillant et humaniste convaincu, More est un homme ambitieux.
Fervent catholique dans un monde en plein bouleversement ou les idées réformistes progressent à travers le royaume. Adversaire acharné de Luther, il fera une chasse impitoyable aux hérétiques et n'hésitera pas à en envoyer quelques-uns sur le bucher.
Mais les idées réformistes se fraieront un chemin jusqu'au Roi (par l'intermédiaire d'Anne Boleyn), qui finira par remettre en question la primauté du Pape et se déclarera chef de l'église, chaque sujet devant prêter serment en reconnaissant la descendance d'Anne Boleyn comme légitime héritière du trône d'une part, et devant également renier la primauté du Pape d'autre part. Thomas, fidèle à ces convictions religieuses, refusera concernant la primauté par crainte de la damnation. Ne faisant aucun effort pour ce concilier les faveurs du Roi, alors qu'il avait déjà refusé de se prononcer au sujet de son divorce d'avec Catherine d'Aragon, ce nouveau refus d'avaliser les lubies de son Roi lui vaudra d'être enfermé à la tour de Londres, espérant que ça le ferait changer d'avis.
L'ironie de l'histoire fera que ces idées humaniste, son amitié avec Érasme, son Utopie deviendront difficile à assumer intellectuellement car « l'humanisme n'a-t-il pas posé à son insu les fondements d'une critique de l'église dont on ne mesurait pas au départ toute la portée ? »
Toujours est-il qu'il n'en démordra pas malgré l'insistance de ces proches. Au bout d'une année et demie d'incarcération il sera donc condamné à être « pendu, découpé vif, castré, éventré pour que l'on pût commodément lui brûler les entrailles avant de déposer les quatre quartiers de son corps aux principales entrées de la ville, en réservant sa tête pour le London Bridge ». Ce programme festif tourna court, le Roi prit de pitié pour son ex chancelier, commua sa peine en simple décollation.
Thomas More le fanatique (rien d'extraordinaire à l'époque), vivra ces épreuves comme le Christ sa passion, allant jusqu'à comparer sa fille (qui l'incitait à sauver sa vie) à Eve (incarnation du mal) lui proposant le fruit défendu.
Il deviendra un des premiers martyrs Catholiques de la réforme et sera béatifié puis canonisé quelques siècles plus tard.
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
...et nous laisserons Thomas More tout à sa joie, ou à ses illusions, lorsqu'il saluait en Henri VIII, en ce beau printemps 1509, un "roi à qui jamais auparavant roi ne ressembla".
Il ne croyait pas si bien dire. Les esprits sont encombrés, du moins en France, par une image largement ultérieure, celle d'un roi sanguinaire, intraitable avec le pape et avec ses épouses, sorte de préfiguration des totalitarismes du XXe siècle. Henri VIII, trop souvent associé à Barbe-Bleue, fut, à l'inverse, pour ses sujets et pour l'opinion de son temps un prince humaniste, ami des lettres et des arts, fils très aimant du pape et serviteur empressé de l’Église. Érasme comme Thomas More participèrent à l'élaboration de cette légende. Ils devaient payer lourdement leur erreur.
Il ne croyait pas si bien dire. Les esprits sont encombrés, du moins en France, par une image largement ultérieure, celle d'un roi sanguinaire, intraitable avec le pape et avec ses épouses, sorte de préfiguration des totalitarismes du XXe siècle. Henri VIII, trop souvent associé à Barbe-Bleue, fut, à l'inverse, pour ses sujets et pour l'opinion de son temps un prince humaniste, ami des lettres et des arts, fils très aimant du pape et serviteur empressé de l’Église. Érasme comme Thomas More participèrent à l'élaboration de cette légende. Ils devaient payer lourdement leur erreur.
L'un des pères fondateurs de l'humanisme anglais [More lui-même alors qu'en Angleterre la situation tourne en défaveur du catholicisme] effectuait son autocritique en confessant publiquement ses écarts de jeunesse [entre autres l'écriture de l'Utopie] ! More n'aimait plus ses œuvres littéraires. Ou du moins il les aimait encore, mais il déplorait leur effet pernicieux sur les esprits. Et en parlant de lui, More parlait également d’Érasme, responsable comme lui, et peut-être même davantage, d'une diatribe qui avait gravement porté atteinte au prestige des hommes d’Église. Si l'humanisme n'est pas le protestantisme, loin de là, il le rend possible. Avec More, l'humanisme prononçait son acte de contrition.
Pourtant, insistait-il (*), on ne réprimait les hérétiques que pour leur plus grand bien, afin de leur "ouvrir les yeux" afin qu'ils ne compromettent pas le salut de leurs âmes. Il ne s'agissait pas tant de punir que de sauver.
(*): Il s'agit de John Fisher, humaniste, évêque de Rochester, défenseur zélé du catholicisme, emprisonné et décapité peu avant Thomas More. Canonisé en 1935.
(*): Il s'agit de John Fisher, humaniste, évêque de Rochester, défenseur zélé du catholicisme, emprisonné et décapité peu avant Thomas More. Canonisé en 1935.
On établit punitions lourdes et terribles à un larron et on devrait plutôt pourvoir d'honnêtes manières de vivre afin que les larrons n'eussent si grande nécessité et occasion de dérober et d'être pendus.
[Extrait de "l'Utopie"]
[Extrait de "l'Utopie"]
Il est difficile d'assigner des bornes précises à la révolution mentale constituée par la Réforme protestante. La négation de la trinité et le refus de la divinité du Christ s'ensuivirent bien au XVIe siècle, au grand dam de réformateurs comme Luther ou Calvin, eux parfaitement orthodoxes sur ce point.
Videos de Bernard Cottret (2)
Voir plusAjouter une vidéo
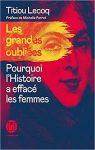
Les grandes oubliées : Pourquoi l'histoire a effacé les femmes
Titiou Lecoq
221
critiques
204
citations
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Bernard Cottret (26)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3206 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3206 lecteurs ont répondu