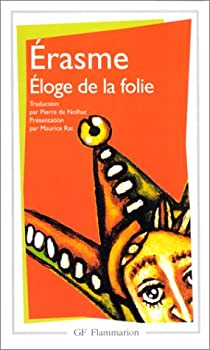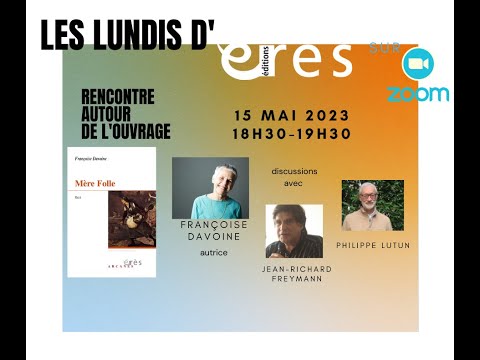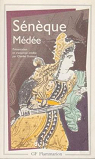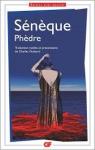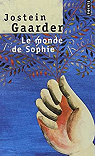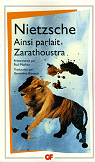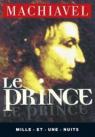Erasme
Pierre de Nolhac (Traducteur)/5 340 notes
Pierre de Nolhac (Traducteur)/5 340 notes
Résumé :
En 1542, six ans après sa mort, celui qui était considéré comme le Prince de la République des Lettres est décrété par les théologiens de la Sorbonne " fol, insensé, injurieux à Dieu, à Jésus-Christ, à la Vierge, aux Saints, aux ordonnances de l'Eglise, aux cérémonies ecclésiastiques, aux théologiens, aux ordres mendiants ". Homme de la synthèse entre christianisme et philosophie païenne, Erasme réalise le difficile équilibre entre foi et savoir.
>Voir plus
>Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Éloge de la folieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (36)
Voir plus
Ajouter une critique
Sur un ton moqueur, Érasme fait parler la folie et très vite son propos se précise :
Oui je suis la douce-folie pétrie de spontanéité, d'insouciance, de gaité qui mène chaque Homme à la condition qu'il me laisse m'exprimer. Tout me souris car je suis le doux esprit, la source de tous ses progrès, de tout ce qui l'élève et le différencie des autres animaux.
Mais comme dans l'univers tout est équilibre, s'il y a la douce-folie il y a aussi et malheureusement, la démence.
La démence, une sorte de douce-folie dénaturée, orgueilleuse qui habite ces messieurs de si grande importance qui ne sont que de dangereux fous-furieux ; des fous de prétention, de pouvoir, de fanatisme, de savoir et de ce qu'ils croient être la sagesse.
Ce que nous pouvons comprendre à travers les propos d'Érasme qui passe allègrement de la douce-folie à la démence, c'est qu'il ne nous parle que de la même chose. En parodiant quelque peu Montaigne, je dirais qu'entre le douce-folie et la démence, il n'y a pas de différence de nature mais une différence de degré.
La folie habite chaque homme, elle lui est intimement liée, je me demande même si elle ne fait pas partie intégrante de sa nature.
Si au XVIème siècle d'Érasme la démence modelait l'esprit des philosophes, des médecins, des théologiens, des grammairiens, le texte garde toute sa pertinence car on ne peut s'empêcher de l'imaginer dénonçant nos déments contemporains : Personnages souvent publics se gargarisant de leur audience et de la vénération tout aussi démentielle que celle de leurs aficionados. Prétentieux dans l'attente de vénération, dirigeants de tous ordres abusant de leur pouvoir fallacieux sur leurs subordonnés assujettis par la démence sociale et ses formatages
Comme cette façon, finalement dichotomique, de voir la vie me plait et colle bien à la réalité avec les déments et ceux qui les suivent, admirent, encensent et se rendent esclaves ; et les fous doux-dingues qui vivent, avancent, créent, jubilent, tirent l'Homme vers le haut.
Oui, l'insensé produit du sens.
Publié en 1509, rédigé sous forme de très courts chapitres pouvant être déclamés, le texte d'Érasme nécessite un bon bagage classique afin d'apprécier les nombreuses citations et références livresques et mythologiques qui le parsèment.
Mais on peut aussi passer outre.
Incroyablement contemporain et servi par une traduction vivante de Claude Barousse, sans notes de lecture autres que le strict nécessaire, il en demeure un livre plaisant qui sous des aspects légers a « dégommé » et « dégomme » toujours pas mal de vérités établies.
Oui je suis la douce-folie pétrie de spontanéité, d'insouciance, de gaité qui mène chaque Homme à la condition qu'il me laisse m'exprimer. Tout me souris car je suis le doux esprit, la source de tous ses progrès, de tout ce qui l'élève et le différencie des autres animaux.
Mais comme dans l'univers tout est équilibre, s'il y a la douce-folie il y a aussi et malheureusement, la démence.
La démence, une sorte de douce-folie dénaturée, orgueilleuse qui habite ces messieurs de si grande importance qui ne sont que de dangereux fous-furieux ; des fous de prétention, de pouvoir, de fanatisme, de savoir et de ce qu'ils croient être la sagesse.
Ce que nous pouvons comprendre à travers les propos d'Érasme qui passe allègrement de la douce-folie à la démence, c'est qu'il ne nous parle que de la même chose. En parodiant quelque peu Montaigne, je dirais qu'entre le douce-folie et la démence, il n'y a pas de différence de nature mais une différence de degré.
La folie habite chaque homme, elle lui est intimement liée, je me demande même si elle ne fait pas partie intégrante de sa nature.
Si au XVIème siècle d'Érasme la démence modelait l'esprit des philosophes, des médecins, des théologiens, des grammairiens, le texte garde toute sa pertinence car on ne peut s'empêcher de l'imaginer dénonçant nos déments contemporains : Personnages souvent publics se gargarisant de leur audience et de la vénération tout aussi démentielle que celle de leurs aficionados. Prétentieux dans l'attente de vénération, dirigeants de tous ordres abusant de leur pouvoir fallacieux sur leurs subordonnés assujettis par la démence sociale et ses formatages
Comme cette façon, finalement dichotomique, de voir la vie me plait et colle bien à la réalité avec les déments et ceux qui les suivent, admirent, encensent et se rendent esclaves ; et les fous doux-dingues qui vivent, avancent, créent, jubilent, tirent l'Homme vers le haut.
Oui, l'insensé produit du sens.
Publié en 1509, rédigé sous forme de très courts chapitres pouvant être déclamés, le texte d'Érasme nécessite un bon bagage classique afin d'apprécier les nombreuses citations et références livresques et mythologiques qui le parsèment.
Mais on peut aussi passer outre.
Incroyablement contemporain et servi par une traduction vivante de Claude Barousse, sans notes de lecture autres que le strict nécessaire, il en demeure un livre plaisant qui sous des aspects légers a « dégommé » et « dégomme » toujours pas mal de vérités établies.
Érasme est avant tout homme de la renaissance, il a pour seul intérêt, seule vraie passion l'homme, le spectacle des hommes qui l'entourent. Il le veut plus libre et surtout plus sincère. Il revêt donc le visage de la folie plaidant sa cause. C'est par l'ironie souvent criante de vérité que dégage cette plaidoirie, qu'il s'en prend à toutes les incongruités de son siècle : superstitions, orgueil, lâcheté et avant tout l'hypocrisie ambiante des courtisans et du pouvoir religieux.)
Ironie et paradoxe sont donc les clés de cet ouvrage car l'humaniste de Rotterdam, qui se veut sage et philosophe, ne cesse de prétendre que les fous sont les plus heureux des hommes. D'autre part, il semble timidement ressortir de l'ouvrage que le bonheur humain n'est pas inconciliable avec une foi sincère.
Mais je n'aurais rien dit sur Érasme, rien d'important en tout cas, si je ne soulignais pas cet appétit de paix autant sociale qu'entre états, qui marque aussi l'avènement de l'esprit de la Renaissance.
Je me permettrais d'ajouter que la traduction de Claude Barousse rend le texte d'une lecture des plus agréables et contemporaines... on le croirait écrit hier tant dans le style que dans son propos.
Ironie et paradoxe sont donc les clés de cet ouvrage car l'humaniste de Rotterdam, qui se veut sage et philosophe, ne cesse de prétendre que les fous sont les plus heureux des hommes. D'autre part, il semble timidement ressortir de l'ouvrage que le bonheur humain n'est pas inconciliable avec une foi sincère.
Mais je n'aurais rien dit sur Érasme, rien d'important en tout cas, si je ne soulignais pas cet appétit de paix autant sociale qu'entre états, qui marque aussi l'avènement de l'esprit de la Renaissance.
Je me permettrais d'ajouter que la traduction de Claude Barousse rend le texte d'une lecture des plus agréables et contemporaines... on le croirait écrit hier tant dans le style que dans son propos.
Éloge de la folie /Érasme (1466-1536)
Bien que né à Rotterdam, c'est en Angleterre qu'Érasme mit la dernière main à cette satire qu'il avait méditée tout au long de ses voyages. Dans l'Éloge de la Folie, il passe en revue toutes les sociétés de son temps et en détaille les vices et les ridicules avec un bon sens de tous les instants. Cette oeuvre, condamnée par la Sorbonne a eu une influence considérable sur la littérature du monde occidental et a été un des catalyseurs de la Réforme, dont Érasme fut un partisan.
L'examen satirique, qui fait constamment référence aux mythes de l'Antiquité, va porter non seulement sur les superstitions et les pratiques pieuses dans l'Église, mais aussi, faisant parler la déesse de la Folie, il développe une critique acerbe non seulement des diverses professions et catégories sociales, notamment les théologiens, les maîtres, les moines et le haut clergé, mais aussi de façon féroce des courtisans.
Malgré tout, il faut bien voir qu'Érasme, ayant conservé toute sa vie un fond de prudence extrême issu de son éducation monacale, avance à pas feutrés et fait montre à fleuret moucheté d'un humour redoutable et bienvenu. Et s'adressant à son ami fidèle Thomas Morus, il déclare que si l'amour-propre ne l'aveugle, il pense qu'il n'est pas tout à fait fou en faisant l'éloge de la folie, et affirme qu'il cherche plus à faire rire qu'à mordre :
« À l'exemple de Juvénal, je ne suis pas descendu dans la sentine des vices pour la remuer, j'ai plutôt passé gaiement en revue les ridicules que les turpitudes. »
Il ridiculise tous ces penseurs et ces sages, les hypocrites stoïciens, qui retenus par une fausse vergogne, se contentent de suborner quelque rhétoricien flagorneur ou quelque poète songe-creux, leur débitant, à beaux deniers comptants, leur panégyrique, autrement dit de gros mensonges !
L'absence de sagesse rend seule la vie agréable a dit Sophocle. Car les dieux les plus austères savent eux-mêmes sacrifier à la Folie ! Diane elle-même, oubliant tout à fait la modestie de son sexe, ne chassait plus rien dans les forêts que le bel Endymion pour qui elle mourait d'amour !
Aux stoïciens cependant, l'auteur concède qu'ils n'ont pas tort quand ils disent que la sagesse consiste à suivre la raison et la folie, au contraire, à suivre ses passions.
Il avoue sans honte mettre en pratique le proverbe populaire qui conseille de se louer soi-même si on ne rencontre personne d'autre pour le faire. Vive l'amour-propre, la flatterie, l'oubli, la paresse, la volupté, la démence, la bonne chère, la fête de la dive bouteille, en bref la Folie ! Rabelais plus tard s'en souviendra !
Évoquant sa naissance, Érasme reconnait qu'elle n'a pas été marquée par des pleurs et que sa vie ne connut que des délices : « car mes lèvres ont pressé le sein de deux nymphes complaisantes, l'ivresse, fille de Bacchus, et l'ignorance, fille de Pan, que vous pouvez voir parmi mes suivantes. »
Et les femmes alors ? « La femme est, il faut l'avouer, un animal inepte et fou, mais au demeurant plaisant et gracieux. » écrit l'auteur., et d'ajouter que ce qui recommande plus particulièrement les femmes aux hommes, c'est leur folie ! « Les hommes permettent tout aux femmes, pourvu qu'elles leur donnent en retour le plaisir ; or, qu'est-ce que le plaisir, sinon la Folie, le source du plus grand plaisir de la vie Sans les plaisirs, l'existence ne saurait échapper à l'ennui. !
Plus loin, Érasme écrit avec malice : « Deux obstacles sont à vaincre : la timidité, qui obscurcit les idées et amoindrit les moyens, et la crainte qui, en exagérant les dangers, détourne des grandes actions. La Folie pare merveilleusement à toutes les deux…Les hommes s'éloignent d'autant plus du bonheur qu'ils possèdent plus de sagesse. »
Plus loin, ce sont les comédiens, les musiciens, les orateurs et les poètes qui sont la cible, de par ce qu'il appelle « leur orgueil, leur jactance et leur morgue qui sont en raison directe de leur ignorance, ce qui ne les empêche pas de trouver chaussure à leurs pieds, car il ne faut jamais oublier, une chose a d'autant plus d'admirateurs qu'elle est inepte. »
« de tous les mortels, la classe la plus folle est sans contredit celle des marchands. le mensonge, le parjure, le vol, la friponnerie, l'imposture, ils mettent tout en oeuvre. » Gloire à eux !
Platon disait que la folie des amants est la plus douce des félicités. Érasme y souscrit en ajoutant par ailleurs que la vie des dévots est une espèce de folie. le passage sur les moines, les évêques, les cardinaux et les papes est des plus savoureux…
La dernière phrase adressée au lecteur : « Adieu donc, applaudissez, vivez en joie, et buvez sec, illustres adeptes de la Folie. » Magnifique !
Un grand texte humaniste et impertinent, d'une grande liberté d'expression, anticonformiste au possible, qui connut un immense succès à l'époque de sa parution, et que l'on lira tel un entremet avec délectation, même si certains passages touchent à l'ennui par leur longueur. Un exercice à haut risque que cet ouvrage provocateur plein d'insolence qui surprit nombre de ses contemporains, en des temps où l'hérésie se voyait condamner durement, temps de schismes et chasse aux sorcières. On peur supposer qu'en demandant l'assentiment de son amis Thomas More qui faisait alors autorité, Érasme cherchait une justification, une protection. Car oser ouvertement s'opposer aux excès mondains d'alors de la religion et de l'Église chrétienne tout en dénonçant le dogmatisme ainsi que le fanatisme religieux de son époque, aurait pu valoir le pire à l'écrivain. D'ailleurs en 1545 lors du Concile de Trente, le livre fut comme l'ensemble de son oeuvre mis à l'index. Cela n'a pas nui à sa popularité, bien au contraire.
On a pu dire à juste raison que ce petit livre subversif écrit en 1509 fut un texte fondateur de l'humanisme européen.
Bien que né à Rotterdam, c'est en Angleterre qu'Érasme mit la dernière main à cette satire qu'il avait méditée tout au long de ses voyages. Dans l'Éloge de la Folie, il passe en revue toutes les sociétés de son temps et en détaille les vices et les ridicules avec un bon sens de tous les instants. Cette oeuvre, condamnée par la Sorbonne a eu une influence considérable sur la littérature du monde occidental et a été un des catalyseurs de la Réforme, dont Érasme fut un partisan.
L'examen satirique, qui fait constamment référence aux mythes de l'Antiquité, va porter non seulement sur les superstitions et les pratiques pieuses dans l'Église, mais aussi, faisant parler la déesse de la Folie, il développe une critique acerbe non seulement des diverses professions et catégories sociales, notamment les théologiens, les maîtres, les moines et le haut clergé, mais aussi de façon féroce des courtisans.
Malgré tout, il faut bien voir qu'Érasme, ayant conservé toute sa vie un fond de prudence extrême issu de son éducation monacale, avance à pas feutrés et fait montre à fleuret moucheté d'un humour redoutable et bienvenu. Et s'adressant à son ami fidèle Thomas Morus, il déclare que si l'amour-propre ne l'aveugle, il pense qu'il n'est pas tout à fait fou en faisant l'éloge de la folie, et affirme qu'il cherche plus à faire rire qu'à mordre :
« À l'exemple de Juvénal, je ne suis pas descendu dans la sentine des vices pour la remuer, j'ai plutôt passé gaiement en revue les ridicules que les turpitudes. »
Il ridiculise tous ces penseurs et ces sages, les hypocrites stoïciens, qui retenus par une fausse vergogne, se contentent de suborner quelque rhétoricien flagorneur ou quelque poète songe-creux, leur débitant, à beaux deniers comptants, leur panégyrique, autrement dit de gros mensonges !
L'absence de sagesse rend seule la vie agréable a dit Sophocle. Car les dieux les plus austères savent eux-mêmes sacrifier à la Folie ! Diane elle-même, oubliant tout à fait la modestie de son sexe, ne chassait plus rien dans les forêts que le bel Endymion pour qui elle mourait d'amour !
Aux stoïciens cependant, l'auteur concède qu'ils n'ont pas tort quand ils disent que la sagesse consiste à suivre la raison et la folie, au contraire, à suivre ses passions.
Il avoue sans honte mettre en pratique le proverbe populaire qui conseille de se louer soi-même si on ne rencontre personne d'autre pour le faire. Vive l'amour-propre, la flatterie, l'oubli, la paresse, la volupté, la démence, la bonne chère, la fête de la dive bouteille, en bref la Folie ! Rabelais plus tard s'en souviendra !
Évoquant sa naissance, Érasme reconnait qu'elle n'a pas été marquée par des pleurs et que sa vie ne connut que des délices : « car mes lèvres ont pressé le sein de deux nymphes complaisantes, l'ivresse, fille de Bacchus, et l'ignorance, fille de Pan, que vous pouvez voir parmi mes suivantes. »
Et les femmes alors ? « La femme est, il faut l'avouer, un animal inepte et fou, mais au demeurant plaisant et gracieux. » écrit l'auteur., et d'ajouter que ce qui recommande plus particulièrement les femmes aux hommes, c'est leur folie ! « Les hommes permettent tout aux femmes, pourvu qu'elles leur donnent en retour le plaisir ; or, qu'est-ce que le plaisir, sinon la Folie, le source du plus grand plaisir de la vie Sans les plaisirs, l'existence ne saurait échapper à l'ennui. !
Plus loin, Érasme écrit avec malice : « Deux obstacles sont à vaincre : la timidité, qui obscurcit les idées et amoindrit les moyens, et la crainte qui, en exagérant les dangers, détourne des grandes actions. La Folie pare merveilleusement à toutes les deux…Les hommes s'éloignent d'autant plus du bonheur qu'ils possèdent plus de sagesse. »
Plus loin, ce sont les comédiens, les musiciens, les orateurs et les poètes qui sont la cible, de par ce qu'il appelle « leur orgueil, leur jactance et leur morgue qui sont en raison directe de leur ignorance, ce qui ne les empêche pas de trouver chaussure à leurs pieds, car il ne faut jamais oublier, une chose a d'autant plus d'admirateurs qu'elle est inepte. »
« de tous les mortels, la classe la plus folle est sans contredit celle des marchands. le mensonge, le parjure, le vol, la friponnerie, l'imposture, ils mettent tout en oeuvre. » Gloire à eux !
Platon disait que la folie des amants est la plus douce des félicités. Érasme y souscrit en ajoutant par ailleurs que la vie des dévots est une espèce de folie. le passage sur les moines, les évêques, les cardinaux et les papes est des plus savoureux…
La dernière phrase adressée au lecteur : « Adieu donc, applaudissez, vivez en joie, et buvez sec, illustres adeptes de la Folie. » Magnifique !
Un grand texte humaniste et impertinent, d'une grande liberté d'expression, anticonformiste au possible, qui connut un immense succès à l'époque de sa parution, et que l'on lira tel un entremet avec délectation, même si certains passages touchent à l'ennui par leur longueur. Un exercice à haut risque que cet ouvrage provocateur plein d'insolence qui surprit nombre de ses contemporains, en des temps où l'hérésie se voyait condamner durement, temps de schismes et chasse aux sorcières. On peur supposer qu'en demandant l'assentiment de son amis Thomas More qui faisait alors autorité, Érasme cherchait une justification, une protection. Car oser ouvertement s'opposer aux excès mondains d'alors de la religion et de l'Église chrétienne tout en dénonçant le dogmatisme ainsi que le fanatisme religieux de son époque, aurait pu valoir le pire à l'écrivain. D'ailleurs en 1545 lors du Concile de Trente, le livre fut comme l'ensemble de son oeuvre mis à l'index. Cela n'a pas nui à sa popularité, bien au contraire.
On a pu dire à juste raison que ce petit livre subversif écrit en 1509 fut un texte fondateur de l'humanisme européen.
Lorsqu'Érasme alias Desiderius Erasmus Roterdamus campe pour se distraire le rôle de la folie, on obtient ce bel Éloge de la folie (1509). Moria pour les Grecs ou Stultitia pour les Latins (cf. p.7), cette entité déifiée par l'auteur rivalise sans complexes avec les Dieux de l'Olympe. Espiègle et même moqueuse, la folie est bien consciente que sans elle, le monde serait d'une morosité à toute épreuve. Partout où la raison n'est pas, nous affirme Érasme, sévit la folie. D'ailleurs, n'est-il pas vrai que tout ce qui touche à l'irrationnel relève de son emprise ? Fantaisie, frivolité, rire, euphorie, tels sont les attributs majeurs que lui reconnait volontiers Érasme et qui compensent largement ses aspects moins luisants tels la démence ou la démesure. Parce qu'il n'y a pas de folie sans hommes et pas d'humanité sans folie, cet éloge qui tire en réalité plus vers la satire que la farce, ne manque pas de piquant. Sujets privilégiés de la Moria, les femmes, les vieillards et les enfants ont ainsi les faveurs de la déesse même si celle-ci se rend accessible à tous dans son immense générosité. Gare pourtant à ceux qui la dénient ou la raillent car son pouvoir est étendu pour ne pas dire omniprésent. Que ceux qui en doutent encore se souviennent de cette maxime de Cicéron (en 4e de couverture) : "La terre est pleine de fous"...
Qu'on ne s'y trompe pas : en dépit de son ton badin, cet éloge dresse entre autres, une joyeuse et acerbe caricature des théologiens, religieux, orateurs ou autres grammairiens qui se refusent à la dérision. Selon l'auteur, user de sa raison ou mimer la sagesse pour rester sain d'esprit est vain. Connu pour ses textes satiriques, l'auteur écorne méchamment au passage toutes les couches de la société. S'appuyant sur la personnification de la folie, Érasme, à force d'user de la langue de bois, s'égare parfois et ses digressions finissent par dissimuler maladroitement l'intention première du texte. le ton change en effet au fur et à mesure que le discours avance et si le texte me semblait au premier abord loin du pamphlet, il en prend toutes les allures en seconde partie. Fondant son argumentaire sur de grands auteurs antiques comme Homère, Cicéron, Horace et bien d'autres, Érasme fait une apologie sans concessions de la folie ("S'il est un seul endroit sur la terre où je n'eusse point d'adorateurs, c'est que cet endroit ne serait point habité par des hommes." p.99). Sans pour autant adhérer complètement à ses théories (exemples et démonstrations parfois capillotractées et vision trop manichéenne), je conviendrai toutefois que l'humanisme d'Érasme est très louable. Et si le ton mais aussi le contenu du texte m'ont quelquefois surpris, je me dis que si l'on pense que le texte a été rédigé au début du 16e siècle, on ne peut qu'applaudir l'ouverture d'esprit et les éclairs de lucidité dont fait preuve Desiderius. Cette satire n'est-elle d'ailleurs pas encore très actuelle ? Sympathique découverte donc, servie dans une belle édition (Le Castor Astral), richement illustrée par les dessins ciselés de Hans Holbein (1523) et brillamment préfacée par Rufus sous la forme d'un truculent dialogue fictif entre Érasme et Vasco de Gama...
Sinon, pour le plaisir des yeux, rendez-vous sur la page dédiée aux dessins de Hans Holbein sur le site Spirit of the ages. L'éloge de la folie en comporte 205 !!!
Lien : http://embuscades-alcapone.b..
Qu'on ne s'y trompe pas : en dépit de son ton badin, cet éloge dresse entre autres, une joyeuse et acerbe caricature des théologiens, religieux, orateurs ou autres grammairiens qui se refusent à la dérision. Selon l'auteur, user de sa raison ou mimer la sagesse pour rester sain d'esprit est vain. Connu pour ses textes satiriques, l'auteur écorne méchamment au passage toutes les couches de la société. S'appuyant sur la personnification de la folie, Érasme, à force d'user de la langue de bois, s'égare parfois et ses digressions finissent par dissimuler maladroitement l'intention première du texte. le ton change en effet au fur et à mesure que le discours avance et si le texte me semblait au premier abord loin du pamphlet, il en prend toutes les allures en seconde partie. Fondant son argumentaire sur de grands auteurs antiques comme Homère, Cicéron, Horace et bien d'autres, Érasme fait une apologie sans concessions de la folie ("S'il est un seul endroit sur la terre où je n'eusse point d'adorateurs, c'est que cet endroit ne serait point habité par des hommes." p.99). Sans pour autant adhérer complètement à ses théories (exemples et démonstrations parfois capillotractées et vision trop manichéenne), je conviendrai toutefois que l'humanisme d'Érasme est très louable. Et si le ton mais aussi le contenu du texte m'ont quelquefois surpris, je me dis que si l'on pense que le texte a été rédigé au début du 16e siècle, on ne peut qu'applaudir l'ouverture d'esprit et les éclairs de lucidité dont fait preuve Desiderius. Cette satire n'est-elle d'ailleurs pas encore très actuelle ? Sympathique découverte donc, servie dans une belle édition (Le Castor Astral), richement illustrée par les dessins ciselés de Hans Holbein (1523) et brillamment préfacée par Rufus sous la forme d'un truculent dialogue fictif entre Érasme et Vasco de Gama...
Sinon, pour le plaisir des yeux, rendez-vous sur la page dédiée aux dessins de Hans Holbein sur le site Spirit of the ages. L'éloge de la folie en comporte 205 !!!
Lien : http://embuscades-alcapone.b..
Sous couvert d'un éloge allégoriquement narré par la Folie même, Erasme se plaît à dresser un tableau peu reluisant d'une humanité orgueilleuse et arrogante. Ce qui est surprenant, c'est qu'il nous prouve que rien n'a foncièrement changé au XXIe siècle ! La folie gouverne toujours aussi bien les hommes. Par folie, Erasme entend plus que ce que l'on croit. Les personnes dites déréglées mentalement ne couvrent en effet qu'une très minime partie de l'humanité. le terme englobe donc toutes les personnes qui agissent couramment sans faire appel à leur raison. Ceux qui se laissent guider par les sens, les pulsions, et les instincts. Il se trouve alors bien peu de personnes qui peuvent se targuer de ne pas faire partie de cet ensemble. Ce que l'on remarque surtout, c'est que les gens d'église y figurent en grand nombre et qu'Erasme leur fait une place de choix. On comprend pourquoi, au récit accablant du vénérable clergé catholique de l'époque, la Réforme menées par Luther a eu autant de succès. Mais Erasme n'en égratigne pas moins les réformés, qui usent des mêmes procédés et se laissent, eux aussi, gouverner par leur corps plutôt que par leur tête.
critiques presse (1)
Le chef-d’œuvre d’Erasme ressort dans une édition bilingue enrichie des commentaires inédits de contemporains de l’humaniste, et des siens. Eblouissant.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (96)
Voir plus
Ajouter une citation
L'innocence et la pureté de l'âge d'or se corrompant peu à peu, les génies malfaisants inventèrent, comme je l'ai déjà dit, les sciences et les arts.
« Le singe est toujours singe, dit l’adage grec, même sous un habit de pourpre. » Pareillement, la femme a beau mettre un masque, elle reste toujours femme, c’est-à-dire folle. Les femmes pourraient-elles m’en vouloir de leur attribuer la folie, à moi qui suis femme et la Folie elle-même ? Assurément non. A y regarder de près, c’est ce don de folie qui leur permet d’être à beaucoup d’égards plus heureuses que les hommes. Elles ont sur eux, d’abord l’avantage de la beauté, qu’elles mettent très justement au-dessus de tout et qui leur sert à tyranniser les tyrans eux-mêmes. L’homme a les traits rudes, la peau rugueuse, une barbe touffue qui le vieillit, et tout cela signifie la sagesse ; les femmes, avec leurs joues toujours lisses, leur voix toujours douce, leur tendre peau, ont pour elles les attributs de l’éternelle jeunesse. D’ailleurs, que cherchent-elles en cette vie, sinon plaire aux hommes le plus possible ? N’est-ce pas la raison de tant de toilettes, de fards, de bains, de coiffures, d’onguents et de parfums, de tout cet art de s’arranger, de se peindre, de se faire le visage, les yeux et le teint ? Et n’est-ce pas la Folie qui leur amène le mieux les hommes ? Ils leur promettent tout, et en échange de quoi ? Du plaisir. Mais elles ne le donnent que par la Folie. C’est de toute évidence, si vous songez aux niaiseries que l’homme conte à la femme, aux sottises qu’il fait pour elle, chaque fois qu’il s’est mis en tête de prendre son plaisir. Vous savez maintenant quel est le premier, le plus grand agrément de la vie, et d’où il découle.
Mais pourquoi me fatiguer sur ce seul texte ? Chacun sait bien que le droit des théologiens leur livre le ciel, c’est-à- dire l’interprétation des Saintes Écritures ; elles sont comme une peau qu’ils étirent à leur gré. On y voit des contradictions avec saint Paul, qui en réalité n’existent pas. S’il faut en croire saint Jérôme, l’homme aux cinq langues, saint Paul avait vu, par hasard, à Athènes, l’inscription d’un autel qu’il modifia à l’avantage de la foi chrétienne. Omettant les mots qui pouvaient gêner sa cause, il n’en garda que les deux derniers : « Au Dieu inconnu » ; encore les changeait-il un peu, car l’inscription complète portait : « Aux Dieux de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, aux Dieux inconnus et étrangers. » A cet exemple, je crois, la famille théologienne détache d’un contexte, ici et là, quelques petits mots dont elle altère le sens pour l’accommoder à ses raisonnements. Peu lui importe qu’il n’y ait aucun rapport avec ce qui précède et ce qui suit, ou même qu’il y ait contradiction. L’impudent procédé vaut tant de succès aux théologiens qu’ils en excitent maintes fois l’envie des jurisconsultes.
Ne peuvent-ils tout se permettre, quand on voit ce grand... (j’allais lâcher le nom, mais j’évite de nouveau le brocard sur la lyre) extraire de saint Luc un passage qui s’accorde avec l’esprit du Christ comme l’eau avec le feu ? Sous la menace du péril suprême, au moment où des clients fidèles se groupent autour de leur patron pour combattre avec lui de toutes leurs forces, le Christ voulut ôter de l’esprit des siens leur confiance dans les secours humains ; il leur demanda s’ils avaient manqué de quelque chose depuis qu’il les avait envoyés prêcher, et cependant ils y étaient allés sans ressources de viatique, sans chaussures pour se garantir des épines et des cailloux, sans besace garnie contre la faim. Les disciples ayant répondu qu’ils n’avaient manqué de rien, il leur dit : « Maintenant, que celui qui a une bourse ou une besace la dépose, et que celui qui n’a pas de glaive vende sa tunique pour en acheter un ! » Comme tout l’enseignement du Christ n’est que douceur, patience, mépris de la vie, qui ne comprend le sens de son précepte ? Il veut dépouiller encore davantage ceux qu’il envoie, de façon qu’ils se défassent non seulement de la chaussure et de la besace, mais encore de la tunique, afin qu’ils abordent nus et dégagés de tout, la mission de l’Evangile ; ils ont à se procurer seulement un glaive, non pas celui qui sert aux larrons et aux parricides, mais le glaive de l’esprit, qui pénètre au plus intime de la conscience et y tranche d’un coup toutes les passions mauvaises, ne laissant au cœur que la piété.
Or, voyez comment le célèbre théologien torture ce passage. Le glaive, pour lui, signifie la défense contre toute persécution, et la besace, une provision de vivres assez abondante, comme si le Christ, ayant changé complètement d’avis, regrettait d’avoir mis en route ses envoyés dans un appareil trop peu royal et chantait la palinodie de ses instructions antérieures ! Il aurait donc oublié qu’il leur avait garanti la béatitude au prix des affronts, des outrages et des supplices, qu’il leur avait interdit de résister aux méchants, parce que la béatitude est pour les doux, non pour les violents, qu’il leur avait donné pour modèles les lis et les passereaux ! Il se refusait maintenant à les laisser partir sans glaive, leur recommandait de vendre, au besoin, leur tunique, pour en avoir un et d’aller plutôt nus que désarmés. Sous ce nom de glaive, notre théologien entend tout ce qui peut repousser une attaque, comme sous le nom de besace, tout ce qui concerne les besoins de la vie. Ainsi, cet interprète de la pensée divine nous montre des apôtres munis de lances, de balistes, de frondes et de bombardes, pour aller prêcher le Crucifié ; et de même il les charge de bourses, de sacoches et de bagages, pour qu’ils ne quittent jamais l’hôtellerie sans avoir bien mangé. Il ne se trouble pas d’entendre, peu après, le Maître ordonner avec un accent d’adjuration de remettre au fourreau le glaive qu’il aurait si vivement recommandé d’acheter. On n’a pourtant jamais entendu dire que les Apôtres se soient servis de glaives et de boucliers contre la violence des païens, ce qu’ils auraient fait assurément si la pensée du Christ avait été celle qu’on lui prête.
Un autre, qui n’est point des derniers et que par respect je ne nomme pas, a confondu la peau de saint Barthélemy écorché et les tentes dont Habacuc a dit : « Les peaux du pays de Madian seront rompues. » J’ai assisté l’autre jour, ce qui m’arrive fréquemment, à une controverse de théologie. Quelqu’un voulait savoir quel texte des Saintes Écritures ordonnait de brûler les hérétiques plutôt que de les convaincre par la discussion. Un vieillard à la mine sévère, que son sourcil révélait théologien, répondit avec véhémence que cette loi venait de l’apôtre Paul, lorsqu’il avait dit : « Évite (devita) l’hérétique, après l’avoir repris une ou deux fois. » Il répéta et fit sonner ces paroles ; chacun s’étonnait ; on se demandait s’il perdait la tête. Il finit par s’expliquer : « Il faut retrancher l’hérétique de la vie », traduisait-il, comprenant de vita au lieu de devita. Quelques auditeurs ont ri ; il s’en est trouvé pour déclarer ce commentaire profondément théologique. Et, tandis qu’on réclamait, survint, comme on dit, un avocat de Ténédos et d’autorité irréfragable : « Écoutez bien, dit-il. Il est écrit. Ne laissez pas vivre le malfaisant (maleficus). Or, l’hérétique est malfaisant. Donc, etc. » Il n’y eut alors qu’une voix pour louer l’ingénieux syllogisme, et toute l’assemblée trépigna de ses lourdes chaussures. Il ne vint à l’esprit de personne que cette loi est faite contre les sorciers, jeteurs de sorts et magiciens, que les Hébreux appellent d’un mot qui se traduit par maleficus. Autrement, la sentence de mort s’appliquerait tout aussi bien à la fornication et à l’ébriété.
Ne peuvent-ils tout se permettre, quand on voit ce grand... (j’allais lâcher le nom, mais j’évite de nouveau le brocard sur la lyre) extraire de saint Luc un passage qui s’accorde avec l’esprit du Christ comme l’eau avec le feu ? Sous la menace du péril suprême, au moment où des clients fidèles se groupent autour de leur patron pour combattre avec lui de toutes leurs forces, le Christ voulut ôter de l’esprit des siens leur confiance dans les secours humains ; il leur demanda s’ils avaient manqué de quelque chose depuis qu’il les avait envoyés prêcher, et cependant ils y étaient allés sans ressources de viatique, sans chaussures pour se garantir des épines et des cailloux, sans besace garnie contre la faim. Les disciples ayant répondu qu’ils n’avaient manqué de rien, il leur dit : « Maintenant, que celui qui a une bourse ou une besace la dépose, et que celui qui n’a pas de glaive vende sa tunique pour en acheter un ! » Comme tout l’enseignement du Christ n’est que douceur, patience, mépris de la vie, qui ne comprend le sens de son précepte ? Il veut dépouiller encore davantage ceux qu’il envoie, de façon qu’ils se défassent non seulement de la chaussure et de la besace, mais encore de la tunique, afin qu’ils abordent nus et dégagés de tout, la mission de l’Evangile ; ils ont à se procurer seulement un glaive, non pas celui qui sert aux larrons et aux parricides, mais le glaive de l’esprit, qui pénètre au plus intime de la conscience et y tranche d’un coup toutes les passions mauvaises, ne laissant au cœur que la piété.
Or, voyez comment le célèbre théologien torture ce passage. Le glaive, pour lui, signifie la défense contre toute persécution, et la besace, une provision de vivres assez abondante, comme si le Christ, ayant changé complètement d’avis, regrettait d’avoir mis en route ses envoyés dans un appareil trop peu royal et chantait la palinodie de ses instructions antérieures ! Il aurait donc oublié qu’il leur avait garanti la béatitude au prix des affronts, des outrages et des supplices, qu’il leur avait interdit de résister aux méchants, parce que la béatitude est pour les doux, non pour les violents, qu’il leur avait donné pour modèles les lis et les passereaux ! Il se refusait maintenant à les laisser partir sans glaive, leur recommandait de vendre, au besoin, leur tunique, pour en avoir un et d’aller plutôt nus que désarmés. Sous ce nom de glaive, notre théologien entend tout ce qui peut repousser une attaque, comme sous le nom de besace, tout ce qui concerne les besoins de la vie. Ainsi, cet interprète de la pensée divine nous montre des apôtres munis de lances, de balistes, de frondes et de bombardes, pour aller prêcher le Crucifié ; et de même il les charge de bourses, de sacoches et de bagages, pour qu’ils ne quittent jamais l’hôtellerie sans avoir bien mangé. Il ne se trouble pas d’entendre, peu après, le Maître ordonner avec un accent d’adjuration de remettre au fourreau le glaive qu’il aurait si vivement recommandé d’acheter. On n’a pourtant jamais entendu dire que les Apôtres se soient servis de glaives et de boucliers contre la violence des païens, ce qu’ils auraient fait assurément si la pensée du Christ avait été celle qu’on lui prête.
Un autre, qui n’est point des derniers et que par respect je ne nomme pas, a confondu la peau de saint Barthélemy écorché et les tentes dont Habacuc a dit : « Les peaux du pays de Madian seront rompues. » J’ai assisté l’autre jour, ce qui m’arrive fréquemment, à une controverse de théologie. Quelqu’un voulait savoir quel texte des Saintes Écritures ordonnait de brûler les hérétiques plutôt que de les convaincre par la discussion. Un vieillard à la mine sévère, que son sourcil révélait théologien, répondit avec véhémence que cette loi venait de l’apôtre Paul, lorsqu’il avait dit : « Évite (devita) l’hérétique, après l’avoir repris une ou deux fois. » Il répéta et fit sonner ces paroles ; chacun s’étonnait ; on se demandait s’il perdait la tête. Il finit par s’expliquer : « Il faut retrancher l’hérétique de la vie », traduisait-il, comprenant de vita au lieu de devita. Quelques auditeurs ont ri ; il s’en est trouvé pour déclarer ce commentaire profondément théologique. Et, tandis qu’on réclamait, survint, comme on dit, un avocat de Ténédos et d’autorité irréfragable : « Écoutez bien, dit-il. Il est écrit. Ne laissez pas vivre le malfaisant (maleficus). Or, l’hérétique est malfaisant. Donc, etc. » Il n’y eut alors qu’une voix pour louer l’ingénieux syllogisme, et toute l’assemblée trépigna de ses lourdes chaussures. Il ne vint à l’esprit de personne que cette loi est faite contre les sorciers, jeteurs de sorts et magiciens, que les Hébreux appellent d’un mot qui se traduit par maleficus. Autrement, la sentence de mort s’appliquerait tout aussi bien à la fornication et à l’ébriété.
Le Christ, dans les psaumes sacrés, dit à son Père : « Vous connaissez ma folie. »
(…)
Sa compagnie de prédilection est celle des petits enfants, des femmes et des pêcheurs. Même parmi les bêtes, il préfère celles qui s’éloignent le plus de la prudence du renard. Aussi choisit-il l’âne pour monture, quand il aurait pu, s’il avait voulu, cheminer sur le dos d’un lion ! Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d’une colombe, non d’un aigle ou d’un milan. L’Écriture sainte fait mention fréquente de cerfs, de faons, d’agneaux. Et notez que le Christ appelle ses brebis ceux des siens qu’il destine à l’immortelle vie. Or, aucun animal n’est plus sot ; Aristote assure que le proverbe « tête de brebis », tiré de la stupidité de cette bête, s’applique comme une injure à tous les gens ineptes et bornés. Tel est le troupeau dont le Christ se déclare le pasteur. Il lui plaît de se faire appeler agneau lui-même, C’est ainsi que le désigne saint Jean: « Voici l’agneau de Dieu ! » et c’est la plus fréquente expression de l’Apocalypse.
Que signifie tout cela sinon que la folie existe chez tous les mortels, même dans la piété ? Le Christ lui-même, pour secourir cette folie, et bien qu’il fût la sagesse du Père, a consenti à en accepter sa part, le jour où il a revêtu la nature humaine et « s’est montré sous l’aspect d’un homme », ou quand il s’est fait péché pour remédier aux péchés. Il n’a voulu y remédier que par la folie de la Croix, à l’aide d’apôtres ignorants et grossiers ; il leur recommande avec soin la Folie, en les détournant de la Sagesse, puisqu’il leur propose en exemple les enfants, les lis, le grain de sénevé, les passereaux, tout ce qui est inintelligent et sans raison, tout ce qui vit sans artifice ni souci et n’a pour guide que la Nature.
Il les avertit de ne pas s’inquiéter, s’ils ont à discourir devant les tribunaux ; il leur interdit de se préoccuper du temps et du moment et même de se fier à leur prudence, pour ne dépendre absolument que de lui seul.
Voilà pourquoi Dieu, lorsqu’il créa le monde, défendit de goûter à l’arbre de la Science, comme si la Science était le poison du bonheur. Saint Paul la rejette ouvertement, comme pernicieuse et nourricière d’orgueil ; et saint Bernard le suit sans doute, lorsque, ayant à désigner la montagne où siège Lucifer, il l’appelle : Montagne de la Science.
Voici sans doute une preuve qu’il ne faut pas oublier. La Folie trouve grâce dans le Ciel, puisqu’elle obtient seule la rémission des péchés, alors que le sage n’est point pardonné.
(…)
Sa compagnie de prédilection est celle des petits enfants, des femmes et des pêcheurs. Même parmi les bêtes, il préfère celles qui s’éloignent le plus de la prudence du renard. Aussi choisit-il l’âne pour monture, quand il aurait pu, s’il avait voulu, cheminer sur le dos d’un lion ! Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d’une colombe, non d’un aigle ou d’un milan. L’Écriture sainte fait mention fréquente de cerfs, de faons, d’agneaux. Et notez que le Christ appelle ses brebis ceux des siens qu’il destine à l’immortelle vie. Or, aucun animal n’est plus sot ; Aristote assure que le proverbe « tête de brebis », tiré de la stupidité de cette bête, s’applique comme une injure à tous les gens ineptes et bornés. Tel est le troupeau dont le Christ se déclare le pasteur. Il lui plaît de se faire appeler agneau lui-même, C’est ainsi que le désigne saint Jean: « Voici l’agneau de Dieu ! » et c’est la plus fréquente expression de l’Apocalypse.
Que signifie tout cela sinon que la folie existe chez tous les mortels, même dans la piété ? Le Christ lui-même, pour secourir cette folie, et bien qu’il fût la sagesse du Père, a consenti à en accepter sa part, le jour où il a revêtu la nature humaine et « s’est montré sous l’aspect d’un homme », ou quand il s’est fait péché pour remédier aux péchés. Il n’a voulu y remédier que par la folie de la Croix, à l’aide d’apôtres ignorants et grossiers ; il leur recommande avec soin la Folie, en les détournant de la Sagesse, puisqu’il leur propose en exemple les enfants, les lis, le grain de sénevé, les passereaux, tout ce qui est inintelligent et sans raison, tout ce qui vit sans artifice ni souci et n’a pour guide que la Nature.
Il les avertit de ne pas s’inquiéter, s’ils ont à discourir devant les tribunaux ; il leur interdit de se préoccuper du temps et du moment et même de se fier à leur prudence, pour ne dépendre absolument que de lui seul.
Voilà pourquoi Dieu, lorsqu’il créa le monde, défendit de goûter à l’arbre de la Science, comme si la Science était le poison du bonheur. Saint Paul la rejette ouvertement, comme pernicieuse et nourricière d’orgueil ; et saint Bernard le suit sans doute, lorsque, ayant à désigner la montagne où siège Lucifer, il l’appelle : Montagne de la Science.
Voici sans doute une preuve qu’il ne faut pas oublier. La Folie trouve grâce dans le Ciel, puisqu’elle obtient seule la rémission des péchés, alors que le sage n’est point pardonné.
Mais je ne sais qui leur a appris qu’il faut prononcer l’exorde d’une voix posée et sans éclats ; ils commencent donc d’un ton si bas qu’à peine entendent-ils le son de leur voix. Comme s’il y avait le moindre intérêt à parler pour n’être compris de personne ! Ils ont ouï dire que pour émouvoir il faut user d’exclamations ; on les voit donc passer brusquement, et sans nul besoin, de la parole calme au cri furieux. On administrerait de l’ellébore à quiconque crierait ainsi hors de propos. Ensuite, on leur a dit qu’il convient de s’échauffer progressivement en parlant ; lorsqu’ils ont récité tant bien que mal le début de chaque partie, leur voix s’enfle tout à coup prodigieusement pour dire les choses les plus simples ; ils en ont perdu le souffle quand s’achève leur discours. Enfin, sachant que la rhétorique utilise le rire, ils s’étudient à égayer leur texte de quelques plaisanteries. Que de grâces, ô chère Aphrodite ! et que d’à- propos, et comme c’est bien l’âne qui joue de la lyre !
Le plus drôle est que tous leurs actes suivent une règle et qu’ils croiraient faire péché grave s’ils s’écartaient le moins du monde de sa rigueur mathématique : combien de nœuds à la sandale, quelle couleur à la ceinture, quelle bigarrure au vêtement, de quelle étoffe la ceinture et de quelle largeur, de quelle forme le capuchon et de quelle capacité en boisseaux, de combien de doigts la largeur de la tonsure, et combien d’heures pour le sommeil ! Qui ne voit à quel point cette égalité est inégale, exigée d’êtres si divers au physique et au moral ? Ces niaiseries, pourtant, les enorgueillissent si fort qu’ils méprisent tout le monde et se méprisent d’un ordre à l’autre. Des hommes, qui professent la charité apostolique, poussent les hauts cris pour un habit différemment serré, pour une couleur un peu plus sombre. Rigidement attachés à leurs usages, les uns ont le froc de laine de Cilicie et la chemise de toile de Milet, les autres portent la toile en dessus, la laine en dessous. Il en est qui redoutent comme un poison le contact de l’argent, mais nullement le vin ni les femmes. Tous ont le désir de se singulariser par leur genre de vie. Ce qu’ils ambitionnent n’est pas de ressembler au Christ, mais de se différencier entre eux. Leurs surnoms aussi les rendent considérablement fiers : entre ceux qui se réjouissent d’être appelés Cordeliers, on distingue les Coletans, les Mineurs, les Minimes, les Bullistes. Et voici les Bénédictins, les Bernardins, les Brigittins, les Augustins, les Guillemites, les Jacobins, comme s’il ne suffisait pas de se nommer Chrétiens !
Leurs cérémonies, leurs petites traditions tout humaines, ont à leurs yeux tant de prix que la récompense n’en saurait être que le ciel. Ils oublient que le Christ, dédaignant tout cela, leur demandera seulement s’ils ont obéi à sa loi, celle de la charité. L’un étalera sa panse gonflée de poissons de toute sorte ; l’autre videra cent boisseaux de psaumes ; un autre comptera ses myriades de jeûnes, où l’unique repas du jour lui remplissait le ventre à crever ; un autre fera de ses pratiques un tas assez gros pour surcharger sept navires ; un autre se glorifiera de n’avoir pas touché à l’argent pendant soixante ans, sinon avec les doigts gantés ; un autre produira son capuchon, si crasseux et si sordide qu’un matelot ne le mettrait pas sur sa peau ; un autre rappellera qu’il a vécu plus de onze lustres au même lieu, attaché comme une éponge ; un autre prétendra qu’il s’est cassé la voix à force de chanter ; un autre qu’il s’est abruti par la solitude ou qu’il a perdu, dans le silence perpétuel, l’usage de la parole.
Mais le Christ arrêtera le flot sans fin de ces glorifications : « Quelle est, dira-t-il, cette nouvelle espèce de Juifs ? Je ne reconnais qu’une loi pour la mienne ; c’est la seule dont nul ne me parle. Jadis, et sans user du voile des paraboles, j’ai promis clairement l’héritage de mon Père, non pour des capuchons, petites oraisons ou abstinences, mais pour les œuvres de foi et de charité. Je ne connais pas ceux-ci, qui connaissent trop leurs mérites ; s’ils veulent paraître plus saints que moi, qu’ils aillent habiter à leur gré le ciel des Abraxasiens ou s’en faire construire un nouveau par ceux dont ils ont mis les mesquines traditions au-dessus de mes préceptes ! » Quand nos gens entendront ce langage et se verront préférer des matelots et des rouliers, quelle tête feront-ils en se regardant ?
Le plus drôle est que tous leurs actes suivent une règle et qu’ils croiraient faire péché grave s’ils s’écartaient le moins du monde de sa rigueur mathématique : combien de nœuds à la sandale, quelle couleur à la ceinture, quelle bigarrure au vêtement, de quelle étoffe la ceinture et de quelle largeur, de quelle forme le capuchon et de quelle capacité en boisseaux, de combien de doigts la largeur de la tonsure, et combien d’heures pour le sommeil ! Qui ne voit à quel point cette égalité est inégale, exigée d’êtres si divers au physique et au moral ? Ces niaiseries, pourtant, les enorgueillissent si fort qu’ils méprisent tout le monde et se méprisent d’un ordre à l’autre. Des hommes, qui professent la charité apostolique, poussent les hauts cris pour un habit différemment serré, pour une couleur un peu plus sombre. Rigidement attachés à leurs usages, les uns ont le froc de laine de Cilicie et la chemise de toile de Milet, les autres portent la toile en dessus, la laine en dessous. Il en est qui redoutent comme un poison le contact de l’argent, mais nullement le vin ni les femmes. Tous ont le désir de se singulariser par leur genre de vie. Ce qu’ils ambitionnent n’est pas de ressembler au Christ, mais de se différencier entre eux. Leurs surnoms aussi les rendent considérablement fiers : entre ceux qui se réjouissent d’être appelés Cordeliers, on distingue les Coletans, les Mineurs, les Minimes, les Bullistes. Et voici les Bénédictins, les Bernardins, les Brigittins, les Augustins, les Guillemites, les Jacobins, comme s’il ne suffisait pas de se nommer Chrétiens !
Leurs cérémonies, leurs petites traditions tout humaines, ont à leurs yeux tant de prix que la récompense n’en saurait être que le ciel. Ils oublient que le Christ, dédaignant tout cela, leur demandera seulement s’ils ont obéi à sa loi, celle de la charité. L’un étalera sa panse gonflée de poissons de toute sorte ; l’autre videra cent boisseaux de psaumes ; un autre comptera ses myriades de jeûnes, où l’unique repas du jour lui remplissait le ventre à crever ; un autre fera de ses pratiques un tas assez gros pour surcharger sept navires ; un autre se glorifiera de n’avoir pas touché à l’argent pendant soixante ans, sinon avec les doigts gantés ; un autre produira son capuchon, si crasseux et si sordide qu’un matelot ne le mettrait pas sur sa peau ; un autre rappellera qu’il a vécu plus de onze lustres au même lieu, attaché comme une éponge ; un autre prétendra qu’il s’est cassé la voix à force de chanter ; un autre qu’il s’est abruti par la solitude ou qu’il a perdu, dans le silence perpétuel, l’usage de la parole.
Mais le Christ arrêtera le flot sans fin de ces glorifications : « Quelle est, dira-t-il, cette nouvelle espèce de Juifs ? Je ne reconnais qu’une loi pour la mienne ; c’est la seule dont nul ne me parle. Jadis, et sans user du voile des paraboles, j’ai promis clairement l’héritage de mon Père, non pour des capuchons, petites oraisons ou abstinences, mais pour les œuvres de foi et de charité. Je ne connais pas ceux-ci, qui connaissent trop leurs mérites ; s’ils veulent paraître plus saints que moi, qu’ils aillent habiter à leur gré le ciel des Abraxasiens ou s’en faire construire un nouveau par ceux dont ils ont mis les mesquines traditions au-dessus de mes préceptes ! » Quand nos gens entendront ce langage et se verront préférer des matelots et des rouliers, quelle tête feront-ils en se regardant ?
Videos de Erasme (12)
Voir plusAjouter une vidéo
Préface de Mieke BAL
Nouvelle édition actualisée
Dans le contexte actuel de guerre et de pandémie, la réédition de Mère Folle prend une tonalité particulière. En effet, dans un récit littéraire, l'ouvrage met en scène la rencontre anachronique des Fous d'un théâtre politique très populaire en Europe après la Grande Peste et la Guerre de Cent ans avec ceux des asiles où l'auteur a travaillé comme analyste pendant trente ans.
Demain, c'est la Toussaint. La narratrice, psychanalyste à l'hôpital psychiatrique, vient d'apprendre la mort par overdose d'un de ses patients psychotiques. Découragée, elle s'en veut et en veut à la psychanalyse de cet échec. Tentée d'abandonner son travail, elle y retourne néanmoins « à reculons ».
Débute alors un étrange voyage où des personnages surgis du passé, fous du Moyen-Âge, acteurs des Sotties – Mère Folle – se mêlent aux malades de l'hôpital, mais aussi à de grands penseurs comme Erasme, René Thom, Artaud, Wittgenstein ou Schrödinger avec qui elle engage des dialogues imaginaires. Cette traversée dialogique, qui est aussi un retour vers son propre passé, la rend capable de recevoir et mettre en actes les enseignements de Gaetano Benedetti à qui elle rend visite à Bâle pendant le Carnaval. Il lui conseille de s'immerger dans le délire de ses patients afin de devenir leur égal fraternel et de leur ménager un espace auxiliaire où pourront être rendues conscientes les « aires catastrophiques » constitutives de leur folie. le traitement possible de la psychose est à ce prix.
Dans le contexte actuel de guerre et de pandémie, la réédition de Mère Folle qui met en scène la rencontre anachronique des Fous d'un théâtre politique très populaire en Europe après la Grande Peste et la Guerre de Cent ans avec ceux des asiles où l'auteur a travaillé comme analyste pendant trente ans, se révèle particulièrement précieuse.
Dans la collection
Hypothèses
Nouvelle édition actualisée
Dans le contexte actuel de guerre et de pandémie, la réédition de Mère Folle prend une tonalité particulière. En effet, dans un récit littéraire, l'ouvrage met en scène la rencontre anachronique des Fous d'un théâtre politique très populaire en Europe après la Grande Peste et la Guerre de Cent ans avec ceux des asiles où l'auteur a travaillé comme analyste pendant trente ans.
Demain, c'est la Toussaint. La narratrice, psychanalyste à l'hôpital psychiatrique, vient d'apprendre la mort par overdose d'un de ses patients psychotiques. Découragée, elle s'en veut et en veut à la psychanalyse de cet échec. Tentée d'abandonner son travail, elle y retourne néanmoins « à reculons ».
Débute alors un étrange voyage où des personnages surgis du passé, fous du Moyen-Âge, acteurs des Sotties – Mère Folle – se mêlent aux malades de l'hôpital, mais aussi à de grands penseurs comme Erasme, René Thom, Artaud, Wittgenstein ou Schrödinger avec qui elle engage des dialogues imaginaires. Cette traversée dialogique, qui est aussi un retour vers son propre passé, la rend capable de recevoir et mettre en actes les enseignements de Gaetano Benedetti à qui elle rend visite à Bâle pendant le Carnaval. Il lui conseille de s'immerger dans le délire de ses patients afin de devenir leur égal fraternel et de leur ménager un espace auxiliaire où pourront être rendues conscientes les « aires catastrophiques » constitutives de leur folie. le traitement possible de la psychose est à ce prix.
Dans le contexte actuel de guerre et de pandémie, la réédition de Mère Folle qui met en scène la rencontre anachronique des Fous d'un théâtre politique très populaire en Europe après la Grande Peste et la Guerre de Cent ans avec ceux des asiles où l'auteur a travaillé comme analyste pendant trente ans, se révèle particulièrement précieuse.
Dans la collection
Hypothèses
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Divers écritsVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature des langues italiques. Littérature latine>Divers écrits (25)
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Erasme (28)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz fou
Érasme a intitulé l'un de ses colloques :
Les pis qu'ont rien
Les Picon-bières
L'Epicurien
Les pis curieux
Et puis plus rien !
Le pis vaut rien
1 questions
22 lecteurs ont répondu
Thème :
ErasmeCréer un quiz sur ce livre22 lecteurs ont répondu