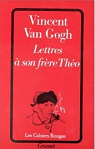Nikol Dziub/5
3 notes
Résumé :
La correspondance entre André Gide et l'orientaliste pétersbourgeois d'origine estonienne Fédor Rosenberg (1867-1934) est l'une des très rares correspondances gidiennes majeures encore inédites. Riche de 338 lettres, elle s'échelonne de 1896 (Gide et Rosenberg se rencontrent à Florence pendant le voyage de noces du premier) à 1934 (date du décès de Rosenberg). Ces lettres permettent d'apporter une lumière nouvelle sur plusieurs aspects fondamentaux de la pensée, de ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Gide & Rosenberg : Correspondance 1896-1934Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
L'échange épistolaire entre les deux amis - l'écrivain français, l'universitaire russe - s'est étendu sur presque quatre décennies, de la rencontre du couple André et Madeleine Gide avec Fédor Rosenberg en Italie pendant leur voyage de noce en 1896 à la mort du correspondant russe de la tuberculose en 1934.
Gide écrivait à un tiers: "Un des plus grands bonheurs de ma vie est d'avoir pu rencontrer Muichkine et d'être entré dans son intimité. Il s'appelle Fédor Rosenberg [...]. Il y a huit jours il était encore ici, et c'est un de mes meilleurs amis."
En plus d'avoir été un pont vers la Russie qu'il chérissait, Rosenberg a été pour Gide "l'ami le plus délicat, le plus sûr et le plus fidèle".
... ami cher et véritable, par delà les goûts qui les ont réunis: goût commun pour la musique, goût pour Dostoïevski - on reconnaît le clin d'oeil de Gide à l'idiot-Muichkine - , goût pour la littérature persane dont Rosenberg a été un éminent spécialiste en Russie etc.
Pourtant Gide et Rosenberg ne se sont presque plus jamais vu directement à partir de 1898, date du retour de Rosenberg en Russie. Leur amitié n'a plus été qu'épistolaire, mais à ce titre, généreuse et dévouée. Nikol Dziub, éditrice du recueil, estime que Rosenberg était l'un des amis dont Gide se sentait le plus proche.
La correspondance est retranscrite de façon quasi-exhaustive, conformément à ce qui a été retrouvé (il manque notamment les lettres de Gide d'avant 1898). Elle a logiquement connu un arrêt au moment de la première guerre mondiale. En 1921, ils se retrouvent, heureux et soulagés de réentendre par le biais du papier la voix de l'autre, après ces années "remplies tout plein de matière chaotique, d'une affreuse purée d'indigestes et d'indicibles ingrédients, mais qu'il a fallu avaler quand même" [Rosenberg]. La conversation reprend, plus espacée, non moins chargée d'affection. Elle supporte sans accrocs la distance entre des mondes plus fractionnés.
En 1921, Gide écrit:
"Et à présent, je suis plongé dans un grand long roman [Les Faux-monnayeurs], qui va m'occuper plusieurs années sans doute, si Dieu me les prête.
De quelque côté que l'on regarde, tout est bien sombre ! Mais, du moins sache, cher, très cher ami, que notre affection pour toi est restée des plus vives, et la mienne plus vive que jamais.
Je t'embrasse bien fort.
Ton
André Gide
"
Dans ses dernières années, Rosenberg ne tiendra pas rigueur à Gide de sa sympathie pour une Union Soviétique "dont les défaillances [le] font souffrir quotidiennement dans sa chair et dans son âme" [Dziub]. C'est peu après sa mort que Gide ira en URSS vanter le régime, puis rapidement s'en désillusionner avec "Retour d'URSS".
Comme le dit Nikol Dziub, l'homme Fédor Rosenberg n'est guère plus connu aujourd'hui que pour avoir été l'ami d'André Gide. A ce titre il est bon de rétablir un peu sa mémoire, celle d'un esprit ardent et passionné, qui écoute et se confie généreusement. Et bien que dans un français d'adoption, son écriture n'a rien à envier à celle de son interlocuteur.
"Quel enchantement que la résurrection d'un été dix mois mort, dix mois pleuré et désiré !
Vraiment les choses bonnes ne sont bonnes qu'en raison de leur rareté. Il y a à peine 20 jours on était dans le désespoir, un ciel gris et glacial ne laissait percer le moindre rayon de soleil, rien ne poussait sur les champs et les cultivateurs - pessimistes par excellence - criaient à la famine. Puis tout à coup, changement à vue : les blés très tristes et anémiques, aujourd'hui se redressent et se vengent du retard de leur développement par une croissance exagérée et à vue d'oeil ; les fleurs qui ne se connaissent pas, s'épanouissent à la fois ; le muguet rougit un tout petit peu à se voir regardé par la rose et celle-ci, de son air superbe et désagréable, fait semblant de ne pas voir l'admirable iris qui étale tous les tons foncés possibles pour donner le change aux oeillets, éclatants comme le sang. Il n'y a que le Nord pour opérer ces miracles-là, mais hélas ! tout cela est si éphémère ; la force longtemps retenue éclate comme une bombe et s'évanouit aussi promptement. Mais enfin il ne faut pas se plaindre : "carpe diem ! Quid sit futurum cras, fuge quaerere" ! [Cueille le jour : Évite de chercher à savoir ce qui adviendra demain]." (P. 116)
Il y a aussi cette confession brûlante, de celles que l'on ne partage qu'aux amis les plus proches :
"Cher vieux,
Félicite-toi de ne pas avoir eu à lire les deux lettres que je t'ai écrites pendant ce mois de crise. Celle d'avant-hier soir est longue, et encore plus idiote que la première, pourtant je n'étais pas ivre ; ou faudrait-il : parce que je ne l'étais pas. Tu es pris de production et de moralité, et moi je suis abattu d'immoralité et de paresse alcoolisée. Quant à moralité et immoralité j'emploierais d'autres mots si je savais transvaluer les valeurs. Jamais crise ne m'a autant duré. Ou bien n'est-ce plus une crise, mais le commencement de cette fin que j'entrevois dans mes cauchemars et qui est la somme de toutes les déchéances dont je serais capable? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que je me méprise ; et de là jusqu'à être méprisé n'est qu'un pas. le "spernere se sperni" [se moquer d'être raillé] reste toujours très loin. Je ne vois plus que des moqueurs et des persécuteurs et pour me paraître un peu moins stupide, je me grise. C'est très beau. ça doit faire terriblement souffrir que d'avoir la manie de la persécution. Je doute qu'on ait alors encore l'énergie de se pendre. Tu souriras de moi entre deux phrases de ton roman [L'immoraliste]; c'est bien. Si tu pouvais sourire là en face dans le fauteuil, je me sentirais guérir et je rirais peut-être au nez à tous les imbéciles qui me poursuivent." (P. 154)
Pour faire bonne mesure, citons ce passage d'une lettre de Gide :
"Cher vieux, je ne vais pas bien. L'absence d'aventures ne me vaut rien, parce que je ne peux pas m'en passer, parce qu'alors je les imagine, et que cela déprave l'esprit, fausse les sens et fatigue terriblement. J'ai parfois la tête si lasse que la moindre lettre m'étonne ; ces jours-là, et qui sont nombreux, "le chef d'oeuvre" m'apparaît à bout de bras. On n'a pas trop de toutes ses forces pour écrire. Ce n'est pas plus d'intelligence que je souhaite, mais plus de santé." (P. 292, 1904)
Dans un monde en mauvaise santé, il est bon de lire ces lettres, authentiques et sincères - contre un certain empire du faux et des images - , qui prennent le temps de se consacrer à l'autre, telles des fils d'Ariane zébrant sans relâche les années imprévisibles.
Je remercie Masse Critique et les Presses universitaires de Lyon pour cet envoi apprécié.
Gide écrivait à un tiers: "Un des plus grands bonheurs de ma vie est d'avoir pu rencontrer Muichkine et d'être entré dans son intimité. Il s'appelle Fédor Rosenberg [...]. Il y a huit jours il était encore ici, et c'est un de mes meilleurs amis."
En plus d'avoir été un pont vers la Russie qu'il chérissait, Rosenberg a été pour Gide "l'ami le plus délicat, le plus sûr et le plus fidèle".
... ami cher et véritable, par delà les goûts qui les ont réunis: goût commun pour la musique, goût pour Dostoïevski - on reconnaît le clin d'oeil de Gide à l'idiot-Muichkine - , goût pour la littérature persane dont Rosenberg a été un éminent spécialiste en Russie etc.
Pourtant Gide et Rosenberg ne se sont presque plus jamais vu directement à partir de 1898, date du retour de Rosenberg en Russie. Leur amitié n'a plus été qu'épistolaire, mais à ce titre, généreuse et dévouée. Nikol Dziub, éditrice du recueil, estime que Rosenberg était l'un des amis dont Gide se sentait le plus proche.
La correspondance est retranscrite de façon quasi-exhaustive, conformément à ce qui a été retrouvé (il manque notamment les lettres de Gide d'avant 1898). Elle a logiquement connu un arrêt au moment de la première guerre mondiale. En 1921, ils se retrouvent, heureux et soulagés de réentendre par le biais du papier la voix de l'autre, après ces années "remplies tout plein de matière chaotique, d'une affreuse purée d'indigestes et d'indicibles ingrédients, mais qu'il a fallu avaler quand même" [Rosenberg]. La conversation reprend, plus espacée, non moins chargée d'affection. Elle supporte sans accrocs la distance entre des mondes plus fractionnés.
En 1921, Gide écrit:
"Et à présent, je suis plongé dans un grand long roman [Les Faux-monnayeurs], qui va m'occuper plusieurs années sans doute, si Dieu me les prête.
De quelque côté que l'on regarde, tout est bien sombre ! Mais, du moins sache, cher, très cher ami, que notre affection pour toi est restée des plus vives, et la mienne plus vive que jamais.
Je t'embrasse bien fort.
Ton
André Gide
"
Dans ses dernières années, Rosenberg ne tiendra pas rigueur à Gide de sa sympathie pour une Union Soviétique "dont les défaillances [le] font souffrir quotidiennement dans sa chair et dans son âme" [Dziub]. C'est peu après sa mort que Gide ira en URSS vanter le régime, puis rapidement s'en désillusionner avec "Retour d'URSS".
Comme le dit Nikol Dziub, l'homme Fédor Rosenberg n'est guère plus connu aujourd'hui que pour avoir été l'ami d'André Gide. A ce titre il est bon de rétablir un peu sa mémoire, celle d'un esprit ardent et passionné, qui écoute et se confie généreusement. Et bien que dans un français d'adoption, son écriture n'a rien à envier à celle de son interlocuteur.
"Quel enchantement que la résurrection d'un été dix mois mort, dix mois pleuré et désiré !
Vraiment les choses bonnes ne sont bonnes qu'en raison de leur rareté. Il y a à peine 20 jours on était dans le désespoir, un ciel gris et glacial ne laissait percer le moindre rayon de soleil, rien ne poussait sur les champs et les cultivateurs - pessimistes par excellence - criaient à la famine. Puis tout à coup, changement à vue : les blés très tristes et anémiques, aujourd'hui se redressent et se vengent du retard de leur développement par une croissance exagérée et à vue d'oeil ; les fleurs qui ne se connaissent pas, s'épanouissent à la fois ; le muguet rougit un tout petit peu à se voir regardé par la rose et celle-ci, de son air superbe et désagréable, fait semblant de ne pas voir l'admirable iris qui étale tous les tons foncés possibles pour donner le change aux oeillets, éclatants comme le sang. Il n'y a que le Nord pour opérer ces miracles-là, mais hélas ! tout cela est si éphémère ; la force longtemps retenue éclate comme une bombe et s'évanouit aussi promptement. Mais enfin il ne faut pas se plaindre : "carpe diem ! Quid sit futurum cras, fuge quaerere" ! [Cueille le jour : Évite de chercher à savoir ce qui adviendra demain]." (P. 116)
Il y a aussi cette confession brûlante, de celles que l'on ne partage qu'aux amis les plus proches :
"Cher vieux,
Félicite-toi de ne pas avoir eu à lire les deux lettres que je t'ai écrites pendant ce mois de crise. Celle d'avant-hier soir est longue, et encore plus idiote que la première, pourtant je n'étais pas ivre ; ou faudrait-il : parce que je ne l'étais pas. Tu es pris de production et de moralité, et moi je suis abattu d'immoralité et de paresse alcoolisée. Quant à moralité et immoralité j'emploierais d'autres mots si je savais transvaluer les valeurs. Jamais crise ne m'a autant duré. Ou bien n'est-ce plus une crise, mais le commencement de cette fin que j'entrevois dans mes cauchemars et qui est la somme de toutes les déchéances dont je serais capable? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que je me méprise ; et de là jusqu'à être méprisé n'est qu'un pas. le "spernere se sperni" [se moquer d'être raillé] reste toujours très loin. Je ne vois plus que des moqueurs et des persécuteurs et pour me paraître un peu moins stupide, je me grise. C'est très beau. ça doit faire terriblement souffrir que d'avoir la manie de la persécution. Je doute qu'on ait alors encore l'énergie de se pendre. Tu souriras de moi entre deux phrases de ton roman [L'immoraliste]; c'est bien. Si tu pouvais sourire là en face dans le fauteuil, je me sentirais guérir et je rirais peut-être au nez à tous les imbéciles qui me poursuivent." (P. 154)
Pour faire bonne mesure, citons ce passage d'une lettre de Gide :
"Cher vieux, je ne vais pas bien. L'absence d'aventures ne me vaut rien, parce que je ne peux pas m'en passer, parce qu'alors je les imagine, et que cela déprave l'esprit, fausse les sens et fatigue terriblement. J'ai parfois la tête si lasse que la moindre lettre m'étonne ; ces jours-là, et qui sont nombreux, "le chef d'oeuvre" m'apparaît à bout de bras. On n'a pas trop de toutes ses forces pour écrire. Ce n'est pas plus d'intelligence que je souhaite, mais plus de santé." (P. 292, 1904)
Dans un monde en mauvaise santé, il est bon de lire ces lettres, authentiques et sincères - contre un certain empire du faux et des images - , qui prennent le temps de se consacrer à l'autre, telles des fils d'Ariane zébrant sans relâche les années imprévisibles.
Je remercie Masse Critique et les Presses universitaires de Lyon pour cet envoi apprécié.
J'ai été intéressée lors de la récente Masse Critique par l'ouvrage des PUL concernant la correspondance entre André Gide et Fédor Rosenberg. C'est le nom de Gide qui m'a plu car j'ignorais vraiment tout de l'orientaliste russe. J'ai aimé à l'adolescence les oeuvres les plus connues de l'écrivain français et j'ai même récemment relu La porte étroite et la Symphonie pastorale. Ici Nikol Dziub s'est « lancé dans l'exploration passionnante de l'amitié entre deux hommes dont l'un, déjà universellement célèbre et célébré, gagne à être fréquenté toujours plus intimement, et l'autre, savant « orientaliste » de très haut partage, mérite d'être mieux connu. »
Dans son avant-propos, Nikol Dziub nous présente Fédor Rosenberg car il « vécut dans l'anonymat, et n'est plus guère connu de nos jours que pour avoir été l'ami d'André Gide ». Ils se sont rencontrés à Florence en 1896. André Gide venait juste de se marier avec Madeleine et ils ont si bien sympathisé que Fédor les a accompagnés ou les a suivis au cours de leur voyage de noces à Naples et Capri, puis à Tunis et jusqu'au désert du Sahara.
Leur amitié s'exprime dans une correspondance nourrie et Nikol Dziub recense dans ce recueil plus de 328 lettres et extraits dont la plupart émane de Fédor car celles de Gide ont été perdues pour la grande majorité et c'est bien dommage. J'ai d'abord lu les 45 premières lettres de l'ouvrage avant de pouvoir lire enfin une lettre d'André Gide à son cher « vieux » ami où il parle de sa déception de ne pas l'avoir vu à Dresde (à l'époque, ces gens-là voyageaient beaucoup – sans doute à la recherche de l'inspiration) et où il est triste de penser que Fédor ne connaîtra pas La Roque-Baignard où il réside avec sa femme assez souvent.
C'est la première fois que je lis un tel recueil de lettres réellement échangées entre deux écrivains lettrés et amis et je suis effarée de voir le nombre de citations écrites en arabe, russe, allemand, italien et même grec et latin. Pratiquement à toutes les pages, il y a des renvois explicatifs en bas. Il est vrai que de nos jours, les langues mortes sont de moins en moins enseignées. J'ai cru entendre un ministre de la culture dire que le latin (après le grec ancien) ne serait plus appris au lycée. C'est dommage pour la compréhension de nos racines mais on va vers une mondialisation et à quand l'Esperanto, le Globish et la langue unique. A bas la tour de Babel.
du point de vue intellectuel et aussi d'un point de vue historique, ces échanges sont passionnants. Ces deux amis ont une vision différente de l'affaire Dreyfus qui a divisé les intellectuels à l'époque. Fédor parle de son antisémitisme et de son dégoût concernant le socialisme et l'égalitarisme. Mais ses sentiments le gouvernent et non sa raison. La signature de Gide apparaît le 22 janvier 1898 dans la « première protestation » du journal l'Aurore. Fédor en est attristé. Il dit : « ne voyez-vous donc pas que vos signatures sont autant de coups dangereux, sinon mortels, portés à votre patrie. » La pauvre patrie, elle en a vu d'autre depuis.
Fédor dit plus loin : "Je ne suis décidément pas partisan du despotisme, mais je suis profondément convaincu qu'une liberté sans bornes n'est possible et viable qu'en théorie ».
Fédor n'aime pas Zola : « Pauvre Zola ! Je crois profondément à sa bonne foi, mais je crois aussi à son manque d'intelligence […] Il est vraiment par trop absurde ce rêve tant de fois ruminé du bonheur universel par la science ». Est-ce que nous lisons encore Zola ? Je pense que oui. J'ai adoré ses livres si réalistes quand j'étais adolescente. de nos jours, les jeunes préfèrent-ils un peu plus de fantasy et les moins jeunes de feel good ? Toujours obligée de m'exprimer en franglais !
Fédor se décrit lui-même dans une de ses lettres – n° 35 - comme : « Inutile, stérile, paresseux, pervers de nature, perverti encore par la vie ». Son souhait est d'avoir « une maison confortable, des livres et mes amis viendraient de temps en temps voir le débonnaire pourceau d'Epicure qui sait pleurer avec les tristes, mais qui sait aussi se réjouir avec ceux qui sont dans la joie.
Lettre 36 : une bien jolie description de la ville italienne de Gênes. Puis aussi une description de la ville d'Istanbul (Stamboul, Constantinople comme il se plait à l'appeler). Plus loin, une description sincère de la ville d'Athènes. Fait étrange pour un inverti : il n'aime pas les Grecs modernes – des « crapules » selon lui. Il n'est pas non plus tendre pour sa patrie : « Ah cher vieux, tu n'as pas une idée de ce que c'est que les gens d'une petite ville perdue, au fond de la Sainte Russie. La classe dite intelligente est aussi impossible que les autres (je suppose du moins que les autres ne sont pas meilleures). Tout ce qui n'est pas vodka, cartes et cancans n'existe pas.
Heureusement dans la lettre qu'il écrit à Gide en septembre 1900 de Felline, il dit : Peut-être demain rien n'est plus vrai [sic] de ce qui me le paraît aujourd'hui ; mais je ne prétends pas d'écrire [sic] des vérités. Méprise-moi comme je me méprise. »
André Gide (lettre 86) a très envie de le rejoindre à Piter (diminutif de Saint-Pétersbourg) et il termine par cette envolée : « A nous les bains russes » ! Une façon très imagée de révéler son impatience charnelle de revoir Fédor.
Sinon ils s'échangent leurs impressions sur leurs amis que je ne connais pas, parlent de la santé des personnes de leur entourage – je remarque que beaucoup d'entre elles sont atteintes de tuberculose, le mal dont mourra Fédor. Ils évoquent énormément leurs ouvrages en cours. L'Immoraliste pour André Gide et Zarathoustra pour Fédor. Gide a promis à Rosenberg sa collaboration pour son livre.
C'est un ouvrage qui intéressera peut-être plus les littéraires que des amateurs de poésie, de polars ou de romans mais c'est une aventure en elle-même que de progresser dans sa lecture. Comme dans les romans de Sylvain Tesson, je voyage principalement en Russie grâce à Fédor que je trouve plus présent et intéressant (pour l'instant) que Gide. Comme quoi, écrire de bons romans ne fait pas de vous un bon épistolier.
Je remercie les Presses Universitaires de Lyon (PUL) pour l'envoi de cet ouvrage ainsi que Babelio qui m'a sélectionnée comme lecteur au cours de la Masse Critique.
Dans son avant-propos, Nikol Dziub nous présente Fédor Rosenberg car il « vécut dans l'anonymat, et n'est plus guère connu de nos jours que pour avoir été l'ami d'André Gide ». Ils se sont rencontrés à Florence en 1896. André Gide venait juste de se marier avec Madeleine et ils ont si bien sympathisé que Fédor les a accompagnés ou les a suivis au cours de leur voyage de noces à Naples et Capri, puis à Tunis et jusqu'au désert du Sahara.
Leur amitié s'exprime dans une correspondance nourrie et Nikol Dziub recense dans ce recueil plus de 328 lettres et extraits dont la plupart émane de Fédor car celles de Gide ont été perdues pour la grande majorité et c'est bien dommage. J'ai d'abord lu les 45 premières lettres de l'ouvrage avant de pouvoir lire enfin une lettre d'André Gide à son cher « vieux » ami où il parle de sa déception de ne pas l'avoir vu à Dresde (à l'époque, ces gens-là voyageaient beaucoup – sans doute à la recherche de l'inspiration) et où il est triste de penser que Fédor ne connaîtra pas La Roque-Baignard où il réside avec sa femme assez souvent.
C'est la première fois que je lis un tel recueil de lettres réellement échangées entre deux écrivains lettrés et amis et je suis effarée de voir le nombre de citations écrites en arabe, russe, allemand, italien et même grec et latin. Pratiquement à toutes les pages, il y a des renvois explicatifs en bas. Il est vrai que de nos jours, les langues mortes sont de moins en moins enseignées. J'ai cru entendre un ministre de la culture dire que le latin (après le grec ancien) ne serait plus appris au lycée. C'est dommage pour la compréhension de nos racines mais on va vers une mondialisation et à quand l'Esperanto, le Globish et la langue unique. A bas la tour de Babel.
du point de vue intellectuel et aussi d'un point de vue historique, ces échanges sont passionnants. Ces deux amis ont une vision différente de l'affaire Dreyfus qui a divisé les intellectuels à l'époque. Fédor parle de son antisémitisme et de son dégoût concernant le socialisme et l'égalitarisme. Mais ses sentiments le gouvernent et non sa raison. La signature de Gide apparaît le 22 janvier 1898 dans la « première protestation » du journal l'Aurore. Fédor en est attristé. Il dit : « ne voyez-vous donc pas que vos signatures sont autant de coups dangereux, sinon mortels, portés à votre patrie. » La pauvre patrie, elle en a vu d'autre depuis.
Fédor dit plus loin : "Je ne suis décidément pas partisan du despotisme, mais je suis profondément convaincu qu'une liberté sans bornes n'est possible et viable qu'en théorie ».
Fédor n'aime pas Zola : « Pauvre Zola ! Je crois profondément à sa bonne foi, mais je crois aussi à son manque d'intelligence […] Il est vraiment par trop absurde ce rêve tant de fois ruminé du bonheur universel par la science ». Est-ce que nous lisons encore Zola ? Je pense que oui. J'ai adoré ses livres si réalistes quand j'étais adolescente. de nos jours, les jeunes préfèrent-ils un peu plus de fantasy et les moins jeunes de feel good ? Toujours obligée de m'exprimer en franglais !
Fédor se décrit lui-même dans une de ses lettres – n° 35 - comme : « Inutile, stérile, paresseux, pervers de nature, perverti encore par la vie ». Son souhait est d'avoir « une maison confortable, des livres et mes amis viendraient de temps en temps voir le débonnaire pourceau d'Epicure qui sait pleurer avec les tristes, mais qui sait aussi se réjouir avec ceux qui sont dans la joie.
Lettre 36 : une bien jolie description de la ville italienne de Gênes. Puis aussi une description de la ville d'Istanbul (Stamboul, Constantinople comme il se plait à l'appeler). Plus loin, une description sincère de la ville d'Athènes. Fait étrange pour un inverti : il n'aime pas les Grecs modernes – des « crapules » selon lui. Il n'est pas non plus tendre pour sa patrie : « Ah cher vieux, tu n'as pas une idée de ce que c'est que les gens d'une petite ville perdue, au fond de la Sainte Russie. La classe dite intelligente est aussi impossible que les autres (je suppose du moins que les autres ne sont pas meilleures). Tout ce qui n'est pas vodka, cartes et cancans n'existe pas.
Heureusement dans la lettre qu'il écrit à Gide en septembre 1900 de Felline, il dit : Peut-être demain rien n'est plus vrai [sic] de ce qui me le paraît aujourd'hui ; mais je ne prétends pas d'écrire [sic] des vérités. Méprise-moi comme je me méprise. »
André Gide (lettre 86) a très envie de le rejoindre à Piter (diminutif de Saint-Pétersbourg) et il termine par cette envolée : « A nous les bains russes » ! Une façon très imagée de révéler son impatience charnelle de revoir Fédor.
Sinon ils s'échangent leurs impressions sur leurs amis que je ne connais pas, parlent de la santé des personnes de leur entourage – je remarque que beaucoup d'entre elles sont atteintes de tuberculose, le mal dont mourra Fédor. Ils évoquent énormément leurs ouvrages en cours. L'Immoraliste pour André Gide et Zarathoustra pour Fédor. Gide a promis à Rosenberg sa collaboration pour son livre.
C'est un ouvrage qui intéressera peut-être plus les littéraires que des amateurs de poésie, de polars ou de romans mais c'est une aventure en elle-même que de progresser dans sa lecture. Comme dans les romans de Sylvain Tesson, je voyage principalement en Russie grâce à Fédor que je trouve plus présent et intéressant (pour l'instant) que Gide. Comme quoi, écrire de bons romans ne fait pas de vous un bon épistolier.
Je remercie les Presses Universitaires de Lyon (PUL) pour l'envoi de cet ouvrage ainsi que Babelio qui m'a sélectionnée comme lecteur au cours de la Masse Critique.
L'amitié entre A. Gide et Fédor Rosenberg (né en Estonie) s'exprime dans une correspondance volumineuse de 1896, date de leur rencontre à Florence, à 1914, correspondance qui s'arrête avec le 1er conflit mondial et la révolution en Russie, puis reprend de 1921 jusqu'à la mort de Rosenberg en 1934. Au total 338 lettres !!!!! Toutes les lettres reçues par Rosenberg sont conservées dans les archives de l'Académie de Russie à Saint Pétersbourg, et celle d'André Gide; à la fondation Catherine-Gide.
Fédor Rosenberg était un savant "orientaliste" qui vécut dans l'anonymat et n'est guère connu, sinon pour avoir été l'ami d'André Gide. Son travail consistait en grande partie, à la traduction de textes du persan au français (avec justement l'assistance d'André Gide).
Gide et Rosenberg partagent de nombreux centres d'intérêt et de goûts communs que ces lettres nous laissent entrevoir. D'ailleurs, c'est grâce à leur goût commun pour la musique qu'ils deviennent amis lors de leur rencontre à Florence dans une pension. Puis ce sera la littérature et notamment la littérature russe. Autre point commun mais déplaisant celui-là c'est l'antisémitisme !!! Cependant Gide se montrera plus clément que Rosenberg, lorsqu'il signera le manifeste en faveur de Dreyfus.
Autre attrait dans ces lettres : les très belles descriptions de certaines villes d'Italie, de Turquie, De Grèce.... où l'on flâne avec eux avec délectation et splendeur.
La lecture de ces lettres ont permis de m'apporter une lumière nouvelle sur plusieurs aspects fondamentaux de la pensée, de l'oeuvre et de la vie d'André Gide.
Fédor Rosenberg était un savant "orientaliste" qui vécut dans l'anonymat et n'est guère connu, sinon pour avoir été l'ami d'André Gide. Son travail consistait en grande partie, à la traduction de textes du persan au français (avec justement l'assistance d'André Gide).
Gide et Rosenberg partagent de nombreux centres d'intérêt et de goûts communs que ces lettres nous laissent entrevoir. D'ailleurs, c'est grâce à leur goût commun pour la musique qu'ils deviennent amis lors de leur rencontre à Florence dans une pension. Puis ce sera la littérature et notamment la littérature russe. Autre point commun mais déplaisant celui-là c'est l'antisémitisme !!! Cependant Gide se montrera plus clément que Rosenberg, lorsqu'il signera le manifeste en faveur de Dreyfus.
Autre attrait dans ces lettres : les très belles descriptions de certaines villes d'Italie, de Turquie, De Grèce.... où l'on flâne avec eux avec délectation et splendeur.
La lecture de ces lettres ont permis de m'apporter une lumière nouvelle sur plusieurs aspects fondamentaux de la pensée, de l'oeuvre et de la vie d'André Gide.
Citations et extraits (24)
Voir plus
Ajouter une citation
Je copie : Ce qu’un autre aurait aussi bien dit que toi, ne le dis pas…(2)
(2.) « Ce qu’un autre aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce qu’un autre aurait aussi bien dit que toi, ne le dis pas, aussi bien écrit que toi, ne l’écris pas. » (André Gide, « Envoi », Les Nourritures terrestres, RR1, p. 442)
186. Fédor Rosenberg à André Gide
(2.) « Ce qu’un autre aurait aussi bien fait que toi, ne le fais pas. Ce qu’un autre aurait aussi bien dit que toi, ne le dis pas, aussi bien écrit que toi, ne l’écris pas. » (André Gide, « Envoi », Les Nourritures terrestres, RR1, p. 442)
186. Fédor Rosenberg à André Gide
Vouloir prouver que la justice n’est pas infaillible, c’est, je crois, porter des chouettes à Athènes.
7. Expression qui signifie « faire un travail inutile », le symbole de la chouette étant indissociable d’Athènes.
27. Fédor Rosenberg à André Gide
7. Expression qui signifie « faire un travail inutile », le symbole de la chouette étant indissociable d’Athènes.
27. Fédor Rosenberg à André Gide
Madame,
Quel enchantement que la résurrection d’un été dix mois mort, dix mois pleuré et désiré !
… Mais enfin il ne faut pas se plaindre : carpe diem ! Quid sit futurum cras, fuge quaerere. (3)
(3) Rosenberg mêle ici deux Odes d’Horace (I,11 et I, 9) : "Cueille le jour ! Evite de chercher à savoir ce qui adviendra demain."
43. Fédor Rosenberg à Madeleine Gide
Quel enchantement que la résurrection d’un été dix mois mort, dix mois pleuré et désiré !
… Mais enfin il ne faut pas se plaindre : carpe diem ! Quid sit futurum cras, fuge quaerere. (3)
(3) Rosenberg mêle ici deux Odes d’Horace (I,11 et I, 9) : "Cueille le jour ! Evite de chercher à savoir ce qui adviendra demain."
43. Fédor Rosenberg à Madeleine Gide
... le tableau est très beau et de mon avis il importe peu s'il est réellement de la main de Raphaël, du moment que l'heureux propriétaire lui-même est convaincu de son authenticité, car enfin ce n'est pas la sèche vérité qui nous rend heureux, mais la douce illusion.
Fédor Rosenberg à Madeleine Gide, 1899, p. 118
Fédor Rosenberg à Madeleine Gide, 1899, p. 118
Adieu, mon vieux, bon travail et bon sang. Quand on est jeune on se relève vite. Tu n'es pas de ceux qui "finissent" avant qu'il en soit temps. Profite des loisirs que te laissent tes obligations et donne-nous un chef d'oeuvre.
A toi comme toujours
Fédor Rosenberg
Fédor Rosenberg à André Gide, 1905, p. 335
A toi comme toujours
Fédor Rosenberg
Fédor Rosenberg à André Gide, 1905, p. 335
autres livres classés : correspondanceVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Ecrivain et malade
Marcel Proust écrivit les derniers volumes de La Recherche dans une chambre obscurcie, tapissée de liège, au milieu des fumigations. Il souffrait
d'agoraphobie
de calculs dans le cosinus
d'asthme
de rhumatismes
10 questions
287 lecteurs ont répondu
Thèmes :
maladie
, écriture
, santéCréer un quiz sur ce livre287 lecteurs ont répondu