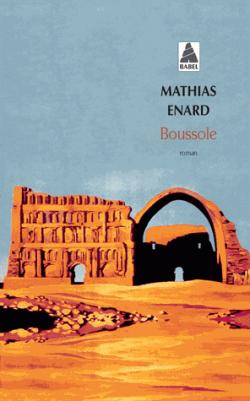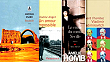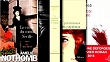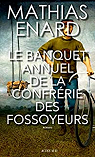Impossible de le finir. Une catastrophe. Je m'endors toutes les dix pages. Hormis quelques anecdotes, le roman est long, fade.
Oui d'accord il y a une multitude de références. Mais ce n'est pas le roman de l'année.
Oui d'accord il y a une multitude de références. Mais ce n'est pas le roman de l'année.
LE grand roman de l'orientalisme.
Dans Boussole, Mathias Enard met en évidence tout ce que l'Orient a pu apporter de beau et d'important aux arts et à la culture occidentaux.
Son personnage Franz Ritter, musicologue féru d'Orient, qui a séjourné à Istanbul, Alep, Damas, Palmyre, Téhéran, cherche le sommeil, la nuit, dans son appartement à Vienne. Et revoit des épisodes de sa vie, ses rencontres dans ce monde qui n'est plus. Comme un pont entre l'Occident et l'Orient.
Lien : https://shot-de-culture.fr/r..
Dans Boussole, Mathias Enard met en évidence tout ce que l'Orient a pu apporter de beau et d'important aux arts et à la culture occidentaux.
Son personnage Franz Ritter, musicologue féru d'Orient, qui a séjourné à Istanbul, Alep, Damas, Palmyre, Téhéran, cherche le sommeil, la nuit, dans son appartement à Vienne. Et revoit des épisodes de sa vie, ses rencontres dans ce monde qui n'est plus. Comme un pont entre l'Occident et l'Orient.
Lien : https://shot-de-culture.fr/r..
Prix du Goncourt 2015, Mathias Enard nous dévoile les mystères de l'Orient avec ses savants. Il nous parle en "Je"omniscient, d'amour éternel entre Franz Ritter et Sarah, Asra. Des voyages de Paris à Vienne, en Syrie, en Turquie... de l'errance solitaire de la Sarah très fragile se cachant en Asie pour devenir bouddhiste puis en Inde, de Franz qui souffre depuis longtemps d'insomnies, quémandant de la morphine à son Docteur pour remplacer l'opium qu'il a fumé lors de ses nombreux voyages en Orient, de la maladie de Sarah la même que lui: ils ont développé une obsession de la philosophie et de l'histoire. Et tout commence par une nuit d'insomnie où il se souvient de tout jusqu'à l'aube. Va-t-il réussir à surmonter son passé et son amour obsessionnel pour Sarah? Un livre magistral difficile à lire, écrit en petit, avec quelques longueurs de trop ennuyeuses
Ce (gros) livre s'apprécie surtout une fois terminée; car il décrit, avec beaucoup d'éruditions, un voyage intérieur. Plongé dans la nuit, le narrateur, autrichien, repense à ses voyages passés, et à Sarah, l'amour de sa vie. S'ensuit dans la nuit des pérégrinations où l'on côtoie les Allemands en Chine (la bière c'est eux !), Zola, Balzac et de nombreux orientalistes…procédant par référence, expliquant peu ses histoires, l'auteur nous perd souvent. Mais ce livre doit s'apprécier comme un tableau impressionniste; de près on ne comprend rien. de loin, il nous accompagne…
BOUSSOLE – Mathias ENARD – Actes Sud - Fiche de lecture rédigée
le 27 9 2015
Cette rentrée littéraire nous fait cadeau du livre de Mathias Enard : Boussole. L'auteur a écrit un livre érudit, dense, envoûtant. Les liens culturels qui unissent l'Occident à l'Orient ou l'Occident et l'Orient sont entrelacés, entremêlés, enchevêtrés. Ils font des arabesques en somme. Comme l'écriture de ce livre.
Mathias Enard, entouré de 300 à 400 livres et de quelques centaines d'articles scientifiques, nous parle ici de la nuit d'insomnie d'un musicologue viennois, Franz, qui vient d'apprendre qu'il est frappé par une maladie grave dont le nom ne sera pas évoqué tout au long du livre. A moins que cela ne soit tout simplement la maladie d'amour ? D'ailleurs, Mathias Enard parle également de l'histoire de Leyla et Majnûn : Majnûn fou d'amour pour Leyla (majnûn signifie « fou » en arabe) erre dans le désert avec les animaux sauvages, se complaît dans sa douleur et va même jusqu'à refuser l'union avec sa bien-aimée, lorsque celle-ci devient libre après la mort de son mari. Par une de ces coïncidences dont la vie a le secret, Franz a reçu le jour même un courrier de la femme aimée qui lui échappe, qui lui a toujours échappé.
Il passe donc une nuit d'insomnie à visiter ses souvenirs qui l'emmènent vers Istanbul, Téhéran, la Syrie. La nuit durant il se raconte des histoires à la manière des Mille et Une Nuits.
Le souvenir de la femme aimée, Sarah, l'accompagne.
Ceci est le cadre du roman. le fond nous secoue. Il nous raconte et démontre que la révolution dans la musique aux XIXème et XXème siècles doit tout à l'Orient, qu'il ne s'agissait pas de « procédés exotiques » comme on le croyait auparavant, que l'exotisme avait un sens, qu'il faisait entrer des éléments extérieurs, de l'altérité, qu'il s'agit d'un large mouvement qui rassemble entre autres, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz, Rimski-Korsakov, Debussy, Bartók, Hindemith, Schonberg, Szymanowski et des centaines de compositeurs dans toute l'Europe. Sur toute l'Europe souffle le vent de l'altérité, ce qui leur vient de l'Autre, pour modifier le Soi, pour l'abâtardir, car «le génie veut la bâtardise ». le mot est lâché : l'altérité. L'altérité est un concept philosophique, c'est le caractère de ce qui est Autre ou la reconnaissance de l'Autre dans sa différence aussi bien culturelle que religieuse. Qu'est ce qui se passe, par exemple, quand l'Allemagne cherche à extirper « l'autre» de sa culture, cherche à se plonger au fond de soi ? Cette quête a débouché sur la plus grande violence, remarque l'auteur.
Il en va de même avec les écrivains. « Depuis Chateaubriand, on voyage pour raconter » écrit Mathias Enard. Hugo (Les Orientales 1829), « Proust et sa Recherche du temps perdu, coeur symbolique du roman européen : Proust fait des Mille et Une Nuits un de ses modèle – le livre de la nuit, le livre de la lutte contre la mort. Comme Schéhérazade se bat chaque soir, après l'amour, contre la sentence qui pèse sur elle en racontant une histoire au sultan Shahryâr, Marcel Proust prend toutes les nuits la plume ; beaucoup de nuits, dit-il, « peut être cent, peut-être mille » pour lutter contre le temps. ». Flaubert (salammbô 1862 et 1874 en version définitive), Balzac qui a publié un livre grand public (La peau de Chagrin – édition 1837) avec une phrase en langue arabe écrite en alphabet arabe et tant autres sont évoqués.
Les allers-retours entre Sadegh Hedayet, l'écrivain persan et Pessoa l'écrivain portugais nous font comprendre que finalement l'Orient et l'Occident ne sont pas si loin l'un de l'autre que ça.
Sarah, la femme aimée, est toujours présente dans ses pensées car elle représente elle-même l'altérité.
Il y a des anecdotes, il y a des histoires dans ce livre de 377 pages d'arabesques mais qui est aussi un livre profondément politique car les renvois vers notre réalité actuelle sont nombreux: La responsabilité du colonialisme, l'espionnage auquel se sont livrés des archéologues, des linguistes, des orientalistes -souvent malgré eux- au bénéfice de l'occident et le nationalisme, sont des faits qui ont sans doute creusé entre nos deux mondes le fossé qui nous fait tant souffrir aujourd'hui. Les « orientalistes » n'ont-ils pas trouvé un confort certain dans les régimes policiers pour bien mener leurs travaux ? La première expédition coloniale européenne au Proche-Orient, mené par Bonaparte, ne fut-elle pas un beau fiasco militaire ? (Ne fut-elle pas un des premiers djhads global ? s'interroge l'auteur. En arabe ce mot signifie « exercer une force »).
En parallèle, dans le livre, les exactions de DAESH sont systématiquement et formellement condamnées.
Les deux camps sont renvoyés dos à dos puisque, Enard écrit : « Les Mille et Une Nuits sont remplies de décapitations, […] dans les romans de chevalerie aussi, on décapite « à tour de bras », [….] La Révolution française mettra bon ordre à cela, en inventant la guillotin. »
Et la condamnation que fait Enard est sans appel. Par exemple, après avoir cité ces quelques vers de Oussama Ibn Mounqidh,
La valeur est certes une épée plus solide que toutes les armures
Mais elle ne protège pas plus le lion de la flèche
Qu'elle ne console le vaincu de la honte et de la ruine,
l'écrivain dit :
« Je me demande ce que penserait Oussama Ibn Mounqidh le brave, de ces images hilarantes de combattants du djihad d'aujourd'hui photographiés en train de brûler les instruments de musique, car non islamiques : des instruments provenant sans doute d'anciennes fanfares militaires libyennes, des tambours, des tambours et des trompettes arrosés d'essence et enflammés devant une troupe respectueuse de barbus, aussi contents que s'il brulaient Satan soi-même. Les mêmes tambours et trompettes, à peu de chose près, que les Francs ont copié à la musique militaire ottomane des siècles plus tôt, les mêmes tambours et trompettes que les Européens décrivaient avec terreur, car ils signifiaient l'approche des janissaires turcs invincibles, accompagnés de « mehter », et aucune image ne représente mieux la terrifiante bataille que les djihadistes livrent en réalité contre l'histoire de l'Islam que ces pauvres types en treillis, dans leur bout de désert, en train de s'acharner sur de tristes instruments martiaux dont ils ignorent la provenance ».
Mais Franz le musicologie lance aussi, au sujet de l'Etat islamique : « C'est une histoire si Européenne, finalement. Des victimes européennes, des bourreaux à l'accent londonien. Un islam radical nouveau et violent, né en Europe et aux Etats-Unis .. »
Mathias Enard, à la question posée par le magazine Lire, « Considérez-vous l'écriture comme une arme ? » répond : « C'est plutôt un outil, qui donne à voir, à penser, à aimer. Une arme se dirige contre quelque chose – cela relèverait alors davantage du pamphlet, de la détestation. Pour ce qui me concerne, j'aurais du mal à écrire « contre ». Je verrais plutôt le livre comme une bombe, qui explose et touche tout le monde. Dans « Mars » par exemple, Fritz Zorn écrit qu'il a été « éduqué à mort », songeant que le cancer dont il souffre découle de son éducation. C'est un livre éminemment politique, d'une très grande violence, mais il donne aussi à entendre cette douleur qui suinte de la société suisse bourgeoise et policée. Les grands livres sont ceux qui arrivent à réunir ces dimensions-là, à faire de leur puissance littéraire, non pas une arme, mais un outil pour leur propre compréhension ».
Avant de conclure je souhaite vous livrer une anecdote : les allemands avaient créé un camp modèle pour les prisonniers de guerre musulmans près de Berlin. Des tabors marocains, des tirailleurs algériens et sénégalais, des musulmans indiens et d'autres y étaient internés lors de la première guerre mondiale. Dans ce camp modèle, Zossen, on rédigeait et publiait à 15 000 exemplaires un journal intitulé « le Djihad », « le journal pour les prisonniers de guerre mahométans » qui paraissait simultanément en arabe en tatar et en russe et une des premières mosquées d'Europe du Nord a été construite en Allemagne au sein de ce camp.
Ce grand livre, un monument de connaissance, un grand livre d'amour, l'amour pour la culture, l'amour pour une femme, l'altérité comme remède vous apportera beaucoup parce qu'il vous aidera à prendre connaissance de tous ces liens qui unissent notre culture à celle des autres. Nous vous le recommandons donc vivement.
le 27 9 2015
Cette rentrée littéraire nous fait cadeau du livre de Mathias Enard : Boussole. L'auteur a écrit un livre érudit, dense, envoûtant. Les liens culturels qui unissent l'Occident à l'Orient ou l'Occident et l'Orient sont entrelacés, entremêlés, enchevêtrés. Ils font des arabesques en somme. Comme l'écriture de ce livre.
Mathias Enard, entouré de 300 à 400 livres et de quelques centaines d'articles scientifiques, nous parle ici de la nuit d'insomnie d'un musicologue viennois, Franz, qui vient d'apprendre qu'il est frappé par une maladie grave dont le nom ne sera pas évoqué tout au long du livre. A moins que cela ne soit tout simplement la maladie d'amour ? D'ailleurs, Mathias Enard parle également de l'histoire de Leyla et Majnûn : Majnûn fou d'amour pour Leyla (majnûn signifie « fou » en arabe) erre dans le désert avec les animaux sauvages, se complaît dans sa douleur et va même jusqu'à refuser l'union avec sa bien-aimée, lorsque celle-ci devient libre après la mort de son mari. Par une de ces coïncidences dont la vie a le secret, Franz a reçu le jour même un courrier de la femme aimée qui lui échappe, qui lui a toujours échappé.
Il passe donc une nuit d'insomnie à visiter ses souvenirs qui l'emmènent vers Istanbul, Téhéran, la Syrie. La nuit durant il se raconte des histoires à la manière des Mille et Une Nuits.
Le souvenir de la femme aimée, Sarah, l'accompagne.
Ceci est le cadre du roman. le fond nous secoue. Il nous raconte et démontre que la révolution dans la musique aux XIXème et XXème siècles doit tout à l'Orient, qu'il ne s'agissait pas de « procédés exotiques » comme on le croyait auparavant, que l'exotisme avait un sens, qu'il faisait entrer des éléments extérieurs, de l'altérité, qu'il s'agit d'un large mouvement qui rassemble entre autres, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz, Rimski-Korsakov, Debussy, Bartók, Hindemith, Schonberg, Szymanowski et des centaines de compositeurs dans toute l'Europe. Sur toute l'Europe souffle le vent de l'altérité, ce qui leur vient de l'Autre, pour modifier le Soi, pour l'abâtardir, car «le génie veut la bâtardise ». le mot est lâché : l'altérité. L'altérité est un concept philosophique, c'est le caractère de ce qui est Autre ou la reconnaissance de l'Autre dans sa différence aussi bien culturelle que religieuse. Qu'est ce qui se passe, par exemple, quand l'Allemagne cherche à extirper « l'autre» de sa culture, cherche à se plonger au fond de soi ? Cette quête a débouché sur la plus grande violence, remarque l'auteur.
Il en va de même avec les écrivains. « Depuis Chateaubriand, on voyage pour raconter » écrit Mathias Enard. Hugo (Les Orientales 1829), « Proust et sa Recherche du temps perdu, coeur symbolique du roman européen : Proust fait des Mille et Une Nuits un de ses modèle – le livre de la nuit, le livre de la lutte contre la mort. Comme Schéhérazade se bat chaque soir, après l'amour, contre la sentence qui pèse sur elle en racontant une histoire au sultan Shahryâr, Marcel Proust prend toutes les nuits la plume ; beaucoup de nuits, dit-il, « peut être cent, peut-être mille » pour lutter contre le temps. ». Flaubert (salammbô 1862 et 1874 en version définitive), Balzac qui a publié un livre grand public (La peau de Chagrin – édition 1837) avec une phrase en langue arabe écrite en alphabet arabe et tant autres sont évoqués.
Les allers-retours entre Sadegh Hedayet, l'écrivain persan et Pessoa l'écrivain portugais nous font comprendre que finalement l'Orient et l'Occident ne sont pas si loin l'un de l'autre que ça.
Sarah, la femme aimée, est toujours présente dans ses pensées car elle représente elle-même l'altérité.
Il y a des anecdotes, il y a des histoires dans ce livre de 377 pages d'arabesques mais qui est aussi un livre profondément politique car les renvois vers notre réalité actuelle sont nombreux: La responsabilité du colonialisme, l'espionnage auquel se sont livrés des archéologues, des linguistes, des orientalistes -souvent malgré eux- au bénéfice de l'occident et le nationalisme, sont des faits qui ont sans doute creusé entre nos deux mondes le fossé qui nous fait tant souffrir aujourd'hui. Les « orientalistes » n'ont-ils pas trouvé un confort certain dans les régimes policiers pour bien mener leurs travaux ? La première expédition coloniale européenne au Proche-Orient, mené par Bonaparte, ne fut-elle pas un beau fiasco militaire ? (Ne fut-elle pas un des premiers djhads global ? s'interroge l'auteur. En arabe ce mot signifie « exercer une force »).
En parallèle, dans le livre, les exactions de DAESH sont systématiquement et formellement condamnées.
Les deux camps sont renvoyés dos à dos puisque, Enard écrit : « Les Mille et Une Nuits sont remplies de décapitations, […] dans les romans de chevalerie aussi, on décapite « à tour de bras », [….] La Révolution française mettra bon ordre à cela, en inventant la guillotin. »
Et la condamnation que fait Enard est sans appel. Par exemple, après avoir cité ces quelques vers de Oussama Ibn Mounqidh,
La valeur est certes une épée plus solide que toutes les armures
Mais elle ne protège pas plus le lion de la flèche
Qu'elle ne console le vaincu de la honte et de la ruine,
l'écrivain dit :
« Je me demande ce que penserait Oussama Ibn Mounqidh le brave, de ces images hilarantes de combattants du djihad d'aujourd'hui photographiés en train de brûler les instruments de musique, car non islamiques : des instruments provenant sans doute d'anciennes fanfares militaires libyennes, des tambours, des tambours et des trompettes arrosés d'essence et enflammés devant une troupe respectueuse de barbus, aussi contents que s'il brulaient Satan soi-même. Les mêmes tambours et trompettes, à peu de chose près, que les Francs ont copié à la musique militaire ottomane des siècles plus tôt, les mêmes tambours et trompettes que les Européens décrivaient avec terreur, car ils signifiaient l'approche des janissaires turcs invincibles, accompagnés de « mehter », et aucune image ne représente mieux la terrifiante bataille que les djihadistes livrent en réalité contre l'histoire de l'Islam que ces pauvres types en treillis, dans leur bout de désert, en train de s'acharner sur de tristes instruments martiaux dont ils ignorent la provenance ».
Mais Franz le musicologie lance aussi, au sujet de l'Etat islamique : « C'est une histoire si Européenne, finalement. Des victimes européennes, des bourreaux à l'accent londonien. Un islam radical nouveau et violent, né en Europe et aux Etats-Unis .. »
Mathias Enard, à la question posée par le magazine Lire, « Considérez-vous l'écriture comme une arme ? » répond : « C'est plutôt un outil, qui donne à voir, à penser, à aimer. Une arme se dirige contre quelque chose – cela relèverait alors davantage du pamphlet, de la détestation. Pour ce qui me concerne, j'aurais du mal à écrire « contre ». Je verrais plutôt le livre comme une bombe, qui explose et touche tout le monde. Dans « Mars » par exemple, Fritz Zorn écrit qu'il a été « éduqué à mort », songeant que le cancer dont il souffre découle de son éducation. C'est un livre éminemment politique, d'une très grande violence, mais il donne aussi à entendre cette douleur qui suinte de la société suisse bourgeoise et policée. Les grands livres sont ceux qui arrivent à réunir ces dimensions-là, à faire de leur puissance littéraire, non pas une arme, mais un outil pour leur propre compréhension ».
Avant de conclure je souhaite vous livrer une anecdote : les allemands avaient créé un camp modèle pour les prisonniers de guerre musulmans près de Berlin. Des tabors marocains, des tirailleurs algériens et sénégalais, des musulmans indiens et d'autres y étaient internés lors de la première guerre mondiale. Dans ce camp modèle, Zossen, on rédigeait et publiait à 15 000 exemplaires un journal intitulé « le Djihad », « le journal pour les prisonniers de guerre mahométans » qui paraissait simultanément en arabe en tatar et en russe et une des premières mosquées d'Europe du Nord a été construite en Allemagne au sein de ce camp.
Ce grand livre, un monument de connaissance, un grand livre d'amour, l'amour pour la culture, l'amour pour une femme, l'altérité comme remède vous apportera beaucoup parce qu'il vous aidera à prendre connaissance de tous ces liens qui unissent notre culture à celle des autres. Nous vous le recommandons donc vivement.
L'insomnie longue et douloureuse pousse le narrateur de Vienne la ville historiquement aux portes de l'orient vers cet est qui a et fait toujours rêver des générations d'intellectuels attirés par ce monde oriental aux facettes aussi nombreuses que les contes des 1001 nuits. Toujours aussi vaste l'écriture de Mathias Enard peu rebuter certains mais porte ceux qui l'apprécie jusqu'à l'aube salvatrice.
Je n'en finis pas d'ouvrir ce livre et de saisir des citations. Plus je l'ouvre plus je plonge avec Franz.
Putain de livre.
Je sais ce que signifie finir cet article sur ce livre. Finir, le ranger, passer à autre chose.
Je ne veux pas passer à autre chose. J'ai peur de passer à autre chose. Trop m'attendent. Je connais la liste. C'est moi qui l'ai faite.
Boussole est mon livre de chevet depuis le début. Je veux rester avec Franz dans sa nuit d'hypocondriaque à regarder l'horloge, à penser au passé, son passé. Au moins tant que je pense au sien... Forme suave d'hypocondrie.
Il va bien falloir ranger ce livre.
Ce livre cause de femmes, de l'Histoire, d'humanité, de lâcheté, d'instants gaspillés, d'amour. Il parle de trajectoires individuelles et de trajectoires d'ensemble, comme en mécanique des fluides, la vitesse du nageur et la vitesse du courant.
C'est un bon livre. le dernier Goncourt que j'ai lu, l'élégance du hérisson m'a bien saoulé. La liste de choses japonaises démontrant à chaque item mon incultie, ne m'a pas apportée d'assez nombreuses sensations. Alors que là, j'ai vécu chaque page.
Boussole est ma bouée. Commencé ce livre avant, fini pendant. Il doit être bon, très bon. Riche, complexe. Il doit vous marquer. Il faut que vous vous souveniez de lui. Autant que pour moi. Dense, multiple.
Je sais que je dois finir cette chronique. Sortir de ce livre.
Il est bien écrit. Bourré de références, mais pas le genre « bouge pas, j'te remplis de ma science », non le genre « j'aime ça, et puis ça, et puis ça, et ça, ça m'a me fait du mal, et ça, ça me fait vomir tellement c'est dégueulasse ».
J'ai oublié mon somnifère. Si je le prends maintenant je vais être infoutue de me lever demain. Si je le prends pas je vais pas dormir du tout. Tiens, ça fait comme pour Franz.
Par certains aspects, Boussole rappelle « le quatrième mur » ou bien « retour à Killybegs » de Sorj Chalendon. Y a cette désespérance en commun.
Boussole donc.
Les éditeurs, parce qu'ils sont plusieurs, ont écrit un quatrième que je n'ai pas compris. Il a fallu que je relise le livre.
J'avais lu une critique dans le magasine Lire, un mois où je cherchais des influenceurs pour mon livre. Voyez l'état dans lequel on peut se trouver ! C'était pour les prix littéraires en septembre, période de énièmes et stériles résolutions.
Je me souviens qu'il portait les thèmes suivants : histoire d'amour, objet d'enfance, Europe de l'est et Orient. Je me rappelle la gueule de l'auteur sur une photo en noir et blanc où il était adossé à un mur, et le fait qu'il habitait Niort.
Bref, j'ai attendu qu'il sorte en poche. Hors de question de payer 20€ un bouquin. Et quand je me suis pointée au rayon livre de Auchan, il ne restait plus de poche. Depuis j'ai paumé la banderole rouge du succès, perdu aussi l'étui glacé de la couverture couleur. L'objet est donc sobre, nu et tout corné. C'est bien.
Le texte donc. Intimiste, bien écrit. J'ai pris un cours de , ; : ( ), et —. C'est écrit simplement, avec humilité. C'est pour ça je crois que je m'y suis accrochée. C'est un livre qui écoute, qui a su s'adapter à ma plongée. Il est facile à lire. Pareil le mélange du présent, du passé et d'un passé dans le désordre en plus, l'ensemble ne pose aucune difficulté. C'est comme ça dans nos têtes aussi. Dans la mienne. Il aura fallu ce quatrième lu à la fin pour me faire douter. Putain d'éditeurs trous du cul. Franz est touchant, il est réel, je l'ai déjà rencontré. Homme centré sur la moyenne, il a quelques colères identitaires et une capacité hors norme à déceler les noeuds de l'espace-temps : choper les liens entre son enfance, Balzac, des Européennes du XIXème trouvées en Orient et les marches militaires.
Toutes ces conjectures, ces inflexions de l'Histoire sont extraordinaires. Les camps musulmans créés par l'Axe pour soudoyer les combattants arabes et africains sous couvert d'études de sciences humaines, la jalousie de Wagner, les Milles et une nuits de Proust… c'est pour cela que c'est vain de chercher à tout vous dire, à vous faire sentir la constellation de ces conjonctions. Tout ce que Franz chope ce sont des petitesses humaines comme les siennes, des petitesses qui font l'Histoire, qui mises bout à bout, tissées ensemble, déroulent le grand tapis du temps et des vies. Mathias Enard partage avec nous une quantité inouïe d'histoires, de morceaux de vies : la boussole de Beethoven, le chien de Schopenhauer, la lâcheté de Goethe, et puis toutes ces femmes évoquées. Rarement auteur citant, n'aura cité autant de femmes. Saviez-vous qu'Alexandra David-Neel avait été Soprano aux opéras de Hanoi et de Haiphong avant ses périples au Tibet ?
Le livre est truffé de références et d'anecdotes mais on ne retient rien. Je ne retiens rien. Faudra que je le relise une nouvelle fois. C'est pas un livre à apprendre c'est un livre à vivre. le texte commence avec le XVIIIème, le XIXème et se termine sur la période contemporaine, voire très contemporaine. La poussière et le fer sont dans la bouche, comme dans « le quatrième mur » de Sorj Chalendon. le narrateur est un acteur impuissant, spectateur impliqué amer. Faut que je commence à mettre des virgules. L'auteur charge son texte de faits historiques dont il ne vient pas à l'esprit de penser qu'ils sont inexacts. Au passage je ne sais pas comment il a fait. La structure du récit est toute mélangée en apparence et se lit comme Franz pense, c'est-à-dire d'associations d'idées en associations d'idées. Construire cela, le synoptique… je ne vois pas comment l'auteur a pu faire. Chapeau donc. On ne sent aucun tuteur à la lecture. le chien du voisin, Sarah, les auteurs orientaux, les orientalistes, ses rencontres passées, lointaines oubliées ou ressassées ; tout s'enchaîne. La lecture se passe comme si Mathias Enard avait tout écrit dans un unique geste, avec des , ; des : des ( ) de – pour ne pas interrompre sa pensée. L'exercice est fait de merveilleuse manière. On est vraiment dans la tête de Franz.
Un truc est divergent. Je ris – c'est vraiment mesquin de ma part (vraiment mesquin) – ce sont les scènes de sensualité. Elles, sont dans un temps qui est autre, elles ne sont pas écrites dans le même geste. A la lecture, on doit s'arrêter et reprendre. le texte est beaucoup plus dense, beaucoup plus épais. Si M. Enard vous me lisez, ce n'est pas une critique, plutôt une remarque, d'auteur à auteur. Je sais que quand on écrit ça, on n'est pas dans le même niveau de sous-sol, c'est ce que je ressens quand j'écris des scènes comme ça et ce que j'ai ressenti en vous lisant. Sans que cela soit un problème. Ça nous fait un point commun. Ouais je rame. Je sais. D'autant que, s'il faut, c'est uniquement ma perception. Ma part d'écriture de ce livre. Probabilité supérieure à 50% d'ailleurs. Ce qui vient de moi, en plus, en sus.
Bref lisez ce texte.
Tout ce qui touche à l'histoire contemporaine, la Syrie, Alep, aujourd'hui, je n'ai rien lu. Zappés les passages amers de la période contemporaine, ma responsabilité d'existante contemporaine de cette liste des horreurs. Comme le corps se met en coma, mon attention n'a pas lu les choses graves et douloureuses. Je n'arrive pas écrire, les mots ne viennent pas. Certains confrères pensent qu'il faut éviter le bonheur pour ne pas voir se tarir la source de la création. J'suis pas sûre. L'état qui me domine n'est pas bonheurie, il m'asservit pourtant et me met dans un état atone.
Posture antalgique.
Terminer, passer à autre chose.
Mais j'aime ce livre. Je voudrais rester encore un peu avec lui. Encore un peu. Je n'ai pas tout lu. Je promets de lire les trucs sur la Syrie, sur les Iraniennes, sur Alep, sur l'hôtel Baron ; je promets ! Les trucs sombres. Je promets ! T'as toujours été là, je veux pas que tu t'en ailles.
Faut que je parle des femmes, et des hommes, ces passeurs des deux rives. Tellement nombreux dans ce texte.
Ce qui est troublant aussi, c'est que le texte que j'étais en train d'écrire avant, évoque cette question de rejoindre une autre rive pour se trouver soi-même. J'ai cité le Bosphore dans ce texte. Troublant donc. Sourire. Ce sera mon tissage à moi, entre les lieux, les arts, les états, entre les vies.
Allez, je saute.
Vous, lisez ce livre !
Lien : https://ninerouve.wordpress...
Putain de livre.
Je sais ce que signifie finir cet article sur ce livre. Finir, le ranger, passer à autre chose.
Je ne veux pas passer à autre chose. J'ai peur de passer à autre chose. Trop m'attendent. Je connais la liste. C'est moi qui l'ai faite.
Boussole est mon livre de chevet depuis le début. Je veux rester avec Franz dans sa nuit d'hypocondriaque à regarder l'horloge, à penser au passé, son passé. Au moins tant que je pense au sien... Forme suave d'hypocondrie.
Il va bien falloir ranger ce livre.
Ce livre cause de femmes, de l'Histoire, d'humanité, de lâcheté, d'instants gaspillés, d'amour. Il parle de trajectoires individuelles et de trajectoires d'ensemble, comme en mécanique des fluides, la vitesse du nageur et la vitesse du courant.
C'est un bon livre. le dernier Goncourt que j'ai lu, l'élégance du hérisson m'a bien saoulé. La liste de choses japonaises démontrant à chaque item mon incultie, ne m'a pas apportée d'assez nombreuses sensations. Alors que là, j'ai vécu chaque page.
Boussole est ma bouée. Commencé ce livre avant, fini pendant. Il doit être bon, très bon. Riche, complexe. Il doit vous marquer. Il faut que vous vous souveniez de lui. Autant que pour moi. Dense, multiple.
Je sais que je dois finir cette chronique. Sortir de ce livre.
Il est bien écrit. Bourré de références, mais pas le genre « bouge pas, j'te remplis de ma science », non le genre « j'aime ça, et puis ça, et puis ça, et ça, ça m'a me fait du mal, et ça, ça me fait vomir tellement c'est dégueulasse ».
J'ai oublié mon somnifère. Si je le prends maintenant je vais être infoutue de me lever demain. Si je le prends pas je vais pas dormir du tout. Tiens, ça fait comme pour Franz.
Par certains aspects, Boussole rappelle « le quatrième mur » ou bien « retour à Killybegs » de Sorj Chalendon. Y a cette désespérance en commun.
Boussole donc.
Les éditeurs, parce qu'ils sont plusieurs, ont écrit un quatrième que je n'ai pas compris. Il a fallu que je relise le livre.
J'avais lu une critique dans le magasine Lire, un mois où je cherchais des influenceurs pour mon livre. Voyez l'état dans lequel on peut se trouver ! C'était pour les prix littéraires en septembre, période de énièmes et stériles résolutions.
Je me souviens qu'il portait les thèmes suivants : histoire d'amour, objet d'enfance, Europe de l'est et Orient. Je me rappelle la gueule de l'auteur sur une photo en noir et blanc où il était adossé à un mur, et le fait qu'il habitait Niort.
Bref, j'ai attendu qu'il sorte en poche. Hors de question de payer 20€ un bouquin. Et quand je me suis pointée au rayon livre de Auchan, il ne restait plus de poche. Depuis j'ai paumé la banderole rouge du succès, perdu aussi l'étui glacé de la couverture couleur. L'objet est donc sobre, nu et tout corné. C'est bien.
Le texte donc. Intimiste, bien écrit. J'ai pris un cours de , ; : ( ), et —. C'est écrit simplement, avec humilité. C'est pour ça je crois que je m'y suis accrochée. C'est un livre qui écoute, qui a su s'adapter à ma plongée. Il est facile à lire. Pareil le mélange du présent, du passé et d'un passé dans le désordre en plus, l'ensemble ne pose aucune difficulté. C'est comme ça dans nos têtes aussi. Dans la mienne. Il aura fallu ce quatrième lu à la fin pour me faire douter. Putain d'éditeurs trous du cul. Franz est touchant, il est réel, je l'ai déjà rencontré. Homme centré sur la moyenne, il a quelques colères identitaires et une capacité hors norme à déceler les noeuds de l'espace-temps : choper les liens entre son enfance, Balzac, des Européennes du XIXème trouvées en Orient et les marches militaires.
Toutes ces conjectures, ces inflexions de l'Histoire sont extraordinaires. Les camps musulmans créés par l'Axe pour soudoyer les combattants arabes et africains sous couvert d'études de sciences humaines, la jalousie de Wagner, les Milles et une nuits de Proust… c'est pour cela que c'est vain de chercher à tout vous dire, à vous faire sentir la constellation de ces conjonctions. Tout ce que Franz chope ce sont des petitesses humaines comme les siennes, des petitesses qui font l'Histoire, qui mises bout à bout, tissées ensemble, déroulent le grand tapis du temps et des vies. Mathias Enard partage avec nous une quantité inouïe d'histoires, de morceaux de vies : la boussole de Beethoven, le chien de Schopenhauer, la lâcheté de Goethe, et puis toutes ces femmes évoquées. Rarement auteur citant, n'aura cité autant de femmes. Saviez-vous qu'Alexandra David-Neel avait été Soprano aux opéras de Hanoi et de Haiphong avant ses périples au Tibet ?
Le livre est truffé de références et d'anecdotes mais on ne retient rien. Je ne retiens rien. Faudra que je le relise une nouvelle fois. C'est pas un livre à apprendre c'est un livre à vivre. le texte commence avec le XVIIIème, le XIXème et se termine sur la période contemporaine, voire très contemporaine. La poussière et le fer sont dans la bouche, comme dans « le quatrième mur » de Sorj Chalendon. le narrateur est un acteur impuissant, spectateur impliqué amer. Faut que je commence à mettre des virgules. L'auteur charge son texte de faits historiques dont il ne vient pas à l'esprit de penser qu'ils sont inexacts. Au passage je ne sais pas comment il a fait. La structure du récit est toute mélangée en apparence et se lit comme Franz pense, c'est-à-dire d'associations d'idées en associations d'idées. Construire cela, le synoptique… je ne vois pas comment l'auteur a pu faire. Chapeau donc. On ne sent aucun tuteur à la lecture. le chien du voisin, Sarah, les auteurs orientaux, les orientalistes, ses rencontres passées, lointaines oubliées ou ressassées ; tout s'enchaîne. La lecture se passe comme si Mathias Enard avait tout écrit dans un unique geste, avec des , ; des : des ( ) de – pour ne pas interrompre sa pensée. L'exercice est fait de merveilleuse manière. On est vraiment dans la tête de Franz.
Un truc est divergent. Je ris – c'est vraiment mesquin de ma part (vraiment mesquin) – ce sont les scènes de sensualité. Elles, sont dans un temps qui est autre, elles ne sont pas écrites dans le même geste. A la lecture, on doit s'arrêter et reprendre. le texte est beaucoup plus dense, beaucoup plus épais. Si M. Enard vous me lisez, ce n'est pas une critique, plutôt une remarque, d'auteur à auteur. Je sais que quand on écrit ça, on n'est pas dans le même niveau de sous-sol, c'est ce que je ressens quand j'écris des scènes comme ça et ce que j'ai ressenti en vous lisant. Sans que cela soit un problème. Ça nous fait un point commun. Ouais je rame. Je sais. D'autant que, s'il faut, c'est uniquement ma perception. Ma part d'écriture de ce livre. Probabilité supérieure à 50% d'ailleurs. Ce qui vient de moi, en plus, en sus.
Bref lisez ce texte.
Tout ce qui touche à l'histoire contemporaine, la Syrie, Alep, aujourd'hui, je n'ai rien lu. Zappés les passages amers de la période contemporaine, ma responsabilité d'existante contemporaine de cette liste des horreurs. Comme le corps se met en coma, mon attention n'a pas lu les choses graves et douloureuses. Je n'arrive pas écrire, les mots ne viennent pas. Certains confrères pensent qu'il faut éviter le bonheur pour ne pas voir se tarir la source de la création. J'suis pas sûre. L'état qui me domine n'est pas bonheurie, il m'asservit pourtant et me met dans un état atone.
Posture antalgique.
Terminer, passer à autre chose.
Mais j'aime ce livre. Je voudrais rester encore un peu avec lui. Encore un peu. Je n'ai pas tout lu. Je promets de lire les trucs sur la Syrie, sur les Iraniennes, sur Alep, sur l'hôtel Baron ; je promets ! Les trucs sombres. Je promets ! T'as toujours été là, je veux pas que tu t'en ailles.
Faut que je parle des femmes, et des hommes, ces passeurs des deux rives. Tellement nombreux dans ce texte.
Ce qui est troublant aussi, c'est que le texte que j'étais en train d'écrire avant, évoque cette question de rejoindre une autre rive pour se trouver soi-même. J'ai cité le Bosphore dans ce texte. Troublant donc. Sourire. Ce sera mon tissage à moi, entre les lieux, les arts, les états, entre les vies.
Allez, je saute.
Vous, lisez ce livre !
Lien : https://ninerouve.wordpress...
Boussole, par Mathias Enard. Prix Goncourt 2015, voilà un livre important, qui tient du roman, de façon assez minimale toutefois, et d'un savoir quasi encyclopédique sur ce qui rattache l'Occident à ce Moyen-Orient si fascinant, en matière d'histoire, d'art, de culture, etc. Boussole fait figure d'un puits de connaissances d'une grande profondeur, servi par une écriture habile et savoureuse.
Franz Ritter, le narrateur, est un musicologue, chercheur attaché à l'Université de Vienne, et dont l'univers est constitué d'orientalistes, au premier rang desquels il y a Sarah, la belle et cérébrale Sarah, rousse à coeur, indépendante, grande voyageuse, prodigue en articles scientifiques, et que le pauvre Frank perçoit comme inaccessible et insoumise. Cependant, après avoir accédé une fois à l'intime, leur relation se relâche tout en restant pleine de promesses. D'autres personnages émergent, l'archéologue Bilger qui deviendra fou, l'opiomane Faugier, arpenteur invétéré des bas-fonds des capitales orientales, l'inélégant Gilbert de Morgan, directeur de thèse de Sarah, qui intrigue salement pour conquérir à Téhéran Azra la révolutionnaire, éperdument amoureuse d'un autre.
En parallèle à la quête amoureuse du narrateur qui jalonne le roman, Boussole est l'évocation des souvenirs qui hantent un Franz Ritter croupissant dans son logis viennois, souffrant, insomniaque, déprimé, en attente d'un message de Sarah qui séjourne alors au Sarawak, en Malaisie. Tous deux on séjourné par le passé en Turquie, à Istanbul, en Syrie, à Damas, à Alep, à Palmyre, en Iran, à Téhéran. Au fil du roman, on croise des multitudes d'artistes, poètes, écrivains, musiciens, peintres, archéologues, explorateurs, qui y ont voyagé ou non, en tout cas qui furent fascinés par l'Orient ou lui appartiennent, Liszt, Mozart, Rimbaud, Hugo, Balzac, Berlioz, Goethe, Heinrich Heine, l'iranien Sadegh Hedayat, Fernando Pessoa, Hafez, Lawrence d'Arabie, et cent ou mille autres, connus ou non. L'érudition de Mathias Enard est sans limite, elle s'étale à chaque page, lumineuse très souvent, quand elle s'exprime au travers d'anecdotes multiples, vaine bien des fois, quand elle consiste en de simples énumérations.
Cette érudition s'intègre toutefois à l'écriture, finalement assez fluide, de l'auteur, rendant cet ouvrage assez imposant, savant et poétique à la fois, en tout cas envoûtant, pénétrant peut-être, par cette manière dépourvue d'aspérités de mélanger les aspects romanesques avec cette écrasante culture. Et l'actualité - la Turquie sous des bottes despotiques, la Syrie à feu et à sang, l'Iran opprimé - qui traverse discrètement le livre, vient renforcer cette admiration, cette passion pour un Moyen-Orient riche de culture qu'un pont fragile reliait hier encore à l'Occident, un Occident fasciné, ébloui, hypnotisé.
Lien : http://lireecrireediter.over..
Franz Ritter, le narrateur, est un musicologue, chercheur attaché à l'Université de Vienne, et dont l'univers est constitué d'orientalistes, au premier rang desquels il y a Sarah, la belle et cérébrale Sarah, rousse à coeur, indépendante, grande voyageuse, prodigue en articles scientifiques, et que le pauvre Frank perçoit comme inaccessible et insoumise. Cependant, après avoir accédé une fois à l'intime, leur relation se relâche tout en restant pleine de promesses. D'autres personnages émergent, l'archéologue Bilger qui deviendra fou, l'opiomane Faugier, arpenteur invétéré des bas-fonds des capitales orientales, l'inélégant Gilbert de Morgan, directeur de thèse de Sarah, qui intrigue salement pour conquérir à Téhéran Azra la révolutionnaire, éperdument amoureuse d'un autre.
En parallèle à la quête amoureuse du narrateur qui jalonne le roman, Boussole est l'évocation des souvenirs qui hantent un Franz Ritter croupissant dans son logis viennois, souffrant, insomniaque, déprimé, en attente d'un message de Sarah qui séjourne alors au Sarawak, en Malaisie. Tous deux on séjourné par le passé en Turquie, à Istanbul, en Syrie, à Damas, à Alep, à Palmyre, en Iran, à Téhéran. Au fil du roman, on croise des multitudes d'artistes, poètes, écrivains, musiciens, peintres, archéologues, explorateurs, qui y ont voyagé ou non, en tout cas qui furent fascinés par l'Orient ou lui appartiennent, Liszt, Mozart, Rimbaud, Hugo, Balzac, Berlioz, Goethe, Heinrich Heine, l'iranien Sadegh Hedayat, Fernando Pessoa, Hafez, Lawrence d'Arabie, et cent ou mille autres, connus ou non. L'érudition de Mathias Enard est sans limite, elle s'étale à chaque page, lumineuse très souvent, quand elle s'exprime au travers d'anecdotes multiples, vaine bien des fois, quand elle consiste en de simples énumérations.
Cette érudition s'intègre toutefois à l'écriture, finalement assez fluide, de l'auteur, rendant cet ouvrage assez imposant, savant et poétique à la fois, en tout cas envoûtant, pénétrant peut-être, par cette manière dépourvue d'aspérités de mélanger les aspects romanesques avec cette écrasante culture. Et l'actualité - la Turquie sous des bottes despotiques, la Syrie à feu et à sang, l'Iran opprimé - qui traverse discrètement le livre, vient renforcer cette admiration, cette passion pour un Moyen-Orient riche de culture qu'un pont fragile reliait hier encore à l'Occident, un Occident fasciné, ébloui, hypnotisé.
Lien : http://lireecrireediter.over..
Une lecture qui me laisse circonspecte. Ai-je ou non aimé ce livre ? La difficulté à répondre à cette question me laisse croire que ce n'est pas un coup de coeur. Et pourtant…
Ce roman se déroule en une nuit, à Vienne, chez un musicologue orientaliste et insomniaque. Se croyant à la fin de sa vie – le lecteur ne saura jamais s'il est un véritable hypocondriaque ou si son mal est réel –, il se remémore ses voyages, ses rencontres et son amour pour une chercheuse française, Sarah. L'ensemble est poussif, fait d'une suite de références orientalistes qui ne doit parler qu'aux spécialistes. On ne retient rien de cette logorrhée interminable et fatigante qui fait le va-et-vient entre Orient et Occident. Ce n'est même pas un discours scientifique puisqu'il n'y a ni construction théorique ni thèse, on en vient même à croire que l'auteur s'est perdu dans ses recherches documentaires.
On comprend peu à peu que c'est une astuce littéraire pour nous faire entrer dans l'état d'esprit du personnage, ses hésitations, ses souvenirs, cette nuit qui n'en finit jamais. Peut-être est-ce également une façon pour l'auteur de recréer cette sensation, si souvent évoquée au cours du texte, que provoque l'opium : la perte de repères, le flottement.
Malgré cette logorrhée pseudo-scientifique, malgré la lenteur du récit tiraillé entre une histoire d'amour dont on ne sait pas si elle existe vraiment et des références orientalistes que l'on comprend (ou non !), malgré tout, on est touché. Il y a une touche de poésie dans ce roman mais elle méritait mieux que de se retrouver engloutie dans un salmigondis qui accumule les références livresques. Elle aurait pu jaillir d'une réelle expérience de vie dans les pays évoqués mais, visiblement, ce n'est pas le cas. Ou peut-être que Mathias Énard, à l'instar de ses personnages, s'est contenté de rester dans des cercles très fermés de diplomates et d'intellectuels.
Cela aurait apporté une épaisseur vivante au récit. À force de vouloir étaler des connaissances, l'auteur se perd et oublie de nous raconter une histoire qui nous parle de nous en tant qu'êtres humains. Cette touche d'universel n'est présente qu'au dernier chapitre et je crains que beaucoup aient abandonné la lecture avant. Dommage.
Ce roman se déroule en une nuit, à Vienne, chez un musicologue orientaliste et insomniaque. Se croyant à la fin de sa vie – le lecteur ne saura jamais s'il est un véritable hypocondriaque ou si son mal est réel –, il se remémore ses voyages, ses rencontres et son amour pour une chercheuse française, Sarah. L'ensemble est poussif, fait d'une suite de références orientalistes qui ne doit parler qu'aux spécialistes. On ne retient rien de cette logorrhée interminable et fatigante qui fait le va-et-vient entre Orient et Occident. Ce n'est même pas un discours scientifique puisqu'il n'y a ni construction théorique ni thèse, on en vient même à croire que l'auteur s'est perdu dans ses recherches documentaires.
On comprend peu à peu que c'est une astuce littéraire pour nous faire entrer dans l'état d'esprit du personnage, ses hésitations, ses souvenirs, cette nuit qui n'en finit jamais. Peut-être est-ce également une façon pour l'auteur de recréer cette sensation, si souvent évoquée au cours du texte, que provoque l'opium : la perte de repères, le flottement.
Malgré cette logorrhée pseudo-scientifique, malgré la lenteur du récit tiraillé entre une histoire d'amour dont on ne sait pas si elle existe vraiment et des références orientalistes que l'on comprend (ou non !), malgré tout, on est touché. Il y a une touche de poésie dans ce roman mais elle méritait mieux que de se retrouver engloutie dans un salmigondis qui accumule les références livresques. Elle aurait pu jaillir d'une réelle expérience de vie dans les pays évoqués mais, visiblement, ce n'est pas le cas. Ou peut-être que Mathias Énard, à l'instar de ses personnages, s'est contenté de rester dans des cercles très fermés de diplomates et d'intellectuels.
Cela aurait apporté une épaisseur vivante au récit. À force de vouloir étaler des connaissances, l'auteur se perd et oublie de nous raconter une histoire qui nous parle de nous en tant qu'êtres humains. Cette touche d'universel n'est présente qu'au dernier chapitre et je crains que beaucoup aient abandonné la lecture avant. Dommage.
Je suis parvenu à un âge où, vitesse de la vie oblige, je ne me force plus à lire jusqu'au bout un livre qui ne m'accroche pas. Boussole a failli me la faire perdre. Je l'ai lu en 3 fois. J'ai cru l'abandonner. Toute cette érudition comme cadeau d'anniversaire, l'amitié a ses limites. Et puis j'y revenais, avec parfois une semaine d'absence, quelques infidélités d'autres lectures. Et à chaque fois, malgré les apparences, je m'y retrouvais. Je suis donc parvenu au "bout". J'étais assez content, un peu comme lorsque l'on a terminé l'escalade d'un sommet pyrénéen, qu'il faisait chaud et que le chemin n'était pas toujours clairement indiqué. Mais ça allait bien au delà. Car comme en montagne, le panorama final s'avérait surprenant, riche, un 360° d'une vision enrichie du monde. Je ne détaillerai pas toutes les pistes ouvertes, les sympathies partagées ( comme Mathias ( pardon comme Franz!), par exemple, j'aime Mahler et grince avec le Vague Nerf!).
Toutes ces digressions...moi ça me va! Roman ou pas, franchement je m'en contrefous!
Dans un monde de lecteurs si friands de "lectures de gare", je ne vais pas me plaindre de trouver en Boussole une sacrée locomotive lourd d'un charbon parfois étouffant mais si copieux à m'emporter dans de fameux voyages dans l'espace et dans le temps.
Toutes ces digressions...moi ça me va! Roman ou pas, franchement je m'en contrefous!
Dans un monde de lecteurs si friands de "lectures de gare", je ne vais pas me plaindre de trouver en Boussole une sacrée locomotive lourd d'un charbon parfois étouffant mais si copieux à m'emporter dans de fameux voyages dans l'espace et dans le temps.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Mathias Enard (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Arts et littérature ...
Quelle romancière publie "Les Hauts de Hurle-vent" en 1847 ?
Charlotte Brontë
Anne Brontë
Emily Brontë
16 questions
1104 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, art
, musique
, peinture
, cinemaCréer un quiz sur ce livre1104 lecteurs ont répondu