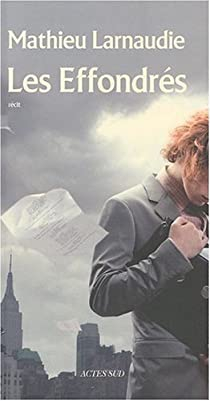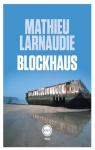Mathieu Larnaudie/5
9 notes
Résumé :
Ils occupent, dans le monde de l'argent, du business ou de la politique, des places dominantes lorsque survient à l'automne 2008 ce violent séisme qu'on appellera : crise. Aussitôt certains vacillent, s'effondrent, passent aux aveux, disparaissent ou se suicident, tandis que d'autres, au sommet des Etats, font rempart de leurs discours, explications, plans de sauvetage, remèdes en tout genre. Qu'ont-ils en commun ?
- D'avoir contemplé l'inimaginable. Car, quo... >Voir plus
- D'avoir contemplé l'inimaginable. Car, quo... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les EffondrésVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Subtil "making of" littéraire de l'effondrement des acteurs de la crise dite "des subprimes"...
Publié en 2010, le cinquième ouvrage de Mathieu Larnaudie prend la forme d'une revue enjouée de l'effondrement économique, mais surtout idéologique, d'un monde, celui du capitalisme libéral des années 1978-2008, dans la tourmente de la crise des subprimes - mais aussi d'une chronique de la réaction obstinée de ses thuriféraires pour nier la réalité.
Si le propos est similaire, la forme diffère profondément de celle du - également - très jouissif travail en alexandrins de l'économiste Frédéric Lordon ("D'un retournement l'autre. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrins", 2011). Mathieu Larnaudie met en scène une terrible galerie de personnages, certains anonymes, d'autres au contraire très connus, et emblématiques, sans toutefois jamais les nommer. Ainsi, au fil des pages, nous assistons aux réactions (abattement, déni, rage, dépression, suicide ou encore impavidité) d'Alan Greenspan (confronté à la commission d'enquête du Congrès sur la crise), de Nicolas Sarkozy (avec ses impressionnantes volte-faces garanties sans sens ajouté), de Marcel Ospel (mis au ban de la "bonne société" suisse pour sa gestion d'UBS), de Richard Madoff, bien entendu, ultime bouc émissaire du système (qui prétend qu'il suffit de "chasser les méchants" pour retrouver tous les illusoires bénéfices de l'égoïsme de la fable des fourmis), et de ses rabatteurs Robert Jaffe ou Thierry Magon de la Villehuchet, ou encore du milliardaire allemand (partiellement ruiné, et allant cacher sa misère relative et sa honte sur les rails d'une ligne de chemin de fer) Adolf Merckle, du patron déchu de Lehman Brothers, le flamboyant Richard S. Fuld, Jr., ou encore, comme une ombre, du carnassier Édouard Stern avant sa tragique sortie de faits divers,...
La longue phrase de Mathieu Larnaudie, parfois difficile à digérer sans reprendre plusieurs fois son souffle, réussit un petit miracle : tout au long de ces portraits en situation, le lecteur aura l'impression d'être à la fois DANS le film (par l'abondance de détails visuels) et DANS le commentaire du DVD, en voix off (par la subtile intrication des commentaires, ajouts, bonus et remarques in petto).
"... un établissement financier et d'assurances belgo-néerlandais qui, avant même que l'ensemble du secteur bancaire n'eût véritablement commencé d'imploser (avant que le séisme ne fut déclaré et identifié, accepté comme tel), avait eu le privilège de préfigurer le chambardement général, d'annoncer, à la manière de ces brusques et ponctuelles variations du champ magnétique local ou de ces légères déformations de la surface du sol qui constituent les signes avant-coureurs du tremblement de terre qui vient, la grande convulsion, de compter parmi les premières sociétés à se déclarer au bord de la faillite, et dont l'État s'était, dès lors, empressé d'empêcher le naufrage, inaugurant ainsi la kyrielle des interventions (la distribution, comme à la criée, de ces enveloppes garnies destinées à garantir la survie - pour éviter la catastrophe, disaient-ils - des entreprises dont tout montrait pourtant que leurs modes de gestion, leurs pratiques - autrement dit, là encore, là comme ailleurs, le réseau des croyances sur lesquelles elles s'étaient, cette gestion et ces pratiques, basées, par quoi elles avaient été induites - étaient les véritables causes de leurs déboires, et qu'une certaine logique (celle du désinvestissement de l'État des affaires privées, péremptoirement prônée par l'école de Chicago, ses maîtres, ses papes, ses évangélistes, ses exécutants, ses ministres, ses petites frappes et ses bras armés, disséminés comme des missionnaires partout dans le monde là où existait ne serait-ce qu'un embryon de marché - c'est-à-dire, précisément, leur propre logique) eût dû conduire à les laisser se débrouiller seules, par leurs propres moyens, s'embourber et déposer le bilan dans leur coin,..."
Un tour de force parfois ardu mais nettement indispensable, tout particulièrement alors que le déni, en 2011-2012, a repris du poil de la bête.
Publié en 2010, le cinquième ouvrage de Mathieu Larnaudie prend la forme d'une revue enjouée de l'effondrement économique, mais surtout idéologique, d'un monde, celui du capitalisme libéral des années 1978-2008, dans la tourmente de la crise des subprimes - mais aussi d'une chronique de la réaction obstinée de ses thuriféraires pour nier la réalité.
Si le propos est similaire, la forme diffère profondément de celle du - également - très jouissif travail en alexandrins de l'économiste Frédéric Lordon ("D'un retournement l'autre. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrins", 2011). Mathieu Larnaudie met en scène une terrible galerie de personnages, certains anonymes, d'autres au contraire très connus, et emblématiques, sans toutefois jamais les nommer. Ainsi, au fil des pages, nous assistons aux réactions (abattement, déni, rage, dépression, suicide ou encore impavidité) d'Alan Greenspan (confronté à la commission d'enquête du Congrès sur la crise), de Nicolas Sarkozy (avec ses impressionnantes volte-faces garanties sans sens ajouté), de Marcel Ospel (mis au ban de la "bonne société" suisse pour sa gestion d'UBS), de Richard Madoff, bien entendu, ultime bouc émissaire du système (qui prétend qu'il suffit de "chasser les méchants" pour retrouver tous les illusoires bénéfices de l'égoïsme de la fable des fourmis), et de ses rabatteurs Robert Jaffe ou Thierry Magon de la Villehuchet, ou encore du milliardaire allemand (partiellement ruiné, et allant cacher sa misère relative et sa honte sur les rails d'une ligne de chemin de fer) Adolf Merckle, du patron déchu de Lehman Brothers, le flamboyant Richard S. Fuld, Jr., ou encore, comme une ombre, du carnassier Édouard Stern avant sa tragique sortie de faits divers,...
La longue phrase de Mathieu Larnaudie, parfois difficile à digérer sans reprendre plusieurs fois son souffle, réussit un petit miracle : tout au long de ces portraits en situation, le lecteur aura l'impression d'être à la fois DANS le film (par l'abondance de détails visuels) et DANS le commentaire du DVD, en voix off (par la subtile intrication des commentaires, ajouts, bonus et remarques in petto).
"... un établissement financier et d'assurances belgo-néerlandais qui, avant même que l'ensemble du secteur bancaire n'eût véritablement commencé d'imploser (avant que le séisme ne fut déclaré et identifié, accepté comme tel), avait eu le privilège de préfigurer le chambardement général, d'annoncer, à la manière de ces brusques et ponctuelles variations du champ magnétique local ou de ces légères déformations de la surface du sol qui constituent les signes avant-coureurs du tremblement de terre qui vient, la grande convulsion, de compter parmi les premières sociétés à se déclarer au bord de la faillite, et dont l'État s'était, dès lors, empressé d'empêcher le naufrage, inaugurant ainsi la kyrielle des interventions (la distribution, comme à la criée, de ces enveloppes garnies destinées à garantir la survie - pour éviter la catastrophe, disaient-ils - des entreprises dont tout montrait pourtant que leurs modes de gestion, leurs pratiques - autrement dit, là encore, là comme ailleurs, le réseau des croyances sur lesquelles elles s'étaient, cette gestion et ces pratiques, basées, par quoi elles avaient été induites - étaient les véritables causes de leurs déboires, et qu'une certaine logique (celle du désinvestissement de l'État des affaires privées, péremptoirement prônée par l'école de Chicago, ses maîtres, ses papes, ses évangélistes, ses exécutants, ses ministres, ses petites frappes et ses bras armés, disséminés comme des missionnaires partout dans le monde là où existait ne serait-ce qu'un embryon de marché - c'est-à-dire, précisément, leur propre logique) eût dû conduire à les laisser se débrouiller seules, par leurs propres moyens, s'embourber et déposer le bilan dans leur coin,..."
Un tour de force parfois ardu mais nettement indispensable, tout particulièrement alors que le déni, en 2011-2012, a repris du poil de la bête.
Les effondrés sont les divers acteurs ayant participé, d'une quelconque manière, à l'effondrement économique de 2008. Faute de connaissances précises, j'ai bien du mal à distinguer ces acteurs, à l'exception de la banque Lehman Brothers, de Sarkozy ou Merkel. Mais qu'importe, ce n'est pas la vérité historique qui compte mais la manière dont ces individus et entités collectives ont réagi, ont vécu ce krach.
Cela commence avec une description sommaire mais déjà représentative de ce petit milieu : aux toilettes, un homme est effondré car une mauvaise action (profitons-en pour jouer un peu sur les mots) lui a fait perdre son emploi, son argent, ainsi que celui de son client. Son voisin de cabinet s'en moque éperdument dans cet environnement merdique où seuls les plus performants parviennent à surnager. Après cette première entrée, l'échec, le mensonge, le désarroi gagnent par capillarité toutes les couches économiques, jusqu'aux sommets d'états. Certains, autrefois adulés, ont à rendre ces comptes devant les juges, d'autres se suicident, d'autres enfin proposent des mesures qui ne seront jamais appliquées afin que cela ne se reproduise pas.
Pas de tendresse, pas de sympathie ni même de pitié pour ces individus qui ont joué avec le feu et avec les autres. Seulement le (les) récit(s) d'un désastre, d'ambitions trop grandes, de risques immatures et d'une confiance aveugle en un système qui (comme tout système) contient sa propre perte – alors expérimentée.
L'écriture est exigeante pour le lecteur : une à cinq phrases par chapitres, lesquels font environ 5 à 10 pages. Cette écriture-fleuve impose une attention qui n'admet pas le rejet facile de la situation, car ici on ne trouvera pas d'idée préfabriquée et démagogique. Non que l'auteur (ou ses narrateurs) ne fasse pas entendre sa voix, son jugement, dans une sorte de dédain marqué pour ces hommes qui ont contribué à la chute économique, mais parce qu'on ne peut se laisser bercer par ses certitudes et ses critiques devenues courantes lorsqu'on lit cet ouvrage. L'écriture-fleuve se distingue par ses périphrases : Lehman Brothers ne sera jamais mentionnée, mais seulement identifiable à travers une rétrospective qui a vu la petite entreprise des deux frères se hisser aux sommets. de même pour les acteurs, reconnaissables à leur histoire particulière, à leur surnom, à leurs tics, à leur position sociale. Ces périphrases permettent aussi de ne pas s'endormir dans l'identification et la critique facile : c'était Lehamn Brothers, cela aurait pu être une autre, toute petite boite devenue grande à force d'ambition, d'exigence, de coups de pouce et de poker. Cela aurait pu être n'importe quel homme, devenu grand par son travail et sa volonté et qui, alors qu'il est au sommet, perd tout ce qui l'a érigé en homme influent. Les périphrases permettent donc de ne pas se laisser aller à accuser des individus, mais un système qui les a créés.
On pense même que l'écriture procède d'un débordement, d'un excès dans la représentation : mots complexes, constructions volontairement labyrinthiques qui gênent et repoussent le lecteur. Excès de mots, de richesse textuelle qui donne la nausée et place le lecteur dans une situation de rejet (de qui ? de quoi ?). La même technique et le même rythme présentent les biographies de ces acteurs et leur désarroi final, leur incompréhension, comme pour affirmer le lien entre l'ascension et la déchéance, comme une suite logique dans le destin extraordinaire de ces personnes/ages.
Ce roman à clés ne donnera pas de réponses à qui voudrait comprendre la crise, ni même à qui voudrait savoir ce qu'ont vécu ces acteurs, mais donne une vision circonstanciée de la crise et de la façon dont elle fut perçue à une époque donnée.
Cela commence avec une description sommaire mais déjà représentative de ce petit milieu : aux toilettes, un homme est effondré car une mauvaise action (profitons-en pour jouer un peu sur les mots) lui a fait perdre son emploi, son argent, ainsi que celui de son client. Son voisin de cabinet s'en moque éperdument dans cet environnement merdique où seuls les plus performants parviennent à surnager. Après cette première entrée, l'échec, le mensonge, le désarroi gagnent par capillarité toutes les couches économiques, jusqu'aux sommets d'états. Certains, autrefois adulés, ont à rendre ces comptes devant les juges, d'autres se suicident, d'autres enfin proposent des mesures qui ne seront jamais appliquées afin que cela ne se reproduise pas.
Pas de tendresse, pas de sympathie ni même de pitié pour ces individus qui ont joué avec le feu et avec les autres. Seulement le (les) récit(s) d'un désastre, d'ambitions trop grandes, de risques immatures et d'une confiance aveugle en un système qui (comme tout système) contient sa propre perte – alors expérimentée.
L'écriture est exigeante pour le lecteur : une à cinq phrases par chapitres, lesquels font environ 5 à 10 pages. Cette écriture-fleuve impose une attention qui n'admet pas le rejet facile de la situation, car ici on ne trouvera pas d'idée préfabriquée et démagogique. Non que l'auteur (ou ses narrateurs) ne fasse pas entendre sa voix, son jugement, dans une sorte de dédain marqué pour ces hommes qui ont contribué à la chute économique, mais parce qu'on ne peut se laisser bercer par ses certitudes et ses critiques devenues courantes lorsqu'on lit cet ouvrage. L'écriture-fleuve se distingue par ses périphrases : Lehman Brothers ne sera jamais mentionnée, mais seulement identifiable à travers une rétrospective qui a vu la petite entreprise des deux frères se hisser aux sommets. de même pour les acteurs, reconnaissables à leur histoire particulière, à leur surnom, à leurs tics, à leur position sociale. Ces périphrases permettent aussi de ne pas s'endormir dans l'identification et la critique facile : c'était Lehamn Brothers, cela aurait pu être une autre, toute petite boite devenue grande à force d'ambition, d'exigence, de coups de pouce et de poker. Cela aurait pu être n'importe quel homme, devenu grand par son travail et sa volonté et qui, alors qu'il est au sommet, perd tout ce qui l'a érigé en homme influent. Les périphrases permettent donc de ne pas se laisser aller à accuser des individus, mais un système qui les a créés.
On pense même que l'écriture procède d'un débordement, d'un excès dans la représentation : mots complexes, constructions volontairement labyrinthiques qui gênent et repoussent le lecteur. Excès de mots, de richesse textuelle qui donne la nausée et place le lecteur dans une situation de rejet (de qui ? de quoi ?). La même technique et le même rythme présentent les biographies de ces acteurs et leur désarroi final, leur incompréhension, comme pour affirmer le lien entre l'ascension et la déchéance, comme une suite logique dans le destin extraordinaire de ces personnes/ages.
Ce roman à clés ne donnera pas de réponses à qui voudrait comprendre la crise, ni même à qui voudrait savoir ce qu'ont vécu ces acteurs, mais donne une vision circonstanciée de la crise et de la façon dont elle fut perçue à une époque donnée.
Sous forme de chapitres courts aux phrases très longues, « Les effondrés » dresse le portrait de protagonistes clés de la crise économique de 2008, jamais nommés, et de l'abîme dans lequel cette crise les a plongé, eux qui tombent de très haut. Il y a les très connus, Alan Greenspan, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Bernard Madoff, et d'autres moins connus, avec en fil rouge la confession d'un milliardaire, qui, contemplant sa fortune qui s'envole en fumée devant les eaux calmes du lac Léman, revient pour la première fois sur la trajectoire de sa vie.
Lire « Les effondrés » sur un coin de table, d'un oeil distrait ? N'y songez pas. Ce livre requiert toute votre concentration pour entrer dans le rythme de ces phrases fleuves à arborescences multiples, qui agissent comme autant de double-fonds, de commentaires ironiques et d'explorations du spectacle qui se joue sous nos yeux.
La récompense est à la hauteur de l'effort, c'est un texte somptueux, envoûtant qui donne, loin de l'agitation de l'actualité, une ampleur mythologique et fascinante à l'effondrement idéologique du dogme libéral révélé par cette crise, au destin de ses protagonistes qui semblent non pas frénétiquement agités mais pensifs, en état de sidération devant la trajectoire de leur propre chute ; un texte qui met en exergue leurs dénégations devant l'écroulement de cette idéologie (excepté pour Greenspan lors de son audition devant le Congrès, scène fondatrice qui m'a vraiment fait entrer dans le livre), qui souligne le rejet de la responsabilité sur une clique de voyous symbolisé par le plus grand escroc de cette bande, Madoff, dissimulant ainsi qu'on assiste ici non pas au naufrage du Titanic mais au « naufrage de l'idée même de navigation ».
Il est très difficile d'extraire une citation de ce texte, je retiens celui-ci de la scène avec Greenspan évoquée plus haut…
« et à l'homme de cire qui lui demanda, brutalement, avec une feinte candeur qui en d'autres époques l'aurait fait passer pour un illuminé irresponsable ou pour un adolescent rebelle, un peu turbulent et provocateur, s'il convenait de ce que sa vision du monde, son idéologie, n'était "pas la bonne", ne fonctionnait pas, on entendit le maître répondre – et sans doute furent-ils, à l'instant précis où ces mots franchirent ses lèvres, nombreux ceux dont le sang se glaça, nombreux ceux qui guettèrent autour d'eux, sur d'autres visages, les réactions les assurant qu'ils n'avaient pas été victimes d'un problème acoustique, que la scène pour ainsi dire surréaliste ,impensable à laquelle ils assistaient avait bel et bien lieu – que, oui, absolument, il s'était rendu compte que pendant quarante ans il avait appliqué une idéologie et que celle-ci avait échoué, qu'il avait constaté "une faille dans l'idéologie capitaliste", dont il ne savait pas à quel point elle était significative ou durable, mais qui l'avait plongé dans un profond désarroi. »
Un livre magnifique.
Lire « Les effondrés » sur un coin de table, d'un oeil distrait ? N'y songez pas. Ce livre requiert toute votre concentration pour entrer dans le rythme de ces phrases fleuves à arborescences multiples, qui agissent comme autant de double-fonds, de commentaires ironiques et d'explorations du spectacle qui se joue sous nos yeux.
La récompense est à la hauteur de l'effort, c'est un texte somptueux, envoûtant qui donne, loin de l'agitation de l'actualité, une ampleur mythologique et fascinante à l'effondrement idéologique du dogme libéral révélé par cette crise, au destin de ses protagonistes qui semblent non pas frénétiquement agités mais pensifs, en état de sidération devant la trajectoire de leur propre chute ; un texte qui met en exergue leurs dénégations devant l'écroulement de cette idéologie (excepté pour Greenspan lors de son audition devant le Congrès, scène fondatrice qui m'a vraiment fait entrer dans le livre), qui souligne le rejet de la responsabilité sur une clique de voyous symbolisé par le plus grand escroc de cette bande, Madoff, dissimulant ainsi qu'on assiste ici non pas au naufrage du Titanic mais au « naufrage de l'idée même de navigation ».
Il est très difficile d'extraire une citation de ce texte, je retiens celui-ci de la scène avec Greenspan évoquée plus haut…
« et à l'homme de cire qui lui demanda, brutalement, avec une feinte candeur qui en d'autres époques l'aurait fait passer pour un illuminé irresponsable ou pour un adolescent rebelle, un peu turbulent et provocateur, s'il convenait de ce que sa vision du monde, son idéologie, n'était "pas la bonne", ne fonctionnait pas, on entendit le maître répondre – et sans doute furent-ils, à l'instant précis où ces mots franchirent ses lèvres, nombreux ceux dont le sang se glaça, nombreux ceux qui guettèrent autour d'eux, sur d'autres visages, les réactions les assurant qu'ils n'avaient pas été victimes d'un problème acoustique, que la scène pour ainsi dire surréaliste ,impensable à laquelle ils assistaient avait bel et bien lieu – que, oui, absolument, il s'était rendu compte que pendant quarante ans il avait appliqué une idéologie et que celle-ci avait échoué, qu'il avait constaté "une faille dans l'idéologie capitaliste", dont il ne savait pas à quel point elle était significative ou durable, mais qui l'avait plongé dans un profond désarroi. »
Un livre magnifique.
Voici une fiction comme on en lit peu dans la littérature contemporaine actuelle.Ce roman est un petit chef d'oeuvre parce qu'il fait acte d'une écriture exigeante (vraiment sublime dans sa dimension d'entremêlement et de longueur surprenante des phrases) tout en étant un récit haletant et dérangeant qui est très bien "senti" dans son approche du capitalisme à travers différentes descriptions, tant émotives que linguistiques : sentiments ambivalents, postures hypocrites, actions extrêmes, consciences figées, jargon du milieu alambiqué, bref... l'auteur donne à lire une série de portraits de grands financiers et riches de ce monde qui, lors du crash de 2008, se retrouvent à penser et à agir en désespoir de cause, c'est-à-dire acculés au mur ( sans doute virtuel de Wall Street si bien décrit par Bartleby lui-même quand ce mur existait encore) et, dans un dernier acte - pour certains - exposent leur corps à la mort d'une manière assez particulière. Pour d'autres, politiciens de notre système corrompu, ils s'accommodent de la situation pour s'enfoncer encore plus dans les petits arrangements "entre amis"... vous savez, ceux de l'entente cordiale !
Un roman qui est une belle leçon d'écriture, de pensée et l'oeuvre réelle d'un écrivain qui en est un.
À LIRE ABSOLUMENT (Ed Actes Sud en format poche "Babel").
Un roman qui est une belle leçon d'écriture, de pensée et l'oeuvre réelle d'un écrivain qui en est un.
À LIRE ABSOLUMENT (Ed Actes Sud en format poche "Babel").
Des portraits successifs des acteurs de la crise de 2008 comme un soulèvement impérieux vers les hautes sphères de la finance et qui retombe un matin comme un soufflé sorti du four.
Le mouvement tourbillonnant de ces élites s'assimile à ce phrasé infini caractéristique de Mathieu Larnaudie. Les phrases nous enveloppent, nous emportent et par petits chaos successifs se déploient à longueur de pages pour s'interrompre presque uniquement à la fin du chapitre, sur une note conclusive acérée.
Ils ont envahi nos écrans et nos magazines et se sont dissous pour réapparaître parfois dans notre actualité, ces magnats de la finance et de la politique qui tiennent le monde entre leurs mains et qu'ils manipulent comme un simple jouet.
"Nous ne sommes pas dupes!" Voilà le message de cet écrivain qui bouscule son lecteur et l'oblige à tout regarder bien en face.
Le mouvement tourbillonnant de ces élites s'assimile à ce phrasé infini caractéristique de Mathieu Larnaudie. Les phrases nous enveloppent, nous emportent et par petits chaos successifs se déploient à longueur de pages pour s'interrompre presque uniquement à la fin du chapitre, sur une note conclusive acérée.
Ils ont envahi nos écrans et nos magazines et se sont dissous pour réapparaître parfois dans notre actualité, ces magnats de la finance et de la politique qui tiennent le monde entre leurs mains et qu'ils manipulent comme un simple jouet.
"Nous ne sommes pas dupes!" Voilà le message de cet écrivain qui bouscule son lecteur et l'oblige à tout regarder bien en face.
Citations et extraits (5)
Ajouter une citation
Et puis un jour, alors même que, depuis plusieurs décennies déjà, la chute de ce que l’on avait désigné sous le nom de bloc communiste, autrement dit de la seule opposition prétendue au modèle dont ils étaient les garants, de la seule alternative possible ou, en tout cas, de ce que l’on avait fait passer pour telle (parce qu’il faut bien – de cela certains penseurs d’alors avaient entériné l’idée – un ennemi pour justifier un état de guerre, quand bien même non déclarée, quand bien même dite froide) le temps d’un règne lapidaire, manqué, destructeur (ils dirent : barbare), soixante-dix années à peine au cours desquelles (comme si, depuis le début ou presque, il n’avait été, ce règne, que la macabre répétition du processus de son deuil amorcé) toutes les promesses dont la révolution qui l’avait institué s’était réclamée avaient été une à une, inéluctablement, annihilées par la révélation pathétique de leur inadéquation à l’existence concrète des hommes et de leurs communautés ; alors que cette chute, donc, avait précipité l’avènement de l’ordre qui était le leur, qui était celui de leur camp, de leur manière de façonner le monde, nécessairement bonne parce que seule conforme à ce qu’ils appelaient la réalité et qui était, ainsi, devenu le signe de leur victoire, du couronnement final de cet ordre désormais invincible et unique ; alors que, dans le même temps, ceux-là qui avaient mené cette guerre et avaient triomphé avaient décrété que le démantèlement définitif de leur adversaire, cette fois, en mettant à bas le péril majeur qui les avait menacés, en vainquant les principaux motifs de fourvoiement des esprits, en ravalant désormais au titre de péripéties nécessaires les obscurs soubresauts venant, comme de simples rappels du hasard et du chaos dont nous sommes tous issus, secouer, le temps d’une discorde vite résorbée, le cours ordinaire du monde immuablement apaisé, avait marqué la fin de toute guerre qui vaille, de tout conflit d’importance ayant pouvoir de se hisser à la hauteur de ce grand récit maintenant passé, relégué, frappé d’obsolescence, qu’ils continueraient d’appeler l’Histoire, et que pour cette raison même leur ordre serait, à jamais, le nôtre et celui de tous, et que ne pas le reconnaître comme un état de fait, comme la marche indépassable et naturelle (indépassable parce que naturelle) des choses ne pourrait plus relever que de la nostalgie morbide, incorrigible, portée vers le lyrisme absurde et déraisonnable d’utopies sanguinaires heureusement enfoncées ; alors que les triomphateurs, ceux qui menaient cet ordre (ce système, avaient-ils pris coutume de le nommer, c’est-à-dire ce fonctionnement autonomisé, libre, qui était le Bien même, puisqu’il avait surpassé – survécu à – toutes les négations qui s’étaient dressées contre lui, qu’il avait su de lui-même, selon sa force et sa vertu propres, abattre tout ce qui prétendait en différer) et se plaisaient, dès lors, à se revendiquer en tant qu’héritiers directs et zélés d’autres vainqueurs, leurs semblables, leur famille spirituelle pensaient-ils (aimaient-ils à penser), des hommes et des femmes nombreux, plus ou moins illustres, plus ou moins discernables, dont les costumes et les robes, les mines sévères, hilares ou graves, photographiés sur le parvis de palaces, de grands hôtels particuliers ou de châteaux, dans les huis clos solennels de bureaux armoriés, détachés sur des fonds ornés d’or, de volutes peintes ou de motifs tapissés, de bannières diversement colorées ou étoilées, de logos designés, signifiaient aux yeux de leur descendance élective l’auguste privilège des lois économiques insubmersibles et des raisons d’Etat qui les coordonnent et les autorisent, qui érigés en panthéon diffus habitaient les mémoires, les nôtres aussi bien, les triomphateurs reconnaissants, donc, se félicitaient de concert d’avoir su échapper à (débarrasser la planète de) ce fléau nommé “idéologie” (ainsi avaient-ils désormais pris l’habitude d’appeler leur ennemi, ce mirage évaporé, disaient-ils, ce véhicule de tous les dangers, de toutes les folies), se louaient d’avoir été face à l’idéologie les bras armés du réel, d’avoir accompli et pour ainsi dire refermé l’Histoire, de l’avoir portée à son point d’aboutissement et, partant, de perfection, d’avoir permis l’advenue de toutes les fins et de se faire les gardiens de cet achèvement ; alors même, enfin, que ces temps bénis d’après les vicissitudes du temps s’étaient ouverts devant eux, devant nous, conditions inaltérables du seul monde futur possible, soudain, tout s’est effondré : tout ce en quoi ils avaient fait profession de croire, ou plutôt dont ils avaient fait profession d’exploiter, de justifier et de propager partout, au travers du monde unifié par elle et par ses effets, la croyance tandis qu’eux-mêmes, probablement, de cette croyance, profondément, n’avaient cure, réduite au simple culte d’une déité magnanime et sans exigences sacrificielles, sans loi ni revendications, qu’ils appelaient tour à tour la confiance ou le marché, tout occupés qu’ils étaient, plutôt qu’à croire, à tirer les dividendes de cette étrange foi devenue injonction, devenue horizon providentiel, et non qu’elle fût, cette croyance, à leurs yeux et dans l’usage qu’ils en faisaient bonne uniquement pour les autres, et pareille en cela à un appât lancé à la meute indistincte du peuple, un simple os à ronger, ou un leurre modelé pour faire diversion pendant qu’ils se réservaient l’apanage de diriger la marche effective des choses, pendant qu’ils s’enrichissaient, non plus qu’elle ne fût pas, en tant que seule efficace, par eux parfaitement partagée, intériorisée, vécue intégralement dans leur âme et conscience, mais bien plutôt qu’elle les libérât précisément du souci d’en rendre compte et de l’interroger, d’en discuter les raisons, les fondements, les us et les principes, et que dès lors leur cynisme ne résidât plus que dans cette acceptation inconditionnelle, absolue et favorable à leurs bénéfices ; toute la prospère et inaltérable stabilité sur laquelle ils avaient compté parce qu’ils n’avaient seulement pas envisagé qu’elle pût n’être pas indéfectible ; tout ce qui avait structuré leur bonne foi et ses logiques impérieuses, autrement dit sa magie, ses mots d’ordre bien connus, répétés à longueur de discours, collant à l’air du temps, aux flux ininterrompus des capitaux et des marchandises (puis des capitaux, sans même qu’il y eût plus besoin de quelconques marchandises pour en supporter ni en légitimer la circulation), au langage qui les colportent et les renforcent, articulations incantatoires et obligées de toute parole publique réputée respectable (ils disaient : réaliste), le profit, le libre-échange, l’investissement, le crédit, la croissance, des mots comme des sésames, des talismans, irréfutables, rhétorique une et incontestable s’imposant, par son autorité douce, par sa sempiternelle, obsessionnelle reprise, comme base et critère de la validité de tout propos ; toute cette scolastique de l’inéluctable (ils disaient : de la modernisation), cette invocation de l’accroissement du capital par tous les moyens disponibles, le dogme qui les accompagnait et les inconséquences qui les soutenaient ; tout ce qui avait fonctionné, ou semblé fonctionner par la grâce d’un acte de foi continu, sans cesse renouvelé, sur la seule force motrice d’un sentiment diffus, de la crédulité, de la très sainte confiance comme d’un pari, et qui avait œuvré à son mouvement plan, régulier, universel, son mouvement sans mouvements, à son déploiement globalisé, partout identique, tout ce qui s’était instauré pour faire définitivement monde dans le temps laissé vacant par la synthèse achevée des convulsions et des luttes, tout cela avait volé en éclats, sous la puissance de son propre délitement et de la brusque proclamation panique de son inanité première avait implosé : la fin de l’Histoire était finie, et l’on vit une main, portant à l’annulaire une alliance en or, au poignet une montre de fabrication suisse, se poser sur un miroir pour en balayer la pellicule opaque déposée par la condensation, au-dessus des lavabos, dans les chiottes du London Stock Exchange, et y faire apparaître une face blafarde, à la fois pouponne et défaite, juvénile et déconfite, aux joues rondes, au menton pendant, aux pommettes gonflées, aux orbites enfoncées dans une crevasse profonde, sombre, forée par la peur, l’état d’alarme et la fatigue, et qui, de se rencontrer soudainement dans ce reflet, interdite, de se voir ainsi, se fixait elle-même avec une insistance désarmée ; l’on vit au même instant, à quelques rues de là seulement, au quatorzième étage d’un building de la City, regardant défiler, s’intervertir, se corriger les colonnes de chiffres actualisées en temps réel, se digitaliser les fluctuations des valeurs sur lesquelles il avait décidé, parce que sa compétence l’y inclinait, parce que l’analyse technique qu’il avait menée, parce que les renseignements dont il disposait, parce que son intime conviction l’y incitaient, de porter la part du fonds d’investissement dont sa profession consistait à garantir le rendement, puis se renversant en arrière sur son fauteuil pour jeter un œil sur le grand cadre lumineux de la télévision, appliqué contre un mur de son bureau – entre une porte capitonnée et le pan d’une lourde bibliothèque de bois sombre supportant les trophées et les médailles glanés dans diverses compétitions sportives, la photographie des rangs, étagés sur trois niveaux pyramidaux, de la promotion d’une grande école anglaise, le portrait d’une femme, celui d’un enfant, et un choix restreint d’ouvrages juridiques, d’actualité et de référence – et branché sur Bloomberg, pour y voir se confirmer les tendances dont il constatait les effets sur son poste, pour vérifier, donc, d’un plan numérique à l’autre, la concordance des informations, par elles la seule validation possible de la réalité, un jeune homme vêtu d’un pantalon de flanelle grise et d’une chemise pâle,
Il fallait, autrement dit, un bouc émissaire, ne serait-ce que pour accréditer l’idée – ou devrait-on dire la thèse, entonnée par le tribun à talonnettes reconverti en moraliste de pupitre et par ses semblables désemparés (comme si cette pauvre, simplette rhétorique de gendarme suivant quoi le monde (la société) se partagerait entre ivraie et bon grain, racailles et citoyens méritants, eût été la seule dont ils disposaient pour interpréter un phénomène, quel qu’il soit), selon laquelle ce qu’ils appelaient la « crise » ne résidait pas tant en un bouleversement systémique dû à un dévoilement criminel d’un bien commun provoqué par des comportements irresponsables, imbéciles et délictueux, par les agissements illicites et les instincts pervers de quelques individus sans morale ni vergogne, et n’était donc pas un problème politique ni même économique mais bien le fait d’une clique de voyous, de délinquants à la moralité impropre, débile, déviante, et qu’il suffisait effectivement de trancher dans le vif du corps social vicié, de l’assainir, le nettoyer, d’en extirper les mauvais sujets, de les exclure et de les punir, les mettre hors d’état de nuire (de les exposer, surtout, au vu et au su de la communauté) pour que les choses s’apaisent et se normalisent (ils disaient : que l’on retrouve la confiance), pour que la main invisible du marché pût reprendre ses bonnes œuvres autorégulatrices et par essence prospères (ils disaient : que la reprise soit là), pour qu’impunément le processus reparte, renoue avec soi-même, à l’identique ou presque, qu’il ravale ses hoquets, s’accommode et intègre ses contradictions vite surpassées...
ainsi, tandis qu'ils avaient cru - comme comme si ce qui modèle les sociétés n'était pas l'oeuvre humaine, n'était pas le corpus des options, des actes, des décisions prises par une communauté, comme si quelque chose comme ce qu'on appelle a politique n'existait donc pas - que la concorde supposée, l'harmonie entre leur ordre et le mouvement incorruptible et éternel de l'univers ( leur ordre étant seul propice à s'accorder à l'univers), c'est-à-dire l'efficacité du système, résidait dans la conviction inattaquable que cet ordre était une émanation de la nature même, et que celle-ci l'avait disposé, qu'il lui était immanent, ils découvrirent que ce qu'ils avaient pris pour une règle spontanée, une naturalité économique - réalisant l'alliance entre le cheminement vertueux sur la voie du bien commun et l'inéluctable férocité qui caractérise les lois de l'évolution en quoi consiste, pour eux, l'idée de nature - n'était finalement que l'une des versions possibles et très imparfaite, et vulnérable, des grandes orientations ou modalités qui impulsent et agencent une civilisation. (p.19)
(...) et se drapant dès lors, dans l'affliction de circonstances qui eussent été l'affirmation rétrospective et paradoxale de leur pouvoir, se donnant le beau rôle dans cette dramaturgie quand ils auraient dû, au contraire, sous la poussée de l'évidence comme d'une fièvre, sous la contrainte acérée des faits, reconnaître la parfaite inanité interchangeable, révocable de leur position, la vacuité de leur mystique bizarre, et qu'aucun d'entre eux ne pourrait plus se targuer d'avoir eu sa part de volonté, sa capacité d'affirmation dans un jeu qui leur avait échappé (..) (p.18)
Ils disaient : c’est un monde qui vient de s’écrouler.
Videos de Mathieu Larnaudie (30)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans le cadre des 18es Rencontres de Chaminadour : Mathieu Larnaudie sur les grands chemins de Dante.
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Mathieu Larnaudie (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Histoire et généralités sur la Normandie
TOUS CONNAISSENT LA TAPISSERIE DE BAYEUX, QUI EN EST LE HÉROS ?
RICHARD COEUR DE LION
ROLLON
MATHILDE
GUILLAUME LE CONQUERANT
GUILLAUME LE ROUX
20 questions
70 lecteurs ont répondu
Thèmes :
histoire
, célébrité
, économieCréer un quiz sur ce livre70 lecteurs ont répondu