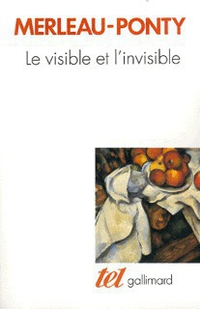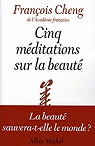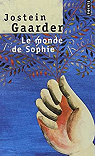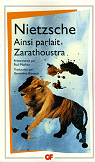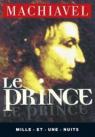Maurice Merleau-Ponty
Claude Lefort (Éditeur scientifique)/5 25 notes
Claude Lefort (Éditeur scientifique)/5 25 notes
Résumé :
Le présent visible n'est pas dans le temps et l'espace, ni, bien entendu, hors d'eux - il n'y a rien avant lui, après lui, autour de lui, qui puisse rivaliser avec sa visibilité. Et pourtant, il n'est pas seul, il n'est pas tout. Exactement : il bouche ma vue, c'est-à-dire, à la fois, que le temps et l'espace s'étendent au-delà, et qu'ils sont derrière lui, en profondeur, en cachette. Le visible ne peut ainsi me remplir et m'occuper que parce que, moi qui le vois, j... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le visible et l'invisible, suivi de Notes de travailVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
La merveilleuse écriture de Merleau-Ponty pose les conclusions de sa pensée dans ce texte qui se voulait une introduction à son grand oeuvre, humblement intitulé "L'origine de la Vérité".
Nous n'aurions pas été déçu d'apprendre quelle était cette origine. Il reste ce texte introductif qui résume la pensée du philosophe et sur laquelle devait se projeter une nouvelle progression. Il s'aborde donc plus simplement que la Phénoménologie de la Perception.
Il faut abandonner le vocabulaire et les concepts de la philosophie classique tel que conscience, sujet, objet, réalité en soi, essence, Idée, etc. Ces notions ne permettent jamais de comprendre en quoi ce que je vois est une réalité semblable à ce que perçoit autrui, elles opposent les subjectivités qui prétendent chacune constituer le monde à sa manière, faisant disparaître la réalité sous le couvert d'une illusion idéalisée en esprit.
Au contraire, il faut se considérer comme un néant qui se nie et la réalité comme ce qui est, ce qui remplit le vide de l'individu. Cette conception est-elle juste dans l'absolu ? Car in fine, il reste toujours quelque chose qui pense en moi, qui voit, qui décide : je ne suis donc pas néant, je ne suis pas "rien". Mais inverser les données de la philosophie qui voyait le plein dans la pensée et le vide dans le monde, permet d'expliquer en quoi cette réalité pleine que je vois est la même que celle qu'autrui voit. Bien sûr, nous la voyons chacun à notre manière, mais la source est la même, et elle n'a plus rien de mystérieux comme l'essence de Kant ou l'Idée platonicienne. La réalité n'est que ce que je vois et rien d'autre.
Cette conception de l'existence autorise alors que nous comprenions comment l'intersubjectivité s'organise, comment nous pouvons ensemble, ignorants que nous sommes, puits au fond desquels un peu de sédiments de connaissance seulement s'est déposés, dépasser nos connaissance et les projeter dans la recherche d'une compréhension mutuelle, donc plus affinée, plus subtile de ce qu'est la réalité, l'être, la pensée et toute chose. Concevoir l'être comme un plein et l'individu comme un néant est la condition qui nous autorise à envisager de vivre ensemble.
Cette idée d'un néant qui inexiste peut sembler étrange, surtout dans la France de Charles de Gaulle où la réalité et les connaissances se constituent en bloc, mais elle donne à comprendre 60 ans plus tard la manière dont notre époque fonctionne, ce que nous appelons avec évidence le "second degré".
La pensée de Merleau-Ponty était sans doute à l'avant-garde dans les année 50, elle semble actuelle aujourd'hui : se serait-elle généralisée ? Ce texte nous ouvre quoi qu'il en soit des perspectives de compréhension de notre époque.
Nous n'aurions pas été déçu d'apprendre quelle était cette origine. Il reste ce texte introductif qui résume la pensée du philosophe et sur laquelle devait se projeter une nouvelle progression. Il s'aborde donc plus simplement que la Phénoménologie de la Perception.
Il faut abandonner le vocabulaire et les concepts de la philosophie classique tel que conscience, sujet, objet, réalité en soi, essence, Idée, etc. Ces notions ne permettent jamais de comprendre en quoi ce que je vois est une réalité semblable à ce que perçoit autrui, elles opposent les subjectivités qui prétendent chacune constituer le monde à sa manière, faisant disparaître la réalité sous le couvert d'une illusion idéalisée en esprit.
Au contraire, il faut se considérer comme un néant qui se nie et la réalité comme ce qui est, ce qui remplit le vide de l'individu. Cette conception est-elle juste dans l'absolu ? Car in fine, il reste toujours quelque chose qui pense en moi, qui voit, qui décide : je ne suis donc pas néant, je ne suis pas "rien". Mais inverser les données de la philosophie qui voyait le plein dans la pensée et le vide dans le monde, permet d'expliquer en quoi cette réalité pleine que je vois est la même que celle qu'autrui voit. Bien sûr, nous la voyons chacun à notre manière, mais la source est la même, et elle n'a plus rien de mystérieux comme l'essence de Kant ou l'Idée platonicienne. La réalité n'est que ce que je vois et rien d'autre.
Cette conception de l'existence autorise alors que nous comprenions comment l'intersubjectivité s'organise, comment nous pouvons ensemble, ignorants que nous sommes, puits au fond desquels un peu de sédiments de connaissance seulement s'est déposés, dépasser nos connaissance et les projeter dans la recherche d'une compréhension mutuelle, donc plus affinée, plus subtile de ce qu'est la réalité, l'être, la pensée et toute chose. Concevoir l'être comme un plein et l'individu comme un néant est la condition qui nous autorise à envisager de vivre ensemble.
Cette idée d'un néant qui inexiste peut sembler étrange, surtout dans la France de Charles de Gaulle où la réalité et les connaissances se constituent en bloc, mais elle donne à comprendre 60 ans plus tard la manière dont notre époque fonctionne, ce que nous appelons avec évidence le "second degré".
La pensée de Merleau-Ponty était sans doute à l'avant-garde dans les année 50, elle semble actuelle aujourd'hui : se serait-elle généralisée ? Ce texte nous ouvre quoi qu'il en soit des perspectives de compréhension de notre époque.
Citations et extraits (43)
Voir plus
Ajouter une citation
Déjà notre existence de voyants, c'est-à-dire, avons-nous dit, d'êtres qui retournent le monde sur lui-même et qui passent de l'autre côté, et qui s'entrevoient, qui voient par les yeux l'un de l'autre, et surtout notre existence d'êtres sonores pour les autres et pour eux-mêmes, contiennent tout ce qui est requis pour qu'il y ait de l'un à l'autre parole, parole sur le monde.
Avec la première vision, le premier contact, le premier plaisir, il y a initiation, c'est-à-dire, non pas position d'un contenu, mais ouverture d'une dimension qui ne pourra plus être refermée, établissement d'un niveau par rapport auquel désormais toute autre expérience sera repérée. L'idée est ce niveau, cette dimension, non pas donc un invisible de fait, comme un objet caché derrière un autre, et non pas un invisible absolu, qui n'aurait rien à faire avec le visible, mais l'invisible de ce monde, celui qui l'habite, le soutient et le rend visible, sa possibilité intérieure et propre, l’Être de cet étant.
Wesen (verbal) – Wesen de l'histoire
Février 1959
Découverte du Wesen (verbal) : première expression de l'être qui
n'est ni l'être-objet ni l'être-sujet, ni essence ni existence : ce qui west
(l’être-rose de la rose, l'être-société de la société, l'être-histoire de
l'histoire) répond à la question was comme à la question dass, ce n'est
pas la société, la rose vue par un sujet, ce n'est pas un être pour soi de
la société et de la rose (contrairement à ce que dit Ruyer) : c'est la
roséité s'étendant tout à travers la rose, c'est ce que Bergson appelait
assez mal les « images » – Que par ailleurs cette roséité donne lieu à
une « idée générale » c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs roses, une espèce
rose, cela n'est pas indifférent, mais cela résulte de l'être-rose considéré
dans toutes ses implications (générativité naturelle) – Par là, – en
retranchant toute généralité de la définition première du Wesen – on
supprime cette opposition du fait et de l'essence qui fausse tout -
L'être société d'une société : ce tout qui rassemble toutes les vues et
les volontés claires ou aveugles aux prises en elle, ce tout anonyme qui
à travers elles hinauswollt, cet Ineinander que personne ne voit, et qui
n'est pas non plus âme du groupe, ni objet, ni sujet, mais leur tissu
conjonctif, qui west puisqu'il y aura un résultat et qui est la seule
satisfaction que l'on puisse donner légitimement à une « philosophie à
plusieurs entrées » (car l'argument contre la pensée alternative de
Sartre, qui est qu'elle ne fait pas un monde, qu'elle n'admet pas une
Weltlichkeit du Geist, qu'elle en reste à l'esprit subjectif, rie doit pas
servir à justifier une philosophie où tous les Ego seraient sur le même
plan, et qui, elle, ignorerait purement et simplement le problème
d'autrui, et ne peut se, réaliser que comme Philosophie du Sujet Absolu)
Le Wesen de la table ≠ un être en soi, où les éléments se
disposeraient :A un être pour soi, une Synopsis ≠ ce qui en elle
« tablifie », ce qui fait que la table est table.
Février 1959
Découverte du Wesen (verbal) : première expression de l'être qui
n'est ni l'être-objet ni l'être-sujet, ni essence ni existence : ce qui west
(l’être-rose de la rose, l'être-société de la société, l'être-histoire de
l'histoire) répond à la question was comme à la question dass, ce n'est
pas la société, la rose vue par un sujet, ce n'est pas un être pour soi de
la société et de la rose (contrairement à ce que dit Ruyer) : c'est la
roséité s'étendant tout à travers la rose, c'est ce que Bergson appelait
assez mal les « images » – Que par ailleurs cette roséité donne lieu à
une « idée générale » c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs roses, une espèce
rose, cela n'est pas indifférent, mais cela résulte de l'être-rose considéré
dans toutes ses implications (générativité naturelle) – Par là, – en
retranchant toute généralité de la définition première du Wesen – on
supprime cette opposition du fait et de l'essence qui fausse tout -
L'être société d'une société : ce tout qui rassemble toutes les vues et
les volontés claires ou aveugles aux prises en elle, ce tout anonyme qui
à travers elles hinauswollt, cet Ineinander que personne ne voit, et qui
n'est pas non plus âme du groupe, ni objet, ni sujet, mais leur tissu
conjonctif, qui west puisqu'il y aura un résultat et qui est la seule
satisfaction que l'on puisse donner légitimement à une « philosophie à
plusieurs entrées » (car l'argument contre la pensée alternative de
Sartre, qui est qu'elle ne fait pas un monde, qu'elle n'admet pas une
Weltlichkeit du Geist, qu'elle en reste à l'esprit subjectif, rie doit pas
servir à justifier une philosophie où tous les Ego seraient sur le même
plan, et qui, elle, ignorerait purement et simplement le problème
d'autrui, et ne peut se, réaliser que comme Philosophie du Sujet Absolu)
Le Wesen de la table ≠ un être en soi, où les éléments se
disposeraient :A un être pour soi, une Synopsis ≠ ce qui en elle
« tablifie », ce qui fait que la table est table.
On dira donc qu'avant la réflexion, et pour la rendre possible,
il faut une fréquentation naïve du monde, et que le Soi auquel on revient
est précédé par un Soi aliéné ou en ek-stase dans l'Être. Le monde, les
choses, ce qui est, est, dira-t-on, de soi, sans commune mesure avec nos
« pensées ». Si nous cherchons ce que veut dire pour nous « la chose »,
nous trouvons qu'elle est ce qui repose en soi-même, qu'elle est
exactement ce qu'elle est, tout en acte, sans aucune virtualité ni
puissance, qu'elle est par définition « transcendante », dehors,
absolument étrangère à toute intériorité. Si elle vient d'être perçue par
quelqu'un, et en particulier par moi, cela n'est pas constitutif de son sens
de chose, qui est au contraire d'être là dans l'indifférence, dans la nuit
de l'identité, comme en-soi pur.
Si je dois
être en ek-stase dans le monde et les choses, il faut que rien ne me
retienne en moi-même loin d'elles, aucune « représentation », aucune
« pensée », aucune « image », et pas même cette qualification de
« sujet », d’« esprit » ou d’« Ego », par laquelle le philosophe veut me
distinguer absolument des choses, mais qui devient trompeuse à son
tour puisque, comme toute désignation, elle finit par retomber au
positif, par réintroduire en moi un fantôme de réalité et par me faire
croire que je suis res cogitans, – une chose très particulière,
insaisissable, invisible, Mais chose tout de même. La seule manière
d'assurer mon accès aux choses mêmes serait de purifier tout à fait ma
notion de la subjectivité : il n'y a pas même de « subjectivité » ou
d'« Ego », la conscience est sans « habitant », il faut que je la dégage
tout à fait des aperceptions secondes qui font d'elle l'envers d'un corps,
la propriété d'un « psychisme », et que je la découvre comme le
« rien », le « vide », qui est capable de la plénitude du monde ou plutôt
qui en a besoin pour porter son inanité.
il faut une fréquentation naïve du monde, et que le Soi auquel on revient
est précédé par un Soi aliéné ou en ek-stase dans l'Être. Le monde, les
choses, ce qui est, est, dira-t-on, de soi, sans commune mesure avec nos
« pensées ». Si nous cherchons ce que veut dire pour nous « la chose »,
nous trouvons qu'elle est ce qui repose en soi-même, qu'elle est
exactement ce qu'elle est, tout en acte, sans aucune virtualité ni
puissance, qu'elle est par définition « transcendante », dehors,
absolument étrangère à toute intériorité. Si elle vient d'être perçue par
quelqu'un, et en particulier par moi, cela n'est pas constitutif de son sens
de chose, qui est au contraire d'être là dans l'indifférence, dans la nuit
de l'identité, comme en-soi pur.
Si je dois
être en ek-stase dans le monde et les choses, il faut que rien ne me
retienne en moi-même loin d'elles, aucune « représentation », aucune
« pensée », aucune « image », et pas même cette qualification de
« sujet », d’« esprit » ou d’« Ego », par laquelle le philosophe veut me
distinguer absolument des choses, mais qui devient trompeuse à son
tour puisque, comme toute désignation, elle finit par retomber au
positif, par réintroduire en moi un fantôme de réalité et par me faire
croire que je suis res cogitans, – une chose très particulière,
insaisissable, invisible, Mais chose tout de même. La seule manière
d'assurer mon accès aux choses mêmes serait de purifier tout à fait ma
notion de la subjectivité : il n'y a pas même de « subjectivité » ou
d'« Ego », la conscience est sans « habitant », il faut que je la dégage
tout à fait des aperceptions secondes qui font d'elle l'envers d'un corps,
la propriété d'un « psychisme », et que je la découvre comme le
« rien », le « vide », qui est capable de la plénitude du monde ou plutôt
qui en a besoin pour porter son inanité.
Il ne faut même pas dire, comme nous le
faisions tout à l'heure, que le corps est fait de deux feuillets, dont l'un,
celui du « sensible », est solidaire du reste du monde ; il n'y a pas en lui
deux feuillets ou deux couches, il n'est fondamentalement ni chose vue
seulement, ni voyant seulement, il est la Visibilité tantôt errante et
tantôt rassemblée, et, a ce titre, il n'est pas dans le monde, il ne détient
pas, comme dans une enceinte privée, sa vue du monde : il voit le
monde même, le monde de tous, et sans avoir à sortir de « soi », parce
qu'il n'est tout entier, parce que ses Mains, ses yeux, ne sont rien d'autre,
que cette référence d'un visible, d'un tangible-étalon à tous ceux dont il
porte la ressemblance, et dont il recueille le témoignage, par une magie
qui est la vision, le toucher mêmes.
faisions tout à l'heure, que le corps est fait de deux feuillets, dont l'un,
celui du « sensible », est solidaire du reste du monde ; il n'y a pas en lui
deux feuillets ou deux couches, il n'est fondamentalement ni chose vue
seulement, ni voyant seulement, il est la Visibilité tantôt errante et
tantôt rassemblée, et, a ce titre, il n'est pas dans le monde, il ne détient
pas, comme dans une enceinte privée, sa vue du monde : il voit le
monde même, le monde de tous, et sans avoir à sortir de « soi », parce
qu'il n'est tout entier, parce que ses Mains, ses yeux, ne sont rien d'autre,
que cette référence d'un visible, d'un tangible-étalon à tous ceux dont il
porte la ressemblance, et dont il recueille le témoignage, par une magie
qui est la vision, le toucher mêmes.
Lire un extrait
Videos de Maurice Merleau-Ponty (23)
Voir plusAjouter une vidéo
Fanny Arama
Camille Froidevaux-Metterie
Najat Vallaud-Belkacem
Kaori Ito
La façon dont une culture traite le corps – en particulier le corps des femmes – dit une profonde vérité sur cette culture. le corps est en effet une construction : il prend forme au cours de notre vie et en fonction de nos relations, il est modelé par nos choix, mais également forgé par les institutions, leurs diktats et leurs requêtes. Les sciences humaines et la philosophie ont mis en évidence cette construction sociale du corps – cette « incorporation » : le corps est façonné, comme l'a montré Foucault, par une kyrielle de dispositifs disciplinaires qui en font une « chair » à racheter, une force de travail à employer, un organisme à soigner, mais aussi, dirait Merleau-Ponty, le véhicule de notre advenir au monde que l'être au monde nous oblige à ajouter sans cesse. Mais le corps n'est jamais neutre : il est déterminé entre autres par des facteurs de race et de genre. Réfléchir sur le corps construit implique donc qu'on analyse la manière dont il est construit, qu'on voie quels corps sont construits, selon quels différentiels, et qu'on mette au jour les effets qui produisent les inégalités de pouvoir entre les hommes et femmes. Dans une telle construction sociale, l'empreinte machiste a été déterminante: aussi le corps féminin a-t-il été façonné selon les désirs des hommes. Quelle vérité sur le corps des femmes – maternité, menstruations, ménopause, apparence, sexualité… – apparaîtrait si, dans une perspective féministe, on déconstruisait cet ensemble iconique et idéologique dans lequel l'homme a trouvé les outils de sa domination, sinon les justifications de sa violence symbolique et réelle exercée sur les corps des femmes ?
+ Lire la suite
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Maurice Merleau-Ponty (34)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
440 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre440 lecteurs ont répondu