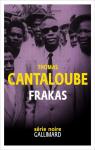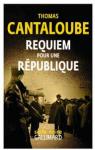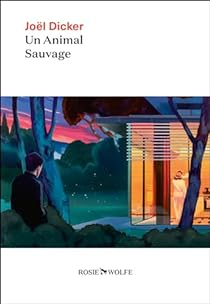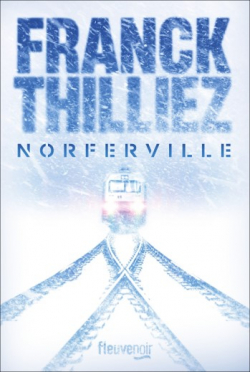Frédéric Paulin/5
175 notes
Résumé :
" Les habitants de Gênes ont fui ou se terrent chez eux. La ville est déserte et l'état de siège a été proclamé. "
Un grand roman noir sur les coulisses du sommet altermondialiste de Gênes en marge du G8, et comment les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont soldés par la mort de Carlo Giuliani, abattu d'une balle en pleine tête par un carabinier.
Gênes, juillet 2001.
Les chefs d'État des huit pays les plus riches de la ... >Voir plus
Un grand roman noir sur les coulisses du sommet altermondialiste de Gênes en marge du G8, et comment les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre se sont soldés par la mort de Carlo Giuliani, abattu d'une balle en pleine tête par un carabinier.
Gênes, juillet 2001.
Les chefs d'État des huit pays les plus riches de la ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La nuit tombée sur nos âmesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (41)
Voir plus
Ajouter une critique
Rentrée littéraire #25
Superbe titre crépusculaire pour nous plonger en plein sommet du G8, à Gênes, 2001, au coeur des manifestations altermondialistes qui ont rassemblée près de 500 .000 personnes, et de la répression policière qui s'y est abattu avec une rare violence.
Une nouvelle fois, son récit permet d'éclairer le présent en expliquant le passé. Les manifestations anti-G8 ont posé les jalons des luttes actuelles, notamment environnementales, même si en 2001, les luttes étaient plus politiques et sociales. Surtout, vingt ans après, les plaies ne sont pas refermées, bien qu'en 2015 l'Italie ait été condamné par la cour européenne des Droits de l'Hommes pour n'avoir jamais cherché à identifier et poursuivre en justice les auteurs des violences policières ( autre thématique au coeur de l'actualité ).
Frédéric Paulin y était, au contre-sommet du G8. Et il a décidé de faire quelque chose de ce traumatisme, de ses souvenirs mais avec la même rigueur que celle déployée pour sa formidable trilogie Benlazar sur la naissance du terrorisme islamiste mondialisé. Il maitrise parfaitement le procédé consistant à mettre en scène des personnages ( fictifs ou pas ) évoluant dans des différentes strates ( des politiques, des policiers, des manifestants ) pour proposer une radiographie précise et complète des quatre journées du 19 au 22 juillet qu'il a choisies de raconter.
Même si on sent très fortement ses affinités, son roman ne tombe pas le manichéisme grâce aux regards croisés de personnages de son casting qui fonctionne par binôme : le couple de manifestants, un proche du NPA et une anarchiste ( pas celui qui m'a le plus accroché, duo un peu artificiellement construit mais qui permet d'évoquer les dissensions au sein de l'ultra-gauche ), deux flics français infiltrés, une journaliste et son photographe qui couvrent le sommet, un conseiller en comm' de Jacques Chirac dépassé par les événements et son alter ego italien fasciste revendiqué au service de Berlusconi.
Une fois le casting présenté et installé, le récit va à cent à l'heure et happe en alternant les points de vue. Frédéric Paulin a l'art de nous immerger au coeur de l'action, que ce soit dans les coulisses des stratégies politique et policière, ou en pleine manifestation hors de la zone rouge. On sent toute l'urgence de la situation dans la vivacité des dialogues directement intégrés au texte, comme dans un flot de passions qui déferlent sur le lecteur. Et c'est passionnant de voir comment les black blocs ont confirmé leur puissance à Gênes, après être apparus en 1991 lors de manifestations contre la première guerre du Golfe puis en 1999 lors du contre-sommet de l'OMC à Séville. Quant à l'épisode terrible de la répression sanglante à l'école Diaz ou celui de la mort de Carlo Giuliani tué par un projectile tiré par un carabinier, ils glacent d'effroi tant il fait écho aux spasmes de l'actualité récente.
Un auteur vraiment important dans ce qu'il dit du monde actuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille vivement de découvrir le premier tome de la trilogie Benlazar, La Guerre est une ruse.
Superbe titre crépusculaire pour nous plonger en plein sommet du G8, à Gênes, 2001, au coeur des manifestations altermondialistes qui ont rassemblée près de 500 .000 personnes, et de la répression policière qui s'y est abattu avec une rare violence.
Une nouvelle fois, son récit permet d'éclairer le présent en expliquant le passé. Les manifestations anti-G8 ont posé les jalons des luttes actuelles, notamment environnementales, même si en 2001, les luttes étaient plus politiques et sociales. Surtout, vingt ans après, les plaies ne sont pas refermées, bien qu'en 2015 l'Italie ait été condamné par la cour européenne des Droits de l'Hommes pour n'avoir jamais cherché à identifier et poursuivre en justice les auteurs des violences policières ( autre thématique au coeur de l'actualité ).
Frédéric Paulin y était, au contre-sommet du G8. Et il a décidé de faire quelque chose de ce traumatisme, de ses souvenirs mais avec la même rigueur que celle déployée pour sa formidable trilogie Benlazar sur la naissance du terrorisme islamiste mondialisé. Il maitrise parfaitement le procédé consistant à mettre en scène des personnages ( fictifs ou pas ) évoluant dans des différentes strates ( des politiques, des policiers, des manifestants ) pour proposer une radiographie précise et complète des quatre journées du 19 au 22 juillet qu'il a choisies de raconter.
Même si on sent très fortement ses affinités, son roman ne tombe pas le manichéisme grâce aux regards croisés de personnages de son casting qui fonctionne par binôme : le couple de manifestants, un proche du NPA et une anarchiste ( pas celui qui m'a le plus accroché, duo un peu artificiellement construit mais qui permet d'évoquer les dissensions au sein de l'ultra-gauche ), deux flics français infiltrés, une journaliste et son photographe qui couvrent le sommet, un conseiller en comm' de Jacques Chirac dépassé par les événements et son alter ego italien fasciste revendiqué au service de Berlusconi.
Une fois le casting présenté et installé, le récit va à cent à l'heure et happe en alternant les points de vue. Frédéric Paulin a l'art de nous immerger au coeur de l'action, que ce soit dans les coulisses des stratégies politique et policière, ou en pleine manifestation hors de la zone rouge. On sent toute l'urgence de la situation dans la vivacité des dialogues directement intégrés au texte, comme dans un flot de passions qui déferlent sur le lecteur. Et c'est passionnant de voir comment les black blocs ont confirmé leur puissance à Gênes, après être apparus en 1991 lors de manifestations contre la première guerre du Golfe puis en 1999 lors du contre-sommet de l'OMC à Séville. Quant à l'épisode terrible de la répression sanglante à l'école Diaz ou celui de la mort de Carlo Giuliani tué par un projectile tiré par un carabinier, ils glacent d'effroi tant il fait écho aux spasmes de l'actualité récente.
Un auteur vraiment important dans ce qu'il dit du monde actuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, je conseille vivement de découvrir le premier tome de la trilogie Benlazar, La Guerre est une ruse.
Le crépuscule de nos espoirs.
Gênes 2001. le sommet du G8 s'annonce mouvementé. le mouvement altermondialiste est à son acmé, et les puissants en ont assez de se faire contester.
La tâche de clore cette plaisanterie sera confiée au plus ridicule chef d'état de l'époque, Silvio Berlusconi, qui ne boude pas son plaisir pervers de transformer "la Superbe" en poudrière.
À l'abri des odeurs de souffre derrière les ors du palais ducal, les puissants peuvent continuer de parlementer et de singer la solidarité.
Bien sûr il y aura de beaux discours, à l'exemple du président français de l'époque, Jacques Chirac, personnage croquignolesque s'il en est de ce roman. Ses belles idées battent autant d'air que ses grands bras, alors que dans les faits le peuple étouffe au sens propre comme au figuré. Les manifestants qui n'arrivent plus à respirer à travers la nuée lacrymogène lancée sur la ville, seront pourtant les plus chanceux. La répression se voulait sanguinaire. Elle sera sanglante.
Les chiens sont lâchés. Une horde d'hommes surarmés, caparaçonnés et lobotomisés aux idéaux fascistes a carte blanche pour "se venger" d'une "fange" prolétaire qui viendrait menacer le pouvoir de leurs maîtres.
Grâce à des personnages parfaitement incarnés implantés aux quatre coins du sommet international et de sa contestation, Frédéric Paulin parvient de façon magistrale à nous faire vivre un des moments clés de la scène politique et de l'engagement de ce siècle.
Si vous n'avez jamais vécu de manifestation, violente qui plus est, vous devez lire ce livre. Si vous n'avez rien compris aux Gilets Jaunes aussi, car on y retrouve les mêmes procédés de manipulation de l'opinion, notamment au niveau médiatique.
La nuit est tombée sur beaucoup d'âmes à Gênes, dont celle sans trop m'avancer de Frédéric Paulin qui était présent.
Elle est tombée aussi sur le corps d'un étudiant de 23 ans ce soir-là, Carlo Giuliani. Ne l'oublions pas.
Gênes 2001. le sommet du G8 s'annonce mouvementé. le mouvement altermondialiste est à son acmé, et les puissants en ont assez de se faire contester.
La tâche de clore cette plaisanterie sera confiée au plus ridicule chef d'état de l'époque, Silvio Berlusconi, qui ne boude pas son plaisir pervers de transformer "la Superbe" en poudrière.
À l'abri des odeurs de souffre derrière les ors du palais ducal, les puissants peuvent continuer de parlementer et de singer la solidarité.
Bien sûr il y aura de beaux discours, à l'exemple du président français de l'époque, Jacques Chirac, personnage croquignolesque s'il en est de ce roman. Ses belles idées battent autant d'air que ses grands bras, alors que dans les faits le peuple étouffe au sens propre comme au figuré. Les manifestants qui n'arrivent plus à respirer à travers la nuée lacrymogène lancée sur la ville, seront pourtant les plus chanceux. La répression se voulait sanguinaire. Elle sera sanglante.
Les chiens sont lâchés. Une horde d'hommes surarmés, caparaçonnés et lobotomisés aux idéaux fascistes a carte blanche pour "se venger" d'une "fange" prolétaire qui viendrait menacer le pouvoir de leurs maîtres.
Grâce à des personnages parfaitement incarnés implantés aux quatre coins du sommet international et de sa contestation, Frédéric Paulin parvient de façon magistrale à nous faire vivre un des moments clés de la scène politique et de l'engagement de ce siècle.
Si vous n'avez jamais vécu de manifestation, violente qui plus est, vous devez lire ce livre. Si vous n'avez rien compris aux Gilets Jaunes aussi, car on y retrouve les mêmes procédés de manipulation de l'opinion, notamment au niveau médiatique.
La nuit est tombée sur beaucoup d'âmes à Gênes, dont celle sans trop m'avancer de Frédéric Paulin qui était présent.
Elle est tombée aussi sur le corps d'un étudiant de 23 ans ce soir-là, Carlo Giuliani. Ne l'oublions pas.
« Les habitants de Gênes ont fui ou se terrent chez eux. La ville est déserte et l'état de siège a été proclamé. » Ainsi commence ce récit choral qui relate, durant le G8 à Gênes en 2001, l'affrontement des manifestants avec les forces de l'ordre. C'était il y a déjà 20 ans, j'étais trop jeune pour me rappeler les tenants et aboutissants de ces événements. Généralement, quand on se plaint que la police « ose » riposter contre les casseurs qui, eux, brisent tout et blessent tout le monde sans état d'âme, ça m'énerve profondément. Pourtant, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, la violence d'où qu'elle vienne engendre la violence jusqu'à, parfois, ne plus pouvoir être maîtrisée. C'est ce qui s'est produit en ce juillet 2001 à Gênes, dans un climat que nous avons connu récemment avec les gilets jaunes. Sauf que j'ignorais que cela avait fini si mal, ainsi que le contexte particulier qui a conduit à cette issue.
Frédéric PAULIN nous fait assister à la montée en puissance des idéologies contestataires : les non-violents, puis ceux qui utilisent la violence symbolique (les tuniques blanches), et les véritables casseurs (le black bloc). Dans le même temps, on assiste aussi à la propagande de peur lancée par le gouvernement italien de Berlusconi pour, d'une part, justifier l'état de siège et l'interdiction de la zone politique aux manifestants (ce qui les motive encore plus car ils trouvent inadmissible d'être interdits de manifester à l'endroit où se déroule le sommet proprement dit) et, d'autre part, justifier l'utilisation de la force répressive pour endiguer la violence quand elle se déploiera. « Leur idée, c'est de pénétrer dans la zone rouge. Ca, le Gouvernement ne le permettra pas ». En effet, tout le monde est persuadé que les casseurs veulent mettre la ville à feu et à sang. Si l'instrumentalisation des médias fonctionne si bien, c'est que les manifestations du précédent sommet politique, à Göteborg, ont marqué les esprits :
« Des chevaux fous de peur lancés au galop sur une foule brandissant des drapeaux rouges et noirs. Des incendies, des commerces ravagés, des chaussées dépavées, une ville dans la chaos. Un vent de colère et le refus qui souffle depuis loin, très loin, remontant sans doute le fleuve Göta älv pour se déverser dans les rues. le Gouvernement a envoyé la police en armure et la gendarmerie montée. Des véhicules blindés foncent sur les avenues, écartant les émeutiers comme le patriarche ouvrit la mer. Mais cette mer d'hommes et de femmes vociférant, projetant des pavés et des bouteilles sur la soldatesque, se referme aussitôt après leur passage. »
Les manifestants ont dépassé les bornes de la violence au sommet précédent, l'Italie de Berlusconi compte s'en servir pour affirmer sa puissance. Frédéric PAULIN nous fait alors infiltrer les coulisses des manigances entre Conseillers politiques, les enquêtes journalistiques au coeur de l'action à la recherche du scoop, ou encore la vie paranoïaque des manifestant qui se savent infiltré par les flics, les balances et même deux agents de la DST qui n'ont rien à faire là et n'avaient pas du tout envie d'aller risquer leur vie pour satisfaire une demande politico-politique… Mais les manipulations sont telles que nous nous retrouvons bientôt tous pris au piège de l'Histoire. « La situation devient ubuesque : des flics, une journaliste, un traître et une pure et dure vont tranquillement se balader au milieu du black bloc ». Les forces de l'ordre ne veulent pas vraiment en venir aux mains, mais les discours alarmistes de la hiérarchie, qui leur a ordonné d'être prêtes à répliquer à mort si nécessaire, les échauffent « Si on essaye de vous tuer, je vous ordonne de répliquer oeil pour oeil, gronde le commandant ».
Les manifestants, quant à eux, n'ont pas toujours l'air d'avoir choisi la voie de la protestation par intime conviction mais plutôt par dépit, à force de ne pas réussir à percer les milieux intellectuels sans piston et se persuadant que tout cela est la faute des « petits bourgeois ». A les entendre, eux seraient des saints : « On veut qu'ils sachent que la violence, on ne fait que la retourner contre les flics et l'Etat qui l'utilisent bien avant nous ». Sauf que cette manif ne fait pas exception : ce sont d'abord les manifestants, qui se sentent si libres et si forts après avoir pété des pare-brises et des boutiques, qui agressent gravement les forces de l'ordre dans leurs véhicules. Celles-ci ne font que répliquer au départ - à la grande surprise des manifestants qui ne comprennent pas qu'on s'en prenne à eux en retour ! A ce moment de l'histoire, les écouter raisonner ne donne vraiment pas envie de les plaindre ni de les soutenir. J'ai apprécié ça : que l'auteur ne me force pas à me faire apprécier ou plaindre les manifestants plus que les autres parties en présence.
D'ailleurs les journalistes qui les suivent et les connaissent ne sont pas dupes : « Gênes pour eux, c'est un grand terrain de jeu où il faut casser le plus de vitrines, faire cramer le plus de bagnoles et, bien sûr, échapper à la police ; rien d'autre », « qu'importe la couleur du flacon pourvu qu'ils aient l'adrénaline » parce que (ça c'est moi qui le rajoute) c'est quand même plus facile de détruire ce que les autres sont parvenus à construire dans leur vie de de se construire une vie à soi. « Si j'appartiens au black bloc, c'est parce que le monde dans lequel je vis est monotone et effrayant. Essayer de le détruire est une jouissance ». Et c'est tellement facile, quand nos polices ont l'ordre de répliquer le moins possible.
Pourtant ici, plus le roman avance, plus on se rend compte que le climat délétère instauré par le gouvernement néo-fasciste, et notamment les ordres et discours aux polices ont portés leurs fruits : « ici, à Gênes, les flics n'ont pas l'air prêts à respecter les règles ». Car finalement c'est bien ce dont il est question : la facilité avec laquelle l'histoire peut se répéter et dégénérer si rapidement, avant que les garde-fous ne se mettent en action. Sur fond de fascisme et de guerre civile, Frédéric PAULIN fait monter la tension jusqu'au point de non-retour, jusqu'à ce que La Nuit tombe sur nos âmes… On regarde ces scènes de guerre où tout le monde a peur, et l'on voudrait que les casseurs en profitent quand même pour comprendre que : « cette terreur, c'est celle qui saisit lorsque l'Etat n'assure plus la sécurité de ses citoyens ». Mais le temps n'est pas encore à la réflexion : aux yeux du monde, et surtout des dirigeants italiens, la violence des manifestants vient simplement de donner une bonne raison aux autorités de se défendre, de riposter, et de frapper plus fort encore. Et une fois les chiens lâchés, qui peut les arrêter ? Quand l'ampleur du désastre apparaît enfin, il est trop tard ; il ne sera plus temps que des sanctions et des procès, des jugements européens.
Si, du fait de ce papillonnage d'un univers à l'autre, je ne suis pas parvenue sur le moment à entrer réellement dans l'un quelconque des personnages et à m'identifier ni à m'attacher à l'un d'eux, l'auteur parvient en 250 pages à reproduire une assez bonne vue d'ensemble de l'ambiance et de chaque partie en présence. On en retient que le danger vient de l'extrémisme en lui-même, de quel que bord qu'il soit (Etat ou citoyen). J'ai pensé au départ que nous faire entrer davantage dans les motivations et convictions profondes des uns et des autres aurait gagné en profondeur. Mais nul besoin en réalité : c'est la fin qui donne le dernier coup de massue, et m'a achevée. C'est encore elle qui donne sa profondeur et sa raison d'être au roman. Une oeuvre importante car réaliste et toujours d'actualité. Menée tambour battant, mais rondement menée.
Frédéric PAULIN nous fait assister à la montée en puissance des idéologies contestataires : les non-violents, puis ceux qui utilisent la violence symbolique (les tuniques blanches), et les véritables casseurs (le black bloc). Dans le même temps, on assiste aussi à la propagande de peur lancée par le gouvernement italien de Berlusconi pour, d'une part, justifier l'état de siège et l'interdiction de la zone politique aux manifestants (ce qui les motive encore plus car ils trouvent inadmissible d'être interdits de manifester à l'endroit où se déroule le sommet proprement dit) et, d'autre part, justifier l'utilisation de la force répressive pour endiguer la violence quand elle se déploiera. « Leur idée, c'est de pénétrer dans la zone rouge. Ca, le Gouvernement ne le permettra pas ». En effet, tout le monde est persuadé que les casseurs veulent mettre la ville à feu et à sang. Si l'instrumentalisation des médias fonctionne si bien, c'est que les manifestations du précédent sommet politique, à Göteborg, ont marqué les esprits :
« Des chevaux fous de peur lancés au galop sur une foule brandissant des drapeaux rouges et noirs. Des incendies, des commerces ravagés, des chaussées dépavées, une ville dans la chaos. Un vent de colère et le refus qui souffle depuis loin, très loin, remontant sans doute le fleuve Göta älv pour se déverser dans les rues. le Gouvernement a envoyé la police en armure et la gendarmerie montée. Des véhicules blindés foncent sur les avenues, écartant les émeutiers comme le patriarche ouvrit la mer. Mais cette mer d'hommes et de femmes vociférant, projetant des pavés et des bouteilles sur la soldatesque, se referme aussitôt après leur passage. »
Les manifestants ont dépassé les bornes de la violence au sommet précédent, l'Italie de Berlusconi compte s'en servir pour affirmer sa puissance. Frédéric PAULIN nous fait alors infiltrer les coulisses des manigances entre Conseillers politiques, les enquêtes journalistiques au coeur de l'action à la recherche du scoop, ou encore la vie paranoïaque des manifestant qui se savent infiltré par les flics, les balances et même deux agents de la DST qui n'ont rien à faire là et n'avaient pas du tout envie d'aller risquer leur vie pour satisfaire une demande politico-politique… Mais les manipulations sont telles que nous nous retrouvons bientôt tous pris au piège de l'Histoire. « La situation devient ubuesque : des flics, une journaliste, un traître et une pure et dure vont tranquillement se balader au milieu du black bloc ». Les forces de l'ordre ne veulent pas vraiment en venir aux mains, mais les discours alarmistes de la hiérarchie, qui leur a ordonné d'être prêtes à répliquer à mort si nécessaire, les échauffent « Si on essaye de vous tuer, je vous ordonne de répliquer oeil pour oeil, gronde le commandant ».
Les manifestants, quant à eux, n'ont pas toujours l'air d'avoir choisi la voie de la protestation par intime conviction mais plutôt par dépit, à force de ne pas réussir à percer les milieux intellectuels sans piston et se persuadant que tout cela est la faute des « petits bourgeois ». A les entendre, eux seraient des saints : « On veut qu'ils sachent que la violence, on ne fait que la retourner contre les flics et l'Etat qui l'utilisent bien avant nous ». Sauf que cette manif ne fait pas exception : ce sont d'abord les manifestants, qui se sentent si libres et si forts après avoir pété des pare-brises et des boutiques, qui agressent gravement les forces de l'ordre dans leurs véhicules. Celles-ci ne font que répliquer au départ - à la grande surprise des manifestants qui ne comprennent pas qu'on s'en prenne à eux en retour ! A ce moment de l'histoire, les écouter raisonner ne donne vraiment pas envie de les plaindre ni de les soutenir. J'ai apprécié ça : que l'auteur ne me force pas à me faire apprécier ou plaindre les manifestants plus que les autres parties en présence.
D'ailleurs les journalistes qui les suivent et les connaissent ne sont pas dupes : « Gênes pour eux, c'est un grand terrain de jeu où il faut casser le plus de vitrines, faire cramer le plus de bagnoles et, bien sûr, échapper à la police ; rien d'autre », « qu'importe la couleur du flacon pourvu qu'ils aient l'adrénaline » parce que (ça c'est moi qui le rajoute) c'est quand même plus facile de détruire ce que les autres sont parvenus à construire dans leur vie de de se construire une vie à soi. « Si j'appartiens au black bloc, c'est parce que le monde dans lequel je vis est monotone et effrayant. Essayer de le détruire est une jouissance ». Et c'est tellement facile, quand nos polices ont l'ordre de répliquer le moins possible.
Pourtant ici, plus le roman avance, plus on se rend compte que le climat délétère instauré par le gouvernement néo-fasciste, et notamment les ordres et discours aux polices ont portés leurs fruits : « ici, à Gênes, les flics n'ont pas l'air prêts à respecter les règles ». Car finalement c'est bien ce dont il est question : la facilité avec laquelle l'histoire peut se répéter et dégénérer si rapidement, avant que les garde-fous ne se mettent en action. Sur fond de fascisme et de guerre civile, Frédéric PAULIN fait monter la tension jusqu'au point de non-retour, jusqu'à ce que La Nuit tombe sur nos âmes… On regarde ces scènes de guerre où tout le monde a peur, et l'on voudrait que les casseurs en profitent quand même pour comprendre que : « cette terreur, c'est celle qui saisit lorsque l'Etat n'assure plus la sécurité de ses citoyens ». Mais le temps n'est pas encore à la réflexion : aux yeux du monde, et surtout des dirigeants italiens, la violence des manifestants vient simplement de donner une bonne raison aux autorités de se défendre, de riposter, et de frapper plus fort encore. Et une fois les chiens lâchés, qui peut les arrêter ? Quand l'ampleur du désastre apparaît enfin, il est trop tard ; il ne sera plus temps que des sanctions et des procès, des jugements européens.
Si, du fait de ce papillonnage d'un univers à l'autre, je ne suis pas parvenue sur le moment à entrer réellement dans l'un quelconque des personnages et à m'identifier ni à m'attacher à l'un d'eux, l'auteur parvient en 250 pages à reproduire une assez bonne vue d'ensemble de l'ambiance et de chaque partie en présence. On en retient que le danger vient de l'extrémisme en lui-même, de quel que bord qu'il soit (Etat ou citoyen). J'ai pensé au départ que nous faire entrer davantage dans les motivations et convictions profondes des uns et des autres aurait gagné en profondeur. Mais nul besoin en réalité : c'est la fin qui donne le dernier coup de massue, et m'a achevée. C'est encore elle qui donne sa profondeur et sa raison d'être au roman. Une oeuvre importante car réaliste et toujours d'actualité. Menée tambour battant, mais rondement menée.
Je connaissais l'auteur, Frédéric Paulin, de nom pour sa trilogie « Tedj Benlazar » constituée des tomes « La guerre est une ruse », « Prémices de la chute » et « La Fabrique de la terreur » dont le plus grand bien avait été écrit sur internet. Je n'ai pas pu m'empêcher de me procurer ce livre récemment mais peu de temps avant, son dernier roman est paru lors de la rentrée littéraire en 2021 avec « La Nuit tombée sur nos âmes ».
Ici, Frédéric Paulin se concentre sur le sommet du G8 de 2001 qui s'est déroulée à Gênes en Italie et qui s'est soldée par la mort d'un manifestant, tué d'une balle dans la tête par un carabinier.
C'est une plongée totalement immersive que l'écrivain offre à ses lecteurs. Cette immersion l'est tant du côté des manifestants altermondialistes que du côté des politiques réunis à l'occasion de cette réunion et de celui des forces de l'ordre. J'ai trouvé que c'était intelligemment écrit et absolument captivant !
Par la lecture de ce bouquin, le lecteur a lui-même l'impression de se trouver sous le soleil plombant de Gênes, évoluant dans les rues, sous la pression constante et permanente des policiers et carabiniers où la moindre étincelle risquait de mettre le feu aux poudres, comme cela fût d'ailleurs le cas en 2001.
Il faut se rappeler qu'à titre précurseur, plus tôt dans l'été, un précédent sommet international avait eu lieu et des échauffourées s'étaient déjà déroulées. Afin d'éviter de potentiels débordements, les forces de l'ordre avaient été massées en masse dans la ville de Gênes. Cela en vue d'éviter le même résultat, par le contre-sommet organisé par des associations altermondialistes et gangrené par la présence de membres d'extrême-droite. Maintenant que l'on connait la suite, ce fût encore bien pire !
Le style fluide est très visuel et permet de revivre le désastre où les victimes se sont comptées par centaines. Car, en plus de la mort d'un manifestant, des jeunes et moins jeunes ont littéralement été tabassés gratuitement par de nombreux fascistes présents au sein des forces de l'ordre elles-mêmes.
En faisant quelques recherches sur ce sommet, pour lequel je n'ai que des brides de souvenirs (soit parce que j'étais assez jeune ou soit parce que les terribles événements qui se sont déroulés 2 mois plus tard lors des attentats du 11 septembre ont totalement occulté mes souvenirs), je suis tombée sur un article de 2017 où le chef de la police italienne tentait de faire son mea culpa en reconnaissant des actes de tortures sur des manifestants !
Tout dans ce bouquin m'a tenue en haleine. Même si on connaît les dégâts au final bien avant la fin, on ne peut s'empêcher de « vivre » ce moment hors du temps, comme si on faisait un saut plus de 20 ans en arrière. Documenté et enrichissant, c'est une lecture à ne pas passer à côté !
Si comme moi, les faits de société vous intéressent, ce livre en est un parfait représentant pour une lecture immersive, totalement aboutie et saisissante.
Lien : https://www.musemaniasbooks...
Ici, Frédéric Paulin se concentre sur le sommet du G8 de 2001 qui s'est déroulée à Gênes en Italie et qui s'est soldée par la mort d'un manifestant, tué d'une balle dans la tête par un carabinier.
C'est une plongée totalement immersive que l'écrivain offre à ses lecteurs. Cette immersion l'est tant du côté des manifestants altermondialistes que du côté des politiques réunis à l'occasion de cette réunion et de celui des forces de l'ordre. J'ai trouvé que c'était intelligemment écrit et absolument captivant !
Par la lecture de ce bouquin, le lecteur a lui-même l'impression de se trouver sous le soleil plombant de Gênes, évoluant dans les rues, sous la pression constante et permanente des policiers et carabiniers où la moindre étincelle risquait de mettre le feu aux poudres, comme cela fût d'ailleurs le cas en 2001.
Il faut se rappeler qu'à titre précurseur, plus tôt dans l'été, un précédent sommet international avait eu lieu et des échauffourées s'étaient déjà déroulées. Afin d'éviter de potentiels débordements, les forces de l'ordre avaient été massées en masse dans la ville de Gênes. Cela en vue d'éviter le même résultat, par le contre-sommet organisé par des associations altermondialistes et gangrené par la présence de membres d'extrême-droite. Maintenant que l'on connait la suite, ce fût encore bien pire !
Le style fluide est très visuel et permet de revivre le désastre où les victimes se sont comptées par centaines. Car, en plus de la mort d'un manifestant, des jeunes et moins jeunes ont littéralement été tabassés gratuitement par de nombreux fascistes présents au sein des forces de l'ordre elles-mêmes.
En faisant quelques recherches sur ce sommet, pour lequel je n'ai que des brides de souvenirs (soit parce que j'étais assez jeune ou soit parce que les terribles événements qui se sont déroulés 2 mois plus tard lors des attentats du 11 septembre ont totalement occulté mes souvenirs), je suis tombée sur un article de 2017 où le chef de la police italienne tentait de faire son mea culpa en reconnaissant des actes de tortures sur des manifestants !
Tout dans ce bouquin m'a tenue en haleine. Même si on connaît les dégâts au final bien avant la fin, on ne peut s'empêcher de « vivre » ce moment hors du temps, comme si on faisait un saut plus de 20 ans en arrière. Documenté et enrichissant, c'est une lecture à ne pas passer à côté !
Si comme moi, les faits de société vous intéressent, ce livre en est un parfait représentant pour une lecture immersive, totalement aboutie et saisissante.
Lien : https://www.musemaniasbooks...
Killing in the name.
Wag, thésard de 28 ans et militant trotskiste, tombe amoureux de Nathalie, pasionaria autonome et membre du Black Bloc. On est en 2001, le sommet du G8 va se tenir à Gênes du 20 au 22 Juillet, et le couple s'y rend pour rejoindre ceux qui rêvent d'un autre monde. Mais tout va mal tourner dans cette Italie berlusconienne affiliée à l'extrême-doite, et parmi les 400 000 manifestants de tous pays, Wag et Nathalie vont devoir louvoyer entre les traîtres, les journalistes, les flics de la DST, et pire encore, les carabiniers prêts à tuer.
Dans ce roman brutal relatant une insoutenable violence d'Etat, Frédéric Paulin raconte le sommet de Gênes comme si on y était -et c'est glaçant. Pour rappel, ce G8 s'est soldé, côté manifestants, par la mort de Carlo Giuliani (tué puis écrasé par les carabiniers), par la séquestration de militants dans la caserne Bolzaneto (où, comme le reconnaîtra en 2017 le chef de la police italienne, les militants ont été victimes "d'actes de torture"), et par plus de 600 blessés. Beau bilan d'une répression disproportionnée. Paulin raconte tout cela, et on ressent alors toute cette terreur, "celle qui saisit lorsque l'Etat n'assure plus la sécurité de ses citoyens.", celle qui rappelle le Chili et l'Argentine.
J'ai donc appris énormément de choses sur ce G8, qui m'avaient échappé à l'époque, et notamment comment les responsables italiens post-fascistes ont anticipé cette répression. J'ai découvert avec effroi le sort réservé aux 300 altermondialistes de l'école Diaz prise d'assaut par les carabiniers, et le sort pire encore de ceux qui, pas assez amochés pour se retrouver à l'hôpital, ont été emmenés dans cette affreuse caserne Bolzaneto. L'auteur s'est basé sur les témoignages recueillis par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour raconter tout cela -difficile, donc, de lui reprocher un parti-pris. D'autant qu'il entre également dans la tête d'autres personnages : un jeune caporal-chef carabinier qui se surprend à douter, un conseiller en sécurité qui rêve d'une nouvelle République de Salo, et un conseiller en communication entièrement dévoué à Jacques Chirac -Chirac fut d'ailleurs le seul chef d'Etat à s'exprimer sur les manifestations et la mort de Giuliani (eh oui !).
Toutefois, je ne me suis pas attachée aux personnages (sauf, paradoxalement ... le jeune caporal-chef ! ), trop revêches à mon goût. Et j'aurais aimé que l'auteur explique davantage les motivations de Wag et Nathalie, plutôt que leur faire tenir le discours anticapitaliste habituel. Je me suis également interrogée sur la complexité de certaines intrigues et la probabilité de certaines alliances -mais qu'importe, celles-ci servent la fiction qui s'avère secondaire par rapport à la réalité.
Néanmoins, j'ai aimé le style sec, nerveux, factuel, de Paulin, qui se prête idéalement à son récit haletant. J'ai eu un peu de mal à desserrer mes doigts du livre au moment de le refermer, tant j'étais crispée.
C'est donc un polar politique dramatiquement instructif sur la "plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale" selon Amnesty, un roman qui met en rage et donne froid dans le dos.
Et qui donne aussi envie de ré-écouter Rage Against the Machine.
Wag, thésard de 28 ans et militant trotskiste, tombe amoureux de Nathalie, pasionaria autonome et membre du Black Bloc. On est en 2001, le sommet du G8 va se tenir à Gênes du 20 au 22 Juillet, et le couple s'y rend pour rejoindre ceux qui rêvent d'un autre monde. Mais tout va mal tourner dans cette Italie berlusconienne affiliée à l'extrême-doite, et parmi les 400 000 manifestants de tous pays, Wag et Nathalie vont devoir louvoyer entre les traîtres, les journalistes, les flics de la DST, et pire encore, les carabiniers prêts à tuer.
Dans ce roman brutal relatant une insoutenable violence d'Etat, Frédéric Paulin raconte le sommet de Gênes comme si on y était -et c'est glaçant. Pour rappel, ce G8 s'est soldé, côté manifestants, par la mort de Carlo Giuliani (tué puis écrasé par les carabiniers), par la séquestration de militants dans la caserne Bolzaneto (où, comme le reconnaîtra en 2017 le chef de la police italienne, les militants ont été victimes "d'actes de torture"), et par plus de 600 blessés. Beau bilan d'une répression disproportionnée. Paulin raconte tout cela, et on ressent alors toute cette terreur, "celle qui saisit lorsque l'Etat n'assure plus la sécurité de ses citoyens.", celle qui rappelle le Chili et l'Argentine.
J'ai donc appris énormément de choses sur ce G8, qui m'avaient échappé à l'époque, et notamment comment les responsables italiens post-fascistes ont anticipé cette répression. J'ai découvert avec effroi le sort réservé aux 300 altermondialistes de l'école Diaz prise d'assaut par les carabiniers, et le sort pire encore de ceux qui, pas assez amochés pour se retrouver à l'hôpital, ont été emmenés dans cette affreuse caserne Bolzaneto. L'auteur s'est basé sur les témoignages recueillis par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour raconter tout cela -difficile, donc, de lui reprocher un parti-pris. D'autant qu'il entre également dans la tête d'autres personnages : un jeune caporal-chef carabinier qui se surprend à douter, un conseiller en sécurité qui rêve d'une nouvelle République de Salo, et un conseiller en communication entièrement dévoué à Jacques Chirac -Chirac fut d'ailleurs le seul chef d'Etat à s'exprimer sur les manifestations et la mort de Giuliani (eh oui !).
Toutefois, je ne me suis pas attachée aux personnages (sauf, paradoxalement ... le jeune caporal-chef ! ), trop revêches à mon goût. Et j'aurais aimé que l'auteur explique davantage les motivations de Wag et Nathalie, plutôt que leur faire tenir le discours anticapitaliste habituel. Je me suis également interrogée sur la complexité de certaines intrigues et la probabilité de certaines alliances -mais qu'importe, celles-ci servent la fiction qui s'avère secondaire par rapport à la réalité.
Néanmoins, j'ai aimé le style sec, nerveux, factuel, de Paulin, qui se prête idéalement à son récit haletant. J'ai eu un peu de mal à desserrer mes doigts du livre au moment de le refermer, tant j'étais crispée.
C'est donc un polar politique dramatiquement instructif sur la "plus grande violation des droits humains et démocratiques dans un pays occidental depuis la Seconde Guerre mondiale" selon Amnesty, un roman qui met en rage et donne froid dans le dos.
Et qui donne aussi envie de ré-écouter Rage Against the Machine.
critiques presse (2)
Frédéric Paulin fait cohabiter des personnages de pure fiction, avec des thèmes historiques et politiques d’actualité.
Lire la critique sur le site : Culturebox
La répression policière est telle que le bilan, au soir du dimanche 22 juillet, sera d’un mort et de 600 blessés parmi les manifestants. Vingt ans plus tard, Frédéric Paulin y revient et choisit une nouvelle fois la fiction pour traiter de cet événement historique qui a, dit-il, bouleversé sa vie
Lire la critique sur le site : Telerama
Citations et extraits (51)
Voir plus
Ajouter une citation
Qui se souvient de ce mois de juillet 2001 durant lequel se déroula la réunion du G8 à Gênes , alors que deux mois plus tard le Monde verra les deux tours du World Trade Center de New York s'écrouler en direct alors qu’elles ont été percutées plus tôt par deux avions kamikazes ?
Qui se souvient de cette manifestation massive de plusieurs centaines de milliers d’opposants à la mondialisation ? Une manifestation où l’ultra violence s’est déployée pendant ces quelques jours avec comme résultat de nombreux blessés, traumatisés à vie et surtout un mort.
Un affrontement que fait revivre pour nous Frédéric Paulin de l’intérieur. Il décortique jour après jour ce face à face grâce à des personnages clefs .
D’un côté les forces de police italiennes dirigées par une hiérarchie nostalgique du régime fasciste alors que les partis d’extrême-droite participent au conglomérat de la majorité piloté par Il Cavaliere Berlusconi. Des militaires qui rêvent de montrer au monde leur capacité à contenir coûte que coûte cette masse grouillante d’activistes de tout poil. Quitte à laisser leur conscience au vestiaire. Quitte à utiliser tous les arguments, même les plus fallacieux, pour stimuler leurs troupes à commettre les pires exactions sur ces jeunes manifestants .
De l’autre, des pacifistes d’extrême-gauche de tous pays et des anarchistes qui souhaitent semer le chaos . Les plus féroces sont les membres des black blocs qui ne connaissent qu’un mot d’ordre : la destruction systématique de tout ce qui passe à leur portée. Parmi eux , Nathalie et Yag , un jeune couple rennais , habitués de ces démonstrations de force et de ces confrontations mais qui vont vivre une expérience hors du commun qui signifiera peut être la fin prématurée de leur jeunesse et de leurs dernières utopies.
Frédéric Paulin était l’un d’entre eux . Un de ces jeunes manifestants présents parmi tant d’autres pour démontrer qu’il y avait une autre voie possible que cette mondialisation à tout crin. Que le destin du monde ne pouvait être régi par huit états , par huit dirigeants faisant l’apologie d’un capitalisme débridé.
Vingt ans après il témoigne , une sorte d’exutoire peut être …qui sait ?
Grâce à des va et vient incessants entre les différentes factions , à travers les discours va t-en guerre des autorités italiennes, on sent la tension monter d’un cran de pages en pages. Même si on est bien dans un roman, l’auteur s’en tient aux déroulés précis des faits , avec le moins de parti pris possible. Chaque personnage a son rôle à jouer pour nous éclairer au mieux sur la succession des événements. Un drame annoncé disséqué avec minutie par l’auteur. Des deux côtés, le parti de la violence et de la force fait la loi. L’extrémisme a vaincu. Même les services secrets infiltrés sont débordés pour ne pas dire impuissants devant ses actes d’une rare violence alors que les médias indépendants tentent de rendre compte du chaos ambiant et des répressions policières disproportionnées.
Une fois de plus , Frédéric Paulin se démarque et nous offre une leçon d’histoire. Un témoignage indispensable qui nous exhorte à la vigilance. Un rappel que le barbarisme ne doit pas passer. Que cet extrémisme qui affole les sondages aujourd’hui peut être combattu dans les urnes. Sans faute.
Qui se souvient de cette manifestation massive de plusieurs centaines de milliers d’opposants à la mondialisation ? Une manifestation où l’ultra violence s’est déployée pendant ces quelques jours avec comme résultat de nombreux blessés, traumatisés à vie et surtout un mort.
Un affrontement que fait revivre pour nous Frédéric Paulin de l’intérieur. Il décortique jour après jour ce face à face grâce à des personnages clefs .
D’un côté les forces de police italiennes dirigées par une hiérarchie nostalgique du régime fasciste alors que les partis d’extrême-droite participent au conglomérat de la majorité piloté par Il Cavaliere Berlusconi. Des militaires qui rêvent de montrer au monde leur capacité à contenir coûte que coûte cette masse grouillante d’activistes de tout poil. Quitte à laisser leur conscience au vestiaire. Quitte à utiliser tous les arguments, même les plus fallacieux, pour stimuler leurs troupes à commettre les pires exactions sur ces jeunes manifestants .
De l’autre, des pacifistes d’extrême-gauche de tous pays et des anarchistes qui souhaitent semer le chaos . Les plus féroces sont les membres des black blocs qui ne connaissent qu’un mot d’ordre : la destruction systématique de tout ce qui passe à leur portée. Parmi eux , Nathalie et Yag , un jeune couple rennais , habitués de ces démonstrations de force et de ces confrontations mais qui vont vivre une expérience hors du commun qui signifiera peut être la fin prématurée de leur jeunesse et de leurs dernières utopies.
Frédéric Paulin était l’un d’entre eux . Un de ces jeunes manifestants présents parmi tant d’autres pour démontrer qu’il y avait une autre voie possible que cette mondialisation à tout crin. Que le destin du monde ne pouvait être régi par huit états , par huit dirigeants faisant l’apologie d’un capitalisme débridé.
Vingt ans après il témoigne , une sorte d’exutoire peut être …qui sait ?
Grâce à des va et vient incessants entre les différentes factions , à travers les discours va t-en guerre des autorités italiennes, on sent la tension monter d’un cran de pages en pages. Même si on est bien dans un roman, l’auteur s’en tient aux déroulés précis des faits , avec le moins de parti pris possible. Chaque personnage a son rôle à jouer pour nous éclairer au mieux sur la succession des événements. Un drame annoncé disséqué avec minutie par l’auteur. Des deux côtés, le parti de la violence et de la force fait la loi. L’extrémisme a vaincu. Même les services secrets infiltrés sont débordés pour ne pas dire impuissants devant ses actes d’une rare violence alors que les médias indépendants tentent de rendre compte du chaos ambiant et des répressions policières disproportionnées.
Une fois de plus , Frédéric Paulin se démarque et nous offre une leçon d’histoire. Un témoignage indispensable qui nous exhorte à la vigilance. Un rappel que le barbarisme ne doit pas passer. Que cet extrémisme qui affole les sondages aujourd’hui peut être combattu dans les urnes. Sans faute.
La LCR et le blackbloc sont infiltrés depuis longtemps, les flics obtiendront facilement des informations au coeur du contre-sommet. Il n'y a bien que les militants gauchistes à croire que l'infiltration de leurs groupes est impossible. Ceux-là pensent qu'un ou deux indics seulement ont réussi. Il y a quelques années, Martinez a rencontré un ancien RG. Il a infiltré les autonomes parisiens au début des années quatre-vingt et lui a raconté qu'à l'époque ils étaient une quinzaine à travailler sous couverture comme lui. Bien sûr, il y a eu des cas foireux qui ont pu corroborer la certitude des totos d'être impossible à infiltrer : les mythomanes ou les délinquants expliquant qu'ils agissent aux ordres des flics pullulent dans les tribunaux.
Chirac a du flair. C’est un trop vieux briscard pour ne pas sentir l’opportunité d’un nouveau combat qui s’annonce, mondial celui-là. Qu’il y croie ou pas, peu importe : il a compris avant tous ses homologues, les autres chefs d’État qui iront à Gênes, que la mondialisation est la dernière fracture planétaire. La guerre froide est terminée, les antagonismes est-ouest se sont dissipés. Maintenant, le temps de l’opposition nord-sud est venu. Et ça, ça fascine Chirac.
La note jaune stipule qu’il faudra dire que Claude Chirac n’est pas à Gênes parce qu’elle est occupée à préparer le voyage du Président dans les pays baltes, juste après le sommet du G8.
Une autre note – sur papier blanc, celle-là – lui demande de rappeler Maître Legorgu. Des emmerdes, encore. Marie-Laure veut sa peau. Depuis ce soir où il lui a collé une baffe, elle a décidé de le taper au portefeuille, de le laisser à poil. Oui, il l’a frappée, oui, ça ne se fait pas. Mais non, il n’a pas été violent avec elle. Ce soir-là, elle l’a insulté, elle l’a traité de lèche-cul et de menteur, elle a surtout hurlé alors que les enfants dormaient à côté. Jusqu’à ce moment, il ne se croyait pas capable de lever la main sur une femme, la sienne qui plus est.
La note jaune stipule qu’il faudra dire que Claude Chirac n’est pas à Gênes parce qu’elle est occupée à préparer le voyage du Président dans les pays baltes, juste après le sommet du G8.
Une autre note – sur papier blanc, celle-là – lui demande de rappeler Maître Legorgu. Des emmerdes, encore. Marie-Laure veut sa peau. Depuis ce soir où il lui a collé une baffe, elle a décidé de le taper au portefeuille, de le laisser à poil. Oui, il l’a frappée, oui, ça ne se fait pas. Mais non, il n’a pas été violent avec elle. Ce soir-là, elle l’a insulté, elle l’a traité de lèche-cul et de menteur, elle a surtout hurlé alors que les enfants dormaient à côté. Jusqu’à ce moment, il ne se croyait pas capable de lever la main sur une femme, la sienne qui plus est.
Génovéfa et Corbeil ont pris des centaines de clichés. La jeune femme a interrogé des dizaines de témoins. Certains avaient un bras ou le nez cassé, d'autres, les stigmates du traitement que les flics leur avaient fait subir pendant une arrestation. Elle a reçu un coup de fil de son rédacteur en chef au JDD. Il voulait des photos, des compte-rendus des violences. Elle lui a dit qu'elle était au cœur des affrontements. Mais lorsqu'elle a proposé un article à charge sur l'attitude des forces de l'ordre, son chef s'est arc-bouté.
- L'attitude des forces de l'ordre? s'est-il étonné. Le black bloc a tout dévasté et tu veux charger les forces de l'ordre?
- Ce n'est pas exactement comme ça que ça c'est déroulé...
- Attends, Génovéfa. On a vu les images, on les a vus à l’œuvre, ces anarchistes. Il est difficile de leur trouver des circonstances atténuantes.
Elle est restée muette.
- Fais-moi un long papier, genre 10 000 signes, et quatre ou cinq photos sur les dégradations commises par le black bloc et je te donne la une.
Elle a raccroché.
Lorsqu'il a essayé de rappeler, elle n'a pas répondu.
Erwan Corbeil a compris.
- C'est le métier qui rentre, t'inquiète.
- Je fais quoi des photos des flics et des infiltrés, je fais quoi des témoignages de tous ces gens?
Il l'a serrée dans ses bras.
- Garde-les. Un jour, tu en feras quelque chose. Un bouquin, va savoir...
- L'attitude des forces de l'ordre? s'est-il étonné. Le black bloc a tout dévasté et tu veux charger les forces de l'ordre?
- Ce n'est pas exactement comme ça que ça c'est déroulé...
- Attends, Génovéfa. On a vu les images, on les a vus à l’œuvre, ces anarchistes. Il est difficile de leur trouver des circonstances atténuantes.
Elle est restée muette.
- Fais-moi un long papier, genre 10 000 signes, et quatre ou cinq photos sur les dégradations commises par le black bloc et je te donne la une.
Elle a raccroché.
Lorsqu'il a essayé de rappeler, elle n'a pas répondu.
Erwan Corbeil a compris.
- C'est le métier qui rentre, t'inquiète.
- Je fais quoi des photos des flics et des infiltrés, je fais quoi des témoignages de tous ces gens?
Il l'a serrée dans ses bras.
- Garde-les. Un jour, tu en feras quelque chose. Un bouquin, va savoir...
Les cris, les applaudissements, les rires, la liesse s’opposent à un vieux monde réuni là pour décider des orientations économiques d’une Europe qu’il ne comprend plus.
Videos de Frédéric Paulin (7)
Voir plusAjouter une vidéo
Après l'Algérie des années 90 dans la trilogie Benlazar, Frédéric Paulin revient dans La Nuit tombée sur nos âmes sur les événements qui ont accompagné le sommet du G8 à Gênes en 2001. Plus de 500 000 manifestants s'étaient réunis contre la mondialisation sauvage. Malheureusement, les violences policières firent aussi un mort, blessant et torturant de nombreux participants.
Frédéric Paulin nous offre un roman noir, comme une leçon d'Histoire, au coeur d'un événement fondateur.
autres livres classés : romans policiers et polarsVoir plus

Millénium, tome 1 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes
Stieg Larsson
813
critiques
202
citations

Millénium, tome 2 : La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette
Stieg Larsson
408
critiques
121
citations
Les plus populaires : Polar et thriller
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Frédéric Paulin (16)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
769 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre769 lecteurs ont répondu