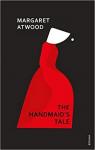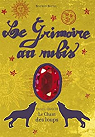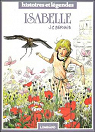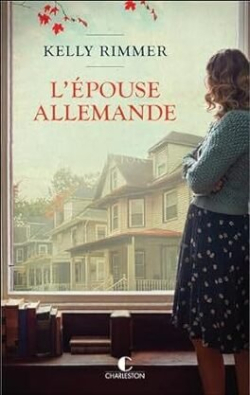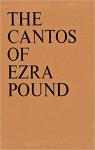Ezra Pound
Jean-Paul Auxeméry (Traducteur)Jean-Michel Rabaté (Préfacier, etc.)Massimo Bacigalupo (Auteur de la postface, du colophon, etc.)Joël-Peter Shapiro (Auteur de la postface, du colophon, etc.)/5 4 notes
Jean-Paul Auxeméry (Traducteur)Jean-Michel Rabaté (Préfacier, etc.)Massimo Bacigalupo (Auteur de la postface, du colophon, etc.)Joël-Peter Shapiro (Auteur de la postface, du colophon, etc.)/5 4 notes
Résumé :
" Il s'agit d'un recueil de textes concernant tout ce qui a aimanté l'esprit du poète : la littérature et la musique, Confucius et Sophocle, les religions, la traduction et l'anthropologie... On tient là l'itinéraire zigzaguant du poète qui incarna, mieux peut-être que nul autre, le besoin de l'espèce de sauver sa mémoire. C'est-à-dire tout ce qui, au cours des siècles, a fait de l'homme ce perplexe animal qui pense, aime la beauté, et sait parfois la créer pour fai... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Je rassemble les membres d'OsirisVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Au départ, il y avait le langage. Parlons peu mais parlons bien. Pas beaucoup d'hommes, la continuité existentielle, la proximité du langage et de ses origines, qu'Ezra Pound suppose essentiellement matérielles. Au fil du temps, il y a eu multiplication des hommes, des activités et des informations. Ça bruisse de partout, souvent pour ne rien dire, et le mot commence à puer. C'est le monde moderne, que voulez-vous, on ne va pas arrêter le progrès par nostalgie ?
Pour emmerder tout le monde, marchant à contre-sens sur une autoroute pleine de petites voitures affolées, Ezra Pound s'est passionné pour les chants des troubadours dans lesquels il reconnaissait une forme musicale achevée qui ne négligeait ni la mélodie, ni le rythme. La découverte de Confucius tomba à point nommé pour le confirmer dans ses impressions. Ernest Fenollosa l'introduisit à la lecture des idéogrammes et on imagine quel fut son choc lorsqu'il découvrit le signe représentant la plus haute musique :
http://i18.servimg.com/u/f18/15/43/25/84/haute_10.jpg
Il faut lire le signe comme s'il s'agissait d'un dessin. En cherchant à revenir au plus simple. La musique apparaît alors comme le portrait sur pied d'un homme. Autour de sa tête, les deux volutes rythmiques figurent la musique parfaite. Elles entourent l'homme, symbolisent un mouvement (qui ne se trouve pas forcément dans le seul mot de « musique ») qui le dynamise et le porte vers l'élévation. le signe percute Ezra Pound plus que toute critique musicale inspirée de son époque. Il y a dans l'idéogramme un mouvement primitif et éclairé en lequel il se reconnaît. Il poursuit alors son étude des idéogrammes et confronte ses propres traductions à celles de ses prédécesseurs, débusquant les interprétations fallacieuses d'un ethnocentrisme nauséabond. La traduction du Tao par les mots « vérité » ou « verbe » lui semble ainsi incorrecte car elle oublie la notion de mouvement représentée par l'empreinte du pied à gauche (à droite se trouve la tête) :
http://i18.servimg.com/u/f18/15/43/25/84/tao10.jpg
Ezra Pound est excité : il a découvert une écriture qui se déchiffre comme un rébus. Dans son idéalisme, il la rêve transparente et affirme qu'elle ne peut pas mentir, parce qu'elle n'est pas abstraite. de même, le confucianisme –le vrai, et non pas celui que l'on coupe de ses sources pour lui faire dire tout et son contraire- représente à son avis le modèle politique parfait qui s'intéresse à la vie (au manger) plutôt qu'à la mort (aux questions métaphysiques). Il admire également sa moralité, qui ne se justifie pas par les chimères des menaces et des récompenses, qui ne connaît pas le concept de péché et qui lutte contre les superstitions de toutes formes.
Si nous avions encore un Confucius, le flot des « immondes écrivains » qui ne font rien d'autre que « répandre la confusion dans l'esprit de leurs lecteurs en parlant des « systèmes » d'inflation, de résiliation, des problèmes du crédit » et qui produisent des « oeuvres qui ne servent à rien », une « moisissure de livres qui n'aboutissent à rien » - ce flot-là serait bien vite jugulé. On arrêterait de se croire à la foire, on deviendrait un peu moins bouffon. On a souvent expliqué la vénération qu'Ezra Pound éprouvait vis-à-vis de Mussolini en invoquant son intérêt pour la Renaissance italienne dynamique et la continuité des dynasties chinoises. C'est peut-être vrai, mais pas seulement. Si on se prend à spéculer, on peut dire qu'Ezra Pound n'aimait pas cette société moderne qui avait réservé les choses artistiques à une élite avinée et remplie de petit-four jusqu'aux amygdales. Son crime le plus abject : avoir fait naître la notion de « culture » comme élément de distinction. Avoir gardé jalousement les belles choses, faisant croire aux autres qu'ils ne pouvaient pas les comprendre. « Pourquoi les belles choses se passent-elles toujours seules dans leur coin ? Faut-il en rendre responsable la démocratie ? »
En contrepoint, Ezra Pound montre l'exemple du chant du Laboureur, daté du 16e siècle et qui, selon lui, nous rappelle que « la démocratie n'a pas commencé avec la Révolution française ; et que des auteurs plus anciens ont pensé au problème du travail, car ce chant n'est pas fait par un travailleur mais par un poète attentif et indigné, et d'une réussite estimable ». La démocratie serait donc une tyrannie comme les autres et si elle convient à certains, Ezra Pound et son besoin d'une âme vive, concrète et sincère ne peut s'en satisfaire.
De toutes les considérations précédentes, on comprend mieux l'oeuvre de traduction d'Ezra Pound. Son objectif était de rendre accessibles les classiques relégués aux oubliettes à cause des intellectuels, professionnels des langues anciennes, garants d'un langage inerte mais reconnu dans le monde clos des doctes. Pour Ezra Pound, il est moins important de respecter mot à mot le texte original que d'en restituer la valeur dynamique, de faire réapparaître toute la vie qui en fut à l'origine, comme on ranimerait un mort jamais décomposé. Sa méthode relève de l'infusion, procédé télépathique vers l'au-delà, résurrection d'un homme et de son monde, télescopage schizophrénique dans une autre peau, des autres moeurs, d'autres façons de penser. Il faut se laisser imprégner par les enjeux vivants de la pièce, imaginer un Sophocle fait de chair, de sang et d'os, qui bande et qui pleure, pour le comprendre dans l'âme. Il faut comprendre la pièce elle aussi, découvrir la « phrase clé pour laquelle existe toute la pièce » (dans les Trachiniennes : « Tu ne peux plus aller contre, mon fils, quelle SPLENDEUR, TOUT S'ACCORDE !") afin de broder un cheminement littéraire qui gravira des sommets avant de s'apaiser lentement vers son dénouement. Tout autre mouvement est bien entendu envisageable, personne ne respire exactement comme son voisin.
Ezra Pound détestait que la tête et le corps soient coupés. S'il considérait que le fascisme pouvait réaliser la réconciliation, c'est parce que la démocratie l'avait déçu. On a enfermé Ezra Pound pendant trente ans dans un asile psychiatrique, préférant faire croire qu'il était fou plutôt que de se demander s'il n'avait pas raison de remettre en cause un système qui drague sa foule pour mieux la maintenir à distance des belles choses. Tout ça parce qu'ils se prennent pour la tête, et parce qu'ils méprisent le corps.
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Pour emmerder tout le monde, marchant à contre-sens sur une autoroute pleine de petites voitures affolées, Ezra Pound s'est passionné pour les chants des troubadours dans lesquels il reconnaissait une forme musicale achevée qui ne négligeait ni la mélodie, ni le rythme. La découverte de Confucius tomba à point nommé pour le confirmer dans ses impressions. Ernest Fenollosa l'introduisit à la lecture des idéogrammes et on imagine quel fut son choc lorsqu'il découvrit le signe représentant la plus haute musique :
http://i18.servimg.com/u/f18/15/43/25/84/haute_10.jpg
Il faut lire le signe comme s'il s'agissait d'un dessin. En cherchant à revenir au plus simple. La musique apparaît alors comme le portrait sur pied d'un homme. Autour de sa tête, les deux volutes rythmiques figurent la musique parfaite. Elles entourent l'homme, symbolisent un mouvement (qui ne se trouve pas forcément dans le seul mot de « musique ») qui le dynamise et le porte vers l'élévation. le signe percute Ezra Pound plus que toute critique musicale inspirée de son époque. Il y a dans l'idéogramme un mouvement primitif et éclairé en lequel il se reconnaît. Il poursuit alors son étude des idéogrammes et confronte ses propres traductions à celles de ses prédécesseurs, débusquant les interprétations fallacieuses d'un ethnocentrisme nauséabond. La traduction du Tao par les mots « vérité » ou « verbe » lui semble ainsi incorrecte car elle oublie la notion de mouvement représentée par l'empreinte du pied à gauche (à droite se trouve la tête) :
http://i18.servimg.com/u/f18/15/43/25/84/tao10.jpg
Ezra Pound est excité : il a découvert une écriture qui se déchiffre comme un rébus. Dans son idéalisme, il la rêve transparente et affirme qu'elle ne peut pas mentir, parce qu'elle n'est pas abstraite. de même, le confucianisme –le vrai, et non pas celui que l'on coupe de ses sources pour lui faire dire tout et son contraire- représente à son avis le modèle politique parfait qui s'intéresse à la vie (au manger) plutôt qu'à la mort (aux questions métaphysiques). Il admire également sa moralité, qui ne se justifie pas par les chimères des menaces et des récompenses, qui ne connaît pas le concept de péché et qui lutte contre les superstitions de toutes formes.
Si nous avions encore un Confucius, le flot des « immondes écrivains » qui ne font rien d'autre que « répandre la confusion dans l'esprit de leurs lecteurs en parlant des « systèmes » d'inflation, de résiliation, des problèmes du crédit » et qui produisent des « oeuvres qui ne servent à rien », une « moisissure de livres qui n'aboutissent à rien » - ce flot-là serait bien vite jugulé. On arrêterait de se croire à la foire, on deviendrait un peu moins bouffon. On a souvent expliqué la vénération qu'Ezra Pound éprouvait vis-à-vis de Mussolini en invoquant son intérêt pour la Renaissance italienne dynamique et la continuité des dynasties chinoises. C'est peut-être vrai, mais pas seulement. Si on se prend à spéculer, on peut dire qu'Ezra Pound n'aimait pas cette société moderne qui avait réservé les choses artistiques à une élite avinée et remplie de petit-four jusqu'aux amygdales. Son crime le plus abject : avoir fait naître la notion de « culture » comme élément de distinction. Avoir gardé jalousement les belles choses, faisant croire aux autres qu'ils ne pouvaient pas les comprendre. « Pourquoi les belles choses se passent-elles toujours seules dans leur coin ? Faut-il en rendre responsable la démocratie ? »
En contrepoint, Ezra Pound montre l'exemple du chant du Laboureur, daté du 16e siècle et qui, selon lui, nous rappelle que « la démocratie n'a pas commencé avec la Révolution française ; et que des auteurs plus anciens ont pensé au problème du travail, car ce chant n'est pas fait par un travailleur mais par un poète attentif et indigné, et d'une réussite estimable ». La démocratie serait donc une tyrannie comme les autres et si elle convient à certains, Ezra Pound et son besoin d'une âme vive, concrète et sincère ne peut s'en satisfaire.
De toutes les considérations précédentes, on comprend mieux l'oeuvre de traduction d'Ezra Pound. Son objectif était de rendre accessibles les classiques relégués aux oubliettes à cause des intellectuels, professionnels des langues anciennes, garants d'un langage inerte mais reconnu dans le monde clos des doctes. Pour Ezra Pound, il est moins important de respecter mot à mot le texte original que d'en restituer la valeur dynamique, de faire réapparaître toute la vie qui en fut à l'origine, comme on ranimerait un mort jamais décomposé. Sa méthode relève de l'infusion, procédé télépathique vers l'au-delà, résurrection d'un homme et de son monde, télescopage schizophrénique dans une autre peau, des autres moeurs, d'autres façons de penser. Il faut se laisser imprégner par les enjeux vivants de la pièce, imaginer un Sophocle fait de chair, de sang et d'os, qui bande et qui pleure, pour le comprendre dans l'âme. Il faut comprendre la pièce elle aussi, découvrir la « phrase clé pour laquelle existe toute la pièce » (dans les Trachiniennes : « Tu ne peux plus aller contre, mon fils, quelle SPLENDEUR, TOUT S'ACCORDE !") afin de broder un cheminement littéraire qui gravira des sommets avant de s'apaiser lentement vers son dénouement. Tout autre mouvement est bien entendu envisageable, personne ne respire exactement comme son voisin.
Ezra Pound détestait que la tête et le corps soient coupés. S'il considérait que le fascisme pouvait réaliser la réconciliation, c'est parce que la démocratie l'avait déçu. On a enfermé Ezra Pound pendant trente ans dans un asile psychiatrique, préférant faire croire qu'il était fou plutôt que de se demander s'il n'avait pas raison de remettre en cause un système qui drague sa foule pour mieux la maintenir à distance des belles choses. Tout ça parce qu'ils se prennent pour la tête, et parce qu'ils méprisent le corps.
Lien : http://colimasson.blogspot.f..
Citations et extraits (38)
Voir plus
Ajouter une citation
Il y a deux idéaux esthétiques : le wagnérien, qui n’est pas d’une nature différente de celui de la foire de Neuilly, c.-à-d. que vous étourdissez le spectateur en fouettant le plus souvent possible le plus grand nombre possible de ses sens, ce qui l’empêche de percevoir quoi que ce soit avec une lucidité inhabituelle ; mais vous pouvez l’agiter ou l’exciter jusqu’à le rendre réceptif, C ;-à-d. que vous pouvez lui filer une émotion, ou vous pouvez lui vendre une poupée de caoutchouc ou un nouveau truc de bricoleur pendant le tohu-bohu.
L’autre esthétique a été approuvée par Brancusi, Lewis, les manifestes vorticistes ; elle vise à focaliser l’esprit sur une définition donnée de la forme, si intensément qu’il devient non seulement plus conscient de cette forme, mais aussi plus sensible à toutes les autres formes, à tous les autres rythmes, plans définis, ou masses.
L’autre esthétique a été approuvée par Brancusi, Lewis, les manifestes vorticistes ; elle vise à focaliser l’esprit sur une définition donnée de la forme, si intensément qu’il devient non seulement plus conscient de cette forme, mais aussi plus sensible à toutes les autres formes, à tous les autres rythmes, plans définis, ou masses.
Je commence à être ennuyé par les Américains qui me disent que le jazz est la musique de l’avenir. De jeunes compositeurs prodiges du jazz américain classique écrivent dans une mesure à 4/4 d’un bout à l’autre. Mon dieu, les noirs d’Afrique ont laissé loin derrière eux les Américains pour tout ce qui est effet musical ou rythmique. Les blancs d’Amérique doivent avoir une mauvaise influence sur leurs noirs, ne croyez-vous pas ?
« Les premiers mythes étaient nés le jour où un homme s’avança tout de go sur le terrain du « non-sens », c’est-à-dire au moment où il entra dans une véritable et éclatante aventure. Il en parla aux autres, qui le traitèrent de menteur. Après cette amère expérience, se rendant compte que personne ne le comprenait quand il disait avoir été « changé en arbre », il fabriqua un mythe –donc, une œuvre d’art-, un récit anonyme, objectif, tissé de sa propre émotion, traduction la plus adéquate qu’il pût en faire avec des mots. Cette histoire […] donna naissance à une copie plus pâle, jusqu’à ce que s’instaure un culte, un consensus à propos du non-sens qui préside à toute relation individuelle avec les dieux.
Ces choses furent ensuite assimilées dans le sens du très suspect « intérêt de l’Etat », et ce qui avait été un temps une forme de vérité ne fut plus que tromperie et propagande. […] La religion disparut et commença l’instruction civique.
Ces choses furent ensuite assimilées dans le sens du très suspect « intérêt de l’Etat », et ce qui avait été un temps une forme de vérité ne fut plus que tromperie et propagande. […] La religion disparut et commença l’instruction civique.
Pourquoi les belles choses se passent-elles toujours seules dans leur coin ? Faut-il en rendre responsable la démocratie ? […]
Est-ce que nous avons une époque où l’art se loge dans des « coins bizarres » et où l’apathie règne parmi les gens aisés ? Est-ce à dire que la démocratie, la vraie, ne peut exister que dans un système féodal où personne n’a peur de reconnaître les capacités de création chez son voisin ?
Est-ce que nous avons une époque où l’art se loge dans des « coins bizarres » et où l’apathie règne parmi les gens aisés ? Est-ce à dire que la démocratie, la vraie, ne peut exister que dans un système féodal où personne n’a peur de reconnaître les capacités de création chez son voisin ?
Aujourd’hui, l’Occident tout entier se baigne dans un égout mental, parce que le « journal du matin » tiré à dix millions d’exemplaires est chargé d’éveiller chaque jour le cerveau des occidentaux.
Videos de Ezra Pound (6)
Voir plusAjouter une vidéo
Ezra POUND — Un périple américain (DOCUMENTAIRE, 1985)
Un documentaire réalisé par Lawrence Pitkethly en 1985. Traduction : Adrien Nicodème (narrateur et intervenants) ; Jacques Darras, Ghislain Sartoris, Michèle Pinson, Alain Suied, Yves di Manno et Denis Roche (poèmes). Avec la présence de : Olga Rudge, James Laughlin, Alfred Kazin, Mary de Rachewiltz, Basil Bunting, Hugh Kenner, Giuseppe Bacigalupo, John Drummond, Rolando Monti et John Gruesen.
Dans la catégorie :
Poésie américaineVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature américaine en anglais>Poésie américaine (87)
autres livres classés : TroubadoursVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ezra Pound (19)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1243 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1243 lecteurs ont répondu