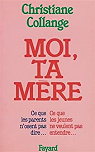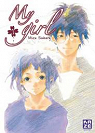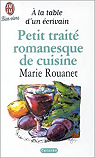Marie Rouanet/5
20 notes
Résumé :
Lorsque nous sommes enfants, ils nous paraissent forts, indestructibles, ces pères et ces mères qui, chaque jour, inlassablement font tout pour nous rendre heureux. Puis, insensiblement, comme le glacier en apparence immobile, le temps pénètre au fond de leur chair et un matin les voilà devenus petits et fragiles. Avec émotion et pudeur, Marie Rouanet regarde ses parents s'engager sur le "petit chemin" qui mène au bout de la "grand-route" jusqu'à ce qu'ils ne soient... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La marche lente des glaciersVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
Marie Rouanet évoque ici les dernières années de vie de ses parents en regardant de pleine face le travail de sape de la vieillesse qui va les mener vers la mort. Tout d'abord chez sa mère dont l'esprit s'embrume peu à peu de ténèbres angoissantes, puis chez le père qui perd son autonomie en devenant fragile physiquement, elle observe le processus de décrépitude progressive mais inéluctable.
A cette occasion, elle ressuscite les souvenirs de la vie de ces gens modestes, une vie de plaisirs simples dont elle hérite et se fait la dépositaire.
On pourrait penser que cette lecture terriblement émouvante a de quoi donner le bourdon. C'est vrai par certains côtés car elle nous met face à ce qui nous attend tous, que ce soit concernant nos parents, nos amis ou nous même, mais Marie Rouanet ne se laisse pas aller au chagrin et à la morosité. Ensoleillée par une belle vitalité, la rondeur sensuelle de son écriture allège la noirceur du propos en opposant à la douleur de la perte, la douceur de vivre grâce aux précieux petits bonheurs que la nature sait nous offrir pour peu qu'on sache les voir.
Carpe diem !
A cette occasion, elle ressuscite les souvenirs de la vie de ces gens modestes, une vie de plaisirs simples dont elle hérite et se fait la dépositaire.
On pourrait penser que cette lecture terriblement émouvante a de quoi donner le bourdon. C'est vrai par certains côtés car elle nous met face à ce qui nous attend tous, que ce soit concernant nos parents, nos amis ou nous même, mais Marie Rouanet ne se laisse pas aller au chagrin et à la morosité. Ensoleillée par une belle vitalité, la rondeur sensuelle de son écriture allège la noirceur du propos en opposant à la douleur de la perte, la douceur de vivre grâce aux précieux petits bonheurs que la nature sait nous offrir pour peu qu'on sache les voir.
Carpe diem !
Elle, c'était la maison, les enfants, puis ce furent les courses hebdomadaires à "Inter", l'économie domestique jalouse et de plus en plus rétrécie à une forme de perfection du minimum, enfin le naufrage inattendu de l'humeur, l'oblativité exactement inversée en égoïsme, l'oubli du monde et des autres succédant à l'oubli de soi qu'elle avait pratiqué toute sa vie. Lui, c'était l'atelier non chauffé du garage, la pin up du calendrier à moitié dissimulée pour ne pas choquer les enfants et les mères de famille, l'odeur de métal chauffé et les mains calleuses imprégnées de cambouis, les interminables journées de chasse entre hommes, la pêche, l'impavidité devant le sort du gibier, du poisson, les rituels barbares mais non cruels de mise à mort. Puis ce fut la solitude à la mort de l'épouse, les promenades de vieillard succédant aux battues d'antan.Le malheur de vouloir encore et de voir s'éteindre ses forces.Les renoncements.
Marie Rouanet évoque l'enfance et la jeunesse de ses deux figures tutélaires au décours d'une description d'un réalisme traversé d'éclats poétiques, et de commentaires poético-philosophiques sur le cadre nécessaire pour que l'enfance puisse s'épanouir et s'élancer à son tour vers la vie. Un des éléments de ce cadre est le regard maternel, reconstitué car jamais croisé par le sien, qui était porté sur ses jeux et son quotidien d'enfant. Mais quel renoncement chez cette mère, qui aurait sûrement souhaité la possibilité d'un ailleurs. Tous ces pas vers l'inéluctable constituent la marche lente des glaciers, très beau titre et un ouvrage qui , de nouveau, me porte à vouloir encore découvrir plus de l'oeuvre de Marie Rouanet.
Marie Rouanet évoque l'enfance et la jeunesse de ses deux figures tutélaires au décours d'une description d'un réalisme traversé d'éclats poétiques, et de commentaires poético-philosophiques sur le cadre nécessaire pour que l'enfance puisse s'épanouir et s'élancer à son tour vers la vie. Un des éléments de ce cadre est le regard maternel, reconstitué car jamais croisé par le sien, qui était porté sur ses jeux et son quotidien d'enfant. Mais quel renoncement chez cette mère, qui aurait sûrement souhaité la possibilité d'un ailleurs. Tous ces pas vers l'inéluctable constituent la marche lente des glaciers, très beau titre et un ouvrage qui , de nouveau, me porte à vouloir encore découvrir plus de l'oeuvre de Marie Rouanet.
“La marche lente des glaciers”, ou le temps qui passe inexorablement, sans que l'on n'y puisse rien. Avec ses souvenirs, ses joies, ses peines.
A travers ces lignes, Marie Rouanet évoque avec tendresse et poésie ses parents, l'amour qu'elle portait pour eux, les derniers instants de partage avec eux. Elle nous parle d'une époque révolue, où le temps bien que précieux semblait s'écouler moins vite, où les gens savaient se contenter de peu, de petits bonheurs infimes, devenus invisibles à nos yeux d'Occidentaux sans cesse pressés, elle rend hommage à cette génération de femmes qui ne se plaignaient jamais, qui ne songeaient pas à contester les devoirs qui leur étaient échus : tenir une maison et élever des enfants.
Ce livre parle de la vie et de la mort, de jeunesse et de vieillesse. Avec délicatesse et pudeur. Un témoignage rare et poignant.
Et même si j'ai eu quelques difficultés avec certains passages, peut-être trop poétiques, trop imagés à mon goût, un livre que je ne regrette pas d'avoir lu, lecture appréciée durant cet après-midi doux et ensoleillé, automnal, apercevant au loin ces massifs où se promènent d'une marche lente, les glaciers.
A travers ces lignes, Marie Rouanet évoque avec tendresse et poésie ses parents, l'amour qu'elle portait pour eux, les derniers instants de partage avec eux. Elle nous parle d'une époque révolue, où le temps bien que précieux semblait s'écouler moins vite, où les gens savaient se contenter de peu, de petits bonheurs infimes, devenus invisibles à nos yeux d'Occidentaux sans cesse pressés, elle rend hommage à cette génération de femmes qui ne se plaignaient jamais, qui ne songeaient pas à contester les devoirs qui leur étaient échus : tenir une maison et élever des enfants.
Ce livre parle de la vie et de la mort, de jeunesse et de vieillesse. Avec délicatesse et pudeur. Un témoignage rare et poignant.
Et même si j'ai eu quelques difficultés avec certains passages, peut-être trop poétiques, trop imagés à mon goût, un livre que je ne regrette pas d'avoir lu, lecture appréciée durant cet après-midi doux et ensoleillé, automnal, apercevant au loin ces massifs où se promènent d'une marche lente, les glaciers.
Je me souviens de ce livre, lu il y a au moins 20 ans. Ici, Marie Rouanet évoque d'une manière délicate et mélancolique son propre passé familial. Devenue adulte, l'auteure essaie de retrouver le regard d'enfant qu'elle portait sur ses parents qui, maintenant, sont disparus. C'était un couple modeste qui menait sa petite vie comme si elle ne devait jamais finir. Et puis le déclin les a frappés et ils sont morts. Tel qu'il est présenté, leur profil "vieux jeu", très années '60, un peu franchouillard, m'a semblé légèrement agaçant. Mais l'authenticité de cet hommage filial, doux et pudique, ne fait pas de doute; elle donne toute sa valeur à ce livre de souvenirs personnels. En outre, l'écriture de l'auteure est soignée et parfois poétique.
Les thèmes de Marie Rouanet ont une connotation ethnographique; ils sont bien enracinés dans le passé ou dans le terroir. Je me souviens en particulier d'avoir lu "Apollonie reine du monde", de la même auteure, qui est un peu de la même veine.
Les thèmes de Marie Rouanet ont une connotation ethnographique; ils sont bien enracinés dans le passé ou dans le terroir. Je me souviens en particulier d'avoir lu "Apollonie reine du monde", de la même auteure, qui est un peu de la même veine.
Evocation mélancolique, mais sans amertume, de la déchéance physique de ses parents, cette lente marche des glaciers qui atteint les êtres chers, qu'on voulait croire indestructibles.
Ecriture limpide, lumineuse, poétique.
Ecriture limpide, lumineuse, poétique.
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
On s'émerveille de la conservation dans la glace.
L'homme a l'air de sourire à travers le temps à celui qui le regarde et s'effare de cette inquiétante présence.
L'homme a l'air de sourire à travers le temps à celui qui le regarde et s'effare de cette inquiétante présence.
De combien d'êtres au monde sommes-nous sûrs qu'ils nous voient avec bonheur ?
Elle me téléphonait : "tu veux de la soupe ?" Et je disais oui. Non pour le besoin, mais pour l'amour, pour ce que j'emportais dans cette bouteille pleine
Videos de Marie Rouanet (8)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : relations parents-enfantsVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marie Rouanet (39)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1722 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1722 lecteurs ont répondu