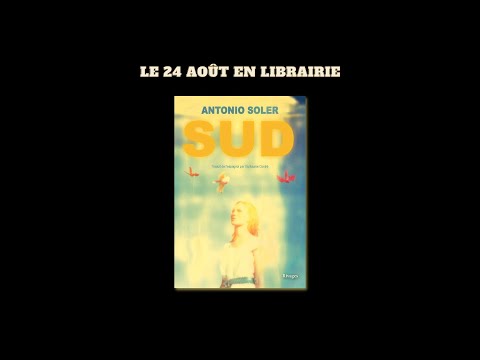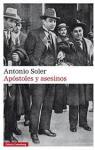Antonio Soler présente son nouveau roman "Sud", à paraître le 24 août en librairie !
Traduit de l'espagnol par Guillaume Contré : au sommet de son art, Antonio Soler emporte le lecteur dans un tourbillon de voix hypnotique et dresse une cartographie de l'âme d'une justesse éblouissante.
Retrouvez toutes nos actualités :
www.payot-rivages.fr
https://www.instagram.com/editionsriv...
https://www.facebook.com/EditionsRivages
https://twitter.com/EditionsRivages
#antoniosoler #sud #été #espagne #chaleur #personnages #destins #rentreelitteraire #littératurétrangère #roman #rivages #editionsrivages

Antonio Soler
Guillaume Contré (Traducteur)/5 18 notes
Guillaume Contré (Traducteur)/5 18 notes
Résumé :
Chronique d'une journée d'été caniculaire en ville, « Sud » emporte le lecteur dans un plan séquence d'une virtuosité folle, où se croisent toute une humanité de personnages : des adolescents au bord de l'abîme, des femmes et des hommes qui tentent de saisir leur destin, un tourbillon de voix quasi hypnotique. Styliste incomparable, Antonio Soler invente une musique, un regard qui plongent au tréfonds de l'âme humaine et donnent à ce roman la saveur unique du réel t... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après SudVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (10)
Voir plus
Ajouter une critique
L'épigraphe de « Sud », empruntée à l'écrivain mexicain Octavio Paz, « La ville, réalité immense et quotidienne qui peut se résumer en deux mots : les autres », donne le ton de ce livre aux 600 pages fiévreuses et poisseuses dont l'incandescence contamine son lecteur.
Connaissez-vous le terral ? Ce vent côtier, en Espagne, qui balaie les rues et les passages solitaires, lèche les façades et les vitres des fenêtres fermées, contraint les gens à cuire lentement à l'intérieur des maisons, à vivre dans l'obscurité de pièces surchauffées aux volets fermés. Un vent qui défile dans les torrents à la recherche de la mer, dans les ruelles des banlieues en modelant tout sur son passage, immeubles, personnages, automobiles et végétation. « Un vent qui gouverne les têtes, pénètre les pores, les oreilles et le moindre orifice ouvert dans le corps de n'importe quel humain, bête, machine, maison, porte, brèche, fenêtre, fissure, blessure ou plaie ». Déposant une patine d'aridité et de sécheresse couleur sepia, patine ondoyante en effluves de mirage. Faisant des insectes et notamment des fourmis les maitres des lieux.
Si eux s'en sortent, il n'en va pas de même des gens. Comme nous le montre Antonio Soler avec virtuosité, d'une plume nerveuse et tranchante. Oui Antonio Soler prend une ville espagnole, Malagà, sa propre ville, comme objet d'étude et personnage principal du roman, et y introduit une lame, la découpe au scalpel, ouvre ses chairs sanguinolentes et regarde. Il regarde juste, sans juger. D'un oeil presque froid. Il voit ce monde grouiller, asticots urbains, asticots humains desséchés, piégés dans leur ville, dans leur quartier, il observe d'un regard dénoué de pitié, dénoué de mépris. Dénoué d'empathie aussi. Il nous offre sur un plateau, comme en pâture, ce vrombissement, ces gesticulations, la vie tellement vaine de personnages dont le destin semble déjà écrit, tracé…glu dont ils n'arrivent pas à s'extraire.
« Sud » est une plongée en abime, sans concession, une caméra filmant, durant une journée caniculaire, la vie d'une kyrielle de personnages, alternant entre arrêts sur image, et travelings vertigineux. Deux cent personnages tous plus ou moins liés, fourmilière grouillante de vie, d'espoirs, de désenchantements, trajectoires implacables allant toutes au même endroit, comme ce soleil ardent qui suit tout simplement son cycle. Cette loupe se promène sur tous ces pauvres bougres, qui vivent la canicule comme une punition ou une malédiction, chaleur les engluant encore davantage dans les affres de l'urbanité, durant vingt-quatre heures, une loupe qui parfois grossit les faits et gestes de quelques-uns, parfois passe vite, liant en un geste rapide et flou les uns aux autres.
Adolescents en quête de sensations et débordant d'émotions, hommes et femmes tiraillés entre ardeur et désenchantement, entre désir poétique et érotisme pathétique, retraités, junkies, ouvriers, femmes au foyer, riches et pauvres, la loupe grossit démesurément leur solitude, leur absurdité, leur fragile condition, leur bonheur aussi parfois même si « le bonheur qui existe bel et bien n'a rien ou presque à raconter ».
Et les moments de communion dans la journée, lorsque tous plus ou moins font la même chose au même moment, comme le déjeuner au milieu de la journée.
« Ils mangent. L'athlète mange, son ancien ami, le meilleur au quatre cents mètre, Felipe Vicarià, mange, Consuelo la Géante mange avec ses petites dents, la soeur de Rafi Villaplana mange debout dans la cuisine, ils mangent. Ils mangent tous, le vent mange et les fourmis mangent, ils mangent des légumes secs, des déchets morts, de la viande coupée en morceaux, des poissons noyés hors de l'eau, des légumes bouillis et des animaux vidés de leur sang. Guille mange un sandwich aux poivrons et au miel, Piluca mange et Pedroche mange. Les molaires et les mâchoires. La docteur Galàn ouvre la bouche et reçoit la première gorgée de levure fermentée, amère, tout en pensant à son fils et à l'homme mort, au milieu du silence Cèspedes l'abattu avale sa première bouchée, Floren l'heureux mange et voit sa fille manger, Pedroche le craintif mange et Ismael avale la dernière cuillérée de lait aigre, les aliments glissent, descendent et coulent dans les bouches et les gorges. En route vers le puits obscur ».
Le début du livre m'a happée et si je l'ai pris sans hésiter, sans trop savoir dans quoi je plongeais, c'est pour son incipit. J'ai lu l'incipit dans ma librairie et je n'ai pu le lâcher. On entre dans ce livre comme on entre dans l'eau, enveloppée de cette résistance plaisante, une douceur qui caresse et opprime légèrement. Dès l'incipit, je savais que ce livre serait hors norme. Cette manière de parler de l'aube laiteuse avec un style de prime abord si flamboyant, cette manière ensuite de nous amener dans un plan très cinématographique- zooms, plans serrés et grand angle- au corps prostré et mourant d'un homme, dans un terrain vague, corps envahi de fourmi y compris dans les cavités nasales, buccales, dans les oreilles…Un fil tiré puis la pelote qui se vide, les fils qui relient les personnages nous parviennent, Antonio Soler tisse telle une araignée la trame de vies qui s'entrechoquent, se bousculent, se croisent. Magistralement écrit, magistralement orchestré, du grand art, une toile de plus en plus large et complexe, qui nous enserre jusqu'à l'étouffement, peut-être, j'en conviens, même si moi je l'ai vécu davantage comme un cocon enveloppant, hypnotisant plus précisément. Qui peut ne pas plaire donc, car il ne se passe rien dans ce livre, si ce n'est la vie, deux cent tranches de vie se superposant.
« le lait tiède du ciel se répand silencieusement sur toute chose. Les toits, les arbres endormis, les automobiles scintillantes. C'est une luminosité blanchâtre qui jaillit dans un soubresaut, épaisse, trouble. Elle tache les nuages et s'y suspend. On entend le halètement du jour qui vient, une respiration profonde qui s'arrête un moment, comme si la Terre était sur le point de s'immobiliser et de tourner dans l'autre sens avant de reprendre sa trajectoire et d'apporter un nouveau jour.
La nuit n'a pas pu refroidir le bitume, il est toujours là, somnolent et chaud, serpentant de toute sa croute de fièvre. le soleil monte, obstiné. La vue frémit. C'en est finit des heures vaines, de la pitrerie de la mort. le jour commence. Les insectes creusent la terre ».
Des histoires racontées comme celle narrée par une grand-mère, la fameuse histoire du « Vampire de la rue Molinillo », un journal intime (celle de l'Athlète) touchant, viennent ponctuer le récit apportant quelques bouffées d'oxygène à l'inexorable défilement du temps et aux faits et gestes qui s'enchainent. A noter : la liste des 200 personnages se trouvent à la fin du récit, personnellement je suis allée le consulter à deux ou trois reprises mais dans l'ensemble on ne se perd pas, les personnages sont bien identifiables.
L'auteur a été multirécompensé dans son pays pour ce livre, il a reçu notamment le Premio de la Crítica et le prix Juan Goytisoloet. Pas étonnant. Ce livre est d'une grande inventivité et d'un style percutant. Inoubliable pour ma part, j'ai été happée. Un coup de coeur !
« Ma vie, cette barque qui s'aventure dans la noirceur de la mer, ces lanternes qui brillent dans l'encre ».
Connaissez-vous le terral ? Ce vent côtier, en Espagne, qui balaie les rues et les passages solitaires, lèche les façades et les vitres des fenêtres fermées, contraint les gens à cuire lentement à l'intérieur des maisons, à vivre dans l'obscurité de pièces surchauffées aux volets fermés. Un vent qui défile dans les torrents à la recherche de la mer, dans les ruelles des banlieues en modelant tout sur son passage, immeubles, personnages, automobiles et végétation. « Un vent qui gouverne les têtes, pénètre les pores, les oreilles et le moindre orifice ouvert dans le corps de n'importe quel humain, bête, machine, maison, porte, brèche, fenêtre, fissure, blessure ou plaie ». Déposant une patine d'aridité et de sécheresse couleur sepia, patine ondoyante en effluves de mirage. Faisant des insectes et notamment des fourmis les maitres des lieux.
Si eux s'en sortent, il n'en va pas de même des gens. Comme nous le montre Antonio Soler avec virtuosité, d'une plume nerveuse et tranchante. Oui Antonio Soler prend une ville espagnole, Malagà, sa propre ville, comme objet d'étude et personnage principal du roman, et y introduit une lame, la découpe au scalpel, ouvre ses chairs sanguinolentes et regarde. Il regarde juste, sans juger. D'un oeil presque froid. Il voit ce monde grouiller, asticots urbains, asticots humains desséchés, piégés dans leur ville, dans leur quartier, il observe d'un regard dénoué de pitié, dénoué de mépris. Dénoué d'empathie aussi. Il nous offre sur un plateau, comme en pâture, ce vrombissement, ces gesticulations, la vie tellement vaine de personnages dont le destin semble déjà écrit, tracé…glu dont ils n'arrivent pas à s'extraire.
« Sud » est une plongée en abime, sans concession, une caméra filmant, durant une journée caniculaire, la vie d'une kyrielle de personnages, alternant entre arrêts sur image, et travelings vertigineux. Deux cent personnages tous plus ou moins liés, fourmilière grouillante de vie, d'espoirs, de désenchantements, trajectoires implacables allant toutes au même endroit, comme ce soleil ardent qui suit tout simplement son cycle. Cette loupe se promène sur tous ces pauvres bougres, qui vivent la canicule comme une punition ou une malédiction, chaleur les engluant encore davantage dans les affres de l'urbanité, durant vingt-quatre heures, une loupe qui parfois grossit les faits et gestes de quelques-uns, parfois passe vite, liant en un geste rapide et flou les uns aux autres.
Adolescents en quête de sensations et débordant d'émotions, hommes et femmes tiraillés entre ardeur et désenchantement, entre désir poétique et érotisme pathétique, retraités, junkies, ouvriers, femmes au foyer, riches et pauvres, la loupe grossit démesurément leur solitude, leur absurdité, leur fragile condition, leur bonheur aussi parfois même si « le bonheur qui existe bel et bien n'a rien ou presque à raconter ».
Et les moments de communion dans la journée, lorsque tous plus ou moins font la même chose au même moment, comme le déjeuner au milieu de la journée.
« Ils mangent. L'athlète mange, son ancien ami, le meilleur au quatre cents mètre, Felipe Vicarià, mange, Consuelo la Géante mange avec ses petites dents, la soeur de Rafi Villaplana mange debout dans la cuisine, ils mangent. Ils mangent tous, le vent mange et les fourmis mangent, ils mangent des légumes secs, des déchets morts, de la viande coupée en morceaux, des poissons noyés hors de l'eau, des légumes bouillis et des animaux vidés de leur sang. Guille mange un sandwich aux poivrons et au miel, Piluca mange et Pedroche mange. Les molaires et les mâchoires. La docteur Galàn ouvre la bouche et reçoit la première gorgée de levure fermentée, amère, tout en pensant à son fils et à l'homme mort, au milieu du silence Cèspedes l'abattu avale sa première bouchée, Floren l'heureux mange et voit sa fille manger, Pedroche le craintif mange et Ismael avale la dernière cuillérée de lait aigre, les aliments glissent, descendent et coulent dans les bouches et les gorges. En route vers le puits obscur ».
Le début du livre m'a happée et si je l'ai pris sans hésiter, sans trop savoir dans quoi je plongeais, c'est pour son incipit. J'ai lu l'incipit dans ma librairie et je n'ai pu le lâcher. On entre dans ce livre comme on entre dans l'eau, enveloppée de cette résistance plaisante, une douceur qui caresse et opprime légèrement. Dès l'incipit, je savais que ce livre serait hors norme. Cette manière de parler de l'aube laiteuse avec un style de prime abord si flamboyant, cette manière ensuite de nous amener dans un plan très cinématographique- zooms, plans serrés et grand angle- au corps prostré et mourant d'un homme, dans un terrain vague, corps envahi de fourmi y compris dans les cavités nasales, buccales, dans les oreilles…Un fil tiré puis la pelote qui se vide, les fils qui relient les personnages nous parviennent, Antonio Soler tisse telle une araignée la trame de vies qui s'entrechoquent, se bousculent, se croisent. Magistralement écrit, magistralement orchestré, du grand art, une toile de plus en plus large et complexe, qui nous enserre jusqu'à l'étouffement, peut-être, j'en conviens, même si moi je l'ai vécu davantage comme un cocon enveloppant, hypnotisant plus précisément. Qui peut ne pas plaire donc, car il ne se passe rien dans ce livre, si ce n'est la vie, deux cent tranches de vie se superposant.
« le lait tiède du ciel se répand silencieusement sur toute chose. Les toits, les arbres endormis, les automobiles scintillantes. C'est une luminosité blanchâtre qui jaillit dans un soubresaut, épaisse, trouble. Elle tache les nuages et s'y suspend. On entend le halètement du jour qui vient, une respiration profonde qui s'arrête un moment, comme si la Terre était sur le point de s'immobiliser et de tourner dans l'autre sens avant de reprendre sa trajectoire et d'apporter un nouveau jour.
La nuit n'a pas pu refroidir le bitume, il est toujours là, somnolent et chaud, serpentant de toute sa croute de fièvre. le soleil monte, obstiné. La vue frémit. C'en est finit des heures vaines, de la pitrerie de la mort. le jour commence. Les insectes creusent la terre ».
Des histoires racontées comme celle narrée par une grand-mère, la fameuse histoire du « Vampire de la rue Molinillo », un journal intime (celle de l'Athlète) touchant, viennent ponctuer le récit apportant quelques bouffées d'oxygène à l'inexorable défilement du temps et aux faits et gestes qui s'enchainent. A noter : la liste des 200 personnages se trouvent à la fin du récit, personnellement je suis allée le consulter à deux ou trois reprises mais dans l'ensemble on ne se perd pas, les personnages sont bien identifiables.
L'auteur a été multirécompensé dans son pays pour ce livre, il a reçu notamment le Premio de la Crítica et le prix Juan Goytisoloet. Pas étonnant. Ce livre est d'une grande inventivité et d'un style percutant. Inoubliable pour ma part, j'ai été happée. Un coup de coeur !
« Ma vie, cette barque qui s'aventure dans la noirceur de la mer, ces lanternes qui brillent dans l'encre ».
Un chapitre de six cents pages et un annuaire répertoriant les deux cent personnes croisées en une seule journée caniculaire dans les rues d'une ville du Sud donnent une première impression indigeste de ce roman segmenté en paragraphes allant de dix lignes à dix pages parfois commises en langage SMS ou WhatsApp.
Ces deux cents personnes (dont Julia Mamea, infirmière, homonyme de la mère d'un empereur romain qui avait trois seins) sont des proies potentielles pour les fourmis qui sont omni présentes avec leur macabre gourmandise qui nourrit l'intrigue à défaut de régaler le lecteur.
Les insectes, comme les humains, ont perdu l'usage du sourire et des mots Bonjour, Au revoir, Merci. La brutalité des rapports, la vulgarité des échanges, la sexualité débridée choqueront le lecteur peu familier du chelou et des dialogues admirablement traduits de l'espagnol :
- « keski fou tu cousin ; y veut quoi ce con »
- « il es correct mn cousin »
- « ben ki dégage » (p 494)
Jean-Jacques Rousseau avait prophétisé : “Les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilières mais épars sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine.”
Sud est la démonstration de cette corruption. Roman inoubliable et original l'est assurément ce cauchemar subi par Ana Galan, médecin urgentiste, épouse d'un Dioni à la sexualité ambiguë, mère d'un ado rebelle Guille, dont les destins basculent en cette funeste journée.
Merci aux éditions Rivages de m'avoir sorti de ma zone de confort à l'occasion d'une masse critique qui m'a permis de découvrir Antonio Soler, admirateur d'Ulysse de Joyce.
Ces deux cents personnes (dont Julia Mamea, infirmière, homonyme de la mère d'un empereur romain qui avait trois seins) sont des proies potentielles pour les fourmis qui sont omni présentes avec leur macabre gourmandise qui nourrit l'intrigue à défaut de régaler le lecteur.
Les insectes, comme les humains, ont perdu l'usage du sourire et des mots Bonjour, Au revoir, Merci. La brutalité des rapports, la vulgarité des échanges, la sexualité débridée choqueront le lecteur peu familier du chelou et des dialogues admirablement traduits de l'espagnol :
- « keski fou tu cousin ; y veut quoi ce con »
- « il es correct mn cousin »
- « ben ki dégage » (p 494)
Jean-Jacques Rousseau avait prophétisé : “Les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilières mais épars sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine.”
Sud est la démonstration de cette corruption. Roman inoubliable et original l'est assurément ce cauchemar subi par Ana Galan, médecin urgentiste, épouse d'un Dioni à la sexualité ambiguë, mère d'un ado rebelle Guille, dont les destins basculent en cette funeste journée.
Merci aux éditions Rivages de m'avoir sorti de ma zone de confort à l'occasion d'une masse critique qui m'a permis de découvrir Antonio Soler, admirateur d'Ulysse de Joyce.
On dirait le Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été
Un scénario ? Un synopsis ? La description hyperdétaillée d'un projet de film en préparation ou peut-être d'une oeuvre déjà réalisée ?
Tout ici est terriblement visuel et en perpetuel mouvement, comme un traveling avant qui prend le temps de bien ingérer les images se présentant à la vorace caméra, cinémascope, haute définition, couleurs by deluxe.
Un film choral alors, au générique pléthorique, au séquencement hyper rapide, syncopé et fluide en même temps, découpage au scalpel, hyper précis tracé au cordeau, fondu enchaîné, jamais au noir.
Les personnages : Un moribond envahi de fourmis, un pompiste vert de chez BP, un joggeur dégoulinant de transpiration, un couple de noctambules de hasard au bord d'une piscine au petit matin, un jeune homme qui ruine des étoffes à coups de ciseaux, un guitariste fauché et camé, une bande de zonards, une réceptionniste d'hôtel, son patron, un gamin qui boit du Fanta, une chirurgienne, une bombasse décolorée, un flic héroïque, une mère dépassée par sa progéniture, une édentée qui trimballe un caddy, un avocat qui aime les hommes, la géante, un homme plaqué par sa femme, une petite frappe, une jeune fille victime de son père incestueux, un prêtre …
Les décors : Un terrain vague, du béton, un taxi, un appartement, un autre, une station service, une villa avec piscine, des affiches publicitaires (literie, voiture…), un hôpital, un train, un hôtel, un square, un ascenseur, une moto défectueuse, une boutique d'encadrement, une plage, un bistrot, des voitures, une rue avec deux bancs, le parvis d'une église, un commissariat, des bars de nuit…
Malaga, Espagne sud, Une ville sèche, poussiéreuse, chauffée à blanc par un vent brûlant qui ramollit le bitume et exacerbe les esprits ou les abrutit. Un enfer, pas de Dante, mais de Picasso, l'empreinte de Pablo marque la cité.
Ça couve, se réveille, s'invective, grouille, se douche, se baigne, se bat, mange, fantasme, bande, se flagelle…s'assassine
C'est ‘Babel' de Alejandro Gonzalez Iñarritu, ‘les uns et les autres' de Claude Lelouch, un kaléidoscope schizophrénique, la mosaïque d'une box internet (canal 0), les pièces d'un puzzle géant qui se mettent en place toutes seules, comme mues par sorcellerie, les nombreuses cellules autonomes d'un super organisme vivant qui sort de sa léthargie, les goutes de mercure d'un antique thermomètre explosé qui coulent et s'agglomèrent pour ne faire plus qu'une visqueuse flaque de métal liquide et éblouissant, des unités disparates et multiples qui, au final, ne forment qu'un tout, unique et indivisible : la ville.
Un Lego, non, un système en action, qui se meut, s'émeut.
Lumière ! Allumez les projos ! Tout s'anime, se met en branle, s'articule sous un soleil torride qui plombe déjà une atmosphère étouffante au matin levant.
Tout bourdonne, bout, se met bout à bout dans une boulimie de mouvement, se télescope et la ronde commence à tourner…
Manège mécanique ! Manège en chantier.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voulez, non…qui vous pouvez ?
Plan de tournage de la journée : Près de la station service BP du pompiste vert, le flic héroïque interroge le guitariste camé qui devait rejoindre les zonards et l'édentée dans la rue avec deux bancs mais qui, dans le terrain vague, a découvert le moribond ‘enfourmillé' qui est l'avocat aimant les hommes et le mari de la chirurgienne qui s'occupera de lui elle-même en dépit de toute déontologie dans l'hôpital…
Autres lieux, autres mouvements: d'autres courent, se déplacent en voiture, en trains, à moto, à pieds, en ascenseur, s'absorbent à regarder par la fenêtre d'un immeuble, de sa voiture, de l'hôpital où du train, écrivent, se disputent, se battent, fantasment, fomente un cambriolage, s'allongent sur une plage, se piquent, se masturbent, baisent, mangent, font la manche, se foutent sur la gueule…meurent.
Le jeu du cadavre exquis !
Action ! Ça tourne : Tout s'emmêle, tous se mêlent, les trajectoires comme les histoires s'entremêlent et fusionnent pour ne devenir que l'unique respiration poussive de l'étouffante ville asthmatique emportée dans le tourbillon incessant d'une de ses journées habituelles toujours rythmées aux pas cadencé (dans la troupe, y'a pas d'jambe de bois…)
Zoom arrière : Vue d'en haut, d'une grue télescopique, d'un drone, d'un satellite, tous ces personnages atypiques ou ordinaires ne sont que les bactéries et les enzymes qui pullulent et fermentent dans les entrailles putrides de la bête à l'haleine fétide, avachie, alanguie près de la Méditerranée, abattue comme écrasée par la touffeur hallucinatoire d'une journée d'été caniculaire, même ici, en bord de mer.
Le style : Une écriture changeante, chamarrée, lumineuse, nerveuse, poisseuse, massive aussi, entrez dans la dense, monolithique même, quand, parfois, les dialogues ou les actions des personnages s'encastrent sans réelle ponctuation, nous obligeant à deviner à qui s'exprime, susurre, éructe ou agit. Les actions ou les pensées des très nombreux protagonistes se ‘carambolent' souvent, avivant cette impression d'entité unique dispersée dans divers corps à la fois lointains et agglomérés, sexy ou fanés, actifs ou désespérément épuisés, vifs, canailles, intelligents ou cancres, las. Un serpent gluant mais à sang chaud, un cas à part.
Tout s'agglomère et pourtant on s'y retrouve sans difficulté, pas d'égarement dans cette construction labyrinthique, pas besoin de fil d'Ariane. Malgré l'architecture atypique de ce roman en surchauffe, on emboite le pas des divers spectres hantant cette ville tentaculaire qui grouille de vie sous nos doigts qui tournent les pages, qu'elles soient trépidantes où passivement vécues, qu'elles soient celles de privilégiés agissant de leur plein gré, ou de pauvres loques qui ne voient que passer des jours, identiques entre eux, pareils, désespérants.
Par moments, la valse à mille temps se fige, la valse à mis le temps de s'arrêter, sentant la nécessité, par un flashback furtif ou un arrêt sur image de nous laisser entrapercevoir les traumatismes multiples que trimballent certains personnages, les torturent et les font avancer : la troublante découverte de son homosexualité pour l'un, une fausse couche imaginaire pour l'autre ou une rupture pour cause de flagrant délit d'adultère, un plan à trois et une confusion libertine, le souvenir d'un fait divers impliquant un…vampire.
C'est comme une respiration alors, une bulle d'oxygène, un changement de tempo, une ronde entre deux noires, mais un ralentissement seulement car jamais le frein à main n'est actionné, jamais, et bientôt, le rythme effréné vas reprendre le dessus. le système va s'ébranler.
Coup d'accélérateur ! Vroum, vroum, gaz d'échappement, odeur de gomme sur l'asphalte !!!
Tournez manèges. Attrapez la queue du Mickey !
Et le final, waouh ce final en apothéose ! Unité de temps, pas de lieux ! Une cinquantaine de pages incandescentes, de la lave en fusion qui coule le long du profil abrupt du bouillonnant volcan de la narration. Une pulsation de damné au bord de l'asphyxie donne son rythme au récit où tous les protagonistes s'enchevêtrent en une transe diabolique, point d'orgue d'une journée hors norme d'un été comme à jamais caniculaire.
Au service étroit de la narration, la traduction aussi est excellente, elle jongle avec les styles divers et variés, le rythme, le vocabulaire ou les expressions qui collent parfaitement aux personnages racontés, aux milieux traversés et nous restitue avec réalisme et virtuosité le souffle étouffant d'une ville multiple abrutie par une chaleur torride qui ne laisse que très peu de place au bonheur ou à la poésie.
Malaga, le sud: 24 heures chromo dans la lumière vive d'une cité incendiaire !
24 heures : une tranche de ville.
24 heures, seulement, pour tout un roman ! Il est vrai que dans ce Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été !
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été
Un scénario ? Un synopsis ? La description hyperdétaillée d'un projet de film en préparation ou peut-être d'une oeuvre déjà réalisée ?
Tout ici est terriblement visuel et en perpetuel mouvement, comme un traveling avant qui prend le temps de bien ingérer les images se présentant à la vorace caméra, cinémascope, haute définition, couleurs by deluxe.
Un film choral alors, au générique pléthorique, au séquencement hyper rapide, syncopé et fluide en même temps, découpage au scalpel, hyper précis tracé au cordeau, fondu enchaîné, jamais au noir.
Les personnages : Un moribond envahi de fourmis, un pompiste vert de chez BP, un joggeur dégoulinant de transpiration, un couple de noctambules de hasard au bord d'une piscine au petit matin, un jeune homme qui ruine des étoffes à coups de ciseaux, un guitariste fauché et camé, une bande de zonards, une réceptionniste d'hôtel, son patron, un gamin qui boit du Fanta, une chirurgienne, une bombasse décolorée, un flic héroïque, une mère dépassée par sa progéniture, une édentée qui trimballe un caddy, un avocat qui aime les hommes, la géante, un homme plaqué par sa femme, une petite frappe, une jeune fille victime de son père incestueux, un prêtre …
Les décors : Un terrain vague, du béton, un taxi, un appartement, un autre, une station service, une villa avec piscine, des affiches publicitaires (literie, voiture…), un hôpital, un train, un hôtel, un square, un ascenseur, une moto défectueuse, une boutique d'encadrement, une plage, un bistrot, des voitures, une rue avec deux bancs, le parvis d'une église, un commissariat, des bars de nuit…
Malaga, Espagne sud, Une ville sèche, poussiéreuse, chauffée à blanc par un vent brûlant qui ramollit le bitume et exacerbe les esprits ou les abrutit. Un enfer, pas de Dante, mais de Picasso, l'empreinte de Pablo marque la cité.
Ça couve, se réveille, s'invective, grouille, se douche, se baigne, se bat, mange, fantasme, bande, se flagelle…s'assassine
C'est ‘Babel' de Alejandro Gonzalez Iñarritu, ‘les uns et les autres' de Claude Lelouch, un kaléidoscope schizophrénique, la mosaïque d'une box internet (canal 0), les pièces d'un puzzle géant qui se mettent en place toutes seules, comme mues par sorcellerie, les nombreuses cellules autonomes d'un super organisme vivant qui sort de sa léthargie, les goutes de mercure d'un antique thermomètre explosé qui coulent et s'agglomèrent pour ne faire plus qu'une visqueuse flaque de métal liquide et éblouissant, des unités disparates et multiples qui, au final, ne forment qu'un tout, unique et indivisible : la ville.
Un Lego, non, un système en action, qui se meut, s'émeut.
Lumière ! Allumez les projos ! Tout s'anime, se met en branle, s'articule sous un soleil torride qui plombe déjà une atmosphère étouffante au matin levant.
Tout bourdonne, bout, se met bout à bout dans une boulimie de mouvement, se télescope et la ronde commence à tourner…
Manège mécanique ! Manège en chantier.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voulez, non…qui vous pouvez ?
Plan de tournage de la journée : Près de la station service BP du pompiste vert, le flic héroïque interroge le guitariste camé qui devait rejoindre les zonards et l'édentée dans la rue avec deux bancs mais qui, dans le terrain vague, a découvert le moribond ‘enfourmillé' qui est l'avocat aimant les hommes et le mari de la chirurgienne qui s'occupera de lui elle-même en dépit de toute déontologie dans l'hôpital…
Autres lieux, autres mouvements: d'autres courent, se déplacent en voiture, en trains, à moto, à pieds, en ascenseur, s'absorbent à regarder par la fenêtre d'un immeuble, de sa voiture, de l'hôpital où du train, écrivent, se disputent, se battent, fantasment, fomente un cambriolage, s'allongent sur une plage, se piquent, se masturbent, baisent, mangent, font la manche, se foutent sur la gueule…meurent.
Le jeu du cadavre exquis !
Action ! Ça tourne : Tout s'emmêle, tous se mêlent, les trajectoires comme les histoires s'entremêlent et fusionnent pour ne devenir que l'unique respiration poussive de l'étouffante ville asthmatique emportée dans le tourbillon incessant d'une de ses journées habituelles toujours rythmées aux pas cadencé (dans la troupe, y'a pas d'jambe de bois…)
Zoom arrière : Vue d'en haut, d'une grue télescopique, d'un drone, d'un satellite, tous ces personnages atypiques ou ordinaires ne sont que les bactéries et les enzymes qui pullulent et fermentent dans les entrailles putrides de la bête à l'haleine fétide, avachie, alanguie près de la Méditerranée, abattue comme écrasée par la touffeur hallucinatoire d'une journée d'été caniculaire, même ici, en bord de mer.
Le style : Une écriture changeante, chamarrée, lumineuse, nerveuse, poisseuse, massive aussi, entrez dans la dense, monolithique même, quand, parfois, les dialogues ou les actions des personnages s'encastrent sans réelle ponctuation, nous obligeant à deviner à qui s'exprime, susurre, éructe ou agit. Les actions ou les pensées des très nombreux protagonistes se ‘carambolent' souvent, avivant cette impression d'entité unique dispersée dans divers corps à la fois lointains et agglomérés, sexy ou fanés, actifs ou désespérément épuisés, vifs, canailles, intelligents ou cancres, las. Un serpent gluant mais à sang chaud, un cas à part.
Tout s'agglomère et pourtant on s'y retrouve sans difficulté, pas d'égarement dans cette construction labyrinthique, pas besoin de fil d'Ariane. Malgré l'architecture atypique de ce roman en surchauffe, on emboite le pas des divers spectres hantant cette ville tentaculaire qui grouille de vie sous nos doigts qui tournent les pages, qu'elles soient trépidantes où passivement vécues, qu'elles soient celles de privilégiés agissant de leur plein gré, ou de pauvres loques qui ne voient que passer des jours, identiques entre eux, pareils, désespérants.
Par moments, la valse à mille temps se fige, la valse à mis le temps de s'arrêter, sentant la nécessité, par un flashback furtif ou un arrêt sur image de nous laisser entrapercevoir les traumatismes multiples que trimballent certains personnages, les torturent et les font avancer : la troublante découverte de son homosexualité pour l'un, une fausse couche imaginaire pour l'autre ou une rupture pour cause de flagrant délit d'adultère, un plan à trois et une confusion libertine, le souvenir d'un fait divers impliquant un…vampire.
C'est comme une respiration alors, une bulle d'oxygène, un changement de tempo, une ronde entre deux noires, mais un ralentissement seulement car jamais le frein à main n'est actionné, jamais, et bientôt, le rythme effréné vas reprendre le dessus. le système va s'ébranler.
Coup d'accélérateur ! Vroum, vroum, gaz d'échappement, odeur de gomme sur l'asphalte !!!
Tournez manèges. Attrapez la queue du Mickey !
Et le final, waouh ce final en apothéose ! Unité de temps, pas de lieux ! Une cinquantaine de pages incandescentes, de la lave en fusion qui coule le long du profil abrupt du bouillonnant volcan de la narration. Une pulsation de damné au bord de l'asphyxie donne son rythme au récit où tous les protagonistes s'enchevêtrent en une transe diabolique, point d'orgue d'une journée hors norme d'un été comme à jamais caniculaire.
Au service étroit de la narration, la traduction aussi est excellente, elle jongle avec les styles divers et variés, le rythme, le vocabulaire ou les expressions qui collent parfaitement aux personnages racontés, aux milieux traversés et nous restitue avec réalisme et virtuosité le souffle étouffant d'une ville multiple abrutie par une chaleur torride qui ne laisse que très peu de place au bonheur ou à la poésie.
Malaga, le sud: 24 heures chromo dans la lumière vive d'une cité incendiaire !
24 heures : une tranche de ville.
24 heures, seulement, pour tout un roman ! Il est vrai que dans ce Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été !
La canicule implacable, l'air brûlant d'un été en ville.
C'est dans cette atmosphère moite et troublante que se déploie le dernier roman d'AntonioSoler, l'ardeur électrique d'une seule journée d'été, dès le lever du jour :« le soleil monte obstiné. La vie frémit.. C'en est fini des heures vaines, de la pitrerie de la mort. le jour commence. Les insectes creusent la terre. »
Cela débute dans une décharge, le corps inanimé d'un homme, des fourmis rouges qui s'immiscent dans toutes ses cavités, et alors, comme le terral, ce vent chaud et sec qui brûle le moindre recoin de la ville, la narration prend son envol et balaye les personnages de cette journée, l'immense fourmilière humaine qui grouille dans les rues, les maisons, sur les plages, dans les voitures, partout.
Rien n'échappe au regard scrutateur et envoûtant de Soler, il décortique, dépèce, retranscrit les espoirs, exhibe les plaies, les cruautés. Dans un flux continu, la narration se déplace d'un personnage à l'autre, sans transition ou presque, dans un perpétuel mouvement, celui des heures qui s'écoulent pour les près de 200 personnages qui défilent sous le microscope de Soler. Ismael et ses triangles, la belle Amelia, Céspedes , l'Athlète et son journal intime, l'histoire du Vampire de la rue Molinillo de la grand-mère, la double vie de Dioni , Guille et sa bande de copains,... Tout, Soler nous montre tout de ces vies parallèles qui finissent toujours par se croiser et se suspendent parfois dans une soudaine instantanéité (merveille de l'heure du repas).
C'est poisseux, cru, désespérant et tellement impressionnant. Je me suis laissée complètement envoûtée par cette ambiance urbaine et oppressante, par cette virtuosité cinématographique d'une écriture qui embrasse mille destins d'un seul regard. J'ai eu tellement chaud, et j'ai désiré la nuit avec les personnages, et le soir est enfin venu: « La nuit se déploie […], elle s'étend comme l'immense peau d'un animal récemment chassé, qui saigne encore. La nuit respire, la nuit a un pouls […]. »
Soler a remporté de nombreux prix en Espagne avec ce roman dont le #PremioNacionaldelaCrítica et raconte que c'est lors d'une visite à Dublin pour le Bloomsday, journée-hommage à James Joyce et à son "Ulysse" qu'il a eu l'idée se ce roman, en transposant son propos dans sa ville de Màlaga. Il faudra un jour que je m'attaque à ce monument la littérature mondiale mais je lirai d'abord d'autres romans de Soler
Vous l'aurez compris, coup de chaud, coup de coeur !
C'est dans cette atmosphère moite et troublante que se déploie le dernier roman d'AntonioSoler, l'ardeur électrique d'une seule journée d'été, dès le lever du jour :« le soleil monte obstiné. La vie frémit.. C'en est fini des heures vaines, de la pitrerie de la mort. le jour commence. Les insectes creusent la terre. »
Cela débute dans une décharge, le corps inanimé d'un homme, des fourmis rouges qui s'immiscent dans toutes ses cavités, et alors, comme le terral, ce vent chaud et sec qui brûle le moindre recoin de la ville, la narration prend son envol et balaye les personnages de cette journée, l'immense fourmilière humaine qui grouille dans les rues, les maisons, sur les plages, dans les voitures, partout.
Rien n'échappe au regard scrutateur et envoûtant de Soler, il décortique, dépèce, retranscrit les espoirs, exhibe les plaies, les cruautés. Dans un flux continu, la narration se déplace d'un personnage à l'autre, sans transition ou presque, dans un perpétuel mouvement, celui des heures qui s'écoulent pour les près de 200 personnages qui défilent sous le microscope de Soler. Ismael et ses triangles, la belle Amelia, Céspedes , l'Athlète et son journal intime, l'histoire du Vampire de la rue Molinillo de la grand-mère, la double vie de Dioni , Guille et sa bande de copains,... Tout, Soler nous montre tout de ces vies parallèles qui finissent toujours par se croiser et se suspendent parfois dans une soudaine instantanéité (merveille de l'heure du repas).
C'est poisseux, cru, désespérant et tellement impressionnant. Je me suis laissée complètement envoûtée par cette ambiance urbaine et oppressante, par cette virtuosité cinématographique d'une écriture qui embrasse mille destins d'un seul regard. J'ai eu tellement chaud, et j'ai désiré la nuit avec les personnages, et le soir est enfin venu: « La nuit se déploie […], elle s'étend comme l'immense peau d'un animal récemment chassé, qui saigne encore. La nuit respire, la nuit a un pouls […]. »
Soler a remporté de nombreux prix en Espagne avec ce roman dont le #PremioNacionaldelaCrítica et raconte que c'est lors d'une visite à Dublin pour le Bloomsday, journée-hommage à James Joyce et à son "Ulysse" qu'il a eu l'idée se ce roman, en transposant son propos dans sa ville de Màlaga. Il faudra un jour que je m'attaque à ce monument la littérature mondiale mais je lirai d'abord d'autres romans de Soler
Vous l'aurez compris, coup de chaud, coup de coeur !
J'ai reçu ce roman dans le cadre d'une Masse critique, et ça a été une découverte intéressante. L'histoire se déroule comme une sorte de très long plan séquence, sans aucun chapitre, mais avec une galerie de personnages extrêmement varié. Ce roman est dense, touffu, complexe. Comme il n'y a pas de chapitres, il n'y a pas de moment de respiration ; c'est bien adapté au contexte de la ville plongée dans la canicule, où tout est moite et lourd. On suit les destins d'une variété de personnages qui finissent tous liés d'une manière ou d'une autre.
L'écriture est particulière, mais pas trop désagréable malgré quelques lourdeurs. Certains passages étaient trop longs à mon sens pour apporter réellement quelque chose. Je trouve qu'il peut être compliqué de vraiment se plonger dans le texte, qui ne laisse pas aborder facilement. Globalement, je ne lisais pas ce livre quand j'avais envie de me détendre et de ne pas me prendre la tête. le style de l'auteur est cru, sans fard sur l'humanité et les comportements humains jusqu'aux plus déviants, mais par contre, j'ai rarement vu autant de passages qui traitent de sexe dans un roman ; à force ça devient quand même un peu pénible parce qu'on finit par savoir à quoi s'attendre de la plupart des personnages...
En bref, je suis plutôt contente d'avoir lu ce roman, qui était une expérience particulière !
L'écriture est particulière, mais pas trop désagréable malgré quelques lourdeurs. Certains passages étaient trop longs à mon sens pour apporter réellement quelque chose. Je trouve qu'il peut être compliqué de vraiment se plonger dans le texte, qui ne laisse pas aborder facilement. Globalement, je ne lisais pas ce livre quand j'avais envie de me détendre et de ne pas me prendre la tête. le style de l'auteur est cru, sans fard sur l'humanité et les comportements humains jusqu'aux plus déviants, mais par contre, j'ai rarement vu autant de passages qui traitent de sexe dans un roman ; à force ça devient quand même un peu pénible parce qu'on finit par savoir à quoi s'attendre de la plupart des personnages...
En bref, je suis plutôt contente d'avoir lu ce roman, qui était une expérience particulière !
critiques presse (4)
L'écrivain espagnol publie une superbe fresque andalouse qui se déroule sur une journée à Malaga.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Le roman de l'écrivain espagnol est peut-être trop expérimental, mais il laisse des souvenirs mémorables jusqu'à son formidable terminus : le centre brûlant du cœur humain.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
L’écrivain espagnol est un admirateur d’« Ulysse », le grand roman de Dublin du maître irlandais. C’est dans le même esprit, mais dans sa ville, qu’il a écrit « Sud ».
Lire la critique sur le site : LeMonde
Une œuvre monumentale sur l’amère impuissance à changer sa destinée.
Lire la critique sur le site : Marianne_
Citations et extraits (19)
Voir plus
Ajouter une citation
Je suivais attentivement le parcours de la coccinelle, elle montait lentement sur le pont, l'autoroute lisse de son tibia, en direction du genou et contournait l'obstacle arrondi de l'os pour s'aventurer dans la plaine du mollet en traversant le blé fragile, ce duvet doré et presque invisible sur la peau, épis solitaires, la plaine, le désert pâle qui se trouve après le mollet, cet espace qui n'est ni ventre ni mollet ni entrejambe ni presque la hanche, avec le vide d'un côté et l'ombre du pubis de l'autre, cette haie découpée derrière laquelle se cache l'entrée dans un autre monde, et continuer, continuer vers le haut en direction du thorax, vers ce nord qui est toujours une promesse, monter par le doux escalier des côtes et par la dune soyeuse de la poitrine jusqu'au sombre monument du téton, contempler de puis la cime le merveilleux paysage, ces vallées et ces collines qui s'étendent, ces rigoles, ces pores invisibles, ces grains de beauté planétaires, ces cuvettes et des lits de rivière dépeuplés, poursuivre le chemin en une descente harmonieuse jusqu'à la dépression de la clavicule, remonter ce léger obstacle et entreprendre l'ascension du cou, à l'ombre déjà de la forêt des cheveux, ces vagues, ces courbes de mèches claires, un champ de blé abondant parmi des veines brunes, achever l'ascension par le menton et depuis ce promontoire contempler la frontière rouge des lèvres, ce cratère élastique qui se répand en un sourire qui est l'incarnation du futur et de la vérité (ce qui est pour moi le futur et la vérité, l'incertain, ce que je n'atteindrai peut-être jamais complètement et qui me fuit, comme la vie me fuit, comme fuient les jours, de même que le paysage reste derrière moi lorsque je cours sans aller nulle part), la bouche, la vérité, le futur, mon destin au fond de cette grotte de laquelle pointe, brillante et humide, la pierre des dents, cette archéologie de stalagmites et de stalactites blanches, monter à l'ombre du versant du nez et, oui, arriver alors vraiment au lieu choisi, à la destination ultime, l'embouchure de l’œil, sa rive, le regard dont tout dépend.
L'Athlète entre pieds nus dans la chambre de sa mère et ouvre le tiroir de la commode. Les sous-vêtements, les soutiens-gorge, couleur chair au tissu un peu lâche, les culottes, la tristesse de ces dentelles, fantaisie pour chair périmée. Ce tiroir a quelque chose de mortuaire et la main de l'Athlète y entre comme dans une crypte. Profanant des tombes, soulevant des pierres tombales, reniflant l'odeur de la mort récente , la main fouille et écarte les tissus funéraires en quête d'argent. Et voici les billets, pareils à des enfants endormis dans les profondeurs de la grotte. Ses doigts vont les sortir au soleil et les déposer dans la main du mécanicien, le Fils du Sourd, dans celle du type de la station-service Repsol, dans celle de la serveuse qui encaissera ce qu'ils vont boire avec Lucia. Il ferme le tiroir et détourne les yeux de ces bretelles couleur chair, de la pauvreté, de sa propre misère. "Ma mère a aussi été une femme à une époque lointaine, il y a des mères qui sont en même temps des femmes, comme celle de Jorge, elle oui".
Ainsi, portées par l'obéissance extrême que leur imposent les phéromones, dans le terrain vague de la rue Ortega y Gasset, sous une température de quarante-deux degrés, se meuvent des milliers de fourmis en quête des traces laissées par leurs camarades évacuées avec le corps de Dionisio Grandes Guimerâ. Elles tissent un réseau mobile toujours plus ample, elles marchent sur un sol surchauffé, évitent les morceaux de plastique ramollis par le soleil, avancent parmi des gravats aux proportions gigantesques, les mauvaises herbes, les forêts incendiées, les fragments et les debris de bâtiments d'une autre civilisation. Une archéologie composée d'agglomérats de béton, de grumeaux de plâtre, de mégots desséchés, de bouts de verre, de canettes de soda, d'aluminium écrasé où s'étalent les restes déteints d'un étrange abécédaire sur sa vieille carcasse de navire échoué. Elles pullulent, elles montent, descendent, pistent, communiquent entre elles et au plus profond de leurs connexions nerveuses souffrent obscurément de ce qui ressemble à de la frustration et à de l'inquiétude. Cet aliment pour plusieurs années, cette réserve inépuisable qu'était le corps de Dioniso Grandes Guimerâ, s'est évaporé et, telles les cellules d'un organisme unique, elles cherchent une réparation à cette tromperie, le retour à la vie de ce mirage.
« La chaussure fait l'homme. » La seule chose utile que lui avait apprise son père avant de se pendre au crochet de la salle à manger. C'était là que l'avait trouvé sa mère, son corps dégingandé et chétif se substituant aux quatre abat-jour de la lampe qu'il avait pris soin de poser sur le guéridon avant de se pendre. Mais il n'avait pu éviter que son ventre se vide, cette ultime saleté qui avait souillé ses adieux au monde, la nappe du guéridon et un des quatre abat-jour.
Ses chaussures, en revanche, étaient restées impeccables. Brillantes, fraîchement cirées.
Une perfection digne d'un magazine, pas comme celles que porte son fils, avec lesquelles il marche sur les dalles rosés et blanches et le goudron brûlant de Portada Alta jusqu'à tomber, dans un coude de la rue Papamoscas, sur Tato.
Ses chaussures, en revanche, étaient restées impeccables. Brillantes, fraîchement cirées.
Une perfection digne d'un magazine, pas comme celles que porte son fils, avec lesquelles il marche sur les dalles rosés et blanches et le goudron brûlant de Portada Alta jusqu'à tomber, dans un coude de la rue Papamoscas, sur Tato.
Portada Alta est un désert qui flotte dans la réverbération de l'après-midi. Briques sèches, murs surchauffés, quelques vêtements étendus dans la rue, amidonnés par le soleil. Des arbres anémiques aux troncs enfoncés dans des carrés de terre craquelée. Refuge des fourmis, des mégots, des emballages et des sacs en plastique transhumants. L'ombre de Rafi Villaplana traverse le jeu géométrique des dalles crasseuses. Une légère brise passe, une illusion atmosphérique, un voile d’air frais qui cède immédiatement de nouveau la place à la chaleur sèche du terral. Au coin de la rue, une épaule contre le mur, le Bambin Olmedo révise les photos du glandu au pansement sur le front ; près de lui, assis sur un banc en pierre, Tato fume un joint et, tout en retenant la fumée dans sa poitrine, lui demande, Bambin on va se faire combien de billets avec ce crétin-là, puis, sans avoir reçu de réponse d’un Olmedo pensif, il sourit, crache de la fumée comme un brouillard et montre les défauts dans sa dentition à tout le quartier.
Videos de Antonio Soler (3)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : littérature espagnoleVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antonio Soler (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature espagnole au cinéma
Qui est le fameux Capitan Alatriste d'Arturo Pérez-Reverte, dans un film d'Agustín Díaz Yanes sorti en 2006?
Vincent Perez
Olivier Martinez
Viggo Mortensen
10 questions
95 lecteurs ont répondu
Thèmes :
cinema
, espagne
, littérature espagnoleCréer un quiz sur ce livre95 lecteurs ont répondu