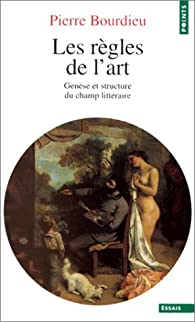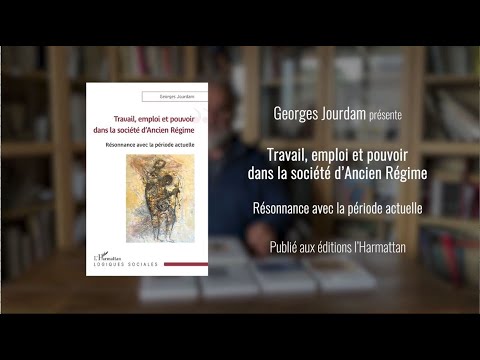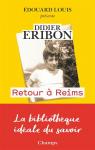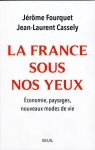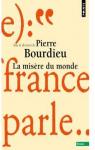Pierre Bourdieu/5
39 notes
Résumé :
C'est au XIXe siècle que se construit un univers littéraire et artistique pleinement arraché aux bureaucraties d'Etat, à leurs académies et aux canons du bon goût qu'elles imposaient. Pierre Bourdieu, décrivant la structure du champ littéraire dans ses configurations successives, montre d'abord ce que l'oeuvre de Flaubert doit à la constitution du champ, c'est-à-dire en quoi Flaubert écrivain est produit par ce qu'il contribue à produire. En définissant la logique -... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les règles de l'artVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
donne des raisons à l'impératif de l'autonomie de l'art et une légitimité à celui-ci en tant que science critique.
Un professeur (d'école d'art) un jour nous a dit: "si vous devez lire un seul livre, lisez celui-là"
À lire uniquement si on fait des études en histoire de l'art, autrement, on pourrait mourir d'ennui. Cela dit, les propos sont intelligents et bien structurés, mais ô combien hermétiques!
Citations et extraits (24)
Voir plus
Ajouter une citation
Il n'est sans doute pas facile, même pour le créateur lui-même dans l'intimité de son expérience, de discerner ce qui sépare l'artiste raté, bohème qui prolonge sa révolte adolescente au-delà de la limite socialement assignée, de l'"artiste maudit", victime provisoire de la réaction suscitée par la révolution symbolique qu'il opère.
Ainsi s'explique que, comme le remarque Marcel Duchamp, les retours à des styles passés n'aient jamais été aussi fréquents : "La caractéristique du siècle qui se termine est d'être comme un "double barelled gun" : Kandinsky, Kupka ont inventé l'abstraction. Puis l'abstraction est morte. On n'en parlerait plus. Elle est ressortie trente-cinq ans après avec les expressionnistes abstraits américains. On peut dire que le cubisme est réapparu sous une forme appauvrie avec l'école de Paris d'après-guerre. Dada est pareillement ressorti. Double feu, second souffle. Cela n'existait pas au XVIII ou XIXe. Après le romantisme, ce fut Courbet. Et le romantisme n'est jamais revenu. Même les préraphaélites ne sont pas une nouvelle mouture des romantiques."
C'est ainsi par exemple que, quand Hugo lui écrit qu'il n'a "jamais dit, l'Art pour l'Art", mais "l'Art pour le Progrès", Baudelaire qui, dans une lettre à sa mère, parle des "Misérables" comme d'un "livre immonde et inepte", redouble dans son mépris pour le sacerdoce politique du mage romantique. Après la période militante de 1848, il rejoint Flaubert dans un désenchantement conduisant au refus de toute insertion dans le monde social et à la condamnation indifférenciée de tous ceux qui sacrifient au culte des bonnes causes, comme George Sand, sa bête noire.
Dans le champ artistique ou littéraire parvenu au stade actuel de son histoire, tous les actes, tous les gestes, toutes les manifestations sont, comme dit bien un peintre, "des sortes de clins d'oeil à l'intérieur d'un milieu" : ces clins d'oeil, références silencieuses et cachées à d'autres artistes, présents ou passés, affirment dans et par les jeux de la distinction une complicité qui exclut le profane, toujours voué à laisser échapper l'essentiel, c'est-à-dire précisément les interrelations et les interactions dont l'oeuvre n'est que la trace silencieuse. Jamais la structure même du champ n'a été aussi présente dans chaque acte de production.
Le ressentiment est une révolte soumise La déception, par l'ambition qui s'y trahit, constitue un aveu de reconnaissance. Le conservatisme ne s'y est jamais trompé : il sait y voir le meilleur hommage rendu à l'ordre social, celui du dépit et de l'ambition frustrée : comme il sait déceler la vérité de plus d'une révolte juvénile dans la trajectoire qui conduit de la bohème révoltée de l'adolescence au conservatisme désabusé ou au fanatisme réactionnaire de l'âge mûr.
Videos de Pierre Bourdieu (58)
Voir plusAjouter une vidéo
Le livre est disponibles sur editions-harmattan.fr : https://www.editions-harmattan.fr/livre-travail_emploi_et_pouvoir_dans_la_societe_d_ancien_regime_resonnance_avec_la_periode_actuelle_georges_jourdam-9782140307652-74976.html
___________________________________________________________________________
Ce livre a pour objectif initial de regrouper dans un même document les différentes formes de travail et d'emploi existant dans les trois ordres de la société d'Ancien Régime. Après avoir souligné le caractère inégalitaire de celle-ci, l'auteur exploite ensuite la question du pouvoir pour ébaucher des points de similitude avec le contexte politico-social actuel. Cet ouvrage propose des comparaisons en utilisant comme points de passage entre les deux mondes les concepts de Pierre Bourdieu que sont l'habitus, le capital économique, le capital social, le capital culturel et le capital symbolique.
Retrouvez nous sur : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp Les librairies L'Harmattan près de chez vous : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp Faire éditer votre livre : https://www.editions-harmattan.fr/envoi_manuscrits
Facebook : https://www.facebook.com/Editions.Harmattan/ Twitter : https://twitter.com/HarmattanParis/ Instagram : https://www.instagram.com/editions.harmattan/
Bonnes lectures !
Crédit : Ariane, la prise de son, d'image et montage vidéo
Ce livre a pour objectif initial de regrouper dans un même document les différentes formes de travail et d'emploi existant dans les trois ordres de la société d'Ancien Régime. Après avoir souligné le caractère inégalitaire de celle-ci, l'auteur exploite ensuite la question du pouvoir pour ébaucher des points de similitude avec le contexte politico-social actuel. Cet ouvrage propose des comparaisons en utilisant comme points de passage entre les deux mondes les concepts de Pierre Bourdieu que sont l'habitus, le capital économique, le capital social, le capital culturel et le capital symbolique.
Retrouvez nous sur : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp Les librairies L'Harmattan près de chez vous : https://www.editions-harmattan.fr/index.asp Faire éditer votre livre : https://www.editions-harmattan.fr/envoi_manuscrits
Facebook : https://www.facebook.com/Editions.Harmattan/ Twitter : https://twitter.com/HarmattanParis/ Instagram : https://www.instagram.com/editions.harmattan/
Bonnes lectures !
Crédit : Ariane, la prise de son, d'image et montage vidéo
+ Lire la suite
autres livres classés : sociologieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Bourdieu (64)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelques questions sur Pierre Bourdieu
En quelle année était-il né ?
1920
1930
1940
1950
7 questions
42 lecteurs ont répondu
Thème :
Pierre BourdieuCréer un quiz sur ce livre42 lecteurs ont répondu