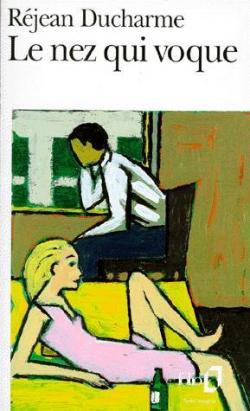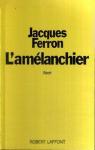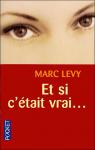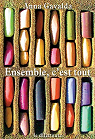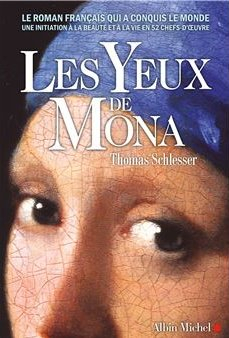"C'est un monstre sacré de la littérature
canadienne qui est mort cet été.Réjean Ducharme avait su conquérir le monde
francophone avec seulement 9 romans en 50 ans d?existence."
Réjean Ducharme - le conseil d'Emmanuel Khérad
https://www.franceinter.fr/emissions/la-librairie-francophone

Réjean Ducharme/5
80 notes
Résumé :
" Je suis un joyeux luron.
J'aime la vie. Je veux la vie et j'ai la vie. Je prends d'un seul coup toute la vie dans mes bras, et je ris en jetant la tête en arrière, sans compter que les haches dont elle est hérissée font gicler le sang.
J'embrasse la vie : on dirait qu'elle est faite pour cela, qu'elle est faite pour me rendre orgueilleux de ma force. Prends une chaise dans tes bras : elle se laissera faire, elle est sans force.
... >Voir plus
J'aime la vie. Je veux la vie et j'ai la vie. Je prends d'un seul coup toute la vie dans mes bras, et je ris en jetant la tête en arrière, sans compter que les haches dont elle est hérissée font gicler le sang.
J'embrasse la vie : on dirait qu'elle est faite pour cela, qu'elle est faite pour me rendre orgueilleux de ma force. Prends une chaise dans tes bras : elle se laissera faire, elle est sans force.
... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le Nez qui voqueVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
Quand j'ai appris tout récemment la disparition, à l'âge de 76 ans, de l'écrivain québecois Réjean Ducharme, je me suis souvenu que j'avais un de ses romans dans ma bibliothèque, acheté l'été 2004 à la librairie Pantoute de Québec et que je n'avais pas encore lu. Je l'ai retrouvé là où il m'attendait patiemment. Il portait ce titre bizarre : "Le nez qui voque" (bizarrerie qui m'avait sûrement poussé à l'acheter à l'époque). Il s'agit du premier roman écrit par Réjean Ducharme, mais publié en second par Gallimard, en 1967, après le succès obtenu l'année précédente par "L'Avalée des avalés" alors que son auteur n'a que vingt-cinq ans. Réjean Ducharme publiera en tout 9 romans, des pièces de théâtre et des scénarios de film. Il écrira des chansons pour Robert Charlebois et Pauline Julien. Son dernier roman, "Gros mots" a été publié par Gallimard en 1999. Il est connu aussi pour avoir toute sa vie fui les média, les photographes et toute forme de publicité, comme les écrivains américains Salinger et Pynchon. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet auteur, je vous invite à visionner cette vidéo, tournée à l'occasion de ses 70 ans et qui respecte sa vie privée : https://www.youtube.com/watch?v=64Nlwvbw3Z8 .
Si j'ai pris la peine de présenter aussi longuement l'auteur du "Nez qui voque" c'est que j'ai beaucoup de mal à parler du livre. Il s'agit d'un objet littéraire à l'interface entre le roman et la poésie, dans la lignée des romans de Queneau et de Vian. le livre comporte d'ailleurs plusieurs poèmes intercalés ça et là dans le texte. Comme Queneau et Vian, Ducharme aime beaucoup jouer avec les mots, leur faire subir diverses distorsions ou substitutions. Alors que La Zazie de Queneau parlait "d'homosessuel" (pour homosexuel), Mille Milles, le narrateur du "Nez qui voque", parle (très fréquemment !) de "s'hortensesturber" (pour se masturber). Disons le tout de suite, le sexe (ou l'absence de sexe) occupe une place très importante dans le roman. Mille Milles (c'est un surnom qu'il s'est donné) est un adolescent de seize ans et il a convié une amie d'enfance, de deux ans sa cadette, qui s'appelle de son vrai nom Ivugivic (elle est d'origine esquimaude), mais qu'il a rebaptisée "Chateaugué", a venir vivre avec lui, à Montréal. Ils couchent dans le même lit, mais s'abstiennent de toute relation sexuelle. Ils ont ensemble le projet de se suicider pour ne pas devenir adultes car "devenir adulte, c'est entrer, être pris de plus en plus, dans le royaume du mal".
Mais dans le monde des adultes, c'est surtout les femmes (et la sexualité) qui posent problème à Mille Milles. Tout au début du livre, il veut choisir un substitut au mot "suicide" et en ouvrant au hasard le dictionnaire, il tombe sur le mot "branle-bas" qu'il adopte immédiatement et désormais Chateaugué et lui parlent de se "branle-basser". le mot "branle-bas" est évidemment très évocateur (sans "nez qui voque" possible !) des difficultés que rencontre le narrateur avec le sexe féminin. Plus encore que la logorrhée du narrateur ou l'omniprésence obsédante de ses jeux de mots, ce sont ses propos caricaturaux, parfois très violents, envers les femmes qui m'ont le plus dérangé dans cette lecture. A titre d'exemple : "Amour ! Amour ! Amour ! Quelle déchéance ! L'homme n'est plus qu'un présent de Dieu à la femme. Il ne faut pas la brusquer, Georges. Il ne faut pas lui faire de mal. Il ne faut pas la violer, Georges. Il faut lui demander la permission." ou encore "Porcs ! Porcs ! Domestiques ! Domestiques de la femme et de l'agent ! Embarquer dans une porcherie, c'est accepter de devenir un porc apprivoisé. La maternité ! La porcherie ! [...] L'homme est le domestique. La femme et le dollar sont les maîtres." Et bien-sûr la femme est l'ennemie du poète, du créateur : "Quant à la femme, j'exècre son influence sur mes idées, ces désirs qu'elle flatte, ces parfums fabriqués avec lesquels elle essaie d'endormir mon aigle. Je subis la femme comme un homme qui se meurt de soif subit la torture d'un mirage. Je déplore la femme. [...] La femme, je la martyriserais ! Son petit visage, c'est à l'acide sulfurique que j'aimerais lui faire ravaler ses faux serments !".
On peut me rétorquer que c'est le narrateur qui tient ces propos, et que rien ne prouve que l'auteur les cautionne. Pourtant la fin du roman est conforme à cette haine de la femme puisque l'auteur met à mort la part féminine de cette histoire (et de son personnage principal ?) et laisse penser que tout est pour le mieux ainsi : "Elle était laide. Elle avait l'air stupide et médiocre dans sa robe trois fois trop grande, dans le lit défait, dans la chambre en désordre. L'odeur âcre du sang m'a pris à la gorge comme quand on passe près d'un abattoir. J'ai comme envie de rire. Je suis fatigué comme une hostie de comique."
On m'objectera aussi qu'Arthur Rimbaud (qui est une référence insistante de Ducharme dans ce roman) n'était pas tendre non plus avec ses "petites amoureuses" : "Ô mes petites amoureuses, / Que je vous hais ! [...] Je voudrais vous casser les hanches / D'avoir aimé !". Mais Rimbaud n'en fait pas un roman de 300 pages et il est difficile d'y voir un côté obsessionnel comme c'est le cas avec le roman de Ducharme.
Que sauver de ce livre amer ? Sans doute un témoignage sincère sur la douleur de vivre d'un adolescent mâle qu'une éducation religieuse culpabilisante aura traumatisé (Ducharme n'en parle pas explicitement mais on peut le lire entre les lignes). Et le dégât est hélas profond ! Et également quelques poèmes, généralement plus souriants que le reste du texte, comme celui-ci :
Les automobiles
Sur le chemin des édicules
Passent des hommes et des femmes
Greffés avec des véhicules
Qui éteignent le sang et l'âme.
Ils passent en automobile,
Ces hommes fous, ces femmes folles.
Et ils se croient, hélas, habiles
De ne vivre que de pétrole.
Ils ne parlent pas : ils klaxonnent.
Et ils ne marchent pas : ils roulent.
Vu qu'à deux jambes, je fonctionne,
Ils rient; ils me traitent de poule.
Ils sont jaunes, ou verts, ou noirs.
Entre eux, point de ségrégation :
Ils bougent entre les trottoirs
Côte à côte et à l'unisson.
––––
Il reste aussi ce dialogue à la fois surréaliste et poignant entre l'auteur et son lecteur : "O mon ami l'homme, que ne t'ai-je encore entretenu des délices symphoniques de t'entendre m'entendre ? Car je t'entends m'entendre.Tu m'entends et c'est comme si tu me parlais. Tu ne m'entends pas à voix basse, tu m'entends à haute voix. Chaque mot que je te dis se répercute en toi comme une goutte d'or, comme dans un puits d'or. Mes murmures te grattent comme les doigts du guitariste grattent la guitare, ô grotte d'or ! Tu es un puits profond et sonore, et un puits qui n'a pas de cordes, mais tu es une guitare, tu es ma guitare. Je joue du puits d'or comme on joue de l'orgue. Je t'entends dire que j'exagère... pourtant je n'entends rien, pourtant, il n'y a personne dans cette chambre."
Une lecture difficile donc, rébarbative, obsessionnelle, irritante à plus d'un titre mais qui ne peut laisser indifférent, comme un cri d'écorché vif qui résonnerait dans la nuit, ou bien peut-être dans un puits d'or.
Si j'ai pris la peine de présenter aussi longuement l'auteur du "Nez qui voque" c'est que j'ai beaucoup de mal à parler du livre. Il s'agit d'un objet littéraire à l'interface entre le roman et la poésie, dans la lignée des romans de Queneau et de Vian. le livre comporte d'ailleurs plusieurs poèmes intercalés ça et là dans le texte. Comme Queneau et Vian, Ducharme aime beaucoup jouer avec les mots, leur faire subir diverses distorsions ou substitutions. Alors que La Zazie de Queneau parlait "d'homosessuel" (pour homosexuel), Mille Milles, le narrateur du "Nez qui voque", parle (très fréquemment !) de "s'hortensesturber" (pour se masturber). Disons le tout de suite, le sexe (ou l'absence de sexe) occupe une place très importante dans le roman. Mille Milles (c'est un surnom qu'il s'est donné) est un adolescent de seize ans et il a convié une amie d'enfance, de deux ans sa cadette, qui s'appelle de son vrai nom Ivugivic (elle est d'origine esquimaude), mais qu'il a rebaptisée "Chateaugué", a venir vivre avec lui, à Montréal. Ils couchent dans le même lit, mais s'abstiennent de toute relation sexuelle. Ils ont ensemble le projet de se suicider pour ne pas devenir adultes car "devenir adulte, c'est entrer, être pris de plus en plus, dans le royaume du mal".
Mais dans le monde des adultes, c'est surtout les femmes (et la sexualité) qui posent problème à Mille Milles. Tout au début du livre, il veut choisir un substitut au mot "suicide" et en ouvrant au hasard le dictionnaire, il tombe sur le mot "branle-bas" qu'il adopte immédiatement et désormais Chateaugué et lui parlent de se "branle-basser". le mot "branle-bas" est évidemment très évocateur (sans "nez qui voque" possible !) des difficultés que rencontre le narrateur avec le sexe féminin. Plus encore que la logorrhée du narrateur ou l'omniprésence obsédante de ses jeux de mots, ce sont ses propos caricaturaux, parfois très violents, envers les femmes qui m'ont le plus dérangé dans cette lecture. A titre d'exemple : "Amour ! Amour ! Amour ! Quelle déchéance ! L'homme n'est plus qu'un présent de Dieu à la femme. Il ne faut pas la brusquer, Georges. Il ne faut pas lui faire de mal. Il ne faut pas la violer, Georges. Il faut lui demander la permission." ou encore "Porcs ! Porcs ! Domestiques ! Domestiques de la femme et de l'agent ! Embarquer dans une porcherie, c'est accepter de devenir un porc apprivoisé. La maternité ! La porcherie ! [...] L'homme est le domestique. La femme et le dollar sont les maîtres." Et bien-sûr la femme est l'ennemie du poète, du créateur : "Quant à la femme, j'exècre son influence sur mes idées, ces désirs qu'elle flatte, ces parfums fabriqués avec lesquels elle essaie d'endormir mon aigle. Je subis la femme comme un homme qui se meurt de soif subit la torture d'un mirage. Je déplore la femme. [...] La femme, je la martyriserais ! Son petit visage, c'est à l'acide sulfurique que j'aimerais lui faire ravaler ses faux serments !".
On peut me rétorquer que c'est le narrateur qui tient ces propos, et que rien ne prouve que l'auteur les cautionne. Pourtant la fin du roman est conforme à cette haine de la femme puisque l'auteur met à mort la part féminine de cette histoire (et de son personnage principal ?) et laisse penser que tout est pour le mieux ainsi : "Elle était laide. Elle avait l'air stupide et médiocre dans sa robe trois fois trop grande, dans le lit défait, dans la chambre en désordre. L'odeur âcre du sang m'a pris à la gorge comme quand on passe près d'un abattoir. J'ai comme envie de rire. Je suis fatigué comme une hostie de comique."
On m'objectera aussi qu'Arthur Rimbaud (qui est une référence insistante de Ducharme dans ce roman) n'était pas tendre non plus avec ses "petites amoureuses" : "Ô mes petites amoureuses, / Que je vous hais ! [...] Je voudrais vous casser les hanches / D'avoir aimé !". Mais Rimbaud n'en fait pas un roman de 300 pages et il est difficile d'y voir un côté obsessionnel comme c'est le cas avec le roman de Ducharme.
Que sauver de ce livre amer ? Sans doute un témoignage sincère sur la douleur de vivre d'un adolescent mâle qu'une éducation religieuse culpabilisante aura traumatisé (Ducharme n'en parle pas explicitement mais on peut le lire entre les lignes). Et le dégât est hélas profond ! Et également quelques poèmes, généralement plus souriants que le reste du texte, comme celui-ci :
Les automobiles
Sur le chemin des édicules
Passent des hommes et des femmes
Greffés avec des véhicules
Qui éteignent le sang et l'âme.
Ils passent en automobile,
Ces hommes fous, ces femmes folles.
Et ils se croient, hélas, habiles
De ne vivre que de pétrole.
Ils ne parlent pas : ils klaxonnent.
Et ils ne marchent pas : ils roulent.
Vu qu'à deux jambes, je fonctionne,
Ils rient; ils me traitent de poule.
Ils sont jaunes, ou verts, ou noirs.
Entre eux, point de ségrégation :
Ils bougent entre les trottoirs
Côte à côte et à l'unisson.
––––
Il reste aussi ce dialogue à la fois surréaliste et poignant entre l'auteur et son lecteur : "O mon ami l'homme, que ne t'ai-je encore entretenu des délices symphoniques de t'entendre m'entendre ? Car je t'entends m'entendre.Tu m'entends et c'est comme si tu me parlais. Tu ne m'entends pas à voix basse, tu m'entends à haute voix. Chaque mot que je te dis se répercute en toi comme une goutte d'or, comme dans un puits d'or. Mes murmures te grattent comme les doigts du guitariste grattent la guitare, ô grotte d'or ! Tu es un puits profond et sonore, et un puits qui n'a pas de cordes, mais tu es une guitare, tu es ma guitare. Je joue du puits d'or comme on joue de l'orgue. Je t'entends dire que j'exagère... pourtant je n'entends rien, pourtant, il n'y a personne dans cette chambre."
Une lecture difficile donc, rébarbative, obsessionnelle, irritante à plus d'un titre mais qui ne peut laisser indifférent, comme un cri d'écorché vif qui résonnerait dans la nuit, ou bien peut-être dans un puits d'or.
Pour mieux comprendre le personnage majeur de ce roman, et donc le roman par lui-même, il convient de l'appréhender par son patronyme « MILLE MILLES » ( Mille : Au Canada, ancienne unité de mesure des distances, équivalente au mile britannique soit environ 1609 m ), un itinéraire phénoménal de plus d' un million six cents mille kilomètres à parcourir, qui condamne le héros à une errance perpétuelle et par voie de conséquence, à une grande lassitude « j'ai tellement de milles dans les jambes" . Mais ce cheminement sans fin est, en fait, un parcours initiatique, une sorte de chemin de croix pour arriver à l'équilibre, à la stabilité voir à l'harmonie, à la paix, à l'âge adulte.
Ducharme métaphorise l'actualité politique et sociale du Québec de la décennie 60 : - La Révolution tranquille - le pays est alors fracturé entre tradition et modernité , innovation et atavisme, partagé entre deux cultures, quatre langues le français académique exacerbé , l'anglais, le franglais, et la québecité , entre pratique religieuse orthodoxe et rétrograde qui frise l'intégrisme et liberté de moeurs et de pensée…
Ce livre peut être lu en se plongeant et en analysant ce contexte historique , il peut être aussi étudié comme un rituel initiatique et traumatisant pour passer à l'âge adulte, d'autres pistes multiples existent, il peut être aussi, et c'est ce que j'ai fait, pris comme un amusement linguistique visant à rechercher les jeux de sonorités , à découvrir les mots- valises, les mots recyclés, les néologismes, les barbarismes, les gallicismes, en traquant les calembours, les contrepèteries , les métaphores, en collectant les références géographiques, historiques, mythologiques, celles concernant les Beaux-arts, … car l'oeuvre de Ducharme foisonne de créations verbales, qui éclatent comme un feu d'artifice lexicologique , et c'est ce qui fait son charme ! En prenant cette option, c'est aussi échapper à toute cette noirceur qui a du mal à se diluer dans le blanc de la neige québécoise.
Ducharme métaphorise l'actualité politique et sociale du Québec de la décennie 60 : - La Révolution tranquille - le pays est alors fracturé entre tradition et modernité , innovation et atavisme, partagé entre deux cultures, quatre langues le français académique exacerbé , l'anglais, le franglais, et la québecité , entre pratique religieuse orthodoxe et rétrograde qui frise l'intégrisme et liberté de moeurs et de pensée…
Ce livre peut être lu en se plongeant et en analysant ce contexte historique , il peut être aussi étudié comme un rituel initiatique et traumatisant pour passer à l'âge adulte, d'autres pistes multiples existent, il peut être aussi, et c'est ce que j'ai fait, pris comme un amusement linguistique visant à rechercher les jeux de sonorités , à découvrir les mots- valises, les mots recyclés, les néologismes, les barbarismes, les gallicismes, en traquant les calembours, les contrepèteries , les métaphores, en collectant les références géographiques, historiques, mythologiques, celles concernant les Beaux-arts, … car l'oeuvre de Ducharme foisonne de créations verbales, qui éclatent comme un feu d'artifice lexicologique , et c'est ce qui fait son charme ! En prenant cette option, c'est aussi échapper à toute cette noirceur qui a du mal à se diluer dans le blanc de la neige québécoise.
Réjean Ducharme est un auteur quebecquois, le Nez qui Voque est son deuxième roman. Publié en 1967 alors que son auteur n'avait que 26 ans, il fait partie de la période des "romans d'enfance" de Ducharme, ses trois premiers ouvrages en fait, dont l'Avalée des Avalés qui fut nommé pour le Goncourt 66.
Ducharme développe en 330 pages les tribulations d'un adolescent qui rejette le monde des adultes. "Je ne veux pas aller plus loin" assure-t'il, "on ne peut pas prétendre à la grandeur quand on est mêlé au sexuel." Aussi Mille Miles, le narrateur, et son amie d'enfance Chateaugué envisagent-ils de se suicider (on dit "branle-basser"), d'en rester là et de s'en tenir pour quitte, parce que "quand on est sorti de l'enfance, il n'y a pas moyen d'aller quelque part sans s'écoeurer." Mais Mille Miles est partagé entre son rêve de pureté et ses pulsions sexuelles.
Réjean Ducharme n'est pas Romain Gary : il n'écrit pas La Vie Devant Soi, il n'y a pas beaucoup de sourires dans ce Nez là ! Il n'y a que la lumière qu'il veut donner, elle est basse, et il fait sombre, il fait cynique. Seule la poésie éclaire un petit peu. L'auteur multiplie les néologismes et les associations d'idées pour en faire des jeux de maux. Et des idées, il en a, Ducharme ! Mais comme dit Mille Miles, ce sont les idées noires, comme les tulipes noires, qui sont les plus belles. Un peu sombre, tout ça. Un beau roman tout de même, à gros caractère. C'est ce qu'il faut pour lire les romans ténébreux.
Merci, précieuse camarade Coli, pour tes judicieuses orientations et cette découverte.
Ducharme développe en 330 pages les tribulations d'un adolescent qui rejette le monde des adultes. "Je ne veux pas aller plus loin" assure-t'il, "on ne peut pas prétendre à la grandeur quand on est mêlé au sexuel." Aussi Mille Miles, le narrateur, et son amie d'enfance Chateaugué envisagent-ils de se suicider (on dit "branle-basser"), d'en rester là et de s'en tenir pour quitte, parce que "quand on est sorti de l'enfance, il n'y a pas moyen d'aller quelque part sans s'écoeurer." Mais Mille Miles est partagé entre son rêve de pureté et ses pulsions sexuelles.
Réjean Ducharme n'est pas Romain Gary : il n'écrit pas La Vie Devant Soi, il n'y a pas beaucoup de sourires dans ce Nez là ! Il n'y a que la lumière qu'il veut donner, elle est basse, et il fait sombre, il fait cynique. Seule la poésie éclaire un petit peu. L'auteur multiplie les néologismes et les associations d'idées pour en faire des jeux de maux. Et des idées, il en a, Ducharme ! Mais comme dit Mille Miles, ce sont les idées noires, comme les tulipes noires, qui sont les plus belles. Un peu sombre, tout ça. Un beau roman tout de même, à gros caractère. C'est ce qu'il faut pour lire les romans ténébreux.
Merci, précieuse camarade Coli, pour tes judicieuses orientations et cette découverte.
L'art de Ducharme dans ce livre est de pouvoir le comprendre à différents niveaux d'interprétation, fable sur l'amour, rite de passage vers l'âge adulte ou lutte pour la vie. le langage comme toujours est le moteur premier de l'intrigue.
Dans ce récit, Ducharme met en scène un personnage adolescent de 16 ans dont le pseudonyme est Mille Milles. Mille Milles s'adresse à Chateaugué en rédigeant son journal. Chateaugué a 14 ans et elle partage la chambre de Mille Milles située au 417 de la rue du Bon-Secours à Montréal. Les deux protagonistes font un pacte de suicide. Ce livre, c'est un adieu à l'enfance, c'est le passage obligé vers le monde des adultes. Divers thèmes y sont abordés comme l'enfance, la littérature, l'écriture, l'incommunicabilité, le refus du monde des adultes, la vie, la mort…
Lien : https://madamelit.me/2017/08..
Lien : https://madamelit.me/2017/08..
Citations et extraits (30)
Voir plus
Ajouter une citation
Je ne me ressemble pas. Je ne me ressemble jamais. Ma main se ressemble. Chaque fois que je me retrouve, je me trouve différent. Je suis différent de ce que j'étais il y a une seconde. J'ai, ce soir, quelque chose à dire, et je n'arriverai pas à le dire. Je ne suis pas moi: voilà en deux mots incompréhensibles ce que je veux dire. Je ne suis pas moi pour la seule et unique raison que moi n'existe pas. Je ne cherche pas à aveugler de paradoxes. Douloureusement, je cherche à comprendre. J'ai un passé, certes, un passé arrêté, fixe, inchangeable, ressemblant à lui-même en tout lieu et toute circonstance. Mais ce passé n'est pas moi, puisque je n'y suis plus. On dit: « Voilà moi ! » comme on dit: « Voilà une chaise! »; c'est-à-dire qu'on se prend pour une chose, pour quelque chose qui peut être défini, nommé, et qui correspond toujours, avec exactitude et précision, à cette définition, à ce nom. Or, je ne suis pas pareil à ce que j'étais hier. Or, ma chaise est ce qu'elle était hier et je ne suis pas ce que j'étais hier. Or, je me réserve des surprises et ma chaise ne me réserve pas de surprises.a chaise a conservé la même couleur, la même forme, le même poids, la même utilité, le même courage, les mêmes doutes, les mêmes certitudes, le même sourire, la même grimace, la même âme. Mille Milles n'a rien conservé, Mille Milles a changé de tout. Hier j'étais fort; aujourd'hui je suis faible. Hier j'étais joyeux; aujourd'hui je suis triste. Hier je n'avais besoin de personne. Aujourd'hui j'ai besoin de moi, du meilleur de moi-même. J'avais soif; je suis soûl.Les arbres étaient beaux; ils sont aigres.
Chateaugué et moi, nous nous sommes assis sur le trottoir. Je note avec précision tout ce qui se déroule avant ma mort et sa mort. Tout ce qui arrive, arrive avant la mort ; car le mort est toujours après et qu’après il y a toujours la mort. En un mot, après la mort, il n’arrive rien. Je ne dis pas cela dans le but de passer pour sérieux et subtil. Je dis cela parce que j’en ai envie. Il y en a tellement qui parlent de la mort pour faire peur aux autres, parce qu’ils veulent se faire prendre au sérieux, parce qu’ils veulent se prendre au sérieux. Si la mort est grande et sérieuse, ceux qui ont la faculté de mourir sont grands et respectables ; c’est ainsi qu’ils raisonnent. Il y a qui grandisse la mort pour se grandir eux-mêmes, pour monter dans leur propre estime. Si la vie est monotone et ennuyeuse, qu’est cette mort qui en est le terme ? La mort est la fin de la monotonie et de l’ennui, de l’attente à vide, de la platitude, de la pluvitude. La mort est la fin de rien, de rien du tout, de moins que rien.
Ecrire est la seule chose que je puise faire pour distraire mon mal et je n’aime pas écrire. Mon état est difficile à décrire. Tout en moi est vide, effondré. Ma maison du rêve , vide, s‘est effondrée. Ma maison de l’amitié, vide, s’est effondrée. Ma maison de la convoitise, vide, s’est effondrée. Ma maison du courage, pourrie, va s’effondrer. Ma maison de la soif, de la faim et des élans, vide, s’est effondrée. Je ne veux plus rien. On ne peut pas vouloir l’impossible. On peut espérer en l’impossible à condition d’être imbécile.
Qu’est-ce que je suis? Je suis seul, j’ai peur, mes bourreaux m’attendent. C’est, encore, la nuit! C’est, déjà, la nuit! Qu’est-ce qui rend tout lent et doux? Mourir. Oui! Mourir! C’est cela. C’est cela. Déjà, tout se calme, tout s’en va. Je suis bien. Déjà, tout est plus simple, plus facile. J’étais amer parce que c’était la nuit, déjà. Je ne suis plus amer : j’ai le goût de mourir et je meurs. Je meurs, doucement, doucement. Les nuits viennent trop tôt… Qu’importe que les nuits viennent trop tôt, que jours et nuits courent et essoufflent… Qu’importe à celui que la mort vient, à son appel, prendre sa douce inertie.
Loin de vous
Tu cours, tu cours ; tu disparais;
Tu es englobée par la nuit.
Du monde, c’est bientôt l’arrêt;
Tous les oiseaux tombent sans bruit.
Je ne suis rien, même pas seul.
Je n’ai plus rien, même pas d’âge.
Je suis en vie dans un linceul,
Enseveli dans un mirage…
Belle, reviens avant un mois.
Dans un mois, je serai pourri.
Viens déclencher les grands émois
Avec un rire ou quelque cri.
Reviens ici tout réveiller.
Reviens. Tout dort, tout cesse.
Les tambours se font oreilles.
Tout semble oublier mon adresse.
Loin de vous
Tu cours, tu cours ; tu disparais;
Tu es englobée par la nuit.
Du monde, c’est bientôt l’arrêt;
Tous les oiseaux tombent sans bruit.
Je ne suis rien, même pas seul.
Je n’ai plus rien, même pas d’âge.
Je suis en vie dans un linceul,
Enseveli dans un mirage…
Belle, reviens avant un mois.
Dans un mois, je serai pourri.
Viens déclencher les grands émois
Avec un rire ou quelque cri.
Reviens ici tout réveiller.
Reviens. Tout dort, tout cesse.
Les tambours se font oreilles.
Tout semble oublier mon adresse.
J'ai seize ans et je suis un enfant de huit ans. C'est difficile à comprendre . Ce n'est pas facile à comprendre. Personne ne le comprend excepté moi. Nêtre pas compris ne me dérange pas. Cela ne me fait rien. Je m'en fiche Moi, je reste le même. Je ne veux pas aller plus loin; je reste donc arrêté
Je les laisses tous vieillir, loin devant moi. Je reste derrière , avec moi , avec moi l'enfant, loin derrière, seul , intact et inccoruptible
Je les laisses tous vieillir, loin devant moi. Je reste derrière , avec moi , avec moi l'enfant, loin derrière, seul , intact et inccoruptible
Videos de Réjean Ducharme (9)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Réjean Ducharme (13)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature québécoise
Quel est le titre du premier roman canadien-français?
Les anciens canadiens
La terre paternelle
Les rapaillages
L'influence d'un livre
Maria Chapdelaine
18 questions
219 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature québécoise
, québec
, québécoisCréer un quiz sur ce livre219 lecteurs ont répondu