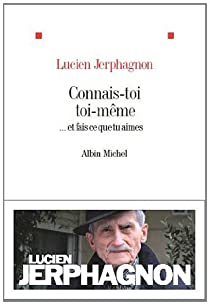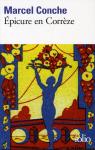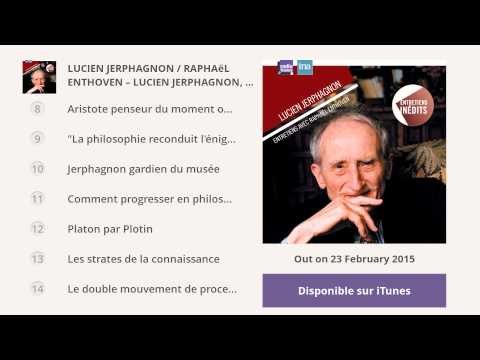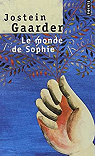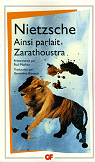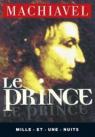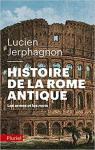Lucien Jerphagnon/5
46 notes
Résumé :
Qu'il parle de Platon ou de Gladiator, qu'il cherche la clef du bonheur ou qu'il réfléchisse à la question de la mort, Lucien Jerphagnon entraîne son lecteur dans un voyage au long cours de trente siècles. Nous voici les complices, dans le rire et l'étonnement, de Socrate, saint Augustin ou Umberto Eco.
Avec ce grand livre, qui tire un trait d'union entre le temps des mythes et celui des mystères, Lucien Jerphagnon, en humaniste éclairé, offre un flor... >Voir plus
Avec ce grand livre, qui tire un trait d'union entre le temps des mythes et celui des mystères, Lucien Jerphagnon, en humaniste éclairé, offre un flor... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Connais-toi toi-même... : Et fais ce que tu aimesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (12)
Voir plus
Ajouter une critique
Il s'agit davantage d'un travail d'historien sur la longue et riche période de l'Antiquité qu'une étude où émergerait la formule mise en exergue avec ce titre un peu racoleur.
C'est donc un titre trompeur "à plus d'un titre", puisqu'il n'est nullement question de bien-être, de santé ou de pensée positive.
En effet le contenu conviendra parfaitement à un passionné d'histoire tant le propos est clair et son cheminement fluide respectant la chronologie.
Le récit commence sous la lumière grecque, avec Socrate, Platon, les sophistes et Plotin puis se développe sous Roma aeterna avec notamment Sénèque puis les Césars et se termine par un hommage vibrant à la vie de Saint Augustin sans qui, on le pressent, le christianisme ne serait pas ce qu'il est actuellement. Les points développés se concentrent finalement sur ce dernier mais aussi sur les sectes chrétiennes. Développements qui montrent l'intérêt de l'auteur pour la foi sans que cela ne tende vers le prosélytisme sinon le livre se serait comme fermé de lui-même entre mes mains.
Jerphagnon propose une lecture de l'Histoire que j'ai trouvée habile et instructive.
Ce qui prévaut pour les trois quarts du livre, voit une dernière partie plus confuse avec un changement radical de période, de style et de contenu.
Jerphagnon se départ alors de sa toge de vieux pédagogue malicieux pour enfiler le bleu de chauffe et se lancer frénétiquement dans l'explication des propos de philosophes plus récents: Jankélévitch et Bergson. Explications pour moi, peu convaincantes mais qui trouveront sans doute preneur chez des initié(e)s.
Mis à part ce dernier point, l'historien Jerphagnon s'appréciera ici grandement par le florilège de ses textes sur l'Antiquité.
C'est donc un titre trompeur "à plus d'un titre", puisqu'il n'est nullement question de bien-être, de santé ou de pensée positive.
En effet le contenu conviendra parfaitement à un passionné d'histoire tant le propos est clair et son cheminement fluide respectant la chronologie.
Le récit commence sous la lumière grecque, avec Socrate, Platon, les sophistes et Plotin puis se développe sous Roma aeterna avec notamment Sénèque puis les Césars et se termine par un hommage vibrant à la vie de Saint Augustin sans qui, on le pressent, le christianisme ne serait pas ce qu'il est actuellement. Les points développés se concentrent finalement sur ce dernier mais aussi sur les sectes chrétiennes. Développements qui montrent l'intérêt de l'auteur pour la foi sans que cela ne tende vers le prosélytisme sinon le livre se serait comme fermé de lui-même entre mes mains.
Jerphagnon propose une lecture de l'Histoire que j'ai trouvée habile et instructive.
Ce qui prévaut pour les trois quarts du livre, voit une dernière partie plus confuse avec un changement radical de période, de style et de contenu.
Jerphagnon se départ alors de sa toge de vieux pédagogue malicieux pour enfiler le bleu de chauffe et se lancer frénétiquement dans l'explication des propos de philosophes plus récents: Jankélévitch et Bergson. Explications pour moi, peu convaincantes mais qui trouveront sans doute preneur chez des initié(e)s.
Mis à part ce dernier point, l'historien Jerphagnon s'appréciera ici grandement par le florilège de ses textes sur l'Antiquité.
Lucien Jerphagnon a un humour qui sert à conter l'histoire antique (grecque et romaine) ; notre histoire. Car comment ne pas discerner dans notre urbanisme, nos institutions la "patte" de ce passé. Un monde grec avec ses cités-Etats telles qu'Athènes, ses mythes, ses esclaves ; Pythagore "l'inventeur" de la philosophie, Socrate et Platon, les plus connus des philosophes grecs.
Rome a vécu mille ans avant de "lâcher" sa dominations politique et militaire. Mais les termes République et Empire sont restés vivaces. Les romains s'approprient les Dieux et l'art de vivre hellénistiques. le polythéisme doit faire face à un nouveau venu le Christianisme qui dans un premier temps est combattu avant d'être adoubé par l'empereur Constantin. Malgré les querelles intestines des premières sectes chrétiennes, le monothéisme grandit. La foi se révèle à des hommes comme Augustin d'Hippone qui devient St Augustin.
Lucien Jerphanon nous livre aussi les ramifications de la philosophie antique pour notre société contemporaine en convoquant Bergson qui se questionne sur les conditions du penseur. Il termine par le cinéma et ses représentations de cette âge remarquable.
Rome a vécu mille ans avant de "lâcher" sa dominations politique et militaire. Mais les termes République et Empire sont restés vivaces. Les romains s'approprient les Dieux et l'art de vivre hellénistiques. le polythéisme doit faire face à un nouveau venu le Christianisme qui dans un premier temps est combattu avant d'être adoubé par l'empereur Constantin. Malgré les querelles intestines des premières sectes chrétiennes, le monothéisme grandit. La foi se révèle à des hommes comme Augustin d'Hippone qui devient St Augustin.
Lucien Jerphanon nous livre aussi les ramifications de la philosophie antique pour notre société contemporaine en convoquant Bergson qui se questionne sur les conditions du penseur. Il termine par le cinéma et ses représentations de cette âge remarquable.
Ce n’est pas en connaissance de cause que j’ai ouvert cet ouvrage.
Pour moi la formule évoquait Saint Augustin, une figure que j’apprécie et je suis donc plongée sur l’ouvrage sans l’examiner plus avant.
Je suis donc restée quelque peu perplexe en me retrouvant avec un ouvrage de philosophie entre les mains…il y a longtemps que je n’ai plus ouvert un manuel de philosophie.
J’ai dû m’aider du dictionnaire maintes fois, cependant la lecture de monsieur Jerphagnon est fort plaisante et sa façon de nous prendre la main pour nous emmener à la découverte de l’histoire des idées et des idéaux transformerait le pire des cancres de la classe de philo en érudit.
Parfum de collège et de syllabi, nostalgie, rires, pensées et sourires, c’était là un beau moment de lecture
Monsieur Jerphagnon ce livre fait de vous un « O capitaine, mon capitaine » pour l’élève avide de découvertes que j’étais restée sans le savoir.
Pour moi la formule évoquait Saint Augustin, une figure que j’apprécie et je suis donc plongée sur l’ouvrage sans l’examiner plus avant.
Je suis donc restée quelque peu perplexe en me retrouvant avec un ouvrage de philosophie entre les mains…il y a longtemps que je n’ai plus ouvert un manuel de philosophie.
J’ai dû m’aider du dictionnaire maintes fois, cependant la lecture de monsieur Jerphagnon est fort plaisante et sa façon de nous prendre la main pour nous emmener à la découverte de l’histoire des idées et des idéaux transformerait le pire des cancres de la classe de philo en érudit.
Parfum de collège et de syllabi, nostalgie, rires, pensées et sourires, c’était là un beau moment de lecture
Monsieur Jerphagnon ce livre fait de vous un « O capitaine, mon capitaine » pour l’élève avide de découvertes que j’étais restée sans le savoir.
Il s'agit d'un ensemble de textes, publiés dans des revues ou magazines. Donc des textes plutôt courts, consacrés aux divers sujets de prédilection de l'auteur, l'antiquité, Saint Augustin, les gnostiques, et quelques sujets plus modernes, comme des articles sur des films, traitant tout de même de l'antiquité.
C'est merveilleusement bien écrit, et se lit tout seul. Cela dit, nous restons à la surface, en ne faisant qu'effleurer les sujets abordés. C'est sans doute inhérent à ces textes courts, destinés à être publiés en revue, mais cela est un peu frustrant. Mes impressions sont contradictoires. C'est à la fois bien agréable de lire quelques pages sur les pérégrinations politiques de Platon, la vie de Sénéque ou les idées de Plotin ou Saint Augustin, rédigées de façon brillante et spirituelle. Mais c'est en même temps frustrant de ne rien apprendre de nouveau, parce que finalement toutes les informations données sont malgré tout relativement connues, et pour ma part, j'ai déjà lu tout cela ailleurs.
J'aurais maintenant envie de lire sur ces sujets des ouvrages un peu plus consistants de l'auteur.
C'est merveilleusement bien écrit, et se lit tout seul. Cela dit, nous restons à la surface, en ne faisant qu'effleurer les sujets abordés. C'est sans doute inhérent à ces textes courts, destinés à être publiés en revue, mais cela est un peu frustrant. Mes impressions sont contradictoires. C'est à la fois bien agréable de lire quelques pages sur les pérégrinations politiques de Platon, la vie de Sénéque ou les idées de Plotin ou Saint Augustin, rédigées de façon brillante et spirituelle. Mais c'est en même temps frustrant de ne rien apprendre de nouveau, parce que finalement toutes les informations données sont malgré tout relativement connues, et pour ma part, j'ai déjà lu tout cela ailleurs.
J'aurais maintenant envie de lire sur ces sujets des ouvrages un peu plus consistants de l'auteur.
Cette compilation d'articles fut publiée de manière posthume . On y retrouve trois veines : l'une historique , portant sur l'Antiquité grecque, latine et les débuts du christianisme . C'est très érudit et intéressant . L'autre plus purement philosophique (Platon,Plotin,Bergson ,Jankélévitch) plus rude car riche en jargon de"métier" qui en a rendu la lecture un peu pénible pour moi. Enfin un troisième aspect qui est celui de commentateur de l'actualité sociale , politique ou cinématographique . C'est plein d'humour et très pertinent ( sur le "politiquement correct "ou le "c'était mieux avant") .
critiques presse (2)
Lire Jerphagnon, c'est élargir son esprit au plus grand nombre d'époques possibles en compagnie d'un érudit aussi intègre que malicieux.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
"Rome a grandi sous trois régimes.
La monarchie d’abord (- 753 à - 509) ; mais le règne du dernier Tarquin rendit les Romains allergiques au mot même de roi, comme en témoignent Tite Live et Cicéron.
Vint alors la république sénatoriale (- 509 à - 27). En droit, l’exécutif était réparti entre magistratures électives : consuls, questeurs, préteurs, censeurs. En fait, sur fond de conquêtes (Afrique, Gaule, Espagne, Orient hellénistique) profitables aux intérêts des grandes familles plus qu’au « peuple romain », la démocratie tourna vite à l’oligarchie ploutocratique, peu soucieuse de la «Rome d’en bas»... D’où plus d’une crise entre possédants et proletarii, gens qui ne pouvaient compter que sur leur descendance (proies) pour vivre. L’instauration d’un tribun de la plèbe ne suffira pas à normaliser les rapports. Et quand on voit Caton l’Ancien, parangon de la vertu ancestrale, énumérer dans son Traité d’agriculture « la vieille vache, le vieil esclave » comme biens sur quoi ne pas perdre à la revente, on comprend mieux l’épisode Spartacus (73-71 av. J.-C.). Et l’on est moins tenté de voir la République romaine comme on l’imaginait en 1789. Ajoutons l’absence d’une administration responsable dans les territoires conquis, ce qui ouvrait la voie à tous les détournements ; la montée en puissance des légions, dont les chefs étaient tentés de se mettre à leur compte ; la prolifération aussi des aventuriers de la politique dans une société instable. Ainsi, on ne s’étonnera pas que, de scandales en empoignades et règlements de comptes entre factions, la République ait basculé dans une guerre civile de cent ans.
Puis ce fut la mise en place de ce qu’on appelle l’empire (27 av. J.-C. à 476).
«Rome doit beaucoup aux guerres civiles», chante Lucain dans la Pharsale... Et, paradoxalement, un régime qui va prolonger de cinq siècles son destin. Vainqueur à Actium (31 av. J.-C.) d’Antoine, qui autrement, en compagnie de Cléopâtre, se fût approprié tout l’Orient romain, le jeune Octave, un petit-neveu de César, prend les affaires en main. Un coup d’Etat ? Que non ! Il savait trop ce qui était arrivé à oncle Jules pour avoir tenté, à ce qu’on disait, de restaurer la monarchie. On ne touche pas à la république. Le Sénat, les élections, les magistratures, tout reste en place, garanti
SPqR . Simplement, Octave se laisse confier tous les pouvoirs par le Sénat, avec en plus l’air de les refuser. A la rigueur, il veut bien être princeps, le premier des sénateurs. De tout cela, il s’explique dans les Res gestae, un testament gravé ici et là en latin et en grec. Du grand art : les apparences sont sauves, les fantasmes démocratiques aussi, et cette géniale astuce des magistratures rassemblées sur une seule tête va être reconduite cinq siècles durant par cinquante-huit « princes » aussi différents qu’il se peut. Tous porteront le nom de César et le surnom d’Auguste, dont Octave, le premier, fut décoré. Ce que nous appelons « l’empire » était né.
Lucien Jerphagnon – Roma Aeterna – dans Connais-toi toi-même p. 98-99
Allbin Michel - 2012"
La monarchie d’abord (- 753 à - 509) ; mais le règne du dernier Tarquin rendit les Romains allergiques au mot même de roi, comme en témoignent Tite Live et Cicéron.
Vint alors la république sénatoriale (- 509 à - 27). En droit, l’exécutif était réparti entre magistratures électives : consuls, questeurs, préteurs, censeurs. En fait, sur fond de conquêtes (Afrique, Gaule, Espagne, Orient hellénistique) profitables aux intérêts des grandes familles plus qu’au « peuple romain », la démocratie tourna vite à l’oligarchie ploutocratique, peu soucieuse de la «Rome d’en bas»... D’où plus d’une crise entre possédants et proletarii, gens qui ne pouvaient compter que sur leur descendance (proies) pour vivre. L’instauration d’un tribun de la plèbe ne suffira pas à normaliser les rapports. Et quand on voit Caton l’Ancien, parangon de la vertu ancestrale, énumérer dans son Traité d’agriculture « la vieille vache, le vieil esclave » comme biens sur quoi ne pas perdre à la revente, on comprend mieux l’épisode Spartacus (73-71 av. J.-C.). Et l’on est moins tenté de voir la République romaine comme on l’imaginait en 1789. Ajoutons l’absence d’une administration responsable dans les territoires conquis, ce qui ouvrait la voie à tous les détournements ; la montée en puissance des légions, dont les chefs étaient tentés de se mettre à leur compte ; la prolifération aussi des aventuriers de la politique dans une société instable. Ainsi, on ne s’étonnera pas que, de scandales en empoignades et règlements de comptes entre factions, la République ait basculé dans une guerre civile de cent ans.
Puis ce fut la mise en place de ce qu’on appelle l’empire (27 av. J.-C. à 476).
«Rome doit beaucoup aux guerres civiles», chante Lucain dans la Pharsale... Et, paradoxalement, un régime qui va prolonger de cinq siècles son destin. Vainqueur à Actium (31 av. J.-C.) d’Antoine, qui autrement, en compagnie de Cléopâtre, se fût approprié tout l’Orient romain, le jeune Octave, un petit-neveu de César, prend les affaires en main. Un coup d’Etat ? Que non ! Il savait trop ce qui était arrivé à oncle Jules pour avoir tenté, à ce qu’on disait, de restaurer la monarchie. On ne touche pas à la république. Le Sénat, les élections, les magistratures, tout reste en place, garanti
SPqR . Simplement, Octave se laisse confier tous les pouvoirs par le Sénat, avec en plus l’air de les refuser. A la rigueur, il veut bien être princeps, le premier des sénateurs. De tout cela, il s’explique dans les Res gestae, un testament gravé ici et là en latin et en grec. Du grand art : les apparences sont sauves, les fantasmes démocratiques aussi, et cette géniale astuce des magistratures rassemblées sur une seule tête va être reconduite cinq siècles durant par cinquante-huit « princes » aussi différents qu’il se peut. Tous porteront le nom de César et le surnom d’Auguste, dont Octave, le premier, fut décoré. Ce que nous appelons « l’empire » était né.
Lucien Jerphagnon – Roma Aeterna – dans Connais-toi toi-même p. 98-99
Allbin Michel - 2012"
Nulle part dans l'histoire, l'homme n'aura pris de sa condition plus exacte connaissance que dans la civilisation grecque, ne l'aura traduite avec pareil génie dans les cosmogonies, les épopées, les tragédies, la philosophie. Cela même valut aux Grecs un rayonnement à nul autre pareil.
Savoir parler en public ne signifiait pas seulement s’exprimer sans bafouiller, mais aussi et surtout capter l’attention de l’auditoire et décocher comme une flèche l’argument qui fait mouche s’il est pointé où et quand il faut.
Rien de plus grec que le mot d’ordre Kairon gnôthi, « Repère le moment » ! Aussi cette denrée nouvelle et surfine que proposait l’enseignement des Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodicos, Antiphon, Thrasymaque et autres, suscita-t-elle dans le monde politique une formidable demande, un remaniement complet des habitudes de pensée, et aussi une violente réaction allergique dont les effets, comme nous venons de le dire, se font encore sentir de nos jours.
Rien de plus grec que le mot d’ordre Kairon gnôthi, « Repère le moment » ! Aussi cette denrée nouvelle et surfine que proposait l’enseignement des Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodicos, Antiphon, Thrasymaque et autres, suscita-t-elle dans le monde politique une formidable demande, un remaniement complet des habitudes de pensée, et aussi une violente réaction allergique dont les effets, comme nous venons de le dire, se font encore sentir de nos jours.
Qu'il y ait du mal dans ce monde, ce n'est pas douteux, mais il n'est que privation du bien. A chacun de s'en délivrer par l’ascèse et par la contemplation philosophique , et non en cédant à des mirages inconsistants où le philosophe ne voit qu'un charlatanisme spirituel.
Tyrans ou démocrates, les gens de pouvoir ont toujours eu le souci d'une uniformité allant dans le bon sens ,le leur.
Videos de Lucien Jerphagnon (10)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : philosophieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Lucien Jerphagnon (53)
Voir plus
Quiz
Voir plus
C'était mieux avant...
« Mon Dieu, protégez-nous de ceux qui nous veulent trop de bien ! » Indice : philosophe et musicologue
Henri de Montherlant
Jean d’Ormesson
Roger Martin du Gard
Vladimir Jankélévitch
16 questions
218 lecteurs ont répondu
Thème : C'était mieux avant suivi du Petit livre des citations latines de
Lucien JerphagnonCréer un quiz sur ce livre218 lecteurs ont répondu