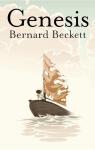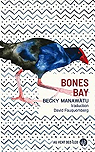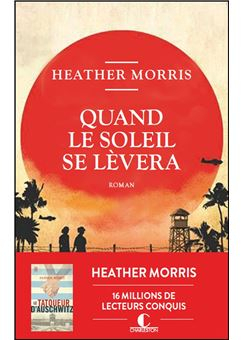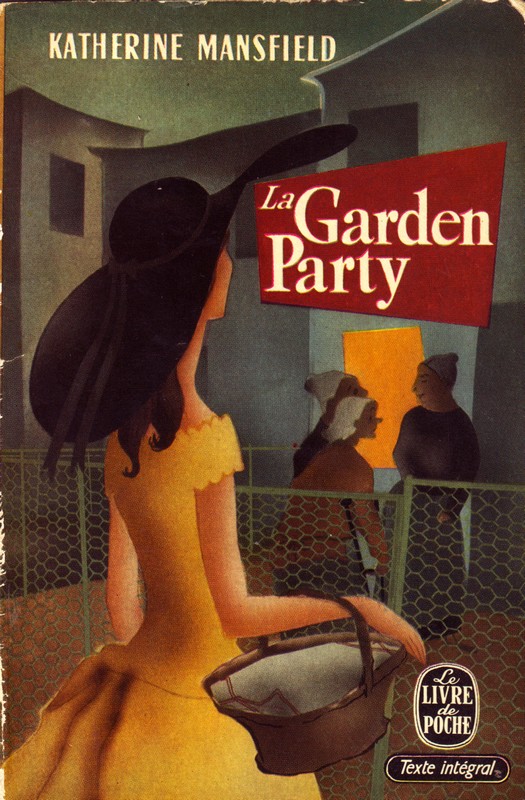Katherine Mansfield
Magali Merle (Traducteur)/5 6 notes
Magali Merle (Traducteur)/5 6 notes
Résumé :
Katherine Mansfield: (1888 - 1923):
Nouvelles:
Bilingue anglais français - Langues pour tous.
***
étiquettes: littérature,nouvelles,recueil de nouvelles,art de la nouvelle,art de la suggestion,fiction,littérature anglaise,littérature britannique,littérature de Nouvelle Zélande,littérature anglophone,littérature anglo-saxonne,classique,classique anglais,classique de la Nouvelle-Zélande,langue... >Voir plus
Nouvelles:
Bilingue anglais français - Langues pour tous.
***
étiquettes: littérature,nouvelles,recueil de nouvelles,art de la nouvelle,art de la suggestion,fiction,littérature anglaise,littérature britannique,littérature de Nouvelle Zélande,littérature anglophone,littérature anglo-saxonne,classique,classique anglais,classique de la Nouvelle-Zélande,langue... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Sur la baie et autres nouvellesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
Etoiles Notabénistes : ******
At The Bay
Traduction : Marthe Duproix pour Stock
ISBN : Inconnu pour l'exemplaire ci-dessus et non encore utilisé pour l'"Intégrale" de Mansfield paru chez Stock et dont cette nouvelle est extraite.
Comme promis, nous retrouvons ici la famille Burnell, alter ego littéraire de la famille natale de Katherine Mansfield. le nourrisson que Linda venait de mettre au monde dans Prélude a un peu grandi et nous confirme, dans un passage très explicite mais non retenu parmi les extraits choisis, ce que nous disions déjà auparavant de l'amour maternel que Linda est censée porter à sa petite tribu : Isabel, Kezia et Lottie, les trois petites filles que nous avions déjà découvertes à l'oeuvre dans Prélude, et le tout dernier, ce benjamin qui ne semble pas encore avoir de prénom (à moins que Linda, dans sa langueur et son indifférence naturelles, ne l'ait oublié.)
La scène est charmante - aussi charmante que glaçante en sa fin. La jeune mère se repose dans le vaste jardin, à l'arrière de la maison, bien à l'ombre sur sa chaise longue, alors que tout le monde a filé à la plage toute proche - c'est la saison des bains de mer. On lui a laissé la garde du petit, probablement installé dans un couffin. Dans la chaleur du soleil néo-zélandais, avec les mille bruissements qui agitent le feuillage des arbres si hauts à l'ombre desquels il repose, au milieu du chant des oiseaux et cerné par le va-et-vient affairé de toute la faune habituelle en cette heure qui est souvent pour elle celle du déjeuner, le nourrisson ne sait plus ni où ni que regarder. Vient l'instant où ses yeux se posent sur sa mère, qui pense, comme d'habitude, à tout autre chose qu'à ce qui l'entoure. Toutefois, se sentant observée, ce qu'elle aime tant puisque c'est signe qu'on s'intéresse à elle, Linda finit par s'interroger. Elle se rend alors compte que c'est son fils, et lui seul, qui la regarde. Un regard malicieux et aimant, l'un de ces regards que les bébés ont pour celle qui leur a donné la vie et que leur instinct repère presque d'office, à l'odeur lorsqu'ils sont à peine nés, au battement du coeur également qui les apaise et aussi en raison de ce quelque chose d'aussi mystérieux que puissant qui fait, que la figure maternelle soit bonne ou mauvaise, qu'elle demeure à jamais la Mère, jusque sous les doigts du fils poussé à bout qui l'étrangle.
Nous ne saurons jamais si le rejeton mâle de la belle Linda Burnell, née Fairfield, à qui, en dépit de ses quatre grossesses successives, son prénom continue à si bien convenir, tentera un jour de l'étrangler. Pour l'instant, un dialogue muet s'instaure entre elle et lui. Et c'est là que Linda, toujours dans ses pensées, avoue au lecteur que non, elle n'aime pas ses enfants. Quoique ce petit ... Peut-être ... Est-ce parce qu'il s'agit d'un garçon ? Ou bien tout simplement parce qu'il était là au bon moment, celui où elle avait envie que, dans cette maison désertée, il traînât encore quelqu'un pour prêter l'attention qu'elle estime due à sa personne ? Toujours est-il qu'elle s'intéresse un moment à lui, et ce très sincèrement. Mais, le regard de l'enfant ayant été attiré par un mouvement dans les arbres, dès lors que cette pauvre petite chose, qui n'a pas encore six mois, fait mine de se désintéresser de sa mère, celle-ci en conclut que non, définitivement, elle ne peut pas aimer ses enfants.
Des enfants qui, loin d'elle, toujours si loin d'elle et tout en admirant sa beauté et son raffinement, mènent très bien leur vie sous la houlette généreuse et attentionnée de leur grand-mère, Mrs Fairfield. Comme dans Prélude, cette petite femme menue, pourtant d'un âge certain, est partout à la fois et veille à tout, avec l'aide, il est vrai, de son autre fille, Beryl, encore célibataire mais toujours fraîche et qui ne désespère pas de se marier. En attendant la concrétisation de ses rêves, ses besoins de jeune femme en bonne santé s'accroissent, surtout en cette atmosphère estivale où les gens se fréquentent avec plus de facilité et ont plus souvent l'occasion de se réunir pour une fête ou une party sans façons. Beryl s'est d'ailleurs rapprochée de Mrs Henry Kember, fréquentation que sa mère voit d'un assez mauvais oeil. Disons que, pour l'époque, Mrs Kember, la seule femme de leur cercle à s'autoriser cigarette sur cigarette, passe pour une femme au mieux libérée, au pire évaporée, voire dépravée. D'un physique banal - qui ne l'a peut-être pas toujours été - dotée d'une fortune confortable, elle a aggravé les choses en épousant un homme de dix ans plus jeune qu'elle. Qui mieux est : cet homme est un Adonis, en tout cas selon les canons de l'époque. Et, s'il ne faut pas être particulièrement malin pour deviner les raisons qui poussent Beryl à fréquenter de si près Mrs Kember, peut-être vaudrait-il mieux bénéficier d'un peu plus d'expérience pour imaginer pourquoi Mrs Kember, laquelle a pourtant bourlingué pas mal, recherche elle-même pareille relation. Enfin, nous vous laissons juges de la situation, à la toute fin de la nouvelle.
Quant à l'Homme de la famille, à savoir l'inénarrable Stanley Burnell, il est toujours aussi actif en ses bureaux, toujours aussi peu présent pour les membres de sa maisonnée, à l'exception de sa chère Linda dont il est, comme de bien entendu, toujours aussi follement amoureux. (A notre grande surprise, nous apprendrons d'ailleurs que Linda est certaine, de son côté, d'être amoureuse de lui et ne déplore, en son héros, qu'une seule facette : l'obligation de se retrouver enceinte plus souvent qu'elle ne le désirerait). Pour en revenir à Stanley le Magnifique, ajoutons qu'il est également toujours aussi convaincu de l'importance de sa propre personne (il n'a pas tout-à-fait tort car ses revenus font tourner une lourde maisonnée) et que, par conséquent, tout, chez lui, doit tourner autour de ladite prodigieuse personne. On dit souvent que les extrêmes s'attirent mais, dans le cas de Linda et Stanley, c'est plutôt l'extrême ressemblance de leur caractère qui les a poussés à s'unir, le besoin congénital d'activité de l'un servant à merveille l'indolence tout aussi innée de l'autre et la beauté de la seconde, son charme et ses bonnes manières rehaussant comme il se doit le statut social du premier.
Nouveauté dans le paysage : l'approfondissement des traits de Jonathan Trout, le beau-frère de Stanley, un bel homme à barbe noire et à voix de stentor, déjà aperçu en silhouette dans Prélude mais qui se révèle ici plus attirant et aussi bien plus intelligent que Stanley. de neuf heures jusqu'à dix-sept heures, Jonathan travaille dans un bureau, afin d'élever ses deux enfants (Pip et Rags, dont nous avions déjà fait la connaissance) mais, s'il rêve de s'évader, il confesse à Linda qu'il ne le fera jamais. Pourquoi ? Oh ! non pour préserver l'adolescence de ses fils, auxquels il semble pourtant vouer une affection sincère, mais tout simplement par paresse et par manque d'ambition. Notons que l'une des rares choses qui lui cause toujours un très grand plaisir, c'est d'ennuyer et d'impatienter le digne Stanley (encore plus de le mettre en retard), notamment en lui gâchant sa baignade matinale par tous les moyens ...
Mais "Sur la Baie" vaut surtout parce que, pour la première fois, dans l'étincelante luminosité qui nimbe la nouvelle - Mansfield y atteint à une incroyable palette de couleurs et d'éclat dans les descriptions qu'elle donne de la Nouvelle-Zélande de son enfance - l'auteur nous y livre, en un parallèle tout aussi impressionnant, sa première rencontre non avec la Mort mais avec l'idée de la Mort. Pour l'enfant encore très jeune qu'est la petite Kezia, la Mort n'est qu'un mot, une abstraction. Elle sait par exemple que son oncle William, celui qui vivait en Australie, est mort - et ceci bien qu'il ne fût pas vieux. Seulement, lors de l'un de ces chauds après-midi consacrés en principe à la sieste mais durant lequel l'enfant discute à bâtons rompus avec sa chère Grand-Mère (dont elle est la préférée et qu'elle-même adore et vénère), Kezia réalise que, un jour ou l'autre, tout le monde meurt. A la question qu'elle lui pose, Mrs Fairfield admet qu'elle aussi, Kezia, un jour ... Qu'elle ne veuille pas mourir n'y fait rien : c'est la loi pour tous. Mais ce n'est pas l'idée de sa mort à elle, Kezia, qui paralyse brusquement l'enfant, c'est l'idée qu'un jour, sa grand-mère, elle aussi, disparaîtra. Ce qui signifie qu'elle ne la verra plus, qu'elle ne l'entendra plus, qu'elle sera séparée d'elle, qu'elle sera seule et que personne ne la protègera plus ...
Le petit dialogue qui amène Kezia à cette amère constatation rappellera peut-être certaines choses à nombre de lecteurs. Toujours par petites touches qui n'ont l'air de rien, Mansfield nous fait appréhender l'une des plus terribles réalités de l'existence, avec son cortège de peurs, d'angoisses, de désespoir et de solitude morale. La scène est émouvante et même parfois drôle, du fait du franc-parler de l'enfant et de la vision de la Grand-Mère, absorbée par son tricot. Mais, justement, la quiétude qui préside en apparence à cet échange, si elle adoucit çà et là le propos, l'aiguise tout autant et le rend plus tranchant, plus inexorable. La scène a beau s'achever dans un jeu entre la grand-mère et la petite-fille, on sait que Kezia - et, à travers elle, celle qui la recréera un jour sur le papier - vient de saisir toute la profondeur de ce mystère abyssal, de cette loi qui s'impose à toutes et à tous et qui, ce faisant, abandonne les survivants à une tristesse qui croît chaque jour et qui finit par les user jusqu'à ce moment où, enfin, leur heure aussi arrive à échéance, au cadran impassible de la Grande Horloge du Temps ...
L'heure du seul écrivain dont Virginia Woolf eut la franchise de se déclarer jalouse, devait sonner le 9 janvier 1923, au prieuré d'Avon, près de Fontainebleau - un retour somme toute logique en notre pays puisque le vrai nom de l'écrivain était "Beauchamp." Nous ne savons pas, par contre, depuis combien d'années la petite Kezia attendait de retrouver la grand-mère qu'elle nous dépeint avec tant d'amour dans "Prélude", "Sur la Baie" et "La Maison de Poupées" ... ;o)
At The Bay
Traduction : Marthe Duproix pour Stock
ISBN : Inconnu pour l'exemplaire ci-dessus et non encore utilisé pour l'"Intégrale" de Mansfield paru chez Stock et dont cette nouvelle est extraite.
Comme promis, nous retrouvons ici la famille Burnell, alter ego littéraire de la famille natale de Katherine Mansfield. le nourrisson que Linda venait de mettre au monde dans Prélude a un peu grandi et nous confirme, dans un passage très explicite mais non retenu parmi les extraits choisis, ce que nous disions déjà auparavant de l'amour maternel que Linda est censée porter à sa petite tribu : Isabel, Kezia et Lottie, les trois petites filles que nous avions déjà découvertes à l'oeuvre dans Prélude, et le tout dernier, ce benjamin qui ne semble pas encore avoir de prénom (à moins que Linda, dans sa langueur et son indifférence naturelles, ne l'ait oublié.)
La scène est charmante - aussi charmante que glaçante en sa fin. La jeune mère se repose dans le vaste jardin, à l'arrière de la maison, bien à l'ombre sur sa chaise longue, alors que tout le monde a filé à la plage toute proche - c'est la saison des bains de mer. On lui a laissé la garde du petit, probablement installé dans un couffin. Dans la chaleur du soleil néo-zélandais, avec les mille bruissements qui agitent le feuillage des arbres si hauts à l'ombre desquels il repose, au milieu du chant des oiseaux et cerné par le va-et-vient affairé de toute la faune habituelle en cette heure qui est souvent pour elle celle du déjeuner, le nourrisson ne sait plus ni où ni que regarder. Vient l'instant où ses yeux se posent sur sa mère, qui pense, comme d'habitude, à tout autre chose qu'à ce qui l'entoure. Toutefois, se sentant observée, ce qu'elle aime tant puisque c'est signe qu'on s'intéresse à elle, Linda finit par s'interroger. Elle se rend alors compte que c'est son fils, et lui seul, qui la regarde. Un regard malicieux et aimant, l'un de ces regards que les bébés ont pour celle qui leur a donné la vie et que leur instinct repère presque d'office, à l'odeur lorsqu'ils sont à peine nés, au battement du coeur également qui les apaise et aussi en raison de ce quelque chose d'aussi mystérieux que puissant qui fait, que la figure maternelle soit bonne ou mauvaise, qu'elle demeure à jamais la Mère, jusque sous les doigts du fils poussé à bout qui l'étrangle.
Nous ne saurons jamais si le rejeton mâle de la belle Linda Burnell, née Fairfield, à qui, en dépit de ses quatre grossesses successives, son prénom continue à si bien convenir, tentera un jour de l'étrangler. Pour l'instant, un dialogue muet s'instaure entre elle et lui. Et c'est là que Linda, toujours dans ses pensées, avoue au lecteur que non, elle n'aime pas ses enfants. Quoique ce petit ... Peut-être ... Est-ce parce qu'il s'agit d'un garçon ? Ou bien tout simplement parce qu'il était là au bon moment, celui où elle avait envie que, dans cette maison désertée, il traînât encore quelqu'un pour prêter l'attention qu'elle estime due à sa personne ? Toujours est-il qu'elle s'intéresse un moment à lui, et ce très sincèrement. Mais, le regard de l'enfant ayant été attiré par un mouvement dans les arbres, dès lors que cette pauvre petite chose, qui n'a pas encore six mois, fait mine de se désintéresser de sa mère, celle-ci en conclut que non, définitivement, elle ne peut pas aimer ses enfants.
Des enfants qui, loin d'elle, toujours si loin d'elle et tout en admirant sa beauté et son raffinement, mènent très bien leur vie sous la houlette généreuse et attentionnée de leur grand-mère, Mrs Fairfield. Comme dans Prélude, cette petite femme menue, pourtant d'un âge certain, est partout à la fois et veille à tout, avec l'aide, il est vrai, de son autre fille, Beryl, encore célibataire mais toujours fraîche et qui ne désespère pas de se marier. En attendant la concrétisation de ses rêves, ses besoins de jeune femme en bonne santé s'accroissent, surtout en cette atmosphère estivale où les gens se fréquentent avec plus de facilité et ont plus souvent l'occasion de se réunir pour une fête ou une party sans façons. Beryl s'est d'ailleurs rapprochée de Mrs Henry Kember, fréquentation que sa mère voit d'un assez mauvais oeil. Disons que, pour l'époque, Mrs Kember, la seule femme de leur cercle à s'autoriser cigarette sur cigarette, passe pour une femme au mieux libérée, au pire évaporée, voire dépravée. D'un physique banal - qui ne l'a peut-être pas toujours été - dotée d'une fortune confortable, elle a aggravé les choses en épousant un homme de dix ans plus jeune qu'elle. Qui mieux est : cet homme est un Adonis, en tout cas selon les canons de l'époque. Et, s'il ne faut pas être particulièrement malin pour deviner les raisons qui poussent Beryl à fréquenter de si près Mrs Kember, peut-être vaudrait-il mieux bénéficier d'un peu plus d'expérience pour imaginer pourquoi Mrs Kember, laquelle a pourtant bourlingué pas mal, recherche elle-même pareille relation. Enfin, nous vous laissons juges de la situation, à la toute fin de la nouvelle.
Quant à l'Homme de la famille, à savoir l'inénarrable Stanley Burnell, il est toujours aussi actif en ses bureaux, toujours aussi peu présent pour les membres de sa maisonnée, à l'exception de sa chère Linda dont il est, comme de bien entendu, toujours aussi follement amoureux. (A notre grande surprise, nous apprendrons d'ailleurs que Linda est certaine, de son côté, d'être amoureuse de lui et ne déplore, en son héros, qu'une seule facette : l'obligation de se retrouver enceinte plus souvent qu'elle ne le désirerait). Pour en revenir à Stanley le Magnifique, ajoutons qu'il est également toujours aussi convaincu de l'importance de sa propre personne (il n'a pas tout-à-fait tort car ses revenus font tourner une lourde maisonnée) et que, par conséquent, tout, chez lui, doit tourner autour de ladite prodigieuse personne. On dit souvent que les extrêmes s'attirent mais, dans le cas de Linda et Stanley, c'est plutôt l'extrême ressemblance de leur caractère qui les a poussés à s'unir, le besoin congénital d'activité de l'un servant à merveille l'indolence tout aussi innée de l'autre et la beauté de la seconde, son charme et ses bonnes manières rehaussant comme il se doit le statut social du premier.
Nouveauté dans le paysage : l'approfondissement des traits de Jonathan Trout, le beau-frère de Stanley, un bel homme à barbe noire et à voix de stentor, déjà aperçu en silhouette dans Prélude mais qui se révèle ici plus attirant et aussi bien plus intelligent que Stanley. de neuf heures jusqu'à dix-sept heures, Jonathan travaille dans un bureau, afin d'élever ses deux enfants (Pip et Rags, dont nous avions déjà fait la connaissance) mais, s'il rêve de s'évader, il confesse à Linda qu'il ne le fera jamais. Pourquoi ? Oh ! non pour préserver l'adolescence de ses fils, auxquels il semble pourtant vouer une affection sincère, mais tout simplement par paresse et par manque d'ambition. Notons que l'une des rares choses qui lui cause toujours un très grand plaisir, c'est d'ennuyer et d'impatienter le digne Stanley (encore plus de le mettre en retard), notamment en lui gâchant sa baignade matinale par tous les moyens ...
Mais "Sur la Baie" vaut surtout parce que, pour la première fois, dans l'étincelante luminosité qui nimbe la nouvelle - Mansfield y atteint à une incroyable palette de couleurs et d'éclat dans les descriptions qu'elle donne de la Nouvelle-Zélande de son enfance - l'auteur nous y livre, en un parallèle tout aussi impressionnant, sa première rencontre non avec la Mort mais avec l'idée de la Mort. Pour l'enfant encore très jeune qu'est la petite Kezia, la Mort n'est qu'un mot, une abstraction. Elle sait par exemple que son oncle William, celui qui vivait en Australie, est mort - et ceci bien qu'il ne fût pas vieux. Seulement, lors de l'un de ces chauds après-midi consacrés en principe à la sieste mais durant lequel l'enfant discute à bâtons rompus avec sa chère Grand-Mère (dont elle est la préférée et qu'elle-même adore et vénère), Kezia réalise que, un jour ou l'autre, tout le monde meurt. A la question qu'elle lui pose, Mrs Fairfield admet qu'elle aussi, Kezia, un jour ... Qu'elle ne veuille pas mourir n'y fait rien : c'est la loi pour tous. Mais ce n'est pas l'idée de sa mort à elle, Kezia, qui paralyse brusquement l'enfant, c'est l'idée qu'un jour, sa grand-mère, elle aussi, disparaîtra. Ce qui signifie qu'elle ne la verra plus, qu'elle ne l'entendra plus, qu'elle sera séparée d'elle, qu'elle sera seule et que personne ne la protègera plus ...
Le petit dialogue qui amène Kezia à cette amère constatation rappellera peut-être certaines choses à nombre de lecteurs. Toujours par petites touches qui n'ont l'air de rien, Mansfield nous fait appréhender l'une des plus terribles réalités de l'existence, avec son cortège de peurs, d'angoisses, de désespoir et de solitude morale. La scène est émouvante et même parfois drôle, du fait du franc-parler de l'enfant et de la vision de la Grand-Mère, absorbée par son tricot. Mais, justement, la quiétude qui préside en apparence à cet échange, si elle adoucit çà et là le propos, l'aiguise tout autant et le rend plus tranchant, plus inexorable. La scène a beau s'achever dans un jeu entre la grand-mère et la petite-fille, on sait que Kezia - et, à travers elle, celle qui la recréera un jour sur le papier - vient de saisir toute la profondeur de ce mystère abyssal, de cette loi qui s'impose à toutes et à tous et qui, ce faisant, abandonne les survivants à une tristesse qui croît chaque jour et qui finit par les user jusqu'à ce moment où, enfin, leur heure aussi arrive à échéance, au cadran impassible de la Grande Horloge du Temps ...
L'heure du seul écrivain dont Virginia Woolf eut la franchise de se déclarer jalouse, devait sonner le 9 janvier 1923, au prieuré d'Avon, près de Fontainebleau - un retour somme toute logique en notre pays puisque le vrai nom de l'écrivain était "Beauchamp." Nous ne savons pas, par contre, depuis combien d'années la petite Kezia attendait de retrouver la grand-mère qu'elle nous dépeint avec tant d'amour dans "Prélude", "Sur la Baie" et "La Maison de Poupées" ... ;o)
Prélude – La famille Burnell déménage. Linda, la mère, est une personne fragile. Stanley, le père est passionnément amoureux. Beryl, la soeur de Linda, est une jeune femme romantique et vaniteuse qui attend le grand. Isabel, Lottie et Kezia sont les enfants de la famille. La découverte de la nouvelle maison et la mise en place d'une nouvelle organisation sont l'occasion d'expériences minuscules mais extraordinaires pour les fillettes. Mais le changement également les rancoeurs de Beryl et Linda. On découvre que Mrs Burnell est un esprit tourmenté et indécis. « Il y avait d'un côté tous ses sentiments pour lui, clairs et précis, tous aussi vrais les uns que les autres. Et il y avait de l'autre cette haine tout aussi réelle que le reste. Elle aurait pu emballer ses sentiments dans de petits paquets et les offrir à Stanley. Elle mourrait d'envie de lui tendre ce dernier paquet pour lui faire une surprise. Elle imaginait ses yeux au moment où il l'ouvrirait… » (p. 91)
Sur la baie - Par une belle journée, les femmes et les enfants de la famille Burnell se rendent à Crescent Bay pour une journée sur la plage. Sous le soleil, les sentiments et les frustrations s'exacerbent. Seul Stanley n'est pas de la partie et sa sortie est des plus fulminantes. « Ah ! le manque de coeur des femmes ! Et cette façon qu'elles avaient de trouver naturel que ce soit votre rôle de vous tuer à la tâche pour elles, alors qu'elles ne prenaient même pas la peine de faire attention à ce que l'on n'égare pas votre canne. » (p. 118) Mais cet emportement durera le temps d'un nuage.
Dans ces deux textes très courts, il est impossible de ne pas trébucher sur le hiatus qui se creuse entre l'insouciance grave des enfants et les troubles puérils des adultes. Linda et Beryl ne sont pas heureuses et le font savoir. Isabel, Lottie et Kezia sont passionnément satisfaites de leur existence dont l'avenir se borne au prochain goûter et, peut-être, à la messe du dimanche.
Du point de vue des enfants, tout paraît plus simple, plus immédiat. Chez Katherine Mansfield, l'enfance se pare des couleurs fragiles et nostalgiques de l'Éden perdu. La Nouvelle-Zélande, cadre des journées des Burnell, est un paradis sur terre mais certains s'échinent à noircir le tableau. Languide et paresseuse, Linda est tout aussi agaçante que Beryl qui soupire après le Prince Charmant.
Je ne sais trop que penser de ces deux textes que j'hésite à qualifier de nouvelles. Ils ressemblent davantage à des chapitres échappés d'un roman. Les deux histoires ont vocation à s'inscrire dans un ensemble plus large et plus construit. Elles donnent une impression d'inachevé, d'incomplétude. Il aurait été plaisant de faire mieux connaissance avec la famille Burnell, davantage que le permettent les deux nouvelles. En refermant l'ouvrage, je suis surtout frustrée. Et c'est dommage car la plume de Katherine Mansfield est plaisante.
Sur la baie - Par une belle journée, les femmes et les enfants de la famille Burnell se rendent à Crescent Bay pour une journée sur la plage. Sous le soleil, les sentiments et les frustrations s'exacerbent. Seul Stanley n'est pas de la partie et sa sortie est des plus fulminantes. « Ah ! le manque de coeur des femmes ! Et cette façon qu'elles avaient de trouver naturel que ce soit votre rôle de vous tuer à la tâche pour elles, alors qu'elles ne prenaient même pas la peine de faire attention à ce que l'on n'égare pas votre canne. » (p. 118) Mais cet emportement durera le temps d'un nuage.
Dans ces deux textes très courts, il est impossible de ne pas trébucher sur le hiatus qui se creuse entre l'insouciance grave des enfants et les troubles puérils des adultes. Linda et Beryl ne sont pas heureuses et le font savoir. Isabel, Lottie et Kezia sont passionnément satisfaites de leur existence dont l'avenir se borne au prochain goûter et, peut-être, à la messe du dimanche.
Du point de vue des enfants, tout paraît plus simple, plus immédiat. Chez Katherine Mansfield, l'enfance se pare des couleurs fragiles et nostalgiques de l'Éden perdu. La Nouvelle-Zélande, cadre des journées des Burnell, est un paradis sur terre mais certains s'échinent à noircir le tableau. Languide et paresseuse, Linda est tout aussi agaçante que Beryl qui soupire après le Prince Charmant.
Je ne sais trop que penser de ces deux textes que j'hésite à qualifier de nouvelles. Ils ressemblent davantage à des chapitres échappés d'un roman. Les deux histoires ont vocation à s'inscrire dans un ensemble plus large et plus construit. Elles donnent une impression d'inachevé, d'incomplétude. Il aurait été plaisant de faire mieux connaissance avec la famille Burnell, davantage que le permettent les deux nouvelles. En refermant l'ouvrage, je suis surtout frustrée. Et c'est dommage car la plume de Katherine Mansfield est plaisante.
Voici un recueil de 6 nouvelles écrites par Katherine Mansfield dans les années 20. Son style peut être rapproché de l'impressionnisme. Elle dresse le tableau de la bonne société néo zélandaise de son enfance. A travers la perception naïve des enfants – particulièrement dans The doll's house – la cruauté et l'injustice d'un monde rigide, engoncé dans un système de classes impitoyable, est mis en évidence avec beaucoup de subtilité. Ses descriptions de la nature dans la première nouvelle, At the bay, sont également d'une grande finesse. La force de l'écriture de Katherine Mansfield tient à sa façon de suggérer plus que de raconter et convient parfaitement au style de la nouvelle. Personnage libre et en décalage avec son époque, l'auteur à la vie personnelle mouvementée a elle-même scandalisé ses contemporains. Elle dénonce dans ses écrits le fonctionnement d'un monde qui s'articule entre dominants et dominés.
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
[...] ... - "Je pensais à ton oncle William, ma chérie," dit-elle tranquillement.
- Mon oncle William d'Australie ?" demanda Kezia.
Elle en avait un autre.
- "Oui, bien sûr.
- Celui que je n'ai jamais vu ?
- Celui-là, oui.
- Eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé ?"
Kezia le savait fort bien, mais elle voulait se le faire redire.
- "Il s'en était allé aux mines, et il y a pris une insolation, et il est mort," dit la vieille Mrs Fairfield.
Kezia clignota et considéra à nouveau le tableau ... Un petit homme renversé comme un soldat de plomb à côté d'un grand trou noir.
- "Ça te rend-il triste de penser à lui, Grand-Maman ?"
Elle détestait voir sa grand-mère attristée.
Ce fut au tour de la vieille femme de réfléchir. Cela la rendait-il triste, de regarder loin, loin derrière elle ? De contempler la longue perspective des années enfuies, comme Kezia le lui avait vu faire ? De les regarder, Eux, comme le fait une femme, longtemps après qu'ils avaient disparu ? Cela la rendait-il triste ? Non, la vie était ainsi.
- "Non, Kezia.
- Mais pourquoi ?" demanda Kezia.
Elle leva un bras nu et se mit à tracer des dessins dans l'air.
- "Pourquoi oncle William a-t-il été obligé de mourir ? Il n'était pas vieux."
Mrs Fairfield commença à compter les mailles par trois.
- "C'est arrivé comme ça," dit-elle, d'un ton absorbé.
- "Est-ce que tout le monde est obligé de mourir ?" demanda Kezia.
- "Tout le monde !"
- "Moi aussi ?"
La voix de Kezia avait un accent de terrible incrédulité.
- "Quelque jour, ma chérie.
- Mais, Grand-Maman ..."
Kezia agita sa jambe gauche et remua les orteils. Elle y sentait du sable.
- "Et si je ne veux pas, moi ?"
La vieille femme soupira de nouveau et tira un long fil de la pelote.
- "On ne nous consulte pas, Kezia," dit-elle tristement. "Ça nous arrive à tous, tôt ou tard."
Kezia demeura immobile, réfléchissant à ces choses. Elle n'avait pas envie de mourir. Mourir signifiait qu'il faudrait partir d'ici, tout quitter pour toujours, quitter ... quitter sa Grand-Maman. Elle roula vivement sur elle-même.
- "Grand-Maman," dit-elle d'une voix surprise et émue.
- "Quoi, mon petit chat ?
- Il ne faut pas que tu meures, toi."
Kezia parlait avec décision.
- "Ah ! Kezia - sa Grand-Maman leva les yeux, sourit, hocha la tête - ne parlons pas de cela.
- Mais il ne faut pas. Tu ne pourrais pas me quitter. Tu ne pourrais pas ne pas être là ..."
Ça, c'était terrible.
- "Promets-moi que tu ne feras pas ça, jamais, Grand-Maman," supplia Kezia.
La vieille femme continua à tricoter.
- "Promets-le moi : Dis jamais !" ... [...]
- Mon oncle William d'Australie ?" demanda Kezia.
Elle en avait un autre.
- "Oui, bien sûr.
- Celui que je n'ai jamais vu ?
- Celui-là, oui.
- Eh bien, qu'est-ce qui lui est arrivé ?"
Kezia le savait fort bien, mais elle voulait se le faire redire.
- "Il s'en était allé aux mines, et il y a pris une insolation, et il est mort," dit la vieille Mrs Fairfield.
Kezia clignota et considéra à nouveau le tableau ... Un petit homme renversé comme un soldat de plomb à côté d'un grand trou noir.
- "Ça te rend-il triste de penser à lui, Grand-Maman ?"
Elle détestait voir sa grand-mère attristée.
Ce fut au tour de la vieille femme de réfléchir. Cela la rendait-il triste, de regarder loin, loin derrière elle ? De contempler la longue perspective des années enfuies, comme Kezia le lui avait vu faire ? De les regarder, Eux, comme le fait une femme, longtemps après qu'ils avaient disparu ? Cela la rendait-il triste ? Non, la vie était ainsi.
- "Non, Kezia.
- Mais pourquoi ?" demanda Kezia.
Elle leva un bras nu et se mit à tracer des dessins dans l'air.
- "Pourquoi oncle William a-t-il été obligé de mourir ? Il n'était pas vieux."
Mrs Fairfield commença à compter les mailles par trois.
- "C'est arrivé comme ça," dit-elle, d'un ton absorbé.
- "Est-ce que tout le monde est obligé de mourir ?" demanda Kezia.
- "Tout le monde !"
- "Moi aussi ?"
La voix de Kezia avait un accent de terrible incrédulité.
- "Quelque jour, ma chérie.
- Mais, Grand-Maman ..."
Kezia agita sa jambe gauche et remua les orteils. Elle y sentait du sable.
- "Et si je ne veux pas, moi ?"
La vieille femme soupira de nouveau et tira un long fil de la pelote.
- "On ne nous consulte pas, Kezia," dit-elle tristement. "Ça nous arrive à tous, tôt ou tard."
Kezia demeura immobile, réfléchissant à ces choses. Elle n'avait pas envie de mourir. Mourir signifiait qu'il faudrait partir d'ici, tout quitter pour toujours, quitter ... quitter sa Grand-Maman. Elle roula vivement sur elle-même.
- "Grand-Maman," dit-elle d'une voix surprise et émue.
- "Quoi, mon petit chat ?
- Il ne faut pas que tu meures, toi."
Kezia parlait avec décision.
- "Ah ! Kezia - sa Grand-Maman leva les yeux, sourit, hocha la tête - ne parlons pas de cela.
- Mais il ne faut pas. Tu ne pourrais pas me quitter. Tu ne pourrais pas ne pas être là ..."
Ça, c'était terrible.
- "Promets-moi que tu ne feras pas ça, jamais, Grand-Maman," supplia Kezia.
La vieille femme continua à tricoter.
- "Promets-le moi : Dis jamais !" ... [...]
[...]... - "Vous pourriez bien me couper une tranche de ce pain, Mère," dit Stanley. "Je n'ai que douze minutes et demie avant que la diligence passe. Quelqu'un a-t-il donné mes souliers à la bonne ?
- Oui, ils sont prêts."
Le calme de Mrs Fairfield n'était nullement troublé.
- "Oh, Kezia ! Pourquoi donc es-tu si malpropre ?" cria Beryl au désespoir.
- "Moi, tante Beryl ?"
Kezia la regarda en ouvrant de grands yeux. Qu'avait-elle bien pu faire ? Elle avait seulement creusé une rigole au beau milieu de sa bouillie, l'avait remplie de lait et était en train d'en manger les bords. Mais c'était ce qu'elle faisait tous les matins, sans que personne lui eût dit un mot jusqu'à présent.
- "Pourquoi ne peux-tu pas manger convenablement, comme Isabel et Lottie ?"
Que les grandes personnes sont injustes !
- "Mais Lottie fait toujours une île, n'est-ce pas, Lottie ?
- Moi pas," dit catégoriquement Isabel. "Je saupoudre tout simplement ma bouillie de sucre, je mets du lait dessus et je la finis. Il n'y a que les bébés qui jouent avec ce qu'ils ont à manger."
Stanley repoussa sa chaise et se leva.
- "Voudriez-vous me faire apporter ces souliers, Mère ? Et, Beryl, si vous avez fini, je voudrais bien que vous filiez jusqu'à la porte et que vous fassiez arrêter la diligence. Isabel, cours demander à ta mère où l'on a mis mon chapeau melon. Attends une minute : vous vous êtes amusées avec ma canne, enfants ?
- Non, Papa.
- Mais je l'avais mise ici."
Stanley commença à tempêter.
- "Je me rappelle nettement l'avoir posée dans ce coin. Maintenant, qui l'a prise ? Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchez-vous ! Il faut absolument que cette canne se retrouve."
Même Alice, la bonne, dut prendre part à la chasse.
- "Vous ne vous en êtes pas servie pour tisonner le feu de la cuisine, par hasard ?"
Stanley se précipita dans la chambre où Linda était couchée.
- "Voilà une chose insensée ! Je n'arrive pas à conserver un seul des objets que je possède. On a fait disparaître ma canne, à présent !
- Ta canne, mon ami ? Quelle canne ?"
L'air vague de Linda en des circonstances pareilles ne pouvait être sincère, décida Stanley. Personne ne sympathiserait donc avec lui !
- "L'omnibus ! L'omnibus ! Stanley !" cria de la porte du jardin la voix de Beryl.
Stanley agita le bras du côté de Linda : "Pas le temps de dire adieu !" cria-t-il. Et il avait l'intention de la punir ainsi.
Il saisit brusquement son chapeau, s'élança hors de la maison et descendit au pas de course l'allée du jardin. Oui, l'omnibus était là qui attendait et Beryl, se penchant par-dessus la porte ouverte, riait, le visage levé vers quelqu'un, tout juste comme s'il n'était rien arrivé. Les femmes n'ont pas de cœur ! Quelle façon elles ont de considérer comme une chose toute naturelle que vous passiez votre vie à peiner pour elles, tandis qu'elles ne lèveraient pas le petit doigt pour empêcher votre canne de se perdre ! ... [...]
- Oui, ils sont prêts."
Le calme de Mrs Fairfield n'était nullement troublé.
- "Oh, Kezia ! Pourquoi donc es-tu si malpropre ?" cria Beryl au désespoir.
- "Moi, tante Beryl ?"
Kezia la regarda en ouvrant de grands yeux. Qu'avait-elle bien pu faire ? Elle avait seulement creusé une rigole au beau milieu de sa bouillie, l'avait remplie de lait et était en train d'en manger les bords. Mais c'était ce qu'elle faisait tous les matins, sans que personne lui eût dit un mot jusqu'à présent.
- "Pourquoi ne peux-tu pas manger convenablement, comme Isabel et Lottie ?"
Que les grandes personnes sont injustes !
- "Mais Lottie fait toujours une île, n'est-ce pas, Lottie ?
- Moi pas," dit catégoriquement Isabel. "Je saupoudre tout simplement ma bouillie de sucre, je mets du lait dessus et je la finis. Il n'y a que les bébés qui jouent avec ce qu'ils ont à manger."
Stanley repoussa sa chaise et se leva.
- "Voudriez-vous me faire apporter ces souliers, Mère ? Et, Beryl, si vous avez fini, je voudrais bien que vous filiez jusqu'à la porte et que vous fassiez arrêter la diligence. Isabel, cours demander à ta mère où l'on a mis mon chapeau melon. Attends une minute : vous vous êtes amusées avec ma canne, enfants ?
- Non, Papa.
- Mais je l'avais mise ici."
Stanley commença à tempêter.
- "Je me rappelle nettement l'avoir posée dans ce coin. Maintenant, qui l'a prise ? Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchez-vous ! Il faut absolument que cette canne se retrouve."
Même Alice, la bonne, dut prendre part à la chasse.
- "Vous ne vous en êtes pas servie pour tisonner le feu de la cuisine, par hasard ?"
Stanley se précipita dans la chambre où Linda était couchée.
- "Voilà une chose insensée ! Je n'arrive pas à conserver un seul des objets que je possède. On a fait disparaître ma canne, à présent !
- Ta canne, mon ami ? Quelle canne ?"
L'air vague de Linda en des circonstances pareilles ne pouvait être sincère, décida Stanley. Personne ne sympathiserait donc avec lui !
- "L'omnibus ! L'omnibus ! Stanley !" cria de la porte du jardin la voix de Beryl.
Stanley agita le bras du côté de Linda : "Pas le temps de dire adieu !" cria-t-il. Et il avait l'intention de la punir ainsi.
Il saisit brusquement son chapeau, s'élança hors de la maison et descendit au pas de course l'allée du jardin. Oui, l'omnibus était là qui attendait et Beryl, se penchant par-dessus la porte ouverte, riait, le visage levé vers quelqu'un, tout juste comme s'il n'était rien arrivé. Les femmes n'ont pas de cœur ! Quelle façon elles ont de considérer comme une chose toute naturelle que vous passiez votre vie à peiner pour elles, tandis qu'elles ne lèveraient pas le petit doigt pour empêcher votre canne de se perdre ! ... [...]
« Il y avait d’un côté tous ses sentiments pour lui, clairs et précis, tous aussi vrais les uns que les autres. Et il y avait de l’autre cette haine tout aussi réelle que le reste. Elle aurait pu emballer ses sentiments dans de petits paquets et les offrir à Stanley. Elle mourrait d’envie de lui tendre ce dernier paquet pour lui faire une surprise. Elle imaginait ses yeux au moment où il l’ouvrirait… » (p. 91)
« Ah ! le manque de cœur des femmes ! Et cette façon qu’elles avaient de trouver naturel que ce soit votre rôle de vous tuer à la tâche pour elles, alors qu’elles ne prenaient même pas la peine de faire attention à ce que l’on n’égare pas votre canne. » (p. 118)
Videos de Katherine Mansfield (16)
Voir plusAjouter une vidéo
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE :
« Je ne parle pas français », in Katherine Mansfield, félicité, traduit de l'anglais par J.-G. Delamain, préface de Louis Gillet, Paris, Stock, 1932, p. 57.
autres livres classés : littérature néo-zélandaiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Katherine Mansfield (36)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3671 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3671 lecteurs ont répondu