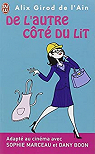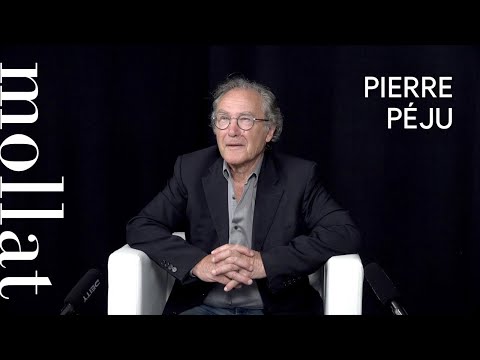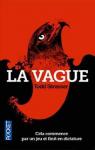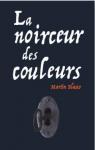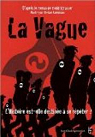Pierre Péju vous présente son ouvrage "Effractions" aux éditions Gallimard.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2626471/pierre-peju-effractions
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Pierre Péju/5
10 notes
Résumé :
Un soir, dans un refuge de haute montagne, un mystérieux randonneur m'a fait don d'un bloc transparent qu'il prétendait être le "Cristal du Temps". Plus tard, au lieu de me remettre à la rédaction de mon roman, j'y ai plongé les yeux. Des moments de ma vie ont surgi en désordre : scènes banales ou incongrues, êtres perdus de vue, anecdotes auxquelles je n'aurais jamais repensé, comme la mise à mort d'un lapin, la folie d'une jeune plasticienne russe, un amnésique ou... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après ReconnaissanceVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
« Reconnaissance », mon premier Péju… Merci aux éditions Gallimard et à Babélio pour cette découverte. Pierre Péju. Bien entendu, le nom ne m'était pas inconnu ni « La petite chartreuse », ni « le rire de l'ogre », bien sûr…
J'attaque en confiance ce recueil de miscellanées reliées entre elles par « le cristal du Temps », sorte de pierre divinatoire offerte dans un refuge de montagne par un marcheur invétéré, et qui permet à l'auteur de revivre des éléments de son passé ; et d'évoquer un futur, désolé… désolant...
Comme toujours, en pareil cas (un recueil de textes plus ou moins courts) je dérive vite vers une impression désagréable : une impression de collecte de fond de tiroir, voire de coupes plus ou moins sombres issues d'ouvrages publiés antérieurement me taraude…
Une impression qui s'estompe bientôt… L'auteur possède une vraie plume : tour à tour, émouvante (« Mélancolie du clown »), poétique (« Marée basse »), enjouée, nostalgique… Et cette épopée Russe ! Madame Karpova … la plasticienne déjantée Nastassja !
Mon premier Péju, disais-je… sans doute pas le dernier…
J'attaque en confiance ce recueil de miscellanées reliées entre elles par « le cristal du Temps », sorte de pierre divinatoire offerte dans un refuge de montagne par un marcheur invétéré, et qui permet à l'auteur de revivre des éléments de son passé ; et d'évoquer un futur, désolé… désolant...
Comme toujours, en pareil cas (un recueil de textes plus ou moins courts) je dérive vite vers une impression désagréable : une impression de collecte de fond de tiroir, voire de coupes plus ou moins sombres issues d'ouvrages publiés antérieurement me taraude…
Une impression qui s'estompe bientôt… L'auteur possède une vraie plume : tour à tour, émouvante (« Mélancolie du clown »), poétique (« Marée basse »), enjouée, nostalgique… Et cette épopée Russe ! Madame Karpova … la plasticienne déjantée Nastassja !
Mon premier Péju, disais-je… sans doute pas le dernier…
Le cristal du "temps retrouvé"
Tout part d'une anecdote étrange. le narrateur, écrivain sur le point d'achever un livre, rencontre au détour d'un chemin de randonnée en haute montagne un marcheur qui l'interpelle en ces termes : "Hé, vous n'auriez pas vu passer mon ombre ?" et lui fait don d'un cristal ayant le pouvoir de restituer les souvenirs. Cette rencontre quelque peu insolite semble faire écho au conte fantastique d' Adelbert von Chamisso , "L'étrange histoire de Peter Schlemihl ou l'Homme qui a perdu son ombre", où le héros vend son ombre à un mystérieux "homme gris", qui n'est autre que le diable, en échange de la bourse de Fortunatus. Pierre Péju est féru de littérature allemande – il a consacré sa thèse au romantisme allemand et est l'auteur notamment d'une biographie sur E.T.A. Hoffmann – et ce clin d'oeil, placé au début du récit, permet d'introduire le caractère surnaturel et quelque peu transgressif du voyage que le narrateur s'apprête à faire au moyen du cristal : pallier la défaillance de la mémoire au moyen d'un outil magique, qui permet de retrouver et de revivre avec toute la précision et l'intensité du présent des souvenirs lointains et perdus.
L'idée du cristal rapporteur de souvenirs, comme surgie d'un conte, est un prétexte pour aborder la question de la mémoire et de l'oubli.
Chaque chapitre présente un épisode de la vie du narrateur dont le souvenir est exhumé par le cristal, relevant à la fois de la vie réelle et de la vie rêvée. La vie réelle, ce sont les sensations d'enfance et le vécu plus ou moins proche restitués avec clarté. La vie rêvée, ce sont les terreurs oniriques d'enfant qui ressurgissent et dont la mise au jour est, on le suppose, cathartique pour l'adulte. Apparaissant dans le désordre, ces anecdotes racontées forment peu à peu une mosaïque de souvenirs.
Mais ce n'est pas tout. le cristal a également le pouvoir de laisser entrevoir ce que j'aurais envie de nommer l'"après-soi" : le narrateur fait l'expérience de se retrouver dans sa propre maison après sa mort, et de voir ses effets et papiers personnels ensevelis sous la poussière, comme un "tas d'ordures". Cette vision terrible, comme une sorte d'allégorie de l'oubli, amène un questionnement essentiel : que laisse-t-on après sa mort ? Faut-il s'accrocher aux souvenirs ? Est-il indispensable de laisser une trace ?
L'expérience du cristal permet de "se satteliser", de "se survoler", d'éprouver le poids de la mémoire à l'heure de faire le bilan. Car, à un âge avancé, les souvenirs peuvent aussi être ressentis comme un fardeau dont on ne parvient pas à se libérer, un fardeau tel que le désir d'amnésie devient impérieux. Ainsi, en posant en filigrane la question : le fait de se souvenir apporte-t-il quelque chose et la mémoire est-elle d'une quelconque utilité ?, l'auteur invite à faire sienne l'idée que l'oubli est finalement salutaire.
Ainsi, l'expérience du cristal prend le sens d'un parcours initiatique, cathartique vers le détachement et une sorte de préparation à la mort, grâce à ce que l'auteur appelle l'"abolition" de la mémoire. "Ne plus rien se rappeler, ça doit aider à bien mourir." N'est-ce pas ce qu'on pourrait souhaiter, comme le disait André Gide dans "Les nourritures terrestres", "mourir complètement désespéré", en s'enfonçant doucement, comme le narrateur, dans les eaux du fleuve Léthé qui apporte l'oubli aux âmes des morts ?
Après, il ne resterait plus qu'à éprouver une immense gratitude pour toutes les choses vues, vécues et perçues et une profonde reconnaissance envers le monde.
J'ai beaucoup apprécié ce livre, parsemé de références littéraires que le lecteur averti se plaira à découvrir ; il constitue une très belle source de réflexion sur la mémoire et les souvenirs. Merci à Gallimard et à Babelio.
Tout part d'une anecdote étrange. le narrateur, écrivain sur le point d'achever un livre, rencontre au détour d'un chemin de randonnée en haute montagne un marcheur qui l'interpelle en ces termes : "Hé, vous n'auriez pas vu passer mon ombre ?" et lui fait don d'un cristal ayant le pouvoir de restituer les souvenirs. Cette rencontre quelque peu insolite semble faire écho au conte fantastique d' Adelbert von Chamisso , "L'étrange histoire de Peter Schlemihl ou l'Homme qui a perdu son ombre", où le héros vend son ombre à un mystérieux "homme gris", qui n'est autre que le diable, en échange de la bourse de Fortunatus. Pierre Péju est féru de littérature allemande – il a consacré sa thèse au romantisme allemand et est l'auteur notamment d'une biographie sur E.T.A. Hoffmann – et ce clin d'oeil, placé au début du récit, permet d'introduire le caractère surnaturel et quelque peu transgressif du voyage que le narrateur s'apprête à faire au moyen du cristal : pallier la défaillance de la mémoire au moyen d'un outil magique, qui permet de retrouver et de revivre avec toute la précision et l'intensité du présent des souvenirs lointains et perdus.
L'idée du cristal rapporteur de souvenirs, comme surgie d'un conte, est un prétexte pour aborder la question de la mémoire et de l'oubli.
Chaque chapitre présente un épisode de la vie du narrateur dont le souvenir est exhumé par le cristal, relevant à la fois de la vie réelle et de la vie rêvée. La vie réelle, ce sont les sensations d'enfance et le vécu plus ou moins proche restitués avec clarté. La vie rêvée, ce sont les terreurs oniriques d'enfant qui ressurgissent et dont la mise au jour est, on le suppose, cathartique pour l'adulte. Apparaissant dans le désordre, ces anecdotes racontées forment peu à peu une mosaïque de souvenirs.
Mais ce n'est pas tout. le cristal a également le pouvoir de laisser entrevoir ce que j'aurais envie de nommer l'"après-soi" : le narrateur fait l'expérience de se retrouver dans sa propre maison après sa mort, et de voir ses effets et papiers personnels ensevelis sous la poussière, comme un "tas d'ordures". Cette vision terrible, comme une sorte d'allégorie de l'oubli, amène un questionnement essentiel : que laisse-t-on après sa mort ? Faut-il s'accrocher aux souvenirs ? Est-il indispensable de laisser une trace ?
L'expérience du cristal permet de "se satteliser", de "se survoler", d'éprouver le poids de la mémoire à l'heure de faire le bilan. Car, à un âge avancé, les souvenirs peuvent aussi être ressentis comme un fardeau dont on ne parvient pas à se libérer, un fardeau tel que le désir d'amnésie devient impérieux. Ainsi, en posant en filigrane la question : le fait de se souvenir apporte-t-il quelque chose et la mémoire est-elle d'une quelconque utilité ?, l'auteur invite à faire sienne l'idée que l'oubli est finalement salutaire.
Ainsi, l'expérience du cristal prend le sens d'un parcours initiatique, cathartique vers le détachement et une sorte de préparation à la mort, grâce à ce que l'auteur appelle l'"abolition" de la mémoire. "Ne plus rien se rappeler, ça doit aider à bien mourir." N'est-ce pas ce qu'on pourrait souhaiter, comme le disait André Gide dans "Les nourritures terrestres", "mourir complètement désespéré", en s'enfonçant doucement, comme le narrateur, dans les eaux du fleuve Léthé qui apporte l'oubli aux âmes des morts ?
Après, il ne resterait plus qu'à éprouver une immense gratitude pour toutes les choses vues, vécues et perçues et une profonde reconnaissance envers le monde.
J'ai beaucoup apprécié ce livre, parsemé de références littéraires que le lecteur averti se plaira à découvrir ; il constitue une très belle source de réflexion sur la mémoire et les souvenirs. Merci à Gallimard et à Babelio.
Que peut un cristal de roche sur notre vie ?
Beaucoup
Le narrateur lors d'une randonnée dans la Vanoise va rencontrer un personnage hors du temps mi SDF mi ascète.
Sa quête au travers d'une traversée des Alpes du Léman à Nice est de trouver le pont qui mène sur l'autre rive , vers un monde subtil.
Il partage cette expérience avec le narrateur et lui offre ce cristal de roche qu'il a lui même reçu.
Si l'on regarde de près ce cristal réapparaisse des petits et grands moments de la vie ainsi que la vie rêvée.
Ce cristal va être propice pour que le narrateur retrouve des moments enfouis de sa vie
Moments importants , moments apparus futiles.
chaque chapitre nous ramène a des moments de bonheur, à des moments où la vie c'est "crac" et il faut repartir nouveau différent.
Ce rappel de sa vie est aussi une marche vers la vieillesse , la mort la disparition.
C'est un livre intime mais dans lequel nous retrouvons une part de nous et de nos vies
Et puis une reconnaissance de cette planète, de ces hommes si différents ,de ces géographies magnifiques et donc de la chance de vivre des bonheurs dérisoires, importants.
Reconnaissance
Beaucoup
Le narrateur lors d'une randonnée dans la Vanoise va rencontrer un personnage hors du temps mi SDF mi ascète.
Sa quête au travers d'une traversée des Alpes du Léman à Nice est de trouver le pont qui mène sur l'autre rive , vers un monde subtil.
Il partage cette expérience avec le narrateur et lui offre ce cristal de roche qu'il a lui même reçu.
Si l'on regarde de près ce cristal réapparaisse des petits et grands moments de la vie ainsi que la vie rêvée.
Ce cristal va être propice pour que le narrateur retrouve des moments enfouis de sa vie
Moments importants , moments apparus futiles.
chaque chapitre nous ramène a des moments de bonheur, à des moments où la vie c'est "crac" et il faut repartir nouveau différent.
Ce rappel de sa vie est aussi une marche vers la vieillesse , la mort la disparition.
C'est un livre intime mais dans lequel nous retrouvons une part de nous et de nos vies
Et puis une reconnaissance de cette planète, de ces hommes si différents ,de ces géographies magnifiques et donc de la chance de vivre des bonheurs dérisoires, importants.
Reconnaissance
On peut considérer ce livre comme une pause, une respiration dans l'oeuvre de P.Péju.
Le cristal est une porte d'entrée dans un univers parallèle, mémoire sélective de l'auteur après 70 ans d'une vie bien remplie. L'heure du ou des bilans aurait-elle sonnée ? Dans l'amoncellement de faits, de souvenirs et de chemins empruntés, le romancier cherche des repères qui pourraient donner un sens à sa vie. Il est bien connu qu'un acte, quel qu'il soit, pour un intellectuel, doit avoir du sens, même a posteriori et un ensemble d'actes, une direction commune sinon, à quoi bon ?
Vouloir tout expliquer, au soir de sa vie, est un travail de Sisyphe, impossible synthèse. La rencontre avec le marcheur ouvre une voie intéressante : s'abstraire de la connaissance est comme se détacher de la possession des choses, rencontrer la sagesse, se retourner, regarder le monde et dire merci , merci de m'avoir construit tel que je suis. le titre dit : reconnaissance, de tous ces instants passés, de morceaux de vie sans lesquels je ne suis rien.
A méditer.
Le cristal est une porte d'entrée dans un univers parallèle, mémoire sélective de l'auteur après 70 ans d'une vie bien remplie. L'heure du ou des bilans aurait-elle sonnée ? Dans l'amoncellement de faits, de souvenirs et de chemins empruntés, le romancier cherche des repères qui pourraient donner un sens à sa vie. Il est bien connu qu'un acte, quel qu'il soit, pour un intellectuel, doit avoir du sens, même a posteriori et un ensemble d'actes, une direction commune sinon, à quoi bon ?
Vouloir tout expliquer, au soir de sa vie, est un travail de Sisyphe, impossible synthèse. La rencontre avec le marcheur ouvre une voie intéressante : s'abstraire de la connaissance est comme se détacher de la possession des choses, rencontrer la sagesse, se retourner, regarder le monde et dire merci , merci de m'avoir construit tel que je suis. le titre dit : reconnaissance, de tous ces instants passés, de morceaux de vie sans lesquels je ne suis rien.
A méditer.
Les préludes de la lecture : Ouvrage que j'ai reçu dans le cadre de l'opération masse critique de Babelio, merci à la plateforme, à Gallimard ainsi qu'à l'auteur.
Résumé : Lors d'une randonnée, l'auteur rencontre un autre randonneur en quête d'un mystérieux pont. Il offre à l'écrivain, un énigmatique cristal du temps dans lequel il se plonge. Il redécouvre ainsi des instants de sa vie, de ses rêves et même de son futur.
Le mot de la fin : Étant déjà conquise par Pierre Péju, la petite chartreuse étant un des plus gros coup de coeur que j'ai eu, je ne suis pas très objective. le style est à nouveau extrêmement poétique et beau. le sujet en revanche est différent. L'auteur fait ici un point sur le temps qui passe, sur la vieillesse, sur la vie et sa reconnaissance envers le monde. le chapitre Enfances lointaines m'a particulièrement touchée.
Lien : http://www.lesmiscellaneesde..
Résumé : Lors d'une randonnée, l'auteur rencontre un autre randonneur en quête d'un mystérieux pont. Il offre à l'écrivain, un énigmatique cristal du temps dans lequel il se plonge. Il redécouvre ainsi des instants de sa vie, de ses rêves et même de son futur.
Le mot de la fin : Étant déjà conquise par Pierre Péju, la petite chartreuse étant un des plus gros coup de coeur que j'ai eu, je ne suis pas très objective. le style est à nouveau extrêmement poétique et beau. le sujet en revanche est différent. L'auteur fait ici un point sur le temps qui passe, sur la vieillesse, sur la vie et sa reconnaissance envers le monde. le chapitre Enfances lointaines m'a particulièrement touchée.
Lien : http://www.lesmiscellaneesde..
critiques presse (1)
Le narrateur de Pierre Péju (Pierre Péju lui-même ?) parcourt ses souvenirs, hors sentier, grâce à un magique « cristal du Temps ».
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (16)
Voir plus
Ajouter une citation
Je ne prétends pas être sorti de nulle part, mais je suis convaincu, depuis longtemps, de l’aléa de toute origine. Du hasard de toute extraction. Le fait de s’enorgueillir d’être d’où l’on est me semble relever d’une variété de bêtise.
Friand d'essais et de tentatives, l'enfant tâtonne. C'est un petit « chercheur », ni sot ni intelligent. C'est plus tard, devenu « grand » qu'on devient bête, quand on commence à se durcir, à s'entêter, à se répéter. quand on est persuadé de savoir ou d'avoir trouvé. La bêtise est réservée aux adultes.
Partout, dans la montagne, il y a des chemins de grande solitude.Passé la limite de la végétation, ils serpentent entre les roches éboulées, l'herbe rase, les plaques de neige sale, en plein vent, dans la proximité du ciel.
Au fond, je ne crois pas que quiconque puisse inventer. Pas plus un roman qu'un conte. Comme si tout était déjà raconté quelque part. Comme si chaque récit préexistait à sa narration.
C'est ainsi que nous demeurons en nos jardins. Nous nous rassurons à l'idée qu'au lendemain des pires batailles, les roses restent à jamais belles, innocentes et « sans pourquoi », et que cent fleurs finissent par repousser dans la terre gorgée de plomb et de sang.
Videos de Pierre Péju (11)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : expérienceVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Péju (28)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les cinq Juifs ...
Tout est Dieu !
Marx
Moïse
Freud
Jésus
Einstein
5 questions
31 lecteurs ont répondu
Thèmes :
humourCréer un quiz sur ce livre31 lecteurs ont répondu