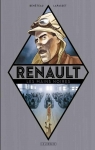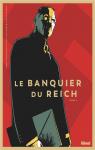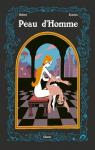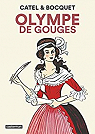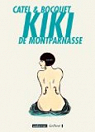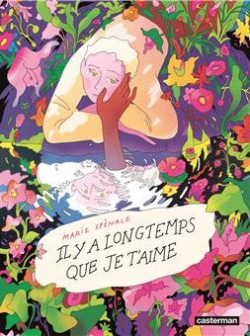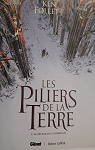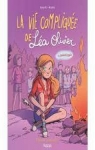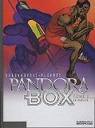AlcanteLaurent-Frédéric BolléeDenis Rodier
LF Bollée (Autre)Didier Alcante (Autre)Denis Rodier (Autre)/5 779 notes
LF Bollée (Autre)Didier Alcante (Autre)Denis Rodier (Autre)/5 779 notes
Résumé :
L'incroyable histoire vraie de l'arme la plus effroyable jamais créée.
Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l'existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ?
Véritable saga de 450 pages, ce roman graphiqu... >Voir plus
Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifié, l'existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ?
Véritable saga de 450 pages, ce roman graphiqu... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La bombe (BD)Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (124)
Voir plus
Ajouter une critique
La bombe, impressionnante bande dessinée réalisée par Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bollée, pour le scénario, avec Denis Rodier pour les 450 planches de dessin, me tentait vraiment et m'effrayait aussi un peu…
Heureusement, sans problème, Vincent, me l'a confiée et j'ai pu me lancer dans une lecture terrible de sens et de révélations sur l'Histoire. Peu de temps avant, au cinéma, j'avais vu Oppenheimer et je voulais en savoir plus sur cette bombe atomique créée par d'éminents scientifiques et larguée sur Hiroshima puis Nagasaki, au Japon, sur décision des dirigeants et militaires des États-Unis, au début du mois d'août 1945.
Ici, le noir et blanc est de rigueur et les dessins de Rodier sont d'une éloquence remarquable. Il a su jouer sur les ombres car, c'est justement une ombre qui a décidé Alcante pour se lancer dans cette folle aventure : raconter La bombe.
Cette fameuse ombre est celle fixée par un être humain sur les marches de la banque Sumimoto, le 6 août 1945, à 8h 15. Ces escaliers ont été conservés et exposés dans le seul bâtiment rappelant ce désastre, près de l'hypocentre de l'explosion. Inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité, le « Mémorial de la Paix d'Hiroshima, dôme de Genbaku » est situé dans l'ancien palais d'exposition industrielle.
Cette catastrophe fit, le jour de l'explosion, 70 000 morts à Hiroshima et 40 000 à Nagasaki, un bilan qui s'éleva rapidement pour atteindre, cinq ans plus tard, 140 000 morts à Hiroshima et 80 000 à Nagasaki…
Pour tenter d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, les auteurs donnent la parole à l'uranium, matière utilisée jusque-là dans la verrerie et la céramique puis dans les recherches sur la radioactivité. Hélas, on ne va pas s'arrêter là car la course à l'armement atomique est lancée avec des chercheurs comme Leo Szilard ou Enrico Fermi, Prix Nobel de Physique en 1938. À partir de là, l'histoire m'emmène au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en Tchécoslovaquie, en Russie, en Norvège, au Congo belge car la Seconde guerre mondiale déchire la planète.
Les scénaristes se sont appuyés sur des recherches historiques poussées afin de faire bien comprendre un engrenage impitoyable.
Pourtant, nous sommes à la fin de la guerre, en 1945, lorsque la décision finale est prise. En effet, le Japon refuse de capituler, lance ses kamikazes sur les bateaux ennemis, ne fait aucun cas de la vie humaine de quelque camp qu'il soit.
Une autre solution aurait-elle pu advenir ? Sûrement, mais impossible de refaire l'Histoire. Il faut simplement tenter de la comprendre et surtout ne pas oublier.
Pour cela, une oeuvre comme La bombe, cette bande dessinée, ce document graphique remarquable publié par Glénat, doit être lu. C'est primordial.
Lien : https://notre-jardin-des-liv..
Heureusement, sans problème, Vincent, me l'a confiée et j'ai pu me lancer dans une lecture terrible de sens et de révélations sur l'Histoire. Peu de temps avant, au cinéma, j'avais vu Oppenheimer et je voulais en savoir plus sur cette bombe atomique créée par d'éminents scientifiques et larguée sur Hiroshima puis Nagasaki, au Japon, sur décision des dirigeants et militaires des États-Unis, au début du mois d'août 1945.
Ici, le noir et blanc est de rigueur et les dessins de Rodier sont d'une éloquence remarquable. Il a su jouer sur les ombres car, c'est justement une ombre qui a décidé Alcante pour se lancer dans cette folle aventure : raconter La bombe.
Cette fameuse ombre est celle fixée par un être humain sur les marches de la banque Sumimoto, le 6 août 1945, à 8h 15. Ces escaliers ont été conservés et exposés dans le seul bâtiment rappelant ce désastre, près de l'hypocentre de l'explosion. Inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité, le « Mémorial de la Paix d'Hiroshima, dôme de Genbaku » est situé dans l'ancien palais d'exposition industrielle.
Cette catastrophe fit, le jour de l'explosion, 70 000 morts à Hiroshima et 40 000 à Nagasaki, un bilan qui s'éleva rapidement pour atteindre, cinq ans plus tard, 140 000 morts à Hiroshima et 80 000 à Nagasaki…
Pour tenter d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, les auteurs donnent la parole à l'uranium, matière utilisée jusque-là dans la verrerie et la céramique puis dans les recherches sur la radioactivité. Hélas, on ne va pas s'arrêter là car la course à l'armement atomique est lancée avec des chercheurs comme Leo Szilard ou Enrico Fermi, Prix Nobel de Physique en 1938. À partir de là, l'histoire m'emmène au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en Tchécoslovaquie, en Russie, en Norvège, au Congo belge car la Seconde guerre mondiale déchire la planète.
Les scénaristes se sont appuyés sur des recherches historiques poussées afin de faire bien comprendre un engrenage impitoyable.
Pourtant, nous sommes à la fin de la guerre, en 1945, lorsque la décision finale est prise. En effet, le Japon refuse de capituler, lance ses kamikazes sur les bateaux ennemis, ne fait aucun cas de la vie humaine de quelque camp qu'il soit.
Une autre solution aurait-elle pu advenir ? Sûrement, mais impossible de refaire l'Histoire. Il faut simplement tenter de la comprendre et surtout ne pas oublier.
Pour cela, une oeuvre comme La bombe, cette bande dessinée, ce document graphique remarquable publié par Glénat, doit être lu. C'est primordial.
Lien : https://notre-jardin-des-liv..
La folie humaine dans toute sa splendeur ! ...
C'est le coeur retourné et complètement dégoûtée que j'ai refermé ce très épais roman graphique, se consacrant à l'histoire de la bombe atomique, de sa création jusqu'à l'éradication des villes d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 8 août 1945.
Tout commence par deux scientifiques : l'un juif hongrois, Leo Szilard, et l'autre italien, Enrico Fermi, s'exilant tous deux aux États-Unis à la fin des années 1930, fuyant l'un l'Allemagne nazie et l'autre l'Italie fasciste. C'est avec eux, et bon nombre d'autres scientifiques physiciens (de grande renommée, et prix Nobel pour certains), que commencera ce qu'on appelle aujourd'hui la course à la bombe. À savoir qui des États-Unis ou de l'Allemagne réussira à fabriquer la première bombe atomique ? Il est clair que pour les États-Unis et l'Angleterre, il faut impérativement y arriver avant l'Allemagne, Hitler étant déjà suffisamment incontrôlable.
Ce qui s'en suit après, je vous laisse le découvrir par vous-mêmes, tellement je ne trouve pas les mots pour en parler. Les injections de plutonium faits sur des êtres humains à leur insu, les milliers et milliers de morts et blessés suite au largage des bombes, le "patriotisme" de certains qui prend des dimensions très excessives, et encore plein d'autres horreurs... Comment y mettre des mots là-dessus, sans avoir la nausée ?
Inhumain. Innommable. Tels sont les seuls mots qui tournent en boucle dans ma tête...
Il y aurait pourtant de quoi dire, "La bombe" m'ayant tenu éveillée plusieurs heures. C'est bien la première fois que je passe autant de temps à venir à bout d'un livre graphique, autant qu'un roman en fait. Et non pas parce qu'il m'ennuyait, non juste parce qu'il est très complet et qu'il ne se lit pas comme une BD lambda. Les auteurs ont mis cinq ans pour mener à bien leur projet : complet et sacrément bien documenté, on ne peut que les féliciter pour leur travail, qu'ils ont tenté de rendre le plus réaliste et le plus véridique possible.
Et c'est très réussi. Les "acteurs" sont nombreux, les événements également, et j'imagine bien toute la difficulté à les encastrer les uns aux autres, tout en faisant en sorte de ne pas perdre le lecteur. Et ils y parviennent : le côté scientifique n'est pas rébarbatif, grâce aux explications simples ; on finit par s'habituer aux nombreux protagonistes ; les dessins en noir et blanc vont à l'essentiel pour n'en être que plus percutants ; et le texte, sous forme de dialogues principalement, rend la lecture très fluide. On y reste longtemps, mais le temps passe vite.
Il est fait un parallèle à la fin, que j'ai trouvé horrible et poignant en même temps. Américains ravis d'un côté. Ruines et "fantômes" d'Hiroshima de l'autre. Dialogues de félicitations chez les premiers pendant que les seconds se passent de tout texte. J'en avais des sueurs froides...
C'est une lecture à la fois enrichissante, dans laquelle j'ai beaucoup appris, et exceptionnelle quant au travail des auteurs, aussi percutante que monstrueuse et glaçante. Une lecture qui ne laisse pas indifférent et qui me marquera à jamais. Une lecture qui fait froid dans le dos, encore plus quand on sait qu'actuellement neuf pays possèdent l'arme nucléaire et que, maintenant perfectionnée (on n'arrête pas le progrès !), elle ferait beaucoup plus de dégâts...
C'est le coeur retourné et complètement dégoûtée que j'ai refermé ce très épais roman graphique, se consacrant à l'histoire de la bombe atomique, de sa création jusqu'à l'éradication des villes d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 8 août 1945.
Tout commence par deux scientifiques : l'un juif hongrois, Leo Szilard, et l'autre italien, Enrico Fermi, s'exilant tous deux aux États-Unis à la fin des années 1930, fuyant l'un l'Allemagne nazie et l'autre l'Italie fasciste. C'est avec eux, et bon nombre d'autres scientifiques physiciens (de grande renommée, et prix Nobel pour certains), que commencera ce qu'on appelle aujourd'hui la course à la bombe. À savoir qui des États-Unis ou de l'Allemagne réussira à fabriquer la première bombe atomique ? Il est clair que pour les États-Unis et l'Angleterre, il faut impérativement y arriver avant l'Allemagne, Hitler étant déjà suffisamment incontrôlable.
Ce qui s'en suit après, je vous laisse le découvrir par vous-mêmes, tellement je ne trouve pas les mots pour en parler. Les injections de plutonium faits sur des êtres humains à leur insu, les milliers et milliers de morts et blessés suite au largage des bombes, le "patriotisme" de certains qui prend des dimensions très excessives, et encore plein d'autres horreurs... Comment y mettre des mots là-dessus, sans avoir la nausée ?
Inhumain. Innommable. Tels sont les seuls mots qui tournent en boucle dans ma tête...
Il y aurait pourtant de quoi dire, "La bombe" m'ayant tenu éveillée plusieurs heures. C'est bien la première fois que je passe autant de temps à venir à bout d'un livre graphique, autant qu'un roman en fait. Et non pas parce qu'il m'ennuyait, non juste parce qu'il est très complet et qu'il ne se lit pas comme une BD lambda. Les auteurs ont mis cinq ans pour mener à bien leur projet : complet et sacrément bien documenté, on ne peut que les féliciter pour leur travail, qu'ils ont tenté de rendre le plus réaliste et le plus véridique possible.
Et c'est très réussi. Les "acteurs" sont nombreux, les événements également, et j'imagine bien toute la difficulté à les encastrer les uns aux autres, tout en faisant en sorte de ne pas perdre le lecteur. Et ils y parviennent : le côté scientifique n'est pas rébarbatif, grâce aux explications simples ; on finit par s'habituer aux nombreux protagonistes ; les dessins en noir et blanc vont à l'essentiel pour n'en être que plus percutants ; et le texte, sous forme de dialogues principalement, rend la lecture très fluide. On y reste longtemps, mais le temps passe vite.
Il est fait un parallèle à la fin, que j'ai trouvé horrible et poignant en même temps. Américains ravis d'un côté. Ruines et "fantômes" d'Hiroshima de l'autre. Dialogues de félicitations chez les premiers pendant que les seconds se passent de tout texte. J'en avais des sueurs froides...
C'est une lecture à la fois enrichissante, dans laquelle j'ai beaucoup appris, et exceptionnelle quant au travail des auteurs, aussi percutante que monstrueuse et glaçante. Une lecture qui ne laisse pas indifférent et qui me marquera à jamais. Une lecture qui fait froid dans le dos, encore plus quand on sait qu'actuellement neuf pays possèdent l'arme nucléaire et que, maintenant perfectionnée (on n'arrête pas le progrès !), elle ferait beaucoup plus de dégâts...
Quelle ne fut pas ma surprise en récupérant cet ouvrage réservé à la bibliothèque, en constatant l'épaisseur du volume et en se soupesant ! J'ai commencé par désespérer en me disant que je ne parviendrai jamais à lire ce pavé !
Finalement je n'ai eu aucun mal à le lire, bien qu'il m'ait fallu trois jours pour en arriver à bout, mais le sujet me passionne, je n'ai donc pas eu de difficulté à progresser dans cette histoire, une histoire particulière, celle de l'uranium personnifié dès le début, faisant sentir qu'il était présent dès le début, avant même la naissance de la Terre, bien avant l'humanité.
On découvre alors toute les facettes de cet élément : il sauve des vies, on le sait, il tue aussi les personnes qui le manipulèrent par ignorance, sans précaution pour donner de la fluorescence au verre, par exemple.
Et puis arrive la guerre, quelques prix Nobel de physique juifs quittent l'Allemagne, pressentant les graves événements qui se profilent. L'un d'eux, Léo Szilard, est détenteur d'une théorie : la fission de l'atome est possible… ce sont les prémices … Puis l'on apprend que l'Allemagne a des projets et fait appel à des spécialistes de la physique nucléaire… La course commence, il ne faut posséder cette bombe avant l'Allemagne comme arme de dissuasion.
C'est ainsi que se construit aux Etats-Unis, une énorme unité de recherche qui aboutira… à Hiroshima et Nagasaki. Entre le début et la fin, on assiste aux travaux des physiciens, aux manoeuvres des politiques, aux hésitations, aux coups de gueule, aux pétitions de ces pères de la bombe qui voudraient faire machine arrière, et on comprend que les terribles Little Boy et Fat Man sont devenues le jouet des politique, peut-être parce qu'on avait investi dans ces joujoux, peut-être par curiosité, les effet d'une telle arme étant relativement méconnus, on notera au passage, les expériences sur des humains dignes des médecins nazis bien que l'on soit aux Etats-Unis.
On ne peut que remercier Alcante, L.F. Bollée et Denis Rodier pour ce travail de titan grâce auquel on apprend beaucoup. Un ouvrage très bien documenté. Merci à l'illustrateur pour ces belles planches et ces visages ressemblants et expressifs.
Lien : http://1001ptitgateau.blogsp..
Finalement je n'ai eu aucun mal à le lire, bien qu'il m'ait fallu trois jours pour en arriver à bout, mais le sujet me passionne, je n'ai donc pas eu de difficulté à progresser dans cette histoire, une histoire particulière, celle de l'uranium personnifié dès le début, faisant sentir qu'il était présent dès le début, avant même la naissance de la Terre, bien avant l'humanité.
On découvre alors toute les facettes de cet élément : il sauve des vies, on le sait, il tue aussi les personnes qui le manipulèrent par ignorance, sans précaution pour donner de la fluorescence au verre, par exemple.
Et puis arrive la guerre, quelques prix Nobel de physique juifs quittent l'Allemagne, pressentant les graves événements qui se profilent. L'un d'eux, Léo Szilard, est détenteur d'une théorie : la fission de l'atome est possible… ce sont les prémices … Puis l'on apprend que l'Allemagne a des projets et fait appel à des spécialistes de la physique nucléaire… La course commence, il ne faut posséder cette bombe avant l'Allemagne comme arme de dissuasion.
C'est ainsi que se construit aux Etats-Unis, une énorme unité de recherche qui aboutira… à Hiroshima et Nagasaki. Entre le début et la fin, on assiste aux travaux des physiciens, aux manoeuvres des politiques, aux hésitations, aux coups de gueule, aux pétitions de ces pères de la bombe qui voudraient faire machine arrière, et on comprend que les terribles Little Boy et Fat Man sont devenues le jouet des politique, peut-être parce qu'on avait investi dans ces joujoux, peut-être par curiosité, les effet d'une telle arme étant relativement méconnus, on notera au passage, les expériences sur des humains dignes des médecins nazis bien que l'on soit aux Etats-Unis.
On ne peut que remercier Alcante, L.F. Bollée et Denis Rodier pour ce travail de titan grâce auquel on apprend beaucoup. Un ouvrage très bien documenté. Merci à l'illustrateur pour ces belles planches et ces visages ressemblants et expressifs.
Lien : http://1001ptitgateau.blogsp..
Une présentation pour le moins originale de ce qui fût une épopée scientifique dans une période guerrière et un désastre humain, soit la conception puis l'utilisation de LA bombe, la seule pouvant se revendiquer identifiable à partir de ce terme générique, celle d'Hiroshima, celle qui détruisit Hiroshima et un peu d'Humanité, déjà bien martyrisée en ces temps troubles.
En fait ce pavé graphique se présente comme la biographie de la matière première de cette arme, sans qui rien n'aurait été possible, objet de toutes études expérimentales et de toutes les convoitises, fascinante et répulsive, aimantant les plus importants cerveaux scientifiques de l'époque, l'uranium.
La genèse et l'épopée de la bombe atomique, boostée par la guerre et les milliards américains, trouvera son apogée et sa gloire au frontispice de l'anéantissement d'une ville et de sa population.
Didactique, cet ouvrage présente équitablement, sans partis-pris, les personnages qui ont participé de près ( les scientifiques, les militaires, les politiques...) ou de loin (les victimes des essais humains, celles du cuirassé qui transporta les têtes nucléaires...), ainsi que les mécanismes qui conduisirent à cette course à la mort.
La paranoïa ambiante entourant ces projets ultra-secrets et les luttes d'influences scientifico-politico-militaires sont très bien mis en exergue.
Les cas de conscience voire les réfractaires dont Einstein lui même, s'opposant aux forcenés de la bombe, le rôle de Szilard, oublié de l'Histoire, le doute qui s'insinue des scientifiques aux plus hautes sphères politiques, l'ambivalence de certains protagonistes tels Fermi et Oppenheimer, sont particulièrement bien exposés.
Ouvrage remarquable par son sérieux et sa vaste exploration objective et sans moralisme de mauvais aloi du sujet remis au goût du jour par le film "Oppenheimer" (que je nai pas vu), me conduira à l'offrir pour noël à quelques jeunes interpellés par le sujet avoir avoir assisté au film.
D'un peu didactique au début, le livre, d'un très beau graphisme tout en noir et blanc, devient vite passionnant. Les dernières pages, les martyrs LA Bombe, sont silencieuses et poignantes, telles les reconstitutions au sein du musée d'Hiroshima.
Reste à l'humanité de faire en sorte que l'épitaphe de l'oeuvre, "Cette ombre est ma signature peut être mon âme...certainement mon pouvoir. Puisse-t-elle vous hanter à jamais", ne soit qu'une menace et non une prémonition.
En fait ce pavé graphique se présente comme la biographie de la matière première de cette arme, sans qui rien n'aurait été possible, objet de toutes études expérimentales et de toutes les convoitises, fascinante et répulsive, aimantant les plus importants cerveaux scientifiques de l'époque, l'uranium.
La genèse et l'épopée de la bombe atomique, boostée par la guerre et les milliards américains, trouvera son apogée et sa gloire au frontispice de l'anéantissement d'une ville et de sa population.
Didactique, cet ouvrage présente équitablement, sans partis-pris, les personnages qui ont participé de près ( les scientifiques, les militaires, les politiques...) ou de loin (les victimes des essais humains, celles du cuirassé qui transporta les têtes nucléaires...), ainsi que les mécanismes qui conduisirent à cette course à la mort.
La paranoïa ambiante entourant ces projets ultra-secrets et les luttes d'influences scientifico-politico-militaires sont très bien mis en exergue.
Les cas de conscience voire les réfractaires dont Einstein lui même, s'opposant aux forcenés de la bombe, le rôle de Szilard, oublié de l'Histoire, le doute qui s'insinue des scientifiques aux plus hautes sphères politiques, l'ambivalence de certains protagonistes tels Fermi et Oppenheimer, sont particulièrement bien exposés.
Ouvrage remarquable par son sérieux et sa vaste exploration objective et sans moralisme de mauvais aloi du sujet remis au goût du jour par le film "Oppenheimer" (que je nai pas vu), me conduira à l'offrir pour noël à quelques jeunes interpellés par le sujet avoir avoir assisté au film.
D'un peu didactique au début, le livre, d'un très beau graphisme tout en noir et blanc, devient vite passionnant. Les dernières pages, les martyrs LA Bombe, sont silencieuses et poignantes, telles les reconstitutions au sein du musée d'Hiroshima.
Reste à l'humanité de faire en sorte que l'épitaphe de l'oeuvre, "Cette ombre est ma signature peut être mon âme...certainement mon pouvoir. Puisse-t-elle vous hanter à jamais", ne soit qu'une menace et non une prémonition.
Vrai gros coup de ❤
Bon, je sais que je vais en agacer encore quelques-un(e), mais celui-là vous ne pouvez pas passer à côté.
La bombe, de Alcante, Bollée et Rodier est une bande dessinée de 460 pages, pour tout savoir sur la bombe atomique et comment l'humanité, le 6 août 1945, en plein chaos de fin de Seconde Guerre mondiale, a perdu le peu qui lui restait....d'humanité.
L'une des pires journées de l'histoire de notre monde nous est racontée ici.
Et qui en est le narrateur ?
Le principal responsable : l'URANIUM.
De sa découverte jusqu'à son utilisation vous saurez tout.
Des savants qui l'ont étudié, de ceux qui l'ont exploité, modifié, mélangé au plutonium par exemple.
Des militaires qui s'en sont emparé.
Des politiques qui l'ont adoubé.
Des scientifiques qui ont compris le danger.
Des soldats qui se sont extasié de ses capacités.
Des gouvernements qui se sont lancé dans la course contre la montre pour mettre au point avant les autres une arme de guerre sans précédent.
Des cobayes qu'on a utilisés à leur insu.
Des tentatives de justification des uns aux tentatives de mise en garde des autres.
Mais dans la bombe, on explique aussi comment on a empêché l'Allemagne de réussir son projet.
Comment l'Amérique a justifié les bombardements d'Hiroshima puis de Nagasaki, détruisant tout, y compris des centaines de milliers de vies.
Le Président Truman, le général Groves (qui supervisa toute l'opération depuis le début, allant jusqu'à espionner certains scientifiques), où les pilotes du tristement célèbre Énola Gay,
l'avion qui largua "little boy" (quel horrible nom pour un engin de mort de 4 tonnes) au-dessus de la ville japonaise, se féliciteront de la parfaite exécution du plan et aucun d'eux n'exprimera jamais de regrets. Tibbets, le pilote, allant même jusqu'à avouer, bien des années plus tard, qu'il dormait bien toutes les nuits...
Tout est argumenté, tout est vrai (hormis quelques civils japonais insérés dans le récit pour aider à s'imprégner de toute l'horreur des événements).
Une BD, où le noir et blanc s'imposent, qui devrait être lue dans tous les pays du monde, pour montrer, s'il en est qui doutent encore, l'âme noire de l'être humain.
RIEN ne justifie qu'on en arrive là...
Mieux qu'un roman, moins barbant que la conférence d'un chimiste (quand on est ignorant en la matière, s'entend) et plus digeste que certains livres d'histoire, une lecture indispensable.
Bravo aux auteurs de ce pavé, bravo à l'éditeur (Glénat).
Bon, je sais que je vais en agacer encore quelques-un(e), mais celui-là vous ne pouvez pas passer à côté.
La bombe, de Alcante, Bollée et Rodier est une bande dessinée de 460 pages, pour tout savoir sur la bombe atomique et comment l'humanité, le 6 août 1945, en plein chaos de fin de Seconde Guerre mondiale, a perdu le peu qui lui restait....d'humanité.
L'une des pires journées de l'histoire de notre monde nous est racontée ici.
Et qui en est le narrateur ?
Le principal responsable : l'URANIUM.
De sa découverte jusqu'à son utilisation vous saurez tout.
Des savants qui l'ont étudié, de ceux qui l'ont exploité, modifié, mélangé au plutonium par exemple.
Des militaires qui s'en sont emparé.
Des politiques qui l'ont adoubé.
Des scientifiques qui ont compris le danger.
Des soldats qui se sont extasié de ses capacités.
Des gouvernements qui se sont lancé dans la course contre la montre pour mettre au point avant les autres une arme de guerre sans précédent.
Des cobayes qu'on a utilisés à leur insu.
Des tentatives de justification des uns aux tentatives de mise en garde des autres.
Mais dans la bombe, on explique aussi comment on a empêché l'Allemagne de réussir son projet.
Comment l'Amérique a justifié les bombardements d'Hiroshima puis de Nagasaki, détruisant tout, y compris des centaines de milliers de vies.
Le Président Truman, le général Groves (qui supervisa toute l'opération depuis le début, allant jusqu'à espionner certains scientifiques), où les pilotes du tristement célèbre Énola Gay,
l'avion qui largua "little boy" (quel horrible nom pour un engin de mort de 4 tonnes) au-dessus de la ville japonaise, se féliciteront de la parfaite exécution du plan et aucun d'eux n'exprimera jamais de regrets. Tibbets, le pilote, allant même jusqu'à avouer, bien des années plus tard, qu'il dormait bien toutes les nuits...
Tout est argumenté, tout est vrai (hormis quelques civils japonais insérés dans le récit pour aider à s'imprégner de toute l'horreur des événements).
Une BD, où le noir et blanc s'imposent, qui devrait être lue dans tous les pays du monde, pour montrer, s'il en est qui doutent encore, l'âme noire de l'être humain.
RIEN ne justifie qu'on en arrive là...
Mieux qu'un roman, moins barbant que la conférence d'un chimiste (quand on est ignorant en la matière, s'entend) et plus digeste que certains livres d'histoire, une lecture indispensable.
Bravo aux auteurs de ce pavé, bravo à l'éditeur (Glénat).
critiques presse (4)
Comme d'habitude chez Nanni, cette évocation est d'une subtilité et d'une poésie rares.
Lire la critique sur le site : BDGest
[Quesnel] insuffle à cette somme de recherches une humanité, une sensibilité et une inventivité graphique et narrative qui subjuguent et émeuvent.
Lire la critique sur le site : LeJournaldeQuebec
L’horreur des évènements est racontée sans que ça devienne sanglant ou trop théâtral.
Lire la critique sur le site : LaPresse
Aussi bien racontée qu’ultra documentée, “La Bombe”, passionnante BD scénarisée par Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bollée, et dessinée par Denis Rodier, nous plonge dans l’histoire de la bombe atomique en compagnie d’un étonnant narrateur : l’uranium !
Lire la critique sur le site : Telerama
Citations et extraits (60)
Voir plus
Ajouter une citation
Je dois prendre d'en moins d'une heure un train pour le Tennessee. C'est là que je vais conclure l'achat de 33 000 hectares de terrain qui serviront à établir les usines et des laboratoires nécessaires à la production d'uranium 235 ! Ce site, baptisé X, réunit tous les critères. Le Tennessee le fournira en électricité et en eau, il n'est pas trop loin de Washington et de Chicago, et il est éloigné des côtes en cas d'attaque ennemie... Et enfin, ses conditions d'acquisition sont raisonnables : seulement 4 millions de dollars et 400 familles à reloger !
« Je suis le feu incandescent des enfers. Je suis le choc. Je suis le créateur de néant. Je suis celui qui a fait se coucher le soleil sur l'Empire du Soleil Levant !
Ce jour-là, le 6 Août, à Tokyo, personne ne savait rien de mon récital. C'est un employé de la compagnie de diffusion du Japon, la fameuse NHK, qui remarqua le premier que les radios d'Hiroshima n'émettaient plus.
C'est ensuite le propre discours de Truman annonçant le bombardement atomique qui permit aux japonais de comprendre la situation !
Le 7 Août, les autorités japonaises envoient sur place le professeur Nishina, leur spécialiste atomique. Suite à des problèmes mécaniques, il n'arrive que le 8 Août à Hiroshima.
Ce qu'il voit du ciel l'effraie.
Ce qu'il constate au sol ne lui laisse aucun doute. Le soir même il avertit le cabinet du premier ministre qu'il s'agit bien d'une bombe atomique. »
Ce jour-là, le 6 Août, à Tokyo, personne ne savait rien de mon récital. C'est un employé de la compagnie de diffusion du Japon, la fameuse NHK, qui remarqua le premier que les radios d'Hiroshima n'émettaient plus.
C'est ensuite le propre discours de Truman annonçant le bombardement atomique qui permit aux japonais de comprendre la situation !
Le 7 Août, les autorités japonaises envoient sur place le professeur Nishina, leur spécialiste atomique. Suite à des problèmes mécaniques, il n'arrive que le 8 Août à Hiroshima.
Ce qu'il voit du ciel l'effraie.
Ce qu'il constate au sol ne lui laisse aucun doute. Le soir même il avertit le cabinet du premier ministre qu'il s'agit bien d'une bombe atomique. »
"- Tout de même, vous pensez à ce pauvre bougre, et à ce qu'on lui a fait subir?
- J'y pense, oui, mais dans l'intérêt de la science! Et n'exagérons rien, ça ne devrait pas altérer significativement sa qualité de vie, vu son âge...
(p. 267, au sujet du patient "HP")
- J'y pense, oui, mais dans l'intérêt de la science! Et n'exagérons rien, ça ne devrait pas altérer significativement sa qualité de vie, vu son âge...
(p. 267, au sujet du patient "HP")
- "Maintenant je suis la mort, le destructeur des mondes..."
(extrait d'un texte sacré hindou, le Bhagavad Gita, cité par le Dr Oppenheimer, Directeur scientifique du Projet Manhattan)
(extrait d'un texte sacré hindou, le Bhagavad Gita, cité par le Dr Oppenheimer, Directeur scientifique du Projet Manhattan)
"What you see here, what you do here, what you hear here, when you leave here, let it stay here!"
(p. 171, Los alomos, panneau)
(p. 171, Los alomos, panneau)
Lire un extrait
Videos de Alcante (15)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans le 171e épisode du podcast Le bulleur, on vous présente Whisky san, que l’on doit au scénario conjoint de Fabien Rodhain et Didier Alcante ainsi qu’au dessin d’Alicia Grande et qui est édité chez Grand angle. Cette semaine aussi, on revient sur l’actualité de la bande dessinée et des sorties avec :
- La sortie de l’album L’honorable partie de campagne que l’on doit au scénario de Jean-David Morvan qui adapte l’ouvrage de Thomas Raucat, mis en dessin par Roberto Melis et édité chez Sarbacane
- La sortie de l’album Jusqu’ici tout va bien, adaptation d’un roman de Gary D. Schmidt par Nicolas Pitz et que publient les éditions Re de Sèvres
- La sortie de Sous la surface, le deuxième tome de la série Le lait paternel que nous devons à Uli Oesterle et aux éditions Dargaud
- La sortie de l’album Les 100 derniers jours d’Hitler, adaptation d’un ouvrage de Jean Lopez par Jean-Pierre Pécau au scénario, le duo Senad Mavric et Filip Andronik au dessin et c’est édité chez Delcourt
- La sortie du premier album sur deux de Quand la nuit tombe, un titre baptisé Lisou que l’on doit au scénario de Marion Achard, au dessin de Toni Galmès et c’est édité chez Delcourt
- La réédition en couleurs de l’album Orignal que l’on doit à Max de Radiguès et qui est sorti chez Casterman
+ Lire la suite
autres livres classés : roman graphiqueVoir plus
Les plus populaires : Bande dessinée
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Alcante (47)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3192 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3192 lecteurs ont répondu