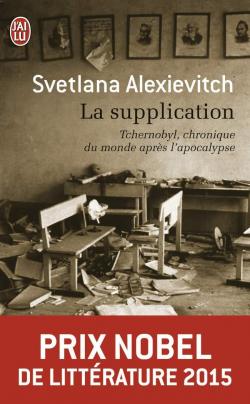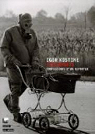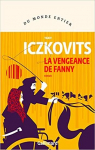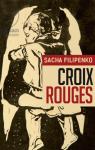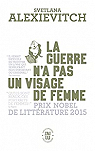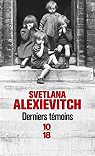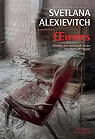Svetlana Alexievitch
Galia Ackerman (Traducteur)Pierre Lorrain (Traducteur)/5 1049 notes
Galia Ackerman (Traducteur)Pierre Lorrain (Traducteur)/5 1049 notes
Résumé :
"Des bribes de conversations me reviennent en mémoire... Quelqu'un m'exhorte : - Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main ! " Tchernobyl. Ce mot évoque dorénavant une catastrophe écologique majeure. Mais que savons-nous du drame humain, quotidien, qui a suivi l'explosion de la centrale ? Svetlana... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Supplication : Tchernobyl, chroniques du monde après l'apocalypseVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (207)
Voir plus
Ajouter une critique
Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature en 2015, a donné la parole à une quantité de personnes de tous bords pour cette supplication, La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse.
Elle aurait pu écrire une fiction, romancer ce drame survenu le 26 avril 1986, en Ukraine, tout près de la Biélorussie, au temps ancien de l'Union Soviétique, l'Urss. Elle qui est originaire de cette région, aurait pu aussi effectuer un reportage sur les lieux mais elle a choisi de laisser parler les gens, de recueillir une quantité impressionnante de témoignages dont se dégage une immense douleur, une formidable incompréhension devant cette catastrophe nucléaire mettant à bas la foi de l'homme dans sa maîtrise de la technique, de la physique, de cette énergie que beaucoup ont considéré, considèrent encore comme miraculeuse, produisant tant d'énergie pour si peu de combustible.
Toutes les précautions étaient prises, les sécurités assurées, les ingénieurs préparés et tout a foiré en quelques minutes causant une catastrophe d'autant plus incompréhensible et dangereuse que ses conséquences sont invisibles et pourtant bien réelles, loin du réacteur en fusion, arrivant même jusqu'en France.
En lisant ce livre si poignant, si bouleversant, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments mis en scène dans la série Chernobyl. Craig Manzin, le réalisateur, s'en est inspiré pour le personnage de Lyudmilla Ignatenko, l'épouse du pompier Vasily Ignatenko parti combattre l'incendie alors qu'il était de repos et qui périt, comme beaucoup d'autres, dans d'atroces souffrances, jamais abandonné par son épouse.
Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet, d'autres le seront et il le faut. Des films ont été consacrés à cela, une série évoquée déjà mais il fallait donner la parole à celles et à ceux qui ont subi, subissent encore des dégâts matériels et surtout physiques et psychologiques irréparables.
Le mot qui ressort de tous ces témoignages, c'est souffrance. Qu'ils soient travailleurs de la centrale, enfants, anciens fonctionnaires du parti, médecins, soldats, émigrants, croyants, athées, paysans ou intellectuels, la catastrophe nucléaire a détruit des vies, brisés de simples bonheurs familiaux, pollué une terre immense, réduit la ville de Pripiat, construite pour abriter les employés de la centrale, à une ville fantôme, pour une éternité.
Il fallait faire ce travail et Svetlana Alexievitch l'a accompli remarquablement pendant trois années entières. Cela donne une suite de monologues et un choeur d'enfants, chacun avec un titre et une signature précise. Si elle laisse la conclusion à Valentina Timofeïevna Panassevitch, épouse d'un liquidateur, c'est pour mieux montrer la douleur, la souffrance intolérable d'une femme qui a accompagné son mari jusqu'au bout alors que tout le monde la suppliait de l'abandonner puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Quel amour, profond, sincère, admirable !
Alors, un court épilogue, une annonce d'agence de voyages de Kiev promet : « … pour de l'argent. Visitez La Mecque du nucléaire. » Ces visites ont été montrées à l'écran. Alexandra Koszelik a très bien raconté cela dans À crier dans les ruines mais rien ne remplacera jamais tous ces témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch, témoignages débordant d'une douleur incroyable dans un pays immense où la centralisation bureaucratique permettait tant d'erreurs et de mauvaises décisions.
En terminant ces lignes, l'émotion me brise en pensant à toutes ces vies sacrifiées ou saccagées et à tous ces gens qui souffrent encore…
Merci à Élodie de m'avoir permis de lire ce livre.
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
Elle aurait pu écrire une fiction, romancer ce drame survenu le 26 avril 1986, en Ukraine, tout près de la Biélorussie, au temps ancien de l'Union Soviétique, l'Urss. Elle qui est originaire de cette région, aurait pu aussi effectuer un reportage sur les lieux mais elle a choisi de laisser parler les gens, de recueillir une quantité impressionnante de témoignages dont se dégage une immense douleur, une formidable incompréhension devant cette catastrophe nucléaire mettant à bas la foi de l'homme dans sa maîtrise de la technique, de la physique, de cette énergie que beaucoup ont considéré, considèrent encore comme miraculeuse, produisant tant d'énergie pour si peu de combustible.
Toutes les précautions étaient prises, les sécurités assurées, les ingénieurs préparés et tout a foiré en quelques minutes causant une catastrophe d'autant plus incompréhensible et dangereuse que ses conséquences sont invisibles et pourtant bien réelles, loin du réacteur en fusion, arrivant même jusqu'en France.
En lisant ce livre si poignant, si bouleversant, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments mis en scène dans la série Chernobyl. Craig Manzin, le réalisateur, s'en est inspiré pour le personnage de Lyudmilla Ignatenko, l'épouse du pompier Vasily Ignatenko parti combattre l'incendie alors qu'il était de repos et qui périt, comme beaucoup d'autres, dans d'atroces souffrances, jamais abandonné par son épouse.
Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet, d'autres le seront et il le faut. Des films ont été consacrés à cela, une série évoquée déjà mais il fallait donner la parole à celles et à ceux qui ont subi, subissent encore des dégâts matériels et surtout physiques et psychologiques irréparables.
Le mot qui ressort de tous ces témoignages, c'est souffrance. Qu'ils soient travailleurs de la centrale, enfants, anciens fonctionnaires du parti, médecins, soldats, émigrants, croyants, athées, paysans ou intellectuels, la catastrophe nucléaire a détruit des vies, brisés de simples bonheurs familiaux, pollué une terre immense, réduit la ville de Pripiat, construite pour abriter les employés de la centrale, à une ville fantôme, pour une éternité.
Il fallait faire ce travail et Svetlana Alexievitch l'a accompli remarquablement pendant trois années entières. Cela donne une suite de monologues et un choeur d'enfants, chacun avec un titre et une signature précise. Si elle laisse la conclusion à Valentina Timofeïevna Panassevitch, épouse d'un liquidateur, c'est pour mieux montrer la douleur, la souffrance intolérable d'une femme qui a accompagné son mari jusqu'au bout alors que tout le monde la suppliait de l'abandonner puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Quel amour, profond, sincère, admirable !
Alors, un court épilogue, une annonce d'agence de voyages de Kiev promet : « … pour de l'argent. Visitez La Mecque du nucléaire. » Ces visites ont été montrées à l'écran. Alexandra Koszelik a très bien raconté cela dans À crier dans les ruines mais rien ne remplacera jamais tous ces témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch, témoignages débordant d'une douleur incroyable dans un pays immense où la centralisation bureaucratique permettait tant d'erreurs et de mauvaises décisions.
En terminant ces lignes, l'émotion me brise en pensant à toutes ces vies sacrifiées ou saccagées et à tous ces gens qui souffrent encore…
Merci à Élodie de m'avoir permis de lire ce livre.
Lien : http://notre-jardin-des-livr..
La lecture de cette supplication est singulière. Il faut y être amené par des voi(x)es détournées. J'aurai beau vous expliquer pourquoi je pense que sa lecture est nécessaire, qu'il vous fau(t)drait le lire au risque de vous voir ravir la sérénité de vos prochaines nuits, s'il n'y a rien au fond de vous même qui vous y pousse, si vous n'avez pas envie de franchir ce pas, vous ne le ferez pas.
Ce livre est un concentré de douleur et d'amour, d'humanité et de monstruosité, de résignation et de colère, d'héroïsme et de lâcheté que l'on confond à chaque page avec l'abnégation et la préservation de soi (plus que l'égoïsme)... Quand on me dit que l'on n'a pas envie de lire « ça », actuellement, qu'on sait ce qui s'est passé « là-bas » et qu'on n'a pas besoin de penser à « ça », j'ai envie de répondre : La parole n'est pas donnée ici à « ce qui est arrivé » mais à « ceux à qui c'est arrivé ». On n'est pas dans un cours d'histoire, dans une tentative de rationalisation ou de compréhension, on est dans le vécu. Avec ses silences et ses non-dits, ses pleurs et ses cris. Et sa dignité, aussi :
«Je me tais. Personne ne trouve les mots qui me feraient répondre. Dans ma langue à moi... Personne ne comprend d'où je suis revenu... Et il m'est impossible de le raconter ! »
«Toute ma vie, je serai reconnaissante à Angelina Vassilievna Gouskova. Toute ma vie ! »
« (Silence.) Je peux en parler, maintenant... Avant, je ne le pouvais pas... Pendant dix ans, je me suis tue... Dix ans. (Silence.) »
« Si les autres se taisent, moi, je vais parler. »
« L'Afghanistan, où j'ai passé deux ans, et Tchernobyl ont été les deux moments de ma vie où j'ai vécu le plus intensément. »
« Lorsque je suis rentré d'Afghanistan, je savais que j'allais vivre. Mais Tchernobyl, c'était le contraire : cela ne tuerait qu'après notre départ... »
« Là-bas, mon âme était morte... Comment donner naissance avec une âme morte ? »
« Écrivez un livre honnête... »
Je pourrais continuer encore...
Une des questions que posent certains des témoins à qui Svetlana Alexievitch a donné la parole est : Pourquoi y a t-il si peu d'écrits sur Tchernobyl ? Pourquoi n'écrivons-nous pas sur Tchernobyl ? Il y a de la littérature sur les camps, la guerre à foison mais si peu sur cette tragédie (?), catastrophe (?) - quel devrait être le mot « juste » et est-ce qu'il y en a un ? - ?
Est-ce encore trop récent ? Tels, au sortir des camps de concentration, les déportés à qui la société n'a pas su laisser d'espace de paroles. Est-il trop tôt pour pouvoir le penser ? Mais quand « penser » Tchernobyl : dans des milliers d'années, à la date de ce qu'on évalue comme la fin de la « nocivité » des radiations ?
Est-ce la continuité d'un processus naturel de l'esprit humain : la nécessité de vivre qui l'emporte ? continuer à vivre « comme si » rien ne s'était passé, pour préserver un système politique, un mode d'exploitation et de profit ? Comme un refoulement à l'échelle planétaire, hors de la conscience de l'humanité... Tous les verrous bloqués à triple tour. En face : Fukushima affleure sans rien y changer. Ou si peu...
Il faut souligner que ce livre est toujours interdit en Biélorussie. Pourquoi est-ce que ces témoignages de simples gens devenus des victimes honteuses réduites au silence et les paroles de toutes celles qui suivront sont-elles jugées inaudibles, privées du droit de citer sur les terres biélorusses ? Pourquoi cette réalité ne peut-elle exister dans ce monde d'après ?
Est-ce compatible et cohérent ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à Penser Tchernobyl autrement que comme une exception qui ne se renouvèlera pas dans l'univers de l'exploitation du nucléaire, civil et militaire ? Et quand la bête immonde se réveille que faire avec Fukushima ? Rien ! On laisse couler. Et qui vivra, verra !
Transparent, Incolore, Inodore, volatile et libre... : « Nous sommes l'air, pas la terre » (Merab Mamardachvili, en épigraphe). Et Tchernobyl poursuit sa course folle... plus de 200 m2 d'interstices et de fissures épars dans le bouclier qui tombe en ruines et toute cette radioactivité qui continue à s'échapper dans l'air. L'effondrement, c'est pour quand ?
Je me suis souvent demandée après avoir achevé la lecture de ce livre, quelle était la raison du choix de ce titre : La supplication.
Est-ce que toutes ces voix des témoins, livrées, confiées, déposées dans la peur, la douleur, l'incrédulité ou la colère, sont une sorte de supplique, de prière lancée à la face du monde ou à cette seule femme, Svetlana Alexievitch, qui aura su les entendre, faire silence pour laisser toutes ces paroles émerger et les diffuser ?
Est-ce pour nous, les ignorants, les auto-proclamés épargnés au sursis précaire, qui vivons nos vies dans l'inconscience de cette tragédie ?
Est-ce pour ceux qui savaient, qui auraient dû « écouter », en 1986 et qui ont bâillonner ces bouches et obstruer l'écoute ?
Est-ce une supplication contre l'oubli ? Ou plutôt, ce satané refoulement d'une conscience auto-protectrice : conscience collective, conscience individuelle... celle de la Société, de l'Histoire et de l'Humanité.
Ce livre est construit comme une tragédie grecque : un prologue, des choeurs et des acteurs, bien malgré eux, qui avancent pour certains masqués, et cette supplication qui tient lieu de lamentation. Il y est question de mythe (de la science et du nucléaire), de dépassement de soi (lisez les témoignages) et de destin (ce vers quoi on va, mais qu'on ne saurait voir). Et cette catharsis qui libère les paroles !
« Dans la tragédie, en effet, tout est là, sous les yeux, réel, proche, immédiat. On y croit. On a peur. […] Parce qu'elle montrait au lieu de raconter, et par les conditions mêmes dans lesquelles elle montrait » (c'est moi qui rajoute cette définition si juste de la tragédie, faîte par Jacqueline de Romilly).
C'est notre humanité que nous montre Svetlana Alexievitch et c'est de là, également, qu'elle nous écrit... en espérant un sursaut, avant la mise à mort.
Ce livre est un concentré de douleur et d'amour, d'humanité et de monstruosité, de résignation et de colère, d'héroïsme et de lâcheté que l'on confond à chaque page avec l'abnégation et la préservation de soi (plus que l'égoïsme)... Quand on me dit que l'on n'a pas envie de lire « ça », actuellement, qu'on sait ce qui s'est passé « là-bas » et qu'on n'a pas besoin de penser à « ça », j'ai envie de répondre : La parole n'est pas donnée ici à « ce qui est arrivé » mais à « ceux à qui c'est arrivé ». On n'est pas dans un cours d'histoire, dans une tentative de rationalisation ou de compréhension, on est dans le vécu. Avec ses silences et ses non-dits, ses pleurs et ses cris. Et sa dignité, aussi :
«Je me tais. Personne ne trouve les mots qui me feraient répondre. Dans ma langue à moi... Personne ne comprend d'où je suis revenu... Et il m'est impossible de le raconter ! »
«Toute ma vie, je serai reconnaissante à Angelina Vassilievna Gouskova. Toute ma vie ! »
« (Silence.) Je peux en parler, maintenant... Avant, je ne le pouvais pas... Pendant dix ans, je me suis tue... Dix ans. (Silence.) »
« Si les autres se taisent, moi, je vais parler. »
« L'Afghanistan, où j'ai passé deux ans, et Tchernobyl ont été les deux moments de ma vie où j'ai vécu le plus intensément. »
« Lorsque je suis rentré d'Afghanistan, je savais que j'allais vivre. Mais Tchernobyl, c'était le contraire : cela ne tuerait qu'après notre départ... »
« Là-bas, mon âme était morte... Comment donner naissance avec une âme morte ? »
« Écrivez un livre honnête... »
Je pourrais continuer encore...
Une des questions que posent certains des témoins à qui Svetlana Alexievitch a donné la parole est : Pourquoi y a t-il si peu d'écrits sur Tchernobyl ? Pourquoi n'écrivons-nous pas sur Tchernobyl ? Il y a de la littérature sur les camps, la guerre à foison mais si peu sur cette tragédie (?), catastrophe (?) - quel devrait être le mot « juste » et est-ce qu'il y en a un ? - ?
Est-ce encore trop récent ? Tels, au sortir des camps de concentration, les déportés à qui la société n'a pas su laisser d'espace de paroles. Est-il trop tôt pour pouvoir le penser ? Mais quand « penser » Tchernobyl : dans des milliers d'années, à la date de ce qu'on évalue comme la fin de la « nocivité » des radiations ?
Est-ce la continuité d'un processus naturel de l'esprit humain : la nécessité de vivre qui l'emporte ? continuer à vivre « comme si » rien ne s'était passé, pour préserver un système politique, un mode d'exploitation et de profit ? Comme un refoulement à l'échelle planétaire, hors de la conscience de l'humanité... Tous les verrous bloqués à triple tour. En face : Fukushima affleure sans rien y changer. Ou si peu...
Il faut souligner que ce livre est toujours interdit en Biélorussie. Pourquoi est-ce que ces témoignages de simples gens devenus des victimes honteuses réduites au silence et les paroles de toutes celles qui suivront sont-elles jugées inaudibles, privées du droit de citer sur les terres biélorusses ? Pourquoi cette réalité ne peut-elle exister dans ce monde d'après ?
Est-ce compatible et cohérent ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à Penser Tchernobyl autrement que comme une exception qui ne se renouvèlera pas dans l'univers de l'exploitation du nucléaire, civil et militaire ? Et quand la bête immonde se réveille que faire avec Fukushima ? Rien ! On laisse couler. Et qui vivra, verra !
Transparent, Incolore, Inodore, volatile et libre... : « Nous sommes l'air, pas la terre » (Merab Mamardachvili, en épigraphe). Et Tchernobyl poursuit sa course folle... plus de 200 m2 d'interstices et de fissures épars dans le bouclier qui tombe en ruines et toute cette radioactivité qui continue à s'échapper dans l'air. L'effondrement, c'est pour quand ?
Je me suis souvent demandée après avoir achevé la lecture de ce livre, quelle était la raison du choix de ce titre : La supplication.
Est-ce que toutes ces voix des témoins, livrées, confiées, déposées dans la peur, la douleur, l'incrédulité ou la colère, sont une sorte de supplique, de prière lancée à la face du monde ou à cette seule femme, Svetlana Alexievitch, qui aura su les entendre, faire silence pour laisser toutes ces paroles émerger et les diffuser ?
Est-ce pour nous, les ignorants, les auto-proclamés épargnés au sursis précaire, qui vivons nos vies dans l'inconscience de cette tragédie ?
Est-ce pour ceux qui savaient, qui auraient dû « écouter », en 1986 et qui ont bâillonner ces bouches et obstruer l'écoute ?
Est-ce une supplication contre l'oubli ? Ou plutôt, ce satané refoulement d'une conscience auto-protectrice : conscience collective, conscience individuelle... celle de la Société, de l'Histoire et de l'Humanité.
Ce livre est construit comme une tragédie grecque : un prologue, des choeurs et des acteurs, bien malgré eux, qui avancent pour certains masqués, et cette supplication qui tient lieu de lamentation. Il y est question de mythe (de la science et du nucléaire), de dépassement de soi (lisez les témoignages) et de destin (ce vers quoi on va, mais qu'on ne saurait voir). Et cette catharsis qui libère les paroles !
« Dans la tragédie, en effet, tout est là, sous les yeux, réel, proche, immédiat. On y croit. On a peur. […] Parce qu'elle montrait au lieu de raconter, et par les conditions mêmes dans lesquelles elle montrait » (c'est moi qui rajoute cette définition si juste de la tragédie, faîte par Jacqueline de Romilly).
C'est notre humanité que nous montre Svetlana Alexievitch et c'est de là, également, qu'elle nous écrit... en espérant un sursaut, avant la mise à mort.
Un recueil de témoignages des suppliciés de Tchernobyl. Sapeurs-pompiers, militaires, réquisitionnés, volontaires pour quelques centaines de roubles, pilotes d'hélicoptères, liquidateurs, infirmières, épouses, ou simples paysans des environs de la centrale nucléaire qui cultivaient leurs concombres…
Svetlana Alexievitch donne la parole aux Tchernobyliens, devenus au fil des ans des curiosités ambulantes, des repoussoirs, des objets radioactifs non identifiés.
C'est poignant, c'est insupportable, c'est révoltant, c'est terrifiant, c'est parfois drôle, c'est toujours digne…
Un accident nucléaire majeur survenu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un drame écologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité remis au niveau de l'Homme, du petit homme sans importance qui essaie de survivre, et de croire malgré tout en l'avenir…
On va combattre gaiement les radiations avec des pelles ; on se soigne avec de bonnes rasades de vodka ; à ce beau verger en fleurs, il manque son odeur ; un gosse est en train de perdre ses cheveux ; dans la forêt, les animaux sauvages sont d'une inquiétante lenteur ; dans les villes évacuées, les loups reviennent ; on croit aux mensonges d'état ou bien on fait semblant ; on entre dans l'inconnu, on côtoie la démence, on ne sait plus faire la différence entre le réel et l'irréel ; enfanter devient un péché ; puis on meurt à petit feu, caché des autres, au milieu d'insupportables souffrances…
Personne ne sait ce qu'est Tchernobyl. Il n'y a que des suppositions. Des pressentiments. Ce drame dépasse notre entendement, notre « temps humain ». Même trente années plus tard, nous ne savons toujours pas en parler, ni même en évaluer toutes les conséquences. Nous n'en sommes pas capables.
Allons-nous oublier Tchernobyl ?
Svetlana Alexievitch donne la parole aux Tchernobyliens, devenus au fil des ans des curiosités ambulantes, des repoussoirs, des objets radioactifs non identifiés.
C'est poignant, c'est insupportable, c'est révoltant, c'est terrifiant, c'est parfois drôle, c'est toujours digne…
Un accident nucléaire majeur survenu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un drame écologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité remis au niveau de l'Homme, du petit homme sans importance qui essaie de survivre, et de croire malgré tout en l'avenir…
On va combattre gaiement les radiations avec des pelles ; on se soigne avec de bonnes rasades de vodka ; à ce beau verger en fleurs, il manque son odeur ; un gosse est en train de perdre ses cheveux ; dans la forêt, les animaux sauvages sont d'une inquiétante lenteur ; dans les villes évacuées, les loups reviennent ; on croit aux mensonges d'état ou bien on fait semblant ; on entre dans l'inconnu, on côtoie la démence, on ne sait plus faire la différence entre le réel et l'irréel ; enfanter devient un péché ; puis on meurt à petit feu, caché des autres, au milieu d'insupportables souffrances…
Personne ne sait ce qu'est Tchernobyl. Il n'y a que des suppositions. Des pressentiments. Ce drame dépasse notre entendement, notre « temps humain ». Même trente années plus tard, nous ne savons toujours pas en parler, ni même en évaluer toutes les conséquences. Nous n'en sommes pas capables.
Allons-nous oublier Tchernobyl ?
Deux jours. C'est ce qu'il m'a fallu pour lire ces 249 pages. Parce que ce n'est pas un livre qu'on dévore, il faut le temps de "digérer", de se remettre de l'uppercut qu'on reçoit, de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe.
.
Svetlana Alexievitch a recueilli les témoignages des survivants de la catastrophe. Tout le monde connaît Tchernobyl, mais peu savent comment l'ont vécu et le vivent encore les habitants des zones contaminées.
.
Et il serait illusoire de croire que c'est terminé.
Le quatrième réacteur, nom de code "Abri" conserve encore vingt tonnes de combustible nucléaire et nul ne sait ce qu'il advient de cette matière.
Le sarcophage, bâti à la hâte, a été monté à distance, à l'aide de robots et d'hélicoptères, d'où des fentes, dont la surface dépasse les 200 mètres carrés et des aérosols radioactifs continuent à s'en échapper.
Si ce sarcophage tombait en ruine, ce qu'il est impossible de prévoir puisque personne ne peut s'en approcher pour en déterminer l'état, s'il était détruit, les conséquences seraient encore plus horribles que celles de 1986.
****
En prologue, "Une voix solitaire", celle de l'épouse d'un pompier nous happe.
Le jeune couple réside au foyer de la caserne, avec trois autres familles.
.
Le 26 avril 1986, à 1 h 23, le jeune pompier est appelé sur un incendie.à la centrale.
.
De la lucarne de leur logement, sa femme voit la flamme, tout le ciel semblait luire, puis de la suie et une horrible chaleur.
Le bitume qui recouvrait le toit de la centrale brûlait et les pompiers marchaient dessus pour étouffer les flammes.
Avec leurs pieds, ils balançaient le graphite brûlant. Ils ne portaient pas leurs tenues en prélart. Personne ne les avait prévenus...
Quelques heures après, les familles étaient informées que les jeunes hommes étaient à l'hôpital...
.
Si ma mémoire est bonne, ils étaient sept. Les tout premiers intervenants. Ils n'avaient qu'un peu plus de 20 ans.
.
Et les témoignages se succèdent. L'auteure par elle-même, Piotr S., psychologue, des résidents sans autorisation, des pères, des mères, des enfants. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Mais aussi des soldats, des enseignants, des médecins, des scientifiques, des liquidateurs, .
Des chasseurs ont été envoyés pour tuer les animaux domestiques, chiens, chats...
Ils enterraient la terre dans la terre.
.
Ce livre est un concentré de peur, de douleur, d'abnégation, de colère, mais aussi d'amour et de solidarité.
.
Ce qui frappe également, c'est l'ncompréhension et le manque d'informations. Comment informer quand personne ne sait ce qui se passe ?
Le matériel de protection, tels les masques, était obsolète ou inadapté.
Ça m'a d'ailleurs rappelé quelque chose...
.
Un livre à mettre entre toutes les mains. Je ne savais pas du tout comment rédiger ce retour, alors j'ai utilisé des bribes du livre.
D'autres retours beaucoup plus élaborés ont été écrits, n'hésitez pas à les parcourir.
Au passage, je remercie mon ami Meps qui m'a incitée à choisir ce livre avec son retour percutant.
.
Svetlana Alexievitch a recueilli les témoignages des survivants de la catastrophe. Tout le monde connaît Tchernobyl, mais peu savent comment l'ont vécu et le vivent encore les habitants des zones contaminées.
.
Et il serait illusoire de croire que c'est terminé.
Le quatrième réacteur, nom de code "Abri" conserve encore vingt tonnes de combustible nucléaire et nul ne sait ce qu'il advient de cette matière.
Le sarcophage, bâti à la hâte, a été monté à distance, à l'aide de robots et d'hélicoptères, d'où des fentes, dont la surface dépasse les 200 mètres carrés et des aérosols radioactifs continuent à s'en échapper.
Si ce sarcophage tombait en ruine, ce qu'il est impossible de prévoir puisque personne ne peut s'en approcher pour en déterminer l'état, s'il était détruit, les conséquences seraient encore plus horribles que celles de 1986.
****
En prologue, "Une voix solitaire", celle de l'épouse d'un pompier nous happe.
Le jeune couple réside au foyer de la caserne, avec trois autres familles.
.
Le 26 avril 1986, à 1 h 23, le jeune pompier est appelé sur un incendie.à la centrale.
.
De la lucarne de leur logement, sa femme voit la flamme, tout le ciel semblait luire, puis de la suie et une horrible chaleur.
Le bitume qui recouvrait le toit de la centrale brûlait et les pompiers marchaient dessus pour étouffer les flammes.
Avec leurs pieds, ils balançaient le graphite brûlant. Ils ne portaient pas leurs tenues en prélart. Personne ne les avait prévenus...
Quelques heures après, les familles étaient informées que les jeunes hommes étaient à l'hôpital...
.
Si ma mémoire est bonne, ils étaient sept. Les tout premiers intervenants. Ils n'avaient qu'un peu plus de 20 ans.
.
Et les témoignages se succèdent. L'auteure par elle-même, Piotr S., psychologue, des résidents sans autorisation, des pères, des mères, des enfants. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Mais aussi des soldats, des enseignants, des médecins, des scientifiques, des liquidateurs, .
Des chasseurs ont été envoyés pour tuer les animaux domestiques, chiens, chats...
Ils enterraient la terre dans la terre.
.
Ce livre est un concentré de peur, de douleur, d'abnégation, de colère, mais aussi d'amour et de solidarité.
.
Ce qui frappe également, c'est l'ncompréhension et le manque d'informations. Comment informer quand personne ne sait ce qui se passe ?
Le matériel de protection, tels les masques, était obsolète ou inadapté.
Ça m'a d'ailleurs rappelé quelque chose...
.
Un livre à mettre entre toutes les mains. Je ne savais pas du tout comment rédiger ce retour, alors j'ai utilisé des bribes du livre.
D'autres retours beaucoup plus élaborés ont été écrits, n'hésitez pas à les parcourir.
Au passage, je remercie mon ami Meps qui m'a incitée à choisir ce livre avec son retour percutant.
Un essai sur les suites de la catastrophe de Tchernobyl, un essai sur l'humain, sur ses sentiments et ses ressentiments.
Un essai coup de poing...
Il faut avouer que pour moi, et pour beaucoup de personnes, Tchernobyl est une catastrophe nucléaire arrivée en Russie en 1986 (j'avais 15 ans). Aujourd'hui, cela est un évènement historique sans vraiment de liens avec notre vie actuelle, à nous français, avec notre petite vie tranquille de consommateurs du XIXème siècle.
Je me souviens à l'époque des reportages d'informations à ce sujet, de ce nuage radioactif qui n'a, semble-t-il, pas passé la frontière française ! Ou si peu...!!!
Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Lorsqu'on entend parler de cet événement, ce sont des chiffres qui ressortent. Des chiffres expliquant les gens déplacés, les chiffres expliquand ce qui a été fait à l'époque au niveau technique, quelques chiffres sur les morts et les malades, le dôme protecteur construit peu après et celui 20 ans plus tard.
Ici, l'auteur partage les témoignages d'hommes et de femmes, qu'ils soient paysans, professeurs, médecins, physiciens.. mais qui ont vécu au plus près cette catastrophe.
Ce qui en ressort est un méli-mélo de sentiments : la peur, l'incompréhension, la crédulité, le désespoir, le fatalisme... mais aussi la survie, la foi. Chaque témoignage rapproche cet accident à la guerre.
Il ne faut pas oublier que c'est arrivé en Biello-Russie, sous un système politique communiste. J'avoue ne pas trop m'y connaître en histoire politique. Ce que j'ai ressenti est qu'il y a eu beaucoup d'acceptations dans les décisions prises. Cette acceptation est due à la culture, à la politique, à l'histoire de ce pays. Ce qui ressort aussi, c'est le désir du retour à une vie normale, le retour à leur lieu de vie.
Dans ce livre, pas de jugements sur les évènements et les causes. C'est arrivé. Chacun tente de vivre ensuite...
Ce livre n'apporte pas de réponse. Cela reste une catastrophe écologique, environnementale et humaine qui perdurera sur des décennies.
Comment cela se passerait-il aujourd'hui ? Que ce soit en Russie ou dans un autre pays ? Y aurait-il autant de mensonge ? le mensonge est-il justifiable pour que le peuple ne panique pas ? Car finalement la panique ne résoudrait absolument rien. Quelle serait la solution ? Y-a-t-il seulement une solution ?
Au final, plus de questions m'assaillent maintenant que j'ai refermé ce livre. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bonnes réponses...
A lire, pour ne pas oublier que des milliers de vies humaines ont été bouleversées à tout jamais, et des générations à suivre qui seront tout autant bouleversées, ceci dans un oubli international...
Un essai coup de poing...
Il faut avouer que pour moi, et pour beaucoup de personnes, Tchernobyl est une catastrophe nucléaire arrivée en Russie en 1986 (j'avais 15 ans). Aujourd'hui, cela est un évènement historique sans vraiment de liens avec notre vie actuelle, à nous français, avec notre petite vie tranquille de consommateurs du XIXème siècle.
Je me souviens à l'époque des reportages d'informations à ce sujet, de ce nuage radioactif qui n'a, semble-t-il, pas passé la frontière française ! Ou si peu...!!!
Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Lorsqu'on entend parler de cet événement, ce sont des chiffres qui ressortent. Des chiffres expliquant les gens déplacés, les chiffres expliquand ce qui a été fait à l'époque au niveau technique, quelques chiffres sur les morts et les malades, le dôme protecteur construit peu après et celui 20 ans plus tard.
Ici, l'auteur partage les témoignages d'hommes et de femmes, qu'ils soient paysans, professeurs, médecins, physiciens.. mais qui ont vécu au plus près cette catastrophe.
Ce qui en ressort est un méli-mélo de sentiments : la peur, l'incompréhension, la crédulité, le désespoir, le fatalisme... mais aussi la survie, la foi. Chaque témoignage rapproche cet accident à la guerre.
Il ne faut pas oublier que c'est arrivé en Biello-Russie, sous un système politique communiste. J'avoue ne pas trop m'y connaître en histoire politique. Ce que j'ai ressenti est qu'il y a eu beaucoup d'acceptations dans les décisions prises. Cette acceptation est due à la culture, à la politique, à l'histoire de ce pays. Ce qui ressort aussi, c'est le désir du retour à une vie normale, le retour à leur lieu de vie.
Dans ce livre, pas de jugements sur les évènements et les causes. C'est arrivé. Chacun tente de vivre ensuite...
Ce livre n'apporte pas de réponse. Cela reste une catastrophe écologique, environnementale et humaine qui perdurera sur des décennies.
Comment cela se passerait-il aujourd'hui ? Que ce soit en Russie ou dans un autre pays ? Y aurait-il autant de mensonge ? le mensonge est-il justifiable pour que le peuple ne panique pas ? Car finalement la panique ne résoudrait absolument rien. Quelle serait la solution ? Y-a-t-il seulement une solution ?
Au final, plus de questions m'assaillent maintenant que j'ai refermé ce livre. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bonnes réponses...
A lire, pour ne pas oublier que des milliers de vies humaines ont été bouleversées à tout jamais, et des générations à suivre qui seront tout autant bouleversées, ceci dans un oubli international...
Citations et extraits (316)
Voir plus
Ajouter une citation
Des milliers de tonnes de césium, d’iode, de plomb, de zirconium, de cadmium, de béryllium, de bore et une quantité inconnue de plutonium (dans les réacteurs de type RBMK à uranium-graphite du type de Tchernobyl on enrichissait du plutonium militaire qui servait à la production des bombes atomiques) étaient déjà retombées sur notre terre. Au total, quatre cent cinquante types de radionucléides différents. Leur quantité était égale à trois cent cinquante bombes de Hiroshima. Il fallait parler de physique, des lois de la physique. Et eux, ils parlaient d’ennemis. Ils cherchaient des ennemis !
(...)
Dans les instructions de sécurité nucléaire, on prescrit la distribution préventive de doses d’iode pour l’ensemble de la population en cas de menace d’accident ou d’attaque atomique. En cas de menace ! Et là, trois mille microröntgens à l’heure... Mais les responsables ne se faisaient pas du souci pour les gens, ils s’en faisaient pour leur pouvoir. Nous vivons dans un pays de pouvoir et non un pays d’êtres humains. L’État bénéficie d’une priorité absolue. Et la valeur de la vie humaine est réduite à zéro. On aurait pourtant bien pu trouver des moyens d’agir ! Sans rien annoncer et sans semer la panique... Simplement en introduisant des préparations à l’iode dans les réservoirs d’eau potable, en les ajoutant dans le lait. Les gens auraient peut-être senti que l’eau et le lait avaient un goût légèrement différent, mais cela se serait arrêté là. La ville était en possession de sept cents kilogrammes de ces préparations qui sont restées dans les entrepôts... Nos responsables avaient plus peur de la colère de leurs supérieurs que de l’atome. Chacun attendait un coup de fil, un ordre, mais n’entreprenait rien de lui-même. Moi, j’avais toujours un dosimètre dans ma serviette. Lorsqu’on ne me laissait pas entrer quelque part (les grands chefs finissaient par en avoir marre de moi !), j’apposais le dosimètre sur la thyroïde des secrétaires ou des membres du personnel qui attendaient dans l’antichambre. Ils s’effrayaient et, parfois, ils me laissaient entrer.
— Mais à quoi bon ces crises d’hystérie, professeur ? me disait-on alors. Vous n’êtes pas le seul à prendre soin du peuple biélorusse. De toute manière, l’homme doit bien mourir de quelque chose : le tabac, les accidents de la route, le suicide...
(...)
Je sais bien que les chefs, eux, prenaient de l’iode. Lorsque les gars de notre Institut les examinaient, ils avaient tous la thyroïde en parfait état. Cela n’est pas possible sans iode. Et ils ont envoyé leurs enfants bien loin, en catimini. Lorsqu’ils se rendaient en inspection dans les régions contaminées, ils portaient des masques et des vêtements de protection. Tout ce dont les autres ne disposaient pas. Et aujourd’hui on sait même qu’un troupeau de vaches spécial paissait aux environs de Minsk. Chaque animal était numéroté et affecté à une famille donnée. À titre personnel. Il y avait aussi des terres spéciales, des serres spéciales... Un contrôle spécial... C’est le plus dégoûtant... (Après un silence.) Et personne n’a encore répondu de cela...
Vassili Borissovitch Nesterenko, ancien directeur de l’Institut de l’énergie nucléaire de l’Académie des sciences de Biélorussie.
(...)
Dans les instructions de sécurité nucléaire, on prescrit la distribution préventive de doses d’iode pour l’ensemble de la population en cas de menace d’accident ou d’attaque atomique. En cas de menace ! Et là, trois mille microröntgens à l’heure... Mais les responsables ne se faisaient pas du souci pour les gens, ils s’en faisaient pour leur pouvoir. Nous vivons dans un pays de pouvoir et non un pays d’êtres humains. L’État bénéficie d’une priorité absolue. Et la valeur de la vie humaine est réduite à zéro. On aurait pourtant bien pu trouver des moyens d’agir ! Sans rien annoncer et sans semer la panique... Simplement en introduisant des préparations à l’iode dans les réservoirs d’eau potable, en les ajoutant dans le lait. Les gens auraient peut-être senti que l’eau et le lait avaient un goût légèrement différent, mais cela se serait arrêté là. La ville était en possession de sept cents kilogrammes de ces préparations qui sont restées dans les entrepôts... Nos responsables avaient plus peur de la colère de leurs supérieurs que de l’atome. Chacun attendait un coup de fil, un ordre, mais n’entreprenait rien de lui-même. Moi, j’avais toujours un dosimètre dans ma serviette. Lorsqu’on ne me laissait pas entrer quelque part (les grands chefs finissaient par en avoir marre de moi !), j’apposais le dosimètre sur la thyroïde des secrétaires ou des membres du personnel qui attendaient dans l’antichambre. Ils s’effrayaient et, parfois, ils me laissaient entrer.
— Mais à quoi bon ces crises d’hystérie, professeur ? me disait-on alors. Vous n’êtes pas le seul à prendre soin du peuple biélorusse. De toute manière, l’homme doit bien mourir de quelque chose : le tabac, les accidents de la route, le suicide...
(...)
Je sais bien que les chefs, eux, prenaient de l’iode. Lorsque les gars de notre Institut les examinaient, ils avaient tous la thyroïde en parfait état. Cela n’est pas possible sans iode. Et ils ont envoyé leurs enfants bien loin, en catimini. Lorsqu’ils se rendaient en inspection dans les régions contaminées, ils portaient des masques et des vêtements de protection. Tout ce dont les autres ne disposaient pas. Et aujourd’hui on sait même qu’un troupeau de vaches spécial paissait aux environs de Minsk. Chaque animal était numéroté et affecté à une famille donnée. À titre personnel. Il y avait aussi des terres spéciales, des serres spéciales... Un contrôle spécial... C’est le plus dégoûtant... (Après un silence.) Et personne n’a encore répondu de cela...
Vassili Borissovitch Nesterenko, ancien directeur de l’Institut de l’énergie nucléaire de l’Académie des sciences de Biélorussie.
J'avais envie de rester seule avec lui, même seulement une minute. Les autres le sentirent et chacun inventa une excuse pour sortir dans le couloir. Alors je l'enlaçai et l'embrassai. Il s'écarta :
- Ne t'assieds pas près de moi. Prends une chaise.
- Mais ce n'est rien. (Je fis un geste de dérision avec le bras.) As-tu vu où s'est produite l'explosion ? Qu'est-ce que c'était ? Vous étiez les premiers à arriver...
- C'est certainement un sabotage. Quelqu'un l'a fait exprès. Tous nos gars sont de cet avis.
C'est ce que l'on disait alors, ce qu'on pensait.
Le lendemain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir. D'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs : point-trait, point-trait... Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que ce que l'un pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs. A gauche, à droite et à l'étage en dessous... On avait dégagé tout le monde et il ne restait plus un seul malade... Personne autour d'eux. Pendant trois jours, je logeai chez des amis, à Moscou. Ils me disaient : Prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin... Je faisais du bouillon de dinde, pour six personnes. Nos six gars... Les sapeurs-pompiers de la même équipe... Ils étaient tous de garde cette nuit-là : Vachtchouk, Kibenok, Titenok, Pravik, Tichtchoura. Au magasin, je leur ai acheté du dentifrice, des brosses à dents et du savon. Il n'y avait rien de tout cela à l'hôpital. Je leur ai aussi acheté des petites serviettes de toilette... Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis : ils avaient sûrement peur, ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur, des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même : Prends tout ce qu'il te faut. Prends ! Comment va-t-il ? Comment vont-ils tous ? Est-ce qu'ils vivront ? Vivre... (Silence.)
- Ne t'assieds pas près de moi. Prends une chaise.
- Mais ce n'est rien. (Je fis un geste de dérision avec le bras.) As-tu vu où s'est produite l'explosion ? Qu'est-ce que c'était ? Vous étiez les premiers à arriver...
- C'est certainement un sabotage. Quelqu'un l'a fait exprès. Tous nos gars sont de cet avis.
C'est ce que l'on disait alors, ce qu'on pensait.
Le lendemain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir. D'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs : point-trait, point-trait... Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que ce que l'un pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs. A gauche, à droite et à l'étage en dessous... On avait dégagé tout le monde et il ne restait plus un seul malade... Personne autour d'eux. Pendant trois jours, je logeai chez des amis, à Moscou. Ils me disaient : Prends la casserole, prends la cuvette, prends tout ce dont tu as besoin... Je faisais du bouillon de dinde, pour six personnes. Nos six gars... Les sapeurs-pompiers de la même équipe... Ils étaient tous de garde cette nuit-là : Vachtchouk, Kibenok, Titenok, Pravik, Tichtchoura. Au magasin, je leur ai acheté du dentifrice, des brosses à dents et du savon. Il n'y avait rien de tout cela à l'hôpital. Je leur ai aussi acheté des petites serviettes de toilette... Je m'étonne maintenant du comportement de mes amis : ils avaient sûrement peur, ils ne pouvaient pas ne pas avoir peur, des rumeurs circulaient déjà. Et pourtant, ils me proposaient quand même : Prends tout ce qu'il te faut. Prends ! Comment va-t-il ? Comment vont-ils tous ? Est-ce qu'ils vivront ? Vivre... (Silence.)
" Pouvez-vous imaginer sept petites filles totalement chauves en même temps ? Elles étaient sept dans la chambre... Non, c'est sassez ! Je ne peux pas continuer ! Lorsque je raconte cela, j'ai l'impression de commettre une trahison. C'est mon cœur qui me le dit. Parce que je dois la décrire comme une étrangère. Ses souffrances... Ma femme ne pouvait plus supporter de la voir à l'hôpital : "Il vaut mieux qu'elle meure, plutôt qu'elle souffre comme ça ! Ou que je meure pour ne plus voir cela !" Non ! Je ne peux plus continuer ! Non !
Nous l'avons allongée sur la porte... Sur la porte qui avait supporté mon père, jadis. Elle est restée jusqu'à l'arrivée du cercueil... Il était à peine plus grand que la boite d'une poupée.
Je veux témoigner que ma fille est morte à cause de Tchernobyl. Et qu'on veut nous faire oublier cela. "
Nous l'avons allongée sur la porte... Sur la porte qui avait supporté mon père, jadis. Elle est restée jusqu'à l'arrivée du cercueil... Il était à peine plus grand que la boite d'une poupée.
Je veux témoigner que ma fille est morte à cause de Tchernobyl. Et qu'on veut nous faire oublier cela. "
J’ai lu que les gens font un détour pour ne pas s’approcher trop des tombes des pompiers de Tchernobyl, enterrés au cimetière de Mitino. Et l’on évite d’enterrer d’autres morts près d’eux. Si les morts ont peur des morts, que dire des vivants ? Car personne ne sait ce qu’est Tchernobyl. Il n’y a que des suppositions. Des pressentiments.
(...)
Et ce qui était encore plus intolérable, c’était l’ignorance. On dit “Tchernobyl”, on écrit “Tchernobyl”. Mais personne ne sait ce que c’est... Nous sommes parmi les premiers à avoir entr’aperçu quelque chose d’horrible... Chez nous, tout se passe différemment que chez les autres : nous naissons de façon différente, nous mourons de façon différente. Vous allez me demander comment on meurt après Tchernobyl ? L’homme que j’aimais, que j’aimais tellement que je n’aurais pu l’aimer davantage si je l’avais mis au monde moi-même, se transformait devant mes yeux... En un monstre...
(...)
Et ce qui était encore plus intolérable, c’était l’ignorance. On dit “Tchernobyl”, on écrit “Tchernobyl”. Mais personne ne sait ce que c’est... Nous sommes parmi les premiers à avoir entr’aperçu quelque chose d’horrible... Chez nous, tout se passe différemment que chez les autres : nous naissons de façon différente, nous mourons de façon différente. Vous allez me demander comment on meurt après Tchernobyl ? L’homme que j’aimais, que j’aimais tellement que je n’aurais pu l’aimer davantage si je l’avais mis au monde moi-même, se transformait devant mes yeux... En un monstre...
Nous nous sommes rendus dans la zone. Les statistiques sont bien connues : il y a huit cents "sépulcres" autour de Tchernobyl. Il s'attendait à des fortifications d'une complexité inouïe alors que ce ne sont que de simples fosses. C'est là que l'on a enterré la "forêt rousse" abattue sur cent cinquante hectares autour du réacteur (dans les deux jours qui ont suivi la catastrophe, les sapins et les pins sont devenu rouges, puis roux). Là gisent des milliers de tonnes de métal et d'acier, des tuyaux, des vêtements de travail, des constructions en béton. Il m'a montré une vue aérienne publiée par un magazine anglais... Des milliers de voitures, de tracteurs, d'hélicoptères... Des véhicules de pompiers, des ambulances... C'était le plus important sépulcre, près du réacteur. Il voulait le photographier dix ans après la catastrophe. On lui avait promis une bonne rémunération pour cette photo. Mais nous avons tourné en rond, d'un responsable à l'autre, et tous refusaient de nous aider : tantôt il n'y avait pas de carte, tantôt il manquait une autorisation. Et puis, j'ai fini par comprendre que le sépulcre n'existait plus que dans les rapports. En réalité, tout a été pillé, vendu dans les marchés, utilisé comme pièces détachées par des kolkhozes et des particuliers.
Videos de Svetlana Alexievitch (29)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans les témoignages saisissants que la journaliste Svetlana Alexievitch a récoltés, notamment dans "La Fin de l'homme rouge" et "La Supplication", les thématiques économiques se révèlent comme des fils conducteurs cruciaux, tissant l'étoffe complexe de la société post-soviétique.
En quoi ses récits témoignent-ils du désenchantement des Soviétiques et de l'avènement du capitalisme en Russie ?
Pour parler de ses travaux, Tiphaine de Rocquigny reçoit : Galia Ackerman, journaliste et historienne, spécialiste du monde russe. Françoise Daucé, directrice de recherche à l'EHESS et directrice du Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC).
#capitalism #russie #economie ----------------------------------------------------- Découvrez les précédentes émissions ici https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqogc4cP5KsCHIFIryY2f1h ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco
Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
En quoi ses récits témoignent-ils du désenchantement des Soviétiques et de l'avènement du capitalisme en Russie ?
Pour parler de ses travaux, Tiphaine de Rocquigny reçoit : Galia Ackerman, journaliste et historienne, spécialiste du monde russe. Françoise Daucé, directrice de recherche à l'EHESS et directrice du Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC).
#capitalism #russie #economie ----------------------------------------------------- Découvrez les précédentes émissions ici https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqogc4cP5KsCHIFIryY2f1h ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco
Suivez France Culture sur : Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture Twitter : https://twitter.com/franceculture Instagram : https://www.instagram.com/franceculture TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture
+ Lire la suite
autres livres classés : BiélorussieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Svetlana Alexievitch (8)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3179 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3179 lecteurs ont répondu