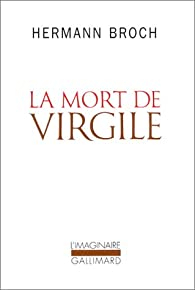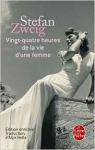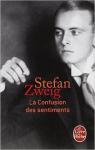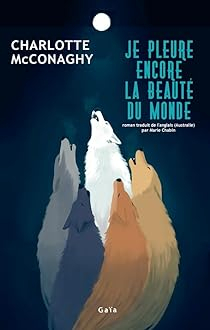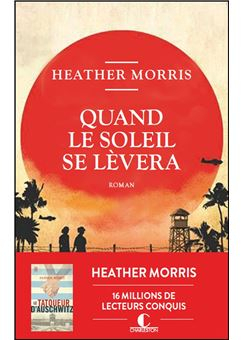Hermann Broch
Albert Kohn (Autre)/5 61 notes
Albert Kohn (Autre)/5 61 notes
Résumé :
Virgile est mort à l'âge de cinquante et un ans, à Brindisi, le 21 septembre 19 av. J. -C ; au retour d'un voyage en Grèce où il avait contracté la malaria. Déçu par son temps, il avait voulu, au cours de ses derniers jours, détruire le manuscrit de L'Enéide.
Tels sont les faits historiques qui ont servi de point de départ à l'ouvrage d'Hermann Broch, vaste méditation lyrique où les rêves du poète à l'approche de la mort se mêlent, dans le flux d'un monologu... >Voir plus
Tels sont les faits historiques qui ont servi de point de départ à l'ouvrage d'Hermann Broch, vaste méditation lyrique où les rêves du poète à l'approche de la mort se mêlent, dans le flux d'un monologu... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Mort de VirgileVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
Poème lyrique et réflexion métaphysique sur la mort, incarnée par la voix de Virgile, le roman d'Hermann Broch retraçant les dernières dix-huit heures de vie du grand poète latin est une oeuvre incomparable à toutes autres. Et - à condition bien sûr d'y adhérer – une expérience de lecture intégrale, qui occupera l'esprit du lecteur pleinement, hautement, longuement...
Porté par une ambition de transcendance hors toute mesure, radical dans son effort titanesque de faire exprimer par le langage littéraire quelque chose qui se situe par principe au-delà de tout langage humain, rédigé dans un style poético-philosophique touffu, fastueux – parfois jusqu'à devenir pesant quand celui-ci se maintient sur quelques pages d'affilée dangereusement «au bord de l'informe», selon l'expression judicieuse utilisée par Claudio Magris dans un article consacré à l'auteur –, LA MORT DE VIRGILE est un roman réputé pour son degré très élevé d'abstraction, par moment quasiment impénétrable – jusqu'à être considérée par certains lecteurs, ou auteurs, tel W. G. Sebald, comme de la «pure mystification»!
Dans tous les cas, il serait souhaitable, pour ceux qui se sentiraient prêts à tenter l'expérience, et pour essayer de l'apprécier à sa juste mesure, de l'approcher autant comme une oeuvre littéraire certes à très haute prétention philosophique, que –et peut-être encore davantage- comme une composition lyrique, une très vaste élégie en prose et partition symphonique consacrée à la mort en tant qu'apothéose cognitive.
(À ce propos, pour la première fois en ce qui me concerne – chose inimaginable jusque-là !-, l'envie m'a pris d'accompagner ma lecture par de l'écoute musicale, et ce jusqu'à me faire noter quelques titres dans la perspective d'une éventuelle relecture - dont je pourrais citer, à titre d'exemple, et conseiller, pourquoi pas, «La Nuit Transfigurée» de Schoenberg, parfaite à mon sens pour la toute dernière partie du roman!)
LA MORT DE VIRGILE peut aussi être envisagée comme une rhapsodie homérique narrant la désagrégation progressive des images mentales à l'approche de la mort («la vie humaine est soumise à la grâce et à la malédiction des images, ce n'est qu'en images qu'elle peut se concevoir elle-même»), la fragmentation des souvenirs personnels du poète jusqu'à leurs derniers maillons symboliques, antérieurs à toute forme de pensée, et son retour, enfin, à l'Ithaque d'avant naissance...
Broch confère au franchissement que représente la mort la possibilité d'accéder à une forme de connaissance totale, permettant en l'occurrence au poète de relier ce qu'il possédait de plus singulier et de plus intime, aux plans universel et cosmique. de replacer son parcours terrestre et le sens de son oeuvre dans le cours de l'Histoire et dans le courant ininterrompu de l'humanité, dans le «majestueux écoulement fluvial du troupeau nu». de bannir toutes limites spatio-temporelles à sa conscience et de disloquer progressivement son identité personnelle vers une sorte de noosphère, avant de la voir peu à peu se dissoudre dans l'Intemporel. Et -pari encore plus délicat en s'agissant de mort et de transcendance– Broch s'évertue à attribuer une stature sacrée à l'expérience de mort vécue (pardon pour l'oxymore !) par le poète, tout en y convoquant accessoirement le religieux : Virgile, mort moins de vingt-ans avant la naissance du Christ, a durant ses visions fiévreuses comme l'intuition de l'avènement proche d'une nouvelle ère monothéiste, et d'une mystique proche du christianisme dont le règne et l'aura divin entourant la personnalité d'Auguste auraient pu constituer les prémisses. L'écrivain réussira néanmoins à écarter toute dimension ouvertement confessionnelle et/ou personnelle à son oeuvre (d'origine juive, Hermann Broch se convertit tardivement au christianisme). Un vrai tour de force qui ne laissera pas indifférents, je pense, des lecteurs qui, quoiqu'agnostiques comme moi, ou franchement athées, n'auraient pas pour autant renoncé à pratiquer le doute vis-à-vis de leurs propres convictions métaphysiques (ou matérialistes)...
Ce dernier aspect semble par ailleurs lui avoir valu, toujours selon Magris, d'être devenu «suspect», aussi bien aux yeux de certains conservateurs «traditionnalistes», qu'à ceux des «post-modernes admirateurs du vide, dans la mesure où il [Broch] avait soumis ce dernier à une critique implacable».
Herman Broch fait partie, avec Thomas Mann et Hermann Hesse, de la sainte trinité du grand roman de langue allemande de la première moitié du XXe qui, abordant de grands sujets universels et philosophiques, ne cèdera pourtant pas à la tentation de quitter les territoires de cette rationalité si caractéristique de la pensée germanique. Ainsi, dans LA MORT DE VIRGILE, les efforts de l'auteur pour conduire la langue au bout de ses ressources sont saisissants, mais ne présentent à aucun moment le caractère désinvolte et farfelu des péripéties langagières proposées par un Joyce (ce dernier étant par ailleurs très admiré par Broch).
Le souci de cohérence et de rationalité discursive ne désertent jamais sa plume, y compris lorsque les tautologies, antinomies, oxymores et autres antilogies envahiront la prose, faisant la langue littéraire et poétique de Virgile tourner en bourrique, révélant par cette même occasion ces solives brutes du langage humain que nous essayons de notre mieux à cacher derrière de belles moulures rhétoriques. La fièvre de Virgile finira par les effriter peu à peu, surtout lorsque le lyrisme dissonant de sa langue mourante l'amènera à vagabonder aux portes de l'indicible, dans ces régions extrêmes et inhospitalières à une parole bien charpentée, plus réceptives aux images éthérées et aux sons purs.
LA MORT DE VIRGILE, divisée en quatre grandes parties, pourrait, si on veut bien, inspirer également quatre mouvements symphoniques :
1er Mouvement : «L'Eau - L'Arrivée» (Adagio con Brio):
Le vaisseau qui transporte le poète, parti de l'Épire avec la flottille d'Auguste, qui était venu personnellement le chercher à Athènes, arrive sur la rade de Brindisi à la tombée du jour, le 20 septembre de l'an 19 av. J.-C. Une fois à quai, les esclaves accompagnant un Virgile malade ne tenant déjà plus debout, allongé sur une litière mais suivant précieusement du regard le manuscrit original de L'Énéide qu'il transporte avec lui, avancent pas à pas, péniblement, au milieu de la confusion qui règne dans le port et dans la ville, provoquée par l'immense foule venue acclamer l'Empereur rentré en Italie le jour même de son anniversaire. Pour échapper à la multitude, la suite devra emprunter des détours et des raccourcis, traversant entre autres une ruelle où le poète moribond, exposé aux insultes et à la «nudité du rire» des plus misérables, mêlera dans son esprit l'avalanche de ces voix moqueuses avec les cris d'Érinyes venues le traquer : au milieu de la jubilation que représente l'offrande de l'Énéide à la gloire d'Auguste, couronnant de lauriers sa carrière de poète, il commence à percevoir devant lui l'oeil d'une longue nuit de fièvre et de doute. La suite arrive enfin au palais, et Virgile est installé dans une chambre.
2ème Mouvement : «Le Feu - La Descente» (Molto Agitato)
En présence d'un enfant qui s'était mystérieusement joint aux esclaves pendant le trajet jusqu'au palais, et que le poète avait finalement autorisé à rester auprès de lui dans sa chambre, le coffret contenant le manuscrit de l'Énéide juste à côté du lit où repose son corps, Virgile, de plus en plus fiévreux, alternant des mouvements animiques d'ascension et de descente, errant entre anabase et catabase, sera livré durant une très longue et éprouvante nuit aux affres d'une horreur sans limites, au «vide ricanement du néant», ainsi qu'aux caprices de volte-face éphémères induits par l'espoir de trouver un abri dans les souvenirs de son enfance de paysan ou encore dans l'extinction définitive de sa voix de poète «parjure» qui n'aurait pas été «à la hauteur de la grâce qui lui avait été faite». Pour le lecteur, ce sera aussi le passage le plus éprouvant du roman, avec ses très longs paragraphes concentriques, parfois étalés sur plusieurs pages, où il avancera comme le poète, empêtré dans ce que le langage humain a à la fois de plus touchant et de plus précaire.
«Quand l'âme est étendue pour le sommeil, pour l'amour et pour la mort (...) c'est une âme infiniment étendue, enclose sans fin pour le cercle des temps, tout comme le paysage qu'elle est elle-même devenue, elle passe comme celui-ci par tous les âges ; elle va de l'âge d'or à l'âge d'airain, et même encore au-delà, jusqu'au retour de l'âge d'or, et parce qu'elle est modelée sur le paysage, elle est également une frontière qui sépare, qui réunit les sphères, entre les régions supérieures et inférieures – âme semblable à Janus dans son infini dans les deux sens, étendue à l'infini, reposant dans la pénombre, si bien que sa conscience aux aguets, sans unir le haut et le bas, peut donner à ces zones une égale importance, pendant que l'événement comme tel, en revanche, perd de son importance, indigne d'être épié et appréhendé par la conscience.»
Au petit matin, en tout âme et conscience, Virgile prend la décision de brûler l'Énéide.
3ème Mouvement «La Terre - L'Attente» (Moderato Affetuoso)
La matinée déjà avancée, Virgile est réveillé par la présence diaphane de l'enfant, Lysanias (ou serait-ce l'esclave - cela n'a d'ailleurs plus aucune importance pour lui: ainsi que de la magnificence qu'il avait pu attribuer à son Énéide, il s'était débarrassé en même temps au cours de sa longue nuit de la surface visible des phénomènes comme d'un «vêtement inutile»).
L'enfant lui annonce la visite de ses amis Plotius Tucca et Lucius Varius, venus exprès de Rome pour le rencontrer. Ceux-ci, à la grande surprise du poète, sont au courant de son dessein de détruire le manuscrit (l'esclave aurait entendu ses divagations nocturnes ?). Ils essaieront par tous les moyens, mais en vain, de l'en dissuader. Après leur départ, ce sera Auguste en personne qui viendra à son chevet avec la détermination de repartir avec le précieux coffret. Il s'en suivra une passionnante joute philosophique entre l'empereur et Virgile, un long dialogue où il sera entre autres question du rapport ambigu de l'art au pouvoir (« le peuple a besoin de symboles », insistera Auguste), ou de l'impuissance du poète à empêcher le mal et la destruction, ou à contribuer à l'avènement d'un ordre nouveau («l'art, aujourd'hui, n'a plus de tâche à accomplir» décrète Virgile).
«L'arme abattit jadis le premier ancêtre et toujours sans cesse, répétant le meurtre, l'homme s'extermine par soi-même, par la force des armes qui s'entrechoquent ; anéantissant l'homme pour se faire un esclave, il est lui-même esclave de son arme, faisant craquer la création, la livrant aux brasiers d'incendie, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que pétrification glacée» : le seul héros qui mériterait d'être chanté, affirme-t-il face à César, sera «celui qui le premier acceptera d'être désarmé».
(Je ne pense pas spoiler en vous indiquant qu'en définitive, le divin Auguste repartira avec le coffret contenant le plus grand poème épique de l'antiquité latine...)
4ème et dernier Mouvement : «L'Éther - le Retour» (Largo e maestoso)
Après le départ d'Auguste, tout devient murmure et ruissèlement apaisé autour de lui. «Ce murmure existait tout simplement, il n'était pas nécessaire de prêter oreille pour l'entendre, aucun effort n'était nécessaire pour le retenir ; bien plus, cette manifestation de murmure ne demandait pas à être retenue, car elle s'efforçait d'aller plus loin». L'image humaine et évanescente créée par les derniers battements du coeur spirituel du grand poète sera celle d'une traversée en bateau, transfiguration et leitmotiv principal des cinquante dernières pages du roman rédigées sous la forme d'un hymne magistral élevé à la dissolution de l'être dans le Grand Tout.
Une oeuvre d'une telle ambition et envergure ne peut que susciter des jugements à sa hauteur : on en sera subjugué, ou on la détestera... Les interprétations qu'elle peut susciter sont multiples, diverses, parfois divergentes aussi, à l'instar d'autres grands romans révolutionnaires de la modernité (et dont l'Ulysse de Joyce deviendrait en quelque sorte le parangon).
C'est ainsi que certains liens existants entre le sens de l'oeuvre et le contexte dans lequel celle-ci avait été rédigée, ont pu être évoqués par ses commentateurs. L'écrivain sortira in extremis de son pays (Autriche), en 1939, grâce à l'intervention d'intellectuels et d'écrivains européens de renom ( Joyce, d'ailleurs, encore une fois, en ferait aussi partie ). Son manuscrit sous le bras, Broch le retravaillera sans cesse durant son exil pour le publier enfin, d'abord dans sa traduction en langue anglaise, aux Etats-Unis, en 1945.
À quoi servirait de continuer d'écrire lorsqu'il faut plutôt agir? À quoi aurait servi, entre autres, tout le foisonnement artistique de la Mitteleuropa entre les deux guerres face à la montée des totalitarismes dans le continent? À quoi en définitve sert l'Art face à la barbarie? Ou enfin, pour dire les choses autrement, toujours dans le contexte de l'époque où le roman fut écrit, et avec la stupeur d'un Adorno : comment écrire un poème après Auschwitz..?
Pour finir ce billet trop excessivement bavard (et peut-être aussi un peu déplacé dans le cadre d'un «after» festif que nous tenterions encore de prolonger - excusez, alors, les amis!), je dirais, et je l'espère pour tous, qu'on aura largement le temps avant de se décider à lire, ou à relire LA MORT DE VIRGILE, et de choisir le moment idéal pour le faire!
Et, pourquoi pas, différer cette lecture éventuellement au moment où l'on aura la fâcheuse sensation de commencer à entendre la Camarde rôder dans nos parages?
Parce que, croyez-moi, la mort va très bien à Virgile! Et aussi, parce que c'est juste beau à en mourir...
Porté par une ambition de transcendance hors toute mesure, radical dans son effort titanesque de faire exprimer par le langage littéraire quelque chose qui se situe par principe au-delà de tout langage humain, rédigé dans un style poético-philosophique touffu, fastueux – parfois jusqu'à devenir pesant quand celui-ci se maintient sur quelques pages d'affilée dangereusement «au bord de l'informe», selon l'expression judicieuse utilisée par Claudio Magris dans un article consacré à l'auteur –, LA MORT DE VIRGILE est un roman réputé pour son degré très élevé d'abstraction, par moment quasiment impénétrable – jusqu'à être considérée par certains lecteurs, ou auteurs, tel W. G. Sebald, comme de la «pure mystification»!
Dans tous les cas, il serait souhaitable, pour ceux qui se sentiraient prêts à tenter l'expérience, et pour essayer de l'apprécier à sa juste mesure, de l'approcher autant comme une oeuvre littéraire certes à très haute prétention philosophique, que –et peut-être encore davantage- comme une composition lyrique, une très vaste élégie en prose et partition symphonique consacrée à la mort en tant qu'apothéose cognitive.
(À ce propos, pour la première fois en ce qui me concerne – chose inimaginable jusque-là !-, l'envie m'a pris d'accompagner ma lecture par de l'écoute musicale, et ce jusqu'à me faire noter quelques titres dans la perspective d'une éventuelle relecture - dont je pourrais citer, à titre d'exemple, et conseiller, pourquoi pas, «La Nuit Transfigurée» de Schoenberg, parfaite à mon sens pour la toute dernière partie du roman!)
LA MORT DE VIRGILE peut aussi être envisagée comme une rhapsodie homérique narrant la désagrégation progressive des images mentales à l'approche de la mort («la vie humaine est soumise à la grâce et à la malédiction des images, ce n'est qu'en images qu'elle peut se concevoir elle-même»), la fragmentation des souvenirs personnels du poète jusqu'à leurs derniers maillons symboliques, antérieurs à toute forme de pensée, et son retour, enfin, à l'Ithaque d'avant naissance...
Broch confère au franchissement que représente la mort la possibilité d'accéder à une forme de connaissance totale, permettant en l'occurrence au poète de relier ce qu'il possédait de plus singulier et de plus intime, aux plans universel et cosmique. de replacer son parcours terrestre et le sens de son oeuvre dans le cours de l'Histoire et dans le courant ininterrompu de l'humanité, dans le «majestueux écoulement fluvial du troupeau nu». de bannir toutes limites spatio-temporelles à sa conscience et de disloquer progressivement son identité personnelle vers une sorte de noosphère, avant de la voir peu à peu se dissoudre dans l'Intemporel. Et -pari encore plus délicat en s'agissant de mort et de transcendance– Broch s'évertue à attribuer une stature sacrée à l'expérience de mort vécue (pardon pour l'oxymore !) par le poète, tout en y convoquant accessoirement le religieux : Virgile, mort moins de vingt-ans avant la naissance du Christ, a durant ses visions fiévreuses comme l'intuition de l'avènement proche d'une nouvelle ère monothéiste, et d'une mystique proche du christianisme dont le règne et l'aura divin entourant la personnalité d'Auguste auraient pu constituer les prémisses. L'écrivain réussira néanmoins à écarter toute dimension ouvertement confessionnelle et/ou personnelle à son oeuvre (d'origine juive, Hermann Broch se convertit tardivement au christianisme). Un vrai tour de force qui ne laissera pas indifférents, je pense, des lecteurs qui, quoiqu'agnostiques comme moi, ou franchement athées, n'auraient pas pour autant renoncé à pratiquer le doute vis-à-vis de leurs propres convictions métaphysiques (ou matérialistes)...
Ce dernier aspect semble par ailleurs lui avoir valu, toujours selon Magris, d'être devenu «suspect», aussi bien aux yeux de certains conservateurs «traditionnalistes», qu'à ceux des «post-modernes admirateurs du vide, dans la mesure où il [Broch] avait soumis ce dernier à une critique implacable».
Herman Broch fait partie, avec Thomas Mann et Hermann Hesse, de la sainte trinité du grand roman de langue allemande de la première moitié du XXe qui, abordant de grands sujets universels et philosophiques, ne cèdera pourtant pas à la tentation de quitter les territoires de cette rationalité si caractéristique de la pensée germanique. Ainsi, dans LA MORT DE VIRGILE, les efforts de l'auteur pour conduire la langue au bout de ses ressources sont saisissants, mais ne présentent à aucun moment le caractère désinvolte et farfelu des péripéties langagières proposées par un Joyce (ce dernier étant par ailleurs très admiré par Broch).
Le souci de cohérence et de rationalité discursive ne désertent jamais sa plume, y compris lorsque les tautologies, antinomies, oxymores et autres antilogies envahiront la prose, faisant la langue littéraire et poétique de Virgile tourner en bourrique, révélant par cette même occasion ces solives brutes du langage humain que nous essayons de notre mieux à cacher derrière de belles moulures rhétoriques. La fièvre de Virgile finira par les effriter peu à peu, surtout lorsque le lyrisme dissonant de sa langue mourante l'amènera à vagabonder aux portes de l'indicible, dans ces régions extrêmes et inhospitalières à une parole bien charpentée, plus réceptives aux images éthérées et aux sons purs.
LA MORT DE VIRGILE, divisée en quatre grandes parties, pourrait, si on veut bien, inspirer également quatre mouvements symphoniques :
1er Mouvement : «L'Eau - L'Arrivée» (Adagio con Brio):
Le vaisseau qui transporte le poète, parti de l'Épire avec la flottille d'Auguste, qui était venu personnellement le chercher à Athènes, arrive sur la rade de Brindisi à la tombée du jour, le 20 septembre de l'an 19 av. J.-C. Une fois à quai, les esclaves accompagnant un Virgile malade ne tenant déjà plus debout, allongé sur une litière mais suivant précieusement du regard le manuscrit original de L'Énéide qu'il transporte avec lui, avancent pas à pas, péniblement, au milieu de la confusion qui règne dans le port et dans la ville, provoquée par l'immense foule venue acclamer l'Empereur rentré en Italie le jour même de son anniversaire. Pour échapper à la multitude, la suite devra emprunter des détours et des raccourcis, traversant entre autres une ruelle où le poète moribond, exposé aux insultes et à la «nudité du rire» des plus misérables, mêlera dans son esprit l'avalanche de ces voix moqueuses avec les cris d'Érinyes venues le traquer : au milieu de la jubilation que représente l'offrande de l'Énéide à la gloire d'Auguste, couronnant de lauriers sa carrière de poète, il commence à percevoir devant lui l'oeil d'une longue nuit de fièvre et de doute. La suite arrive enfin au palais, et Virgile est installé dans une chambre.
2ème Mouvement : «Le Feu - La Descente» (Molto Agitato)
En présence d'un enfant qui s'était mystérieusement joint aux esclaves pendant le trajet jusqu'au palais, et que le poète avait finalement autorisé à rester auprès de lui dans sa chambre, le coffret contenant le manuscrit de l'Énéide juste à côté du lit où repose son corps, Virgile, de plus en plus fiévreux, alternant des mouvements animiques d'ascension et de descente, errant entre anabase et catabase, sera livré durant une très longue et éprouvante nuit aux affres d'une horreur sans limites, au «vide ricanement du néant», ainsi qu'aux caprices de volte-face éphémères induits par l'espoir de trouver un abri dans les souvenirs de son enfance de paysan ou encore dans l'extinction définitive de sa voix de poète «parjure» qui n'aurait pas été «à la hauteur de la grâce qui lui avait été faite». Pour le lecteur, ce sera aussi le passage le plus éprouvant du roman, avec ses très longs paragraphes concentriques, parfois étalés sur plusieurs pages, où il avancera comme le poète, empêtré dans ce que le langage humain a à la fois de plus touchant et de plus précaire.
«Quand l'âme est étendue pour le sommeil, pour l'amour et pour la mort (...) c'est une âme infiniment étendue, enclose sans fin pour le cercle des temps, tout comme le paysage qu'elle est elle-même devenue, elle passe comme celui-ci par tous les âges ; elle va de l'âge d'or à l'âge d'airain, et même encore au-delà, jusqu'au retour de l'âge d'or, et parce qu'elle est modelée sur le paysage, elle est également une frontière qui sépare, qui réunit les sphères, entre les régions supérieures et inférieures – âme semblable à Janus dans son infini dans les deux sens, étendue à l'infini, reposant dans la pénombre, si bien que sa conscience aux aguets, sans unir le haut et le bas, peut donner à ces zones une égale importance, pendant que l'événement comme tel, en revanche, perd de son importance, indigne d'être épié et appréhendé par la conscience.»
Au petit matin, en tout âme et conscience, Virgile prend la décision de brûler l'Énéide.
3ème Mouvement «La Terre - L'Attente» (Moderato Affetuoso)
La matinée déjà avancée, Virgile est réveillé par la présence diaphane de l'enfant, Lysanias (ou serait-ce l'esclave - cela n'a d'ailleurs plus aucune importance pour lui: ainsi que de la magnificence qu'il avait pu attribuer à son Énéide, il s'était débarrassé en même temps au cours de sa longue nuit de la surface visible des phénomènes comme d'un «vêtement inutile»).
L'enfant lui annonce la visite de ses amis Plotius Tucca et Lucius Varius, venus exprès de Rome pour le rencontrer. Ceux-ci, à la grande surprise du poète, sont au courant de son dessein de détruire le manuscrit (l'esclave aurait entendu ses divagations nocturnes ?). Ils essaieront par tous les moyens, mais en vain, de l'en dissuader. Après leur départ, ce sera Auguste en personne qui viendra à son chevet avec la détermination de repartir avec le précieux coffret. Il s'en suivra une passionnante joute philosophique entre l'empereur et Virgile, un long dialogue où il sera entre autres question du rapport ambigu de l'art au pouvoir (« le peuple a besoin de symboles », insistera Auguste), ou de l'impuissance du poète à empêcher le mal et la destruction, ou à contribuer à l'avènement d'un ordre nouveau («l'art, aujourd'hui, n'a plus de tâche à accomplir» décrète Virgile).
«L'arme abattit jadis le premier ancêtre et toujours sans cesse, répétant le meurtre, l'homme s'extermine par soi-même, par la force des armes qui s'entrechoquent ; anéantissant l'homme pour se faire un esclave, il est lui-même esclave de son arme, faisant craquer la création, la livrant aux brasiers d'incendie, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que pétrification glacée» : le seul héros qui mériterait d'être chanté, affirme-t-il face à César, sera «celui qui le premier acceptera d'être désarmé».
(Je ne pense pas spoiler en vous indiquant qu'en définitive, le divin Auguste repartira avec le coffret contenant le plus grand poème épique de l'antiquité latine...)
4ème et dernier Mouvement : «L'Éther - le Retour» (Largo e maestoso)
Après le départ d'Auguste, tout devient murmure et ruissèlement apaisé autour de lui. «Ce murmure existait tout simplement, il n'était pas nécessaire de prêter oreille pour l'entendre, aucun effort n'était nécessaire pour le retenir ; bien plus, cette manifestation de murmure ne demandait pas à être retenue, car elle s'efforçait d'aller plus loin». L'image humaine et évanescente créée par les derniers battements du coeur spirituel du grand poète sera celle d'une traversée en bateau, transfiguration et leitmotiv principal des cinquante dernières pages du roman rédigées sous la forme d'un hymne magistral élevé à la dissolution de l'être dans le Grand Tout.
Une oeuvre d'une telle ambition et envergure ne peut que susciter des jugements à sa hauteur : on en sera subjugué, ou on la détestera... Les interprétations qu'elle peut susciter sont multiples, diverses, parfois divergentes aussi, à l'instar d'autres grands romans révolutionnaires de la modernité (et dont l'Ulysse de Joyce deviendrait en quelque sorte le parangon).
C'est ainsi que certains liens existants entre le sens de l'oeuvre et le contexte dans lequel celle-ci avait été rédigée, ont pu être évoqués par ses commentateurs. L'écrivain sortira in extremis de son pays (Autriche), en 1939, grâce à l'intervention d'intellectuels et d'écrivains européens de renom ( Joyce, d'ailleurs, encore une fois, en ferait aussi partie ). Son manuscrit sous le bras, Broch le retravaillera sans cesse durant son exil pour le publier enfin, d'abord dans sa traduction en langue anglaise, aux Etats-Unis, en 1945.
À quoi servirait de continuer d'écrire lorsqu'il faut plutôt agir? À quoi aurait servi, entre autres, tout le foisonnement artistique de la Mitteleuropa entre les deux guerres face à la montée des totalitarismes dans le continent? À quoi en définitve sert l'Art face à la barbarie? Ou enfin, pour dire les choses autrement, toujours dans le contexte de l'époque où le roman fut écrit, et avec la stupeur d'un Adorno : comment écrire un poème après Auschwitz..?
Pour finir ce billet trop excessivement bavard (et peut-être aussi un peu déplacé dans le cadre d'un «after» festif que nous tenterions encore de prolonger - excusez, alors, les amis!), je dirais, et je l'espère pour tous, qu'on aura largement le temps avant de se décider à lire, ou à relire LA MORT DE VIRGILE, et de choisir le moment idéal pour le faire!
Et, pourquoi pas, différer cette lecture éventuellement au moment où l'on aura la fâcheuse sensation de commencer à entendre la Camarde rôder dans nos parages?
Parce que, croyez-moi, la mort va très bien à Virgile! Et aussi, parce que c'est juste beau à en mourir...
Le livre est bâti sur les 18 dernières heures de la fin de vie de Virgile lequel est ramené en piteux état De Grèce où il avait contracté la malaria. Broch a organisé cette temporalité en 4 chapitres liés au cycle de la vie: L‘arrivée, La descente, L'attente et le retour. Et la mort est racontée en 4 mouvements qui correspondent aux 4 éléments naturels : l'eau, le feu, la terre et l'air (éther).
Dans ce texte empreint de mysticisme, Broch va consacrer 600 pages a une sorte de rêve, de délire agonique, d'une lente surrection des souvenirs les plus intimes de Virgile. C'est un texte mystique, impregné de la présence du Christ qui va hanter tout le roman (à noter la conversion au christianisme de Broch) et son originalité est de nous présenter le Sauveur comme le pressentiment d'une Voix et d'une Chair. L'auteur développe les thèmes de la vie et de la mort, la responsabilité du poète face à l'irruption du Mal : la maladie, la misère du peuple. (p.29 …Le Mal, un déferlement immense d'une malédiction indicible, inexprimable, inconcevable). L'auteur Broch se base aussi sur la légende qui dit que Virgile voulait détruire l'Énéide.
Nous sommes à Brindisi en septembre 19 av JC, Publius Vergilius Maro (Virgile) est un poète latin très reconnu, né le 15 octobre 70 av JC à Andes, Lombardie. Il revient malade De Grèce atteint de malaria: l'empereur Auguste est allé le chercher là, car Virgile a manifesté le désir de brûler le texte de l'Énéide qui flattait Auguste; le poète trouve que l'Énéide est une oeuvre inachevée et il voudrait l'offrir en sacrifice aux dieux. Or ce poème que Virgile a mis les 11 dernières années de sa vie à écrire, rend un hommage appuyé à Auguste, grand vainqueur d'Actium, et qui est au début de son règne, un règne enfin pacifique.
Après dures négociations, Auguste sauvera le manuscrit des flammes.
Le livre de Broch n'est pas un roman mais un texte poétique avec des phrases interminables « à la Proust », un monologue intérieur qui ne s'achève jamais mais sans la signification qui existe chez Proust. C'est un délire, un rêve entre comateux et éveillé qui se remémore, mais se perd aussi. Il existe une moyenne de 2 phrases par page et j'ai fait une nouvelle expérience de dédoublement de la pensée en lisant et en même temps en pensant à autre chose bien concrète. A la fin de la page je m'apercevais du dédoublement et la relisais bien concentrée pour me dire, à la fin, que je n'obtenais pas plus de renseignements; c'était en réalité un rêve éveillé, incantatoire, hypnotique et seule la musicalité du phrasé avait une signification car le reste était abscons. le texte est surabondant en anaphores qui servent à lui donner un rythme, une musicalité.
Par moments le texte peut être si beau qu'il nous élève nettement au dessus d'une certaine médiocrité. Félicitations au traducteur qui a su garder le côté très lyrique à la métrique. Il faut lui rendre hommage, il s'agit d'Albert Kohn.
Mais par bonheur, tout le livre n'est pas délire et les conversations entre Virgile et Auguste sont de haute teneur politique et philosophique, ainsi que les conversations entre Virgile et ses deux plus vieux amis qui seront aussi ses exécuteurs testamentaires. Elles restent d'une notable modernité.
Cette lecture est une mise à l'épreuve du lecteur, c'est une expérience en soi, mais il faut beaucoup de patience et d'un esprit libre de toute préoccupation.
Lien : https://pasiondelalectura.wo..
Dans ce texte empreint de mysticisme, Broch va consacrer 600 pages a une sorte de rêve, de délire agonique, d'une lente surrection des souvenirs les plus intimes de Virgile. C'est un texte mystique, impregné de la présence du Christ qui va hanter tout le roman (à noter la conversion au christianisme de Broch) et son originalité est de nous présenter le Sauveur comme le pressentiment d'une Voix et d'une Chair. L'auteur développe les thèmes de la vie et de la mort, la responsabilité du poète face à l'irruption du Mal : la maladie, la misère du peuple. (p.29 …Le Mal, un déferlement immense d'une malédiction indicible, inexprimable, inconcevable). L'auteur Broch se base aussi sur la légende qui dit que Virgile voulait détruire l'Énéide.
Nous sommes à Brindisi en septembre 19 av JC, Publius Vergilius Maro (Virgile) est un poète latin très reconnu, né le 15 octobre 70 av JC à Andes, Lombardie. Il revient malade De Grèce atteint de malaria: l'empereur Auguste est allé le chercher là, car Virgile a manifesté le désir de brûler le texte de l'Énéide qui flattait Auguste; le poète trouve que l'Énéide est une oeuvre inachevée et il voudrait l'offrir en sacrifice aux dieux. Or ce poème que Virgile a mis les 11 dernières années de sa vie à écrire, rend un hommage appuyé à Auguste, grand vainqueur d'Actium, et qui est au début de son règne, un règne enfin pacifique.
Après dures négociations, Auguste sauvera le manuscrit des flammes.
Le livre de Broch n'est pas un roman mais un texte poétique avec des phrases interminables « à la Proust », un monologue intérieur qui ne s'achève jamais mais sans la signification qui existe chez Proust. C'est un délire, un rêve entre comateux et éveillé qui se remémore, mais se perd aussi. Il existe une moyenne de 2 phrases par page et j'ai fait une nouvelle expérience de dédoublement de la pensée en lisant et en même temps en pensant à autre chose bien concrète. A la fin de la page je m'apercevais du dédoublement et la relisais bien concentrée pour me dire, à la fin, que je n'obtenais pas plus de renseignements; c'était en réalité un rêve éveillé, incantatoire, hypnotique et seule la musicalité du phrasé avait une signification car le reste était abscons. le texte est surabondant en anaphores qui servent à lui donner un rythme, une musicalité.
Par moments le texte peut être si beau qu'il nous élève nettement au dessus d'une certaine médiocrité. Félicitations au traducteur qui a su garder le côté très lyrique à la métrique. Il faut lui rendre hommage, il s'agit d'Albert Kohn.
Mais par bonheur, tout le livre n'est pas délire et les conversations entre Virgile et Auguste sont de haute teneur politique et philosophique, ainsi que les conversations entre Virgile et ses deux plus vieux amis qui seront aussi ses exécuteurs testamentaires. Elles restent d'une notable modernité.
Cette lecture est une mise à l'épreuve du lecteur, c'est une expérience en soi, mais il faut beaucoup de patience et d'un esprit libre de toute préoccupation.
Lien : https://pasiondelalectura.wo..
Ce roman, le plus grand, le plus intense, le plus beau de tous les romans de Broch, selon Kundera, plonge le lecteur dans un état second. C'est un texte visionnaire, où la fièvre du personnage dont nous accompagnons le délire intérieur nous transporte quelque part dans les limbes du sublime, en un lieu où la littérature, plutôt que de chercher à reproduire le réel, élabore un monde qui lui est propre. Il faut certes du courage et de la persévérance pour en venir à bout, mais ce livre-engrenage "ne vous lâchera qu'après avoir donné un tour à votre esprit", comme disait Victor Hugo dans son "Tas de pierres". TL
Une vaste flotte escorte le navire d'Auguste qui débarque dans le port de l'actuelle Brindisi, accueilli en triomphateur, dans l'hubris de la foule venue à sa rencontre. Dans un de ses bateaux git le poète Virgile, affaibli et délirant, victime de la malaria qu'il a contracté en Grèce, rapatrié par la volonté expresse de César. Il a cinquante et un ans et ses jours sont comptés. Alternant hallucinations où se pressent des visages du passé et des figures fantasmées et moments de lucidité où il reconnait les gens venus à son chevet, notemment ses amis de toujours les poêtes Lucius Varius Rufus et Plotius Tucca, qui seront ses exécuteurs testamentaires, et Caius Octavius lui-même, Virgile est pris de l'idée folle et obsédante de livrer aux flammes son grand oeuvre, l'Énéide, pendant latin de l'Iliade et l'odyssée, .épopée contant les épreuves du Troyen Énée, ancêtre mythique du peuple romain, Ces derniers n'auront de cesse qu'à l'article de la mort il renonce à son projet sacrilège.
La Mort de Virgile est un roman exigeant et ardu, dans sa dimension poétique et métaphysique L'auteur à voulu retranscrire les atermoiements et les visions d'un esprit divinateur dans les affres de la fièvre. Ainsi un tiers du volume est occupé par une exténuante divagation où l'esprit du malade englobe tous les mondes que l'esprit humain saisit et ce qu'ils sreflètent d'inconcevable, l'oeuvre s'achèvant par le passage de Virgile dans l'autre rive, par-delà les règnes animal, végétal et minéral, jusqu'au chaos primordial qui précédé l'éternel retour. Certes, c'est un roman ambitieux, foisonnant, et le lecteur ne peut que s'incliner devant une telle maitrise, s'incliner certes, mais de guerre lasse.
La Mort de Virgile est un roman exigeant et ardu, dans sa dimension poétique et métaphysique L'auteur à voulu retranscrire les atermoiements et les visions d'un esprit divinateur dans les affres de la fièvre. Ainsi un tiers du volume est occupé par une exténuante divagation où l'esprit du malade englobe tous les mondes que l'esprit humain saisit et ce qu'ils sreflètent d'inconcevable, l'oeuvre s'achèvant par le passage de Virgile dans l'autre rive, par-delà les règnes animal, végétal et minéral, jusqu'au chaos primordial qui précédé l'éternel retour. Certes, c'est un roman ambitieux, foisonnant, et le lecteur ne peut que s'incliner devant une telle maitrise, s'incliner certes, mais de guerre lasse.
Citations et extraits (19)
Voir plus
Ajouter une citation
incipit :
"Bleu d'acier et légères, agitées par un imperceptible vent debout, les vagues de l'Adriatique avaient déferlé à la rencontre de l'escadre impériale lorsque celle-ci, ayant à sa gauche les collines aplaties de la côte de Calabre qui se rapprochaient peu à peu, cinglait vers le port de Brundisium, et maintenant que la solitude ensoleillée et pourtant si funèbre de la mer faisait place à la joie pacifique de l'activité humaine, maintenant que les flots doucement transfigurés par l'approche de la présence et de la demeure humaine la peuplaient de nombreux bateaux, - de ceux qui faisaient route également vers le port et de ceux qui venaient d'appareiller, - maintenant que les barques de pêche aux voiles brunes venaient de quitter, pour leur expédition nocturne, les petites jetées des nombreux villages et hameaux étendus le long des blanches plages, la mer était devenue presque aussi lisse qu'un miroir."
"Bleu d'acier et légères, agitées par un imperceptible vent debout, les vagues de l'Adriatique avaient déferlé à la rencontre de l'escadre impériale lorsque celle-ci, ayant à sa gauche les collines aplaties de la côte de Calabre qui se rapprochaient peu à peu, cinglait vers le port de Brundisium, et maintenant que la solitude ensoleillée et pourtant si funèbre de la mer faisait place à la joie pacifique de l'activité humaine, maintenant que les flots doucement transfigurés par l'approche de la présence et de la demeure humaine la peuplaient de nombreux bateaux, - de ceux qui faisaient route également vers le port et de ceux qui venaient d'appareiller, - maintenant que les barques de pêche aux voiles brunes venaient de quitter, pour leur expédition nocturne, les petites jetées des nombreux villages et hameaux étendus le long des blanches plages, la mer était devenue presque aussi lisse qu'un miroir."
L'obscurité s'épaissit, les visages se firent plus imprécis, les rives pâlirent, le navire se fit plus imprécis, la voix seule subsista; elle devint plus claire, plus impérieuse comme si elle voulait conduire le navire et la cadence de ses rames, la voix conductrice d'un jeune esclave; mais déjà pourtant une voix dont on avait oublié l'origine, parce que ce n'était plus elle, mais la chanson qui reposant en elle-même était devenue un guide: car seul ce qui repose en soi-même est ouvert sur l'éternité et capable d'être un guide, car seul l'instant unique, tiré ou plutôt sauvé de l'écoulement des choses, s'ouvre sur l'infini, seul ce que l'ont tient vraiment, ne fût-ce qu'un instant unique dans l'océan des millions d'années, devient durée intemporelle, devient un chant qui oriente.
«Es-tu venue, Plotia, pour réentendre le poème ?» Alors Plotia sourit, elle sourit très lentement : le sourire commença dans les yeux, glissa vers la peau des tempes, brillant d’un doux éclat, comme si les veines délicates qui se dessinaient sous la peau devaient aussi participer à ce sourire ; tout à fait imperceptiblement, le sourire s’étendit aux lèvres qui palpitaient comme sous un baiser, avant de s’ouvrir à lui, et de découvrir la frange des dents, la frange du squelette, la frange rocheuse et ivoirine de la mortalité dans l’existence humaine. Ainsi, le sourire persista et demeura sur son visage, sourire sur les rives de la mortalité, sourire sur les rives de l’éternité, et c’était le scintillement argenté et infini de la mer ensoleillée, qui devenait parole dans un sourire : «Je veux toujours rester près de toi ; sans fin».
En effet, comme conscient de l’abolition de toute durée, comme conscient de l’unité du commencement et de la fin, mais comme conscient également de la dualité à laquelle toute unité est soumise, à laquelle lui aussi devait se soumettre, il se défit de l’unité de son être, il devint, tout au moins pour un certain temps, dualité; d’une part restant assis dans une tranquille quiétude sur le banc des rameurs,d’autre part se levant et s’approchant avec l’allure souple du marin, lui tendant le gobelet une nouvelle fois, afin que l’ami altéré-oh ! était-il altéré?- y puisse boire encore une fois ! Et lorsque cela s’accomplit, Ô miracle, ce ne fut pas l’absorption d’un breuvage que l’on boit, ce ne fut pas comme l’étanchement, une soif que l’on étanche, non, ce fut une participation, ce fut une part à la double existence reflétée, ce fut une intégration à la marée infinie des eaux, ce fut le sentiment d’une pénétration de soi par la vue intérieure du monde invisible, mais ce fut aussi, un savoir sans savoir, au point où se referme le cycle de la connaissance, qui enclot le néant, ce fut cette fermeture même, ce fût la jonction des infinis divergents, la jonction par laquelle l’avenir se mue en passé, le passé en avenir, ô duplication à l’intérieur de la duplication, réflexion à l’intérieur de la réflexion, invisibilité à l’intérieur de l’invisible. Il n’était donc plus besoin d’un médiateur ni d’un ustensile, ni du gobelet qui enferme le liquide, ni de la main qui tend le gobelet, à peine besoin de la bouche qui accueille le liquide, il n’en était plus besoin parce que toute action, celle de boire ou une autre, parce que les liens de toute vie avaient été relâchés et dénoués en vertu d’une connexion qui annulait toute discordance… Et voilà que l’ivoire du gobelet se métamorphosa en une corne de brune et solide qui se dissipa en un nuage brun et léger; en même temps le passé se dissipa aussi, entièrement, non pas comme un simple phantasme, mais comme une réalité vue en rêve, autorisée à demeurer, dans l’assurance qu’elle n’aura pas été vaine…Voilà ce qui eût lieu,tandis que le liquide sans humidité, la boisson sans goût, courait sur ses lèvres et à travers son gosier, sans que ses lèvres sa langue et son gosier en fussent humectés.
Plus sa mémoire cherchait les traces de l’Énéide, plus celle-ci se dissolvait rapidement, chant après chant (...) Tout le contenu remémorable s’évanouissait, tout ce que le poème avait pu chanter : navigation et rives ensoleillées, guerre et bruit des armes, sort des dieux et mouvement des astres parcourant leurs orbites, tout cela et bien d’autres choses, couchées par écrit ou non, se détachait ; le poème s’en dépouillait, il l’avait rejeté comme un vêtement inutile et il retournait dans la nudité sans voile précédant sa naissance, dans l’invisibilité mélodique où prend racine toute poésie.
Dans la catégorie :
Romans, contes, nouvellesVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature des langues germaniques. Allemand>Romans, contes, nouvelles (879)
autres livres classés : littérature autrichienneVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Hermann Broch (13)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz: l'Allemagne et la Littérature
Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?
Hoffmann
Gordon
Grimm
Marx
10 questions
415 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature allemande
, guerre mondiale
, allemagneCréer un quiz sur ce livre415 lecteurs ont répondu