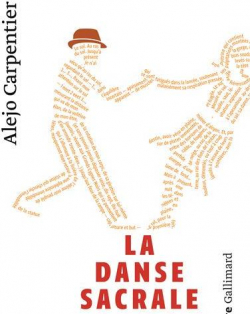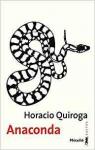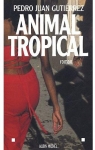Alejo Carpentier
René L. F. Durand (Autre)/5 22 notes
René L. F. Durand (Autre)/5 22 notes
Résumé :
Deux couples sont les étoiles de cette oeuvre conçue comme un ballet: Vera, danseuse d'origine russe et Enrique le Cubain, puis Calixto et Mirka, élèves de Vera à La Havane: lui est noir, elle est blanche. L'aventure des héros de cette grandiose fresque s'inscrit dans l'histoire: la résistance cubaine à la dictature de Machado, qui oblige Enrique à s'exiler en Europe, la guerre d'Espagne puis la Seconde Guerre mondiale, le régime sanglant de Batista qui provoque la ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La danse sacraleVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Oeuvre sublime d'Alejo Carpentier, fruit d'une longue gestation, véritable somme de ses engagements, de son humanisme horrifié par les préjugés sociaux et raciaux, de ses identités européennes et latino-américaine et de ses convictions, La danse sacrale est une vaste fresque historique, idéologique et humaine, largement fondée sur le désir de témoignage. le récit très dense couvre à la fois une grande diversité géographique (Cuba, Espagne, France, Venezuela...) et les grands événements de l'histoire contemporaine. Alejo Carpentier construit ses protagonistes comme des archétypes incarnant les horreurs de la guerre tout autant que les idéaux exaltés de ceux qui veulent révolutionner le monde : il réussit à forger des confrontations émouvantes entre des destins individuels et collectifs, rendant L Histoire presque palpable.
Le titre emprunté au Sacre du printemps de Stravinski est un symbole en soi du triomphe annoncé d'une révolution que l'auteur a ardemment souhaitée. Cependant, sans se départir de son enthousiasme quant à la révolution cubaine, Alejo Carpentier rétablit l'équilibre en défendant la beauté et l'harmonie universelle d'une humanité plurielle et ouverte.
Lien : https://tandisquemoiquatrenu..
Le titre emprunté au Sacre du printemps de Stravinski est un symbole en soi du triomphe annoncé d'une révolution que l'auteur a ardemment souhaitée. Cependant, sans se départir de son enthousiasme quant à la révolution cubaine, Alejo Carpentier rétablit l'équilibre en défendant la beauté et l'harmonie universelle d'une humanité plurielle et ouverte.
Lien : https://tandisquemoiquatrenu..
Comment parler de ce livre si foisonnant , pour essayer d'en restituer l'atmosphère et vous communiquer l'enthousiasme - je préfère dire les choses tout de suite - que j'ai eu à découvrir cet écrivain.
Je pourrais vous dire qu'il évoque Véra, danseuse d'origine russe, qui a fui en 1917 son pays, pour s'exiler en Europe et gagner l'Angleterre puis Paris. Elle refuse de prononcer et d'entendre prononcer le mot "Révolution" tant les révolutions ont modifié son destin et encore celui de la jeune femme dont le compagnon s'est engagé dans les Brigades Internationales pour combattre en Espagne.
Je pourrais vous parler d'Enrique, cubain, riche jeune homme qui refuse la compromission et l'adaptabilité politique de son milieu, qui embrasse la cause révolutionnaire étudiante de son pays face à une dictature impitoyable. Il fuit Cuba après des démêlés avec la police du pays et se retrouve de fil en aiguille engagé dans les Brigades Internationales pour y servir un idéal.
Je pourrais vous parler de Gaspar le joueur de trompette, l'ami indéfectible rencontré dans la lutte, en Espagne, que l'on accompagne à Cuba dans son retour et qui jamais ne changera ses idées, et qui semble avoir un jugement sûr de tout homme qu'il croise.
Et il faudrait parler également de Calixto et de Mirta....
Mais je ne vous aurais encore rien dit : il faut parler de la trame littéraire , musicale,, poétique, artistique de ce roman, de l'Histoire qui lui sert de squelette et de toutes les autres figures évoquées, personnages célèbres ou moins mais qui en font un merveilleux récit. Et dire encore le style de l'écriture, chatoyant, coloré...
Donc je vais me tare et simplement dire qu'en lisant Alejo Carpentier, j'ai appris, découvert, projeté de lire bon nombre d'auteurs et découvrir poètes et musique...Et finalement , n'est-ce pas cela le compagnonnage des livres, agrandir le cercle, emporter loin et "nourrir" ?
J'ai aimé, vous le saviez déjà...
Je pourrais vous dire qu'il évoque Véra, danseuse d'origine russe, qui a fui en 1917 son pays, pour s'exiler en Europe et gagner l'Angleterre puis Paris. Elle refuse de prononcer et d'entendre prononcer le mot "Révolution" tant les révolutions ont modifié son destin et encore celui de la jeune femme dont le compagnon s'est engagé dans les Brigades Internationales pour combattre en Espagne.
Je pourrais vous parler d'Enrique, cubain, riche jeune homme qui refuse la compromission et l'adaptabilité politique de son milieu, qui embrasse la cause révolutionnaire étudiante de son pays face à une dictature impitoyable. Il fuit Cuba après des démêlés avec la police du pays et se retrouve de fil en aiguille engagé dans les Brigades Internationales pour y servir un idéal.
Je pourrais vous parler de Gaspar le joueur de trompette, l'ami indéfectible rencontré dans la lutte, en Espagne, que l'on accompagne à Cuba dans son retour et qui jamais ne changera ses idées, et qui semble avoir un jugement sûr de tout homme qu'il croise.
Et il faudrait parler également de Calixto et de Mirta....
Mais je ne vous aurais encore rien dit : il faut parler de la trame littéraire , musicale,, poétique, artistique de ce roman, de l'Histoire qui lui sert de squelette et de toutes les autres figures évoquées, personnages célèbres ou moins mais qui en font un merveilleux récit. Et dire encore le style de l'écriture, chatoyant, coloré...
Donc je vais me tare et simplement dire qu'en lisant Alejo Carpentier, j'ai appris, découvert, projeté de lire bon nombre d'auteurs et découvrir poètes et musique...Et finalement , n'est-ce pas cela le compagnonnage des livres, agrandir le cercle, emporter loin et "nourrir" ?
J'ai aimé, vous le saviez déjà...
Oeuvre sublime d'Alejo Carpentier, fruit d'une longue gestation, véritable somme de ses engagements, de son humanisme horrifié par les préjugés sociaux et raciaux, de ses identités européennes et latino-américaine et de ses convictions, La Consagración de la Primavera est une vaste fresque historique, idéologique et humaine, largement fondée sur le désir de témoignage. le récit très dense couvre à la fois une grande diversité géographique (Cuba, Espagne, France, Venezuela...) et les grands événements de l'histoire contemporaine. Alejo Carpentier construit ses protagonistes comme des archétypes incarnant les horreurs de la guerre tout autant que les idéaux exaltés de ceux qui veulent révolutionner le monde : il réussit à forger des confrontations émouvantes entre des destins individuels et collectifs, rendant L Histoire presque palpable.
Le titre emprunté au Sacre du printemps de Stravinki est un symbole en soi du triomphe annoncé d'une révolution que l'auteur a ardemment souhaitée. Cependant, sans se départir de son enthousiasme quant à la révolution cubaine, Alejo Carpentier rétablit l'équilibre en défendant la beauté et l'harmonie universelle d'une humanité plurielle et ouverte.
Lien : https://tandisquemoiquatrenu..
Le titre emprunté au Sacre du printemps de Stravinki est un symbole en soi du triomphe annoncé d'une révolution que l'auteur a ardemment souhaitée. Cependant, sans se départir de son enthousiasme quant à la révolution cubaine, Alejo Carpentier rétablit l'équilibre en défendant la beauté et l'harmonie universelle d'une humanité plurielle et ouverte.
Lien : https://tandisquemoiquatrenu..
Il y a l'art éphémère, comme le théâtre, le chant, la danse, le ballet, la musique. Il y a l'art fixe ou défini, comme la littérature, la sculpture, la peinture. Mais ce qui demeure n'est pas toujours saisissable ou constant, car c'est dans le mouvement que s'incarne parfois ce qui est esthétique. La nature de l'art, de l'expression humaine, est devenue particulièrement difficile suite aux nombreux échecs de la conscience, aux multiples revers des hommes à travers leurs utopies déréalisantes et massacrantes. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de Guernica aux fresques de Rivera, de Gulliver à Giacometti en passant par Stravinsky et Rodin: ce qui humanise, ce qui résonne en nous; ce qui déshumanise et contrevient, contrefait la conscience. le roman de Carpentier agit comme un double miroir et se questionne sur l'apport et les conséquences de ce parallèle entre l'art éphémère et l'art fixe, de ce que représente la danse (ici le ballet classique) et sa consécration, sa relation avec le monde, sa place, sa part d'humanité, son inconstance et son mouvement, mais cartographié par le roman, réincarné par le roman. La prose ici est mouvement, contredanse des personnages, se repoussant, s'attirant à nouveau, en une hybridation des corps, hybridation du roman et de la danse, hybridation des cultures européennes et cubaine.
Certains auteurs écrivent une comédie humaine en quarante volumes; d'autres se contentent de quelques oeuvres, comme Carpentier, mais la densité est telle que bien peu de lecteurs s'y risquent. Autant par les sujets abordés ici: les nazis qui bombardent l'Espagne, les collabos français à Paris ("Hitler plutôt que les communistes"), le règne de Batista et son Cuba Nostra, la chasse aux communistes du gouvernement réactionnaire états-uniens, les surréalistes et les cubistes européens désoeuvrés à New York, les trois révolutions du vingtième siècle...
Tout au long de ma lecture de ce roman, je pensais à Herzog, un livre unique et complet, abordant tous les sujets, s'invitant à toutes les controverses, épuisant les philosophes et les idéologues, consternant son lecteur. Se sentir vivre pour Herzog, c'est une lutte perpétuelle contre l'abstraction, c'est faire appel aux paroles des sages pour les confronter à la triste réalité, aberrante et faussée. le roman de Carpentier prend parfois des allures de manifeste contre cette abstraction, cette déshumanisation des arts, comme un hommage à Ortega y Gasset qui s'inquiétait de voir une esthétique dépourvue de signification et de visée autre que formelle, quand l'esthétique renonce à être une éthique. La danse sacrale serait-elle une poétique du roman qui refuse la révolution artistique de la première moitié du vingtième siècle, contre Joyce, contre Breton et Duchamp, contre Debussy et Mallarmé?
Certains auteurs écrivent une comédie humaine en quarante volumes; d'autres se contentent de quelques oeuvres, comme Carpentier, mais la densité est telle que bien peu de lecteurs s'y risquent. Autant par les sujets abordés ici: les nazis qui bombardent l'Espagne, les collabos français à Paris ("Hitler plutôt que les communistes"), le règne de Batista et son Cuba Nostra, la chasse aux communistes du gouvernement réactionnaire états-uniens, les surréalistes et les cubistes européens désoeuvrés à New York, les trois révolutions du vingtième siècle...
Tout au long de ma lecture de ce roman, je pensais à Herzog, un livre unique et complet, abordant tous les sujets, s'invitant à toutes les controverses, épuisant les philosophes et les idéologues, consternant son lecteur. Se sentir vivre pour Herzog, c'est une lutte perpétuelle contre l'abstraction, c'est faire appel aux paroles des sages pour les confronter à la triste réalité, aberrante et faussée. le roman de Carpentier prend parfois des allures de manifeste contre cette abstraction, cette déshumanisation des arts, comme un hommage à Ortega y Gasset qui s'inquiétait de voir une esthétique dépourvue de signification et de visée autre que formelle, quand l'esthétique renonce à être une éthique. La danse sacrale serait-elle une poétique du roman qui refuse la révolution artistique de la première moitié du vingtième siècle, contre Joyce, contre Breton et Duchamp, contre Debussy et Mallarmé?
Fresque dansante sur un siècle d'exodes, ballet amoureux de l'engagement artistique au XXième siècle, La danse sacrale transporte le lecteur de la Révolution de 17 à celle castriste. Au-delà de l'aspect historique, parfois contestable, Carpentier livre une oeuvre profonde et lumineuse sur notre rapport aux territoires temporels.
Lien : https://viduite.wordpress.co..
Lien : https://viduite.wordpress.co..
Citations et extraits (6)
Voir plus
Ajouter une citation
Otra vez sobre mí el gran sol redondo y cercano, con pequeños rectángulos concéntricos. Pero ahora, el gran sol redondo se mueve lentamente hacia mis piernas, en una escenografía que, esta vez, es de gran estreno. Aquí habrá función mayor. Me rodean Hombres Blancos y varias coéforas que, con leves entrechoques metálicos, disponen una panoplia de pequeños enseres relucientes, con filos, puntas y dientes, que prefiero no mirar. —“¿Cómo se siente?” —me pregunta, detrás de mí, uno a quien no veo. —“Bien. Muy bien.” —“¡Oxígeno!” Me tapan la boca y las narices con una máscara. Grata sensación de respirar plenamente, de sorber una brisa fina que se me cuela en los pulmones. Se abre una puerta. Aparecen los Grandes Oficiantes con los gorros puestos y las caras cerradas, hasta los ojos, como los de las mujeres mahometanas. Quiero hacer un chiste, pero no me dan tiempo. Ya se me acerca, con una aguja en alto, el anestesista. —“No vas a tener el tiempo de contar hasta tres…” —me dice. Llego a dos, y salgo de este mundo para renacer en el mundo de mi infancia. Todo es enorme, gigantesco, en casa de mi tía. Y mi tía también es grande, gigantesca, con esa papada, esos brazos blancos, esos collares de varias vueltas. Salimos en su grande, gigantesco, automóvil negro —ella, detrás, como una reina; yo, delante, al lado del grande, gigantesco, chofer uniformado. Pero al salir por la grande, gigantesca verja de la entrada, tenemos que detenemos ante una jaula negra, montada en ruedas, tirada por una mula, conducida por un policía, que está llena de niños presos. Unos lloran, otros dicen cosas feas, otros me sacan la lengua por el enrejillado. —“La jaula de los niños majaderos y desobedientes” —dice mi tía. —“Diga más bien la Señora Condesa que son ‘mataperros’, y con perdón” —dice el chofer: “Hacen bien en recogerlos. Se pasan la vida correteando por las calles, comiendo mangos y bañándose en las pocetas del litoral.” (A mí, esa vida me parecía maravillosa, y no la mía, de niño obligado a levantarse por reloj, hacerlo todo con mesura, y besar señoras gordas y sudorosas, y a horribles ancianos, con mejillas olientes a tabaco y a sepultura, porque eran “personas de respeto…” —“Ésos no respetan nada” —proseguía el chofer, señalando a los enjaulados. —“¡Cómo van a respetar nada, si no tienen religión ni fundamento! Y nacidos en esos solares, donde las negras paren como conejas…” Volvemos del paseo por el Prado y el Malecón, Mademoiselle me hace comer y me acuesta. Pero apenas Mademoiselle me arropa y sale, me levanto, saco el carrito bombero y lo hago correr por el cuarto. Vuelve la Mademoiselle, enojada. A la tercera, sube con mi tía, toda perfumada y envuelta en gasas, que me amenaza con su pericón. —“Si no te acuestas, llamo a la Policía para que te lleven en la jaula.” Y sale, después de apagar la luz. La jaula no. Todo menos la jaula. Es terrible, espantosa, la jaula. Sólo hay una manera de impedir que mi tía pida la jaula: matarla. En el cajón de los juguetes, tengo dos pistolas amarillas y azules, con un corcho en cada cañón. Corto los cordeles que retienen los corchos a las mirillas del arma, y, con una culata en cada mano, bajo las escaleras…
Ici les montres et le chronomètres perdent de leur autorité, et il arrive même qu'on oublie de les remonter ;
(...)
On se lève au son des clochettes des crieurs de chocolat épais au cacao brut, que l'on vend dans des boules sucrées ; pendant la journée, on entend souvent sonner le glas, isochrone et nullement sinistre, pour les âmes des fidèles défunts, que de nombreux habitants recommandent à la cloche du curé en vertu d'une vieille coutume ; à la tombée de la nuit, après la promenade provinciale dans le parc qui est ici triangulaire - seule particularité remarquable de cette ville -, on entend retentir le timbre d'un cinéma (il n'y a qu'un), où l'on projette des films qui sont déjà passés sur tous les écrans de l'île ; puis c'est la nuit, identique aux autres nuits, dans l'attente d'une aurore semblable à celles de toujours - à moins que le ciel ne se bouche, que les nuages n'encapuchonnent de gris la cime du rocher, et qu'il ne se mette à pleuvoir.
(...)
On se lève au son des clochettes des crieurs de chocolat épais au cacao brut, que l'on vend dans des boules sucrées ; pendant la journée, on entend souvent sonner le glas, isochrone et nullement sinistre, pour les âmes des fidèles défunts, que de nombreux habitants recommandent à la cloche du curé en vertu d'une vieille coutume ; à la tombée de la nuit, après la promenade provinciale dans le parc qui est ici triangulaire - seule particularité remarquable de cette ville -, on entend retentir le timbre d'un cinéma (il n'y a qu'un), où l'on projette des films qui sont déjà passés sur tous les écrans de l'île ; puis c'est la nuit, identique aux autres nuits, dans l'attente d'une aurore semblable à celles de toujours - à moins que le ciel ne se bouche, que les nuages n'encapuchonnent de gris la cime du rocher, et qu'il ne se mette à pleuvoir.
Mais j'ai toujours été épouvanté par ce qui est nocturne, informe, indéfini - une forme, entrevue dans l'obscurité, dont je n'arrive pas à saisir la nature ; quelque chose qui se déplace sans raison, une ombre qui ne répond pas à une réalité... Je déteste les cavernes, parce que je suis atterré par les stalagmites soudainement éclairées par le projecteur d'une lanterne électrique. On ignore si ce sont des personnes, des animaux, ou quoi...
J'avais souffert si souvent à cause d'éléments étrangers à mes volitions profondes, que je me cuirassais contre les commotions du milieu ambiant, m'enfermant dans une sorte de réduit personnel où je prenais soin de ne pas être atteinte par le fracas de la rue.
Je saurai plus tard que chaque ville connue, vécue, sentie en fonction de mer, d'odeur marine, de lueurs marines - avec la présence de la mer - exercera toujours sur moi l'attrait d'une réalité à la fois une et multiple, sur laquelle j'aurais en quelque sorte un droit ancestral de propriété...
Videos de Alejo Carpentier (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Romans, contes, nouvellesVoir plus
>Littérature (Belles-lettres)>Littérature espagnole et portugaise>Romans, contes, nouvelles (822)
autres livres classés : littérature cubaineVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Alejo Carpentier (23)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les classiques de la littérature sud-américaine
Quel est l'écrivain colombien associé au "réalisme magique"
Gabriel Garcia Marquez
Luis Sepulveda
Alvaro Mutis
Santiago Gamboa
10 questions
371 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature sud-américaine
, latino-américain
, amérique du sudCréer un quiz sur ce livre371 lecteurs ont répondu