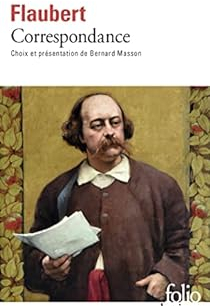Gustave Flaubert
Bernard Masson (Préfacier, etc.)Jean Bruneau (Éditeur scientifique)/5 96 notes
Bernard Masson (Préfacier, etc.)Jean Bruneau (Éditeur scientifique)/5 96 notes
Résumé :
L'ouvrage a été spécifiquement mis en forme pour votre liseuse.
- Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre.
- Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale.
- Une table des matières est placée également au début de chaque titre.
- Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre.
- Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale.
- Une table des matières est placée également au début de chaque titre.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après CorrespondanceVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
Ces lettres sont l'envers du décor, là où l'auteur se libère de sa retenue romanesque et confesse à peu près tout ce qu'il est.
Si certaines sont anodines, d'autres mériteraient de figurer dans une anthologie de la littérature.
Et dans cet espace intime de la correspondance, Flaubert livre, en plus de sa vie, l'écrivain sans détour.
Parce que ce sont les lettres d'un homme qui doute et raconte le lent cheminement vers l'accomplissement littéraire, elles nous semblent tellement familières qu'une irrépressible proximité s'installe.
On peut lire ces courriers intimes dans le désordre ou en suivant rigoureusement leur chronologie, n'en lire qu'une poignée, peu importe à vrai dire puisque nombre d'entre elles se suffisent à elles-mêmes et nous marqueront inévitablement.
Si certaines sont anodines, d'autres mériteraient de figurer dans une anthologie de la littérature.
Et dans cet espace intime de la correspondance, Flaubert livre, en plus de sa vie, l'écrivain sans détour.
Parce que ce sont les lettres d'un homme qui doute et raconte le lent cheminement vers l'accomplissement littéraire, elles nous semblent tellement familières qu'une irrépressible proximité s'installe.
On peut lire ces courriers intimes dans le désordre ou en suivant rigoureusement leur chronologie, n'en lire qu'une poignée, peu importe à vrai dire puisque nombre d'entre elles se suffisent à elles-mêmes et nous marqueront inévitablement.
Ce volume regroupe 297 lettres écrites par Gustave Flaubert à divers correspondants de 1839 à 1880. Classées de manière chronologique, elles permettent de suivre l'évolution d'un homme sur près d'un demi-siècle, de l'année de ses 18 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 58 ans, sa vie familiale, ses amitiés, ses amours, mais aussi, bien sûr, son travail d'écrivain.
L'ouvrage est construit de manière à nous faire un récit passionnant tant du point de vue historique que littéraire : Flaubert décrit en effet aussi bien son siècle (les années du Second Empire, la guerre de 1870 et ses répercussions…) que ses recherches pour composer ses romans (il est par exemple dépité d'apprendre que la ligne de chemin de fer qu'il voulait faire emprunter à son héros dans L'Éducation sentimentale n'existait pas à l'époque où il situe son histoire !), ses voyages, ses lectures. Il a des discussions passionnées et très vivantes (d'autant que l'éditeur a choisi de ne faire aucune coupe dans les lettres reproduites, quitte à laisser des répétitions ou des formules énigmatiques) avec des correspondants tels que Georges Sand, Guy de Maupassant ou Ivan Tourguéniev. Et il partage ses coups de coeur comme ses coups de gueule avec beaucoup de style.
Bien sûr, il faut quelques pages au début pour se familiariser avec le contexte, se retrouver parmi les différents interlocuteurs de Flaubert, mais l'important appareil critique (notes, introductions aux différentes parties de l'anthologie, index…) de l'édition réalisée par Bernard Masson nous facilite beaucoup la lecture, si bien qu'on y prend vite goût.
Un volume de correspondance très bien écrit, composé et intéressant tant du point de vue historique que littéraire. Pour voir Gustave Flaubert d'un autre oeil, même si l'on garde de mauvais souvenirs d'heures passées à étudier Madame Bovary.
L'ouvrage est construit de manière à nous faire un récit passionnant tant du point de vue historique que littéraire : Flaubert décrit en effet aussi bien son siècle (les années du Second Empire, la guerre de 1870 et ses répercussions…) que ses recherches pour composer ses romans (il est par exemple dépité d'apprendre que la ligne de chemin de fer qu'il voulait faire emprunter à son héros dans L'Éducation sentimentale n'existait pas à l'époque où il situe son histoire !), ses voyages, ses lectures. Il a des discussions passionnées et très vivantes (d'autant que l'éditeur a choisi de ne faire aucune coupe dans les lettres reproduites, quitte à laisser des répétitions ou des formules énigmatiques) avec des correspondants tels que Georges Sand, Guy de Maupassant ou Ivan Tourguéniev. Et il partage ses coups de coeur comme ses coups de gueule avec beaucoup de style.
Bien sûr, il faut quelques pages au début pour se familiariser avec le contexte, se retrouver parmi les différents interlocuteurs de Flaubert, mais l'important appareil critique (notes, introductions aux différentes parties de l'anthologie, index…) de l'édition réalisée par Bernard Masson nous facilite beaucoup la lecture, si bien qu'on y prend vite goût.
Un volume de correspondance très bien écrit, composé et intéressant tant du point de vue historique que littéraire. Pour voir Gustave Flaubert d'un autre oeil, même si l'on garde de mauvais souvenirs d'heures passées à étudier Madame Bovary.
Faubert..Sand... Maupassant.. Mon trio préfère.... Nohant Croisset Paris... Notre duo ne bouge pour ainsi dire pas beaucoup... on devine Faubert replié sur lui même... Et une George Sand. Dynamique joviale aimante et surtout toujours de un bon conseil qu ils agisse de critiquer de long en large ses oeuvres notamment l insuccès de ' éducation sentimentale... Un livre incompris à raison... Cependant. Elle ne tarit pas de éloge et porte aux nues ses oeuvres qu elle compare à des oeuvres de art...ce qui transparaît de cette correspondance ce sont deux thèses qui s affrontent.. Celle du fond soutenu e par Sand et celle de la forme privilégié e par Flaubert.... Autre chose... l'échange épistolaire pendantet sur la Commune de Paris.... Les deux semblent horrifiés.. Flaubert prône une aristocratie éduquée .. Il faut tenir le peuple loin de la politique... Mais surtout... Moin de l éducation... Chose surprenante pour un homme proche du peuple et des pauvres... Même chose chez Sand qui semble lui donner raison en tout point.... Une correspondance comme celle la valent bien même un manuel historiens.. Un pamphlet.... Une biographie ou que sais je encore.... J ak Lu ce texte avec intérêt... Délice.. Et une certaine émotion que l on éprouve toujours vers ces fins.. Que l on devine toute proche s....
Une mine d'informations d'une valeur humaine, littéraire et historique, inestimable, et qui couvre cinq décennies. A savourer en lecture croisée avec la correspondance de George Sand.
Il m'est toujours difficile d'accepter de voir un auteur dévoilé, là cela atteint des sommets.
Citations et extraits (105)
Voir plus
Ajouter une citation
148. À LA MÊME.
Dimanche matin, 11 h. [27 septembre 1846.]
Enfin, le quatrième jour, je reçois une lettre. Je croyais que c’était un parti pris pour me tenter et pour voir qu’est-ce que je ferais ? Tiens, pendant que j’y pense, que je te donne de suite un conseil. Ne confie ton secret à personne, et, pour les lettres, ne te fie pas plus à ta couturière qu’à tout autre. On est toujours trahi par ces gens-là tout aussi bien que par vos amis. Quoique ce soit une course épouvantable que d’aller rue Saint-Jacques, cela vaudra mieux, cela sera plus sûr. Tu iras tous les deux jours (dans chaque lettre je t’annoncerai positivement le jour où la suivante arrivera à Paris). Retiens cette grande maxime, ma chère enfant : « La défiance est la mère de la sûreté ». — Tu t’étonnes que j’aie si bien jugé le Philosophe sans le connaître ? C’est que j’ai déjà, quoique je n’en aie pas l’air, quelque expérience des choses. Tu n’as pas voulu le croire, quand je te l’ai dit dès le premier jour. Je suis mûr, mûr avant l’âge c’est vrai, parce que j’ai vécu en serre chaude. Je ne me pose jamais en homme qui a de l’expérience, ce serait trop sot ; mais j’observe beaucoup et je ne conclus jamais, moyen infaillible de ne pas se tromper. J’ai retourné et j’ai joué par-dessus la jambe, dans une affaire personnelle, des diplomates illustres, ce qui m’a donné un dégoût profond de leur capacité !
La vie pratique m’est odieuse ; la nécessité de venir seulement s’asseoir à heures fixes dans une salle à manger me remplit l’âme d’un sentiment de misère. Mais quand je m’en mêle (de la vie pratique), quand je m’y mets (à table), je m’y entends tout comme un autre. Tu voudrais me faire connaître Béranger ; je le désire aussi. C’est une grande nature qui me touche. Mais il y a, je parle de ses œuvres, un malheur immense, c’est la classe de ses admirateurs. Il y a des génies énormes qui n’ont qu’un défaut, qu’un vice, c’est d’être sentis surtout par les esprits vulgaires, par les cœurs à poésie facile. Béranger, depuis trente ans, défraye les amours d’étudiants et les rêves sensuels des commis voyageurs. Je sais bien que ce n’est [pas] pour eux qu’il écrit ; mais c’est surtout ces gens-là qui le sentent. D’ailleurs on a beau dire, la popularité, qui semble élargir le génie, le vulgarise, parce que le vrai Beau n’est pas pour la masse, surtout en France. Hamlet amusera toujours moins que Mademoiselle de Belle-Isle. Béranger, quant à moi, ne me parle ni de mes passions, ni de mes rêves, ni de ma poésie. Je le lis historiquement, car c’est un homme d’un autre âge. Il était vrai dans son temps, il ne l’est plus pour le nôtre. Son amour heureux, qui chante si joyeusement à la fenêtre de sa mansarde, est pour nous, jeunes gens d’à présent, quelque chose de tout étrange ; on admire ça comme l’hymne d’une religion disparue, mais on ne le sent pas. J’ai vu tant d’imbéciles, tant de bourgeois étroits, chanter « ses gueux » et « son Dieu des bonnes gens », qu’il faut vraiment que ce soit un grand poète pour avoir résisté dans mon esprit à tous ces ébranlements prodigieux. Ce que j’aime pour ma consommation particulière, ce sont les génies un peu moins agréables au toucher, plus dédaigneux du peuple, plus retirés, plus fiers dans leurs façons et dans leurs goûts ; ou bien le seul homme qui puisse remplacer tous les autres, mon vieux Shakespeare, que je vais recommencer d’un bout à l’autre et ne quitter cette fois que quand les pages m’en seront restées aux doigts. Quand je lis Shakespeare je deviens plus grand, plus intelligent et plus pur. Parvenu au sommet d’une de ses œuvres, il me semble que je suis sur une haute montagne : tout disparaît et tout apparaît. On n’est plus homme, on est œil ; des horizons nouveaux surgissent, les perspectives se prolongent à l’infini ; on ne pense pas que l’on a vécu aussi dans ces cabanes qu’on distingue à peine, que l’on a bu à tous ces fleuves qui ont l’air plus petits que des ruisseaux, que l’on s’est agité enfin dans cette fourmilière et que l’on en fait partie. J’ai écrit autrefois, dans un mouvement d’orgueil heureux (et que je voudrais bien retrouver), une phrase que tu comprendras. C’était en parlant de la joie causée par la lecture des grands poètes : « Il me semblait parfois que l’enthousiasme qu’ils me donnaient me faisait leur égal et me montait jusqu’à eux[1]. » Allons, voilà mon papier plein et je ne t’ai pas dit un mot de ce que je voulais te dire. Il faut que j’aille à Rouen (mes agréables parents m’y font aller souvent, encore 15 jours comme ça ; ce sont des promenades perpétuelles. Molière a oublié une espèce de fâcheux, c’est le Parent), pour réclamer au chemin de fer un fauteuil que l’on m’envoie de Paris. C’est un grand fauteuil pour écrire, à dossier élevé, genre Louis XIII, en maroquin vert et en bois tourné. Je l’étrennerai demain en t’écrivant. Allons, ma vieille, tu t’es encore fâchée de ce que je t’ai dit sur la Saint-Sylvestre. Je t’avais dit cela tout bonnement pour te divertir. Je suis bien peu perspicace envers toi, à ce qu’il paraît. Ma science croule devant les femmes. Il est vrai que c’est un chapitre où la ligne suivante vous prouve toujours que l’on n’a rien entendu à la précédente.
Mille baisers sur ta bouche rose à la Mignon.
Voir Novembre, œuvres de jeunesse inédites, t. II, p. 173.
Dimanche matin, 11 h. [27 septembre 1846.]
Enfin, le quatrième jour, je reçois une lettre. Je croyais que c’était un parti pris pour me tenter et pour voir qu’est-ce que je ferais ? Tiens, pendant que j’y pense, que je te donne de suite un conseil. Ne confie ton secret à personne, et, pour les lettres, ne te fie pas plus à ta couturière qu’à tout autre. On est toujours trahi par ces gens-là tout aussi bien que par vos amis. Quoique ce soit une course épouvantable que d’aller rue Saint-Jacques, cela vaudra mieux, cela sera plus sûr. Tu iras tous les deux jours (dans chaque lettre je t’annoncerai positivement le jour où la suivante arrivera à Paris). Retiens cette grande maxime, ma chère enfant : « La défiance est la mère de la sûreté ». — Tu t’étonnes que j’aie si bien jugé le Philosophe sans le connaître ? C’est que j’ai déjà, quoique je n’en aie pas l’air, quelque expérience des choses. Tu n’as pas voulu le croire, quand je te l’ai dit dès le premier jour. Je suis mûr, mûr avant l’âge c’est vrai, parce que j’ai vécu en serre chaude. Je ne me pose jamais en homme qui a de l’expérience, ce serait trop sot ; mais j’observe beaucoup et je ne conclus jamais, moyen infaillible de ne pas se tromper. J’ai retourné et j’ai joué par-dessus la jambe, dans une affaire personnelle, des diplomates illustres, ce qui m’a donné un dégoût profond de leur capacité !
La vie pratique m’est odieuse ; la nécessité de venir seulement s’asseoir à heures fixes dans une salle à manger me remplit l’âme d’un sentiment de misère. Mais quand je m’en mêle (de la vie pratique), quand je m’y mets (à table), je m’y entends tout comme un autre. Tu voudrais me faire connaître Béranger ; je le désire aussi. C’est une grande nature qui me touche. Mais il y a, je parle de ses œuvres, un malheur immense, c’est la classe de ses admirateurs. Il y a des génies énormes qui n’ont qu’un défaut, qu’un vice, c’est d’être sentis surtout par les esprits vulgaires, par les cœurs à poésie facile. Béranger, depuis trente ans, défraye les amours d’étudiants et les rêves sensuels des commis voyageurs. Je sais bien que ce n’est [pas] pour eux qu’il écrit ; mais c’est surtout ces gens-là qui le sentent. D’ailleurs on a beau dire, la popularité, qui semble élargir le génie, le vulgarise, parce que le vrai Beau n’est pas pour la masse, surtout en France. Hamlet amusera toujours moins que Mademoiselle de Belle-Isle. Béranger, quant à moi, ne me parle ni de mes passions, ni de mes rêves, ni de ma poésie. Je le lis historiquement, car c’est un homme d’un autre âge. Il était vrai dans son temps, il ne l’est plus pour le nôtre. Son amour heureux, qui chante si joyeusement à la fenêtre de sa mansarde, est pour nous, jeunes gens d’à présent, quelque chose de tout étrange ; on admire ça comme l’hymne d’une religion disparue, mais on ne le sent pas. J’ai vu tant d’imbéciles, tant de bourgeois étroits, chanter « ses gueux » et « son Dieu des bonnes gens », qu’il faut vraiment que ce soit un grand poète pour avoir résisté dans mon esprit à tous ces ébranlements prodigieux. Ce que j’aime pour ma consommation particulière, ce sont les génies un peu moins agréables au toucher, plus dédaigneux du peuple, plus retirés, plus fiers dans leurs façons et dans leurs goûts ; ou bien le seul homme qui puisse remplacer tous les autres, mon vieux Shakespeare, que je vais recommencer d’un bout à l’autre et ne quitter cette fois que quand les pages m’en seront restées aux doigts. Quand je lis Shakespeare je deviens plus grand, plus intelligent et plus pur. Parvenu au sommet d’une de ses œuvres, il me semble que je suis sur une haute montagne : tout disparaît et tout apparaît. On n’est plus homme, on est œil ; des horizons nouveaux surgissent, les perspectives se prolongent à l’infini ; on ne pense pas que l’on a vécu aussi dans ces cabanes qu’on distingue à peine, que l’on a bu à tous ces fleuves qui ont l’air plus petits que des ruisseaux, que l’on s’est agité enfin dans cette fourmilière et que l’on en fait partie. J’ai écrit autrefois, dans un mouvement d’orgueil heureux (et que je voudrais bien retrouver), une phrase que tu comprendras. C’était en parlant de la joie causée par la lecture des grands poètes : « Il me semblait parfois que l’enthousiasme qu’ils me donnaient me faisait leur égal et me montait jusqu’à eux[1]. » Allons, voilà mon papier plein et je ne t’ai pas dit un mot de ce que je voulais te dire. Il faut que j’aille à Rouen (mes agréables parents m’y font aller souvent, encore 15 jours comme ça ; ce sont des promenades perpétuelles. Molière a oublié une espèce de fâcheux, c’est le Parent), pour réclamer au chemin de fer un fauteuil que l’on m’envoie de Paris. C’est un grand fauteuil pour écrire, à dossier élevé, genre Louis XIII, en maroquin vert et en bois tourné. Je l’étrennerai demain en t’écrivant. Allons, ma vieille, tu t’es encore fâchée de ce que je t’ai dit sur la Saint-Sylvestre. Je t’avais dit cela tout bonnement pour te divertir. Je suis bien peu perspicace envers toi, à ce qu’il paraît. Ma science croule devant les femmes. Il est vrai que c’est un chapitre où la ligne suivante vous prouve toujours que l’on n’a rien entendu à la précédente.
Mille baisers sur ta bouche rose à la Mignon.
Voir Novembre, œuvres de jeunesse inédites, t. II, p. 173.
Tu me rappelles dans ta lettre que je t'en ai promis une pleine de tendresses. Je vais t'envoyer la vérité ou, si tu aimes mieux, je vais faire vis-à-vis de toi ma liquidation sentimentale non pour cause de faillite. (Ah ! il est joli celui-là.) Au sens élevé du mot, à ce sens merveilleux et rêvé qui rend les cœurs béants après cette manne impossible, eh bien non, ce n'est pas de l'amour. J'ai tant sondé ces matières-là dans ma jeunesse que j'en ai la tête étourdie pour le reste de mes jours. J'éprouve pour toi un mélange d'amitié, d'attrait, d'estime, d'attendrissement de cœur et d'entraînement de sens qui fait un tout complexe, dont je ne sais pas le nom mais qui me paraît solide. Il y a pour toi, en mon âme, des bénédictions mouillées. Tu y es en un coin, dans une petite place douce, à toi seule. Si j'en aime d'autres, tu y resteras néanmoins (il me semble) ; tu seras comme l'épouse, la préférée, celle à qui l'on retourne ; et puis n'est-ce pas en vertu d'un sophisme que l'on nierait le contraire ? Sonde-toi bien : y a-t-il un sentiment que tu aies eu qui soit disparu ? Non, tout reste, n'est-ce pas ? tout. Les momies que l'on a dans le cœur ne tombent jamais en poussière et, quand on penche la tête par le soupirail, on les voit en bas, qui vous regardent avec leurs yeux ouverts, immobiles.
Les sens, un jour, vous mènent ailleurs ; le caprice s'éprend à des chatoiements nouveaux. Qu'est-ce que cela fait ? Si je t'avais aimée dans le temps comme tu le voulais alors, je ne t'aimerais plus autant maintenant. Les affections qui suintent goutte à goutte de votre cœur finissent par y faire des stalactites. Cela vaut mieux que les grands torrents qui l'emportent. Voilà le vrai et je m'y tiens.
Oui je t'aime, ma pauvre Louise, je voudrais que ta vie fût douce de toute façon, et sablée, bordée de fleurs et de joies. J'aime ton beau et bon visage franc, la pression de ta main, le contact de ta peau sous mes lèvres. Si je suis dur pour toi, pense que c'est le contrecoup des tristesses, des nervosités âcres et des langueurs mortuaires qui me harcèlent ou me submergent. J'ai toujours au fond de moi comme l'arrière-saveur des mélancolies moyen âge de mon pays. Ça sent le brouillard, la peste rapportée d'Orient, et ça tombe de côté avec ses ciselures, ses vitraux et ses pignons de plomb, comme les vieilles maisons de bois de Rouen. C'est dans cette niche que vous demeurez, ma belle ; il y a beaucoup de punaises, grattez-vous.
Les sens, un jour, vous mènent ailleurs ; le caprice s'éprend à des chatoiements nouveaux. Qu'est-ce que cela fait ? Si je t'avais aimée dans le temps comme tu le voulais alors, je ne t'aimerais plus autant maintenant. Les affections qui suintent goutte à goutte de votre cœur finissent par y faire des stalactites. Cela vaut mieux que les grands torrents qui l'emportent. Voilà le vrai et je m'y tiens.
Oui je t'aime, ma pauvre Louise, je voudrais que ta vie fût douce de toute façon, et sablée, bordée de fleurs et de joies. J'aime ton beau et bon visage franc, la pression de ta main, le contact de ta peau sous mes lèvres. Si je suis dur pour toi, pense que c'est le contrecoup des tristesses, des nervosités âcres et des langueurs mortuaires qui me harcèlent ou me submergent. J'ai toujours au fond de moi comme l'arrière-saveur des mélancolies moyen âge de mon pays. Ça sent le brouillard, la peste rapportée d'Orient, et ça tombe de côté avec ses ciselures, ses vitraux et ses pignons de plomb, comme les vieilles maisons de bois de Rouen. C'est dans cette niche que vous demeurez, ma belle ; il y a beaucoup de punaises, grattez-vous.
142. À LOUISE COLET.
Jeudi soir. [17 septembre 1846.]
Du Camp est parti lundi soir pour le Maine. Il en reviendra dans un mois, vers le milieu d’octobre. Si l’Officiel arrive d’ici là, comment faire pour que tu reçoives mes lettres ? Je crois qu’en les adressant poste restante à un bureau de poste, soit à la Bourse par exemple, sous un nom convenu et en prévenant d’avance, on te les donnerait. C’est là, jusqu’au moment où Maxime sera revenu, ce qu’il y a de plus sage. Une fois de retour à Paris, ce sera très facile. Je lui écrirai à son adresse et je mettrai sur la lettre un signe qui signifiera que c’est pour toi. Il se chargera de te les faire parvenir aux heures où tu seras seule. Enfin, vous vous entendrez ensemble. Tu désirerais le voir, n’est-ce pas, pauvre amour ? Moi aussi je voudrais bien avoir quelqu’un avec qui causer de toi, qui te connût, qui ait été dans ton intérieur, qui puisse me parler de toi, ne fût-ce que [de] tes meubles ou de ta bonne.
Cent fois le jour je me retiens, prêt à dire ton nom ; à propos de rien il me vient toujours des comparaisons, des rapports, des antithèses dont tu es le centre. Toutes les petites étoiles de mon cœur convergent autour de ta planète, ô mon bel astre.
Je travaille le plus que je peux. Je suis resté cet après-midi sept heures sans bouger de mon fauteuil, et ce soir trois. Tout cela ne vaut pas deux heures d’un travail raisonnable. Ton image vient toujours comme un brouillard léger (tu sais, une de ces vapeurs matinales qui dansent et montent lumineuses, aériennes, rosées) entre mes yeux et les lignes qu’ils parcourent. Je relis l’Énéide, dont je me répète à satiété quelques vers ; il ne m’en faut pas plus pour longtemps. Je m’en fatigue l’esprit moi-même ; il y a des phrases qui me restent dans la tête et dont je suis obsédé, comme de ces airs qui vous reviennent toujours et qui vous font mal tant on les aime. Je lis toujours mon drame indien, et le soir je relis ce bon Boileau, le législateur du Parnasse. Voilà ma vie. Dis-moi toute la tienne, tout ; rien ne m’est insignifiant ou inutile. Tu me parles de chagrins que tu veux me cacher. Oh ! je t’en prie ; au nom de notre amour, dis-les-moi tous ; peut-être aurais-je un mot pour les adoucir ? Je suis mûr, tu sais. J’ai quelque expérience. Confie-toi à moi sur tout cela, non pas comme à un amant, mais comme à un vieil ami. Je veux être tout pour toi ; Je voudrais que ta vie matérielle dépendît de moi pour te l’entourer de soins, de luxe et de délicatesses recherchées. Je voudrais te voir écraser les autres, comme tu les écrases dans mon cœur quand je te compare à elles.
Ah ! si nous étions libres, nous voyagerions ensemble. C’est un rêve que je fais souvent, va. Quels rêves n’ai-je pas faits d’ailleurs ? C’est là mon infirmité à moi. Dis-moi donc tout ; conte-moi tes peines, tes soucis. Est-ce que je ne t’ai pas déjà donné assez des miens ? Je veux être utile à quelque chose enfin, puisque chaque jour s’écoule sans que je te puisse apporter une joie.
Un jour, plus tard (tu me parles de mes ennuis, c’est cela qui m’y fait penser), je t’étalerai la longue histoire de ma jeunesse. On en ferait un beau livre s’il se trouvait quelqu’un d’assez fort pour l’écrire ; ce ne sera pas moi. J’ai perdu déjà beaucoup. À 15 ans, j’avais certes plus d’imagination que je n’en ai. À mesure que j’avance, je perds en verve, en originalité, ce que j’acquiers peut-être en critique et en goût. J’arriverai, j’en ai peur, à ne plus oser écrire une ligne. La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche. Je ne mettrai pas tes lettres dans une cassette comme toi, mais dans le pupitre de ma sœur que je vais avoir là, sur la table où je lui donnais des leçons. Elle est là, à ma droite, recouverte d’une vieille étoffe de soie à ramages qui a été une robe de bal à ma grand’mère. Je ne mettrai pas autre chose dans ce pupitre. Maintenant tous mes trésors sont dans le tiroir d’une étagère. Sais-tu que je ne regarde jamais ta médaille sans attendrissement ? Tu n’imagines pas combien j’ai trouvé cela bon et singulier, tendre. Je me souviens de ta figure quand tu me l’as offerte. Je ne t’ai pas assez remerciée. J’en étais embarrassé et tout gauche ; j’étais sot et stupide. Oh ! un baiser pour cela, un bon baiser, un long, un doux, un de ceux dont parle Montaigne (les âcres baisers de la jeunesse, longs, savoureux, gluants).
Adieu ma pauvre, ma chère adorée (tu n’aimes pas ce mot-là, tant pis ! il m’est venu sous la plume). Écris-moi, pense à moi. Je prends ta jolie tête par les deux oreilles, et j’applique ta bouche sur la mienne. Il est minuit, Je vais me coucher, que le Dieu des songes t’envoie à moi !
Jeudi soir. [17 septembre 1846.]
Du Camp est parti lundi soir pour le Maine. Il en reviendra dans un mois, vers le milieu d’octobre. Si l’Officiel arrive d’ici là, comment faire pour que tu reçoives mes lettres ? Je crois qu’en les adressant poste restante à un bureau de poste, soit à la Bourse par exemple, sous un nom convenu et en prévenant d’avance, on te les donnerait. C’est là, jusqu’au moment où Maxime sera revenu, ce qu’il y a de plus sage. Une fois de retour à Paris, ce sera très facile. Je lui écrirai à son adresse et je mettrai sur la lettre un signe qui signifiera que c’est pour toi. Il se chargera de te les faire parvenir aux heures où tu seras seule. Enfin, vous vous entendrez ensemble. Tu désirerais le voir, n’est-ce pas, pauvre amour ? Moi aussi je voudrais bien avoir quelqu’un avec qui causer de toi, qui te connût, qui ait été dans ton intérieur, qui puisse me parler de toi, ne fût-ce que [de] tes meubles ou de ta bonne.
Cent fois le jour je me retiens, prêt à dire ton nom ; à propos de rien il me vient toujours des comparaisons, des rapports, des antithèses dont tu es le centre. Toutes les petites étoiles de mon cœur convergent autour de ta planète, ô mon bel astre.
Je travaille le plus que je peux. Je suis resté cet après-midi sept heures sans bouger de mon fauteuil, et ce soir trois. Tout cela ne vaut pas deux heures d’un travail raisonnable. Ton image vient toujours comme un brouillard léger (tu sais, une de ces vapeurs matinales qui dansent et montent lumineuses, aériennes, rosées) entre mes yeux et les lignes qu’ils parcourent. Je relis l’Énéide, dont je me répète à satiété quelques vers ; il ne m’en faut pas plus pour longtemps. Je m’en fatigue l’esprit moi-même ; il y a des phrases qui me restent dans la tête et dont je suis obsédé, comme de ces airs qui vous reviennent toujours et qui vous font mal tant on les aime. Je lis toujours mon drame indien, et le soir je relis ce bon Boileau, le législateur du Parnasse. Voilà ma vie. Dis-moi toute la tienne, tout ; rien ne m’est insignifiant ou inutile. Tu me parles de chagrins que tu veux me cacher. Oh ! je t’en prie ; au nom de notre amour, dis-les-moi tous ; peut-être aurais-je un mot pour les adoucir ? Je suis mûr, tu sais. J’ai quelque expérience. Confie-toi à moi sur tout cela, non pas comme à un amant, mais comme à un vieil ami. Je veux être tout pour toi ; Je voudrais que ta vie matérielle dépendît de moi pour te l’entourer de soins, de luxe et de délicatesses recherchées. Je voudrais te voir écraser les autres, comme tu les écrases dans mon cœur quand je te compare à elles.
Ah ! si nous étions libres, nous voyagerions ensemble. C’est un rêve que je fais souvent, va. Quels rêves n’ai-je pas faits d’ailleurs ? C’est là mon infirmité à moi. Dis-moi donc tout ; conte-moi tes peines, tes soucis. Est-ce que je ne t’ai pas déjà donné assez des miens ? Je veux être utile à quelque chose enfin, puisque chaque jour s’écoule sans que je te puisse apporter une joie.
Un jour, plus tard (tu me parles de mes ennuis, c’est cela qui m’y fait penser), je t’étalerai la longue histoire de ma jeunesse. On en ferait un beau livre s’il se trouvait quelqu’un d’assez fort pour l’écrire ; ce ne sera pas moi. J’ai perdu déjà beaucoup. À 15 ans, j’avais certes plus d’imagination que je n’en ai. À mesure que j’avance, je perds en verve, en originalité, ce que j’acquiers peut-être en critique et en goût. J’arriverai, j’en ai peur, à ne plus oser écrire une ligne. La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche. Je ne mettrai pas tes lettres dans une cassette comme toi, mais dans le pupitre de ma sœur que je vais avoir là, sur la table où je lui donnais des leçons. Elle est là, à ma droite, recouverte d’une vieille étoffe de soie à ramages qui a été une robe de bal à ma grand’mère. Je ne mettrai pas autre chose dans ce pupitre. Maintenant tous mes trésors sont dans le tiroir d’une étagère. Sais-tu que je ne regarde jamais ta médaille sans attendrissement ? Tu n’imagines pas combien j’ai trouvé cela bon et singulier, tendre. Je me souviens de ta figure quand tu me l’as offerte. Je ne t’ai pas assez remerciée. J’en étais embarrassé et tout gauche ; j’étais sot et stupide. Oh ! un baiser pour cela, un bon baiser, un long, un doux, un de ceux dont parle Montaigne (les âcres baisers de la jeunesse, longs, savoureux, gluants).
Adieu ma pauvre, ma chère adorée (tu n’aimes pas ce mot-là, tant pis ! il m’est venu sous la plume). Écris-moi, pense à moi. Je prends ta jolie tête par les deux oreilles, et j’applique ta bouche sur la mienne. Il est minuit, Je vais me coucher, que le Dieu des songes t’envoie à moi !
Quant aux autres jours, ç’a été comme les autres, l’eau a passé de même dans la rivière, mon chien a mangé sa soupe comme de coutume, les hommes ont couru, bu, mangé, dormi, et la civilisation, cet avorton ridé des efforts de l’homme, a marché, trottiné sur ses trottoirs, du port elle a regardé les bateaux à vapeur, le pont suspendu, les murailles bien blanches, les bordeaux protégés par la police, et chemin faisant, ivre et gaie, elle a déposé au coin des murs, avec les écailles d’huîtres et les tronçons de choux quelques unes de ses croyances, quelque lambeau bien fané de poésie ; et puis, détournant ses regards de la cathédrale et cachant sur ses contours gracieux, la pauvre petite fille déjà folle et glacée a pris la nature, l’a égratignée de ses ongles et s’est mise à rire et à crier tout haut, mais bien haut, avec une voix aigre et perçante : « J’avance ! »- pardon de t’avoir insultée, ô pardon, car tu es une bonne grosse fille qui marches tête baissée à travers le sang et les cadavres, qui ris quant tu écrases, qui livres tes grosses et sales mamelles à tous tes enfants, et qui as encore la gorge toute cuivrée et toute rougie des baisers que tu leur vends à prix d’or. Oh ! cette bonne civilisation, cette bon pâte de garce qui a inventé les chemins de fer, les prisons, les clysopompes, les tartes à la crème, la royauté et la guillotine ! – Tu me vois en bonne veine de délire et d’exaltation. Eh ! bon Dieu ! pourquoi, quand la plume court sur le papier, l’arrêter dans sa course, la faire passer subitement de la chaleur de la passion au froid de l’écritoire et lui faire gagner une fluxion de poitrine à cause de la sueur qu’elle a gagnée, cette pauvre plume.
146. À LOUISE COLET.
Mardi, 10 heures du matin. [22 septembre 1846.]
Je suis obligé d’aller à Rouen pour recevoir la statue que le mouleur de Phidias m’envoie (c’est l’Eau qui écoute, une de celles de la fontaine de Nîmes, tu sais). Je pensais n’y aller que demain pour divers arrangements de notre logement d’hiver et je voulais t’écrire ce soir tout à mon aise une lettre que j’aurais mise à la poste avant 11 heures, pour qu’elle t’arrivât le soir. Mais je n’irai pas demain. Tous ces dérangements m’assomment. Aussi je me dépêche bien vite de t’envoyer quelques bons baisers pendant que le domestique s’apprête. Merci de l’envoi de ce matin. J’attendais le facteur sur le quai, sans en avoir l’air, et tout en fumant. Ce bon facteur ! Je lui fais donner à la cuisine un verre de vin pour le rafraîchir ; il aime beaucoup la maison et est très exact. Hier il ne m’a rien apporté ; il n’a rien eu ! Tu m’envoies tout ce que tu peux trouver pour flatter mon amour ; tu me jettes, à moi, tous les hommages que tu reçois. J’ai lu la lettre de Platon avec toute l’intensité dont mon intelligence est susceptible ; j’y ai vu beau-coup, énormément. Le fond du cœur de cet homme-là, quoi qu’il fasse pour le montrer calme, est froid et vide ; sa vie est triste et rien n’y rayonne, j’en suis sûr. Mais il t’a beaucoup aimée et il t’aime encore d’un amour profond et solitaire ; cela lui durera longtemps. Sa lettre m’a fait mal ; j’ai découvert jusqu’au fond l’intérieur de cette existence blafarde, remplie de travaux conçus sans enthousiasme et exécutés avec un entêtement enragé qui, seul, le soutient. Ton amour y jetait un peu de joie, il s’y cramponnait avec l’appétit que les vieillards ont pour la vie. Tu étais sa dernière passion et la seule chose qui le consolât de lui-même. Il est, je crois, jaloux de Béranger ; la vie et la gloire de cet homme ne doivent pas lui plaire. Le philosophe, d’ordinaire, est une espèce d’être bâtard entre le savant et le poète, et qui porte envie à l’un et à l’autre. La métaphysique vous met beaucoup d’âcreté dans le sang ; c’est très curieux et très amusant. J’y ai travaillé avec assez d’ardeur pendant deux ans, mais c’est un temps perdu que je regrette. Tu dis un mot bien vrai : « l’amour est une grande comédie et la vie aussi, quand on n’y est pas acteur » ; seulement je n’admets pas que ça fasse rire. Il y a à peu près dix-huit mois, j’ai fait cette expérience sur nature vivante, c’est-à-dire que l’expérience s’est trouvée faite d’elle-même ; c’est moi qui n’ai pas voulu la voir complète. Je fréquentais une maison où il y avait une jeune fille charmante, admirablement belle, d’une beauté toute chrétienne et presque gothique, si je puis dire. Elle avait un esprit naïf, facile à l’émotion ; elle pleurait et riait tour à tour, comme il fait tour à tour pluie et soleil. J’agitais au gré de ma parole tout ce beau cœur où il n’y avait rien que de pur. Je la vois encore couchée sur son oreiller rose et me regardant, quand je lisais, avec ses grands yeux bleus. Un jour, nous étions seuls, assis sur un canapé ; elle me prit la main, me passa ses doigts dans les miens ; je me laissais faire sans penser à rien du tout, car je suis très innocent la plupart du temps, et elle me regarda avec un regard… qui me fait froid encore. La mère entra là-dessus, elle comprit tout et sourit en songeant à la consommation du gendre. Je n’oublierai pas ce sourire ; c’est ce que j’ai vu de plus sublime. Il était composé d’indulgence bénigne et de canaillerie supérieure. Je suis sûr que la pauvre fille s’était laissée aller à un mouvement de tendresse invincible, à une de ces fadeurs de l’âme où il semble que tout ce qu’on a en vous se liquéfie et se dissout, agonie voluptueuse qui serait pleine de délices, si on n’était prêt à éclater en sanglots ou à fondre en larmes. Tu ne peux pas te figurer l’impression de terreur que j’en ai ressentie. Je suis revenu chez moi bouleversé et me reprochant de vivre. Je ne sais pas si je m’étais exagéré les choses, mais moi qui ne l’aimais pas, j’aurais donné ma vie avec plaisir pour racheter ce regard d’amour triste auquel le mien n’avait pas répondu.
Je t’engage à faire le pendant de la Provinciale à Paris, le colon à Paris, comme tu en as le dessein. Quelle atroce invention que celle du bourgeois, n’est-ce pas ? Pourquoi est-il sur la terre, et qu’y fait-il, le misérable ? Pour moi, je ne sais pas à quoi peuvent passer leur temps ici les gens qui ne s’occupent pas d’art. La manière dont ils vivent est un problème. Tu as peut-être raison sur ce que tu me dis que trop lire éteint l’imagination, l’élément individuel, seule chose après tout qui ait quelque valeur. Mais je suis engagé dans un tas de travaux qu’il faut que je finisse, et puis maintenant j’ai toujours peur d’écrire, de manquer mes plans ; de sorte que je recule devant l’exécution. Attends, pour m’envoyer ce que tu veux, que Du Camp soit revenu. À son retour, il viendra ici deux jours. J’attends néanmoins très incessamment la fin de Mantes.
Adieu, il est temps que je parte. À toi, cher amour, celui qui t’aime et t’embrasse sur les seins. Regarde-les et dis : Il rêve votre rondeur et son désir pose sa tête sur vous.
Mardi, 10 heures du matin. [22 septembre 1846.]
Je suis obligé d’aller à Rouen pour recevoir la statue que le mouleur de Phidias m’envoie (c’est l’Eau qui écoute, une de celles de la fontaine de Nîmes, tu sais). Je pensais n’y aller que demain pour divers arrangements de notre logement d’hiver et je voulais t’écrire ce soir tout à mon aise une lettre que j’aurais mise à la poste avant 11 heures, pour qu’elle t’arrivât le soir. Mais je n’irai pas demain. Tous ces dérangements m’assomment. Aussi je me dépêche bien vite de t’envoyer quelques bons baisers pendant que le domestique s’apprête. Merci de l’envoi de ce matin. J’attendais le facteur sur le quai, sans en avoir l’air, et tout en fumant. Ce bon facteur ! Je lui fais donner à la cuisine un verre de vin pour le rafraîchir ; il aime beaucoup la maison et est très exact. Hier il ne m’a rien apporté ; il n’a rien eu ! Tu m’envoies tout ce que tu peux trouver pour flatter mon amour ; tu me jettes, à moi, tous les hommages que tu reçois. J’ai lu la lettre de Platon avec toute l’intensité dont mon intelligence est susceptible ; j’y ai vu beau-coup, énormément. Le fond du cœur de cet homme-là, quoi qu’il fasse pour le montrer calme, est froid et vide ; sa vie est triste et rien n’y rayonne, j’en suis sûr. Mais il t’a beaucoup aimée et il t’aime encore d’un amour profond et solitaire ; cela lui durera longtemps. Sa lettre m’a fait mal ; j’ai découvert jusqu’au fond l’intérieur de cette existence blafarde, remplie de travaux conçus sans enthousiasme et exécutés avec un entêtement enragé qui, seul, le soutient. Ton amour y jetait un peu de joie, il s’y cramponnait avec l’appétit que les vieillards ont pour la vie. Tu étais sa dernière passion et la seule chose qui le consolât de lui-même. Il est, je crois, jaloux de Béranger ; la vie et la gloire de cet homme ne doivent pas lui plaire. Le philosophe, d’ordinaire, est une espèce d’être bâtard entre le savant et le poète, et qui porte envie à l’un et à l’autre. La métaphysique vous met beaucoup d’âcreté dans le sang ; c’est très curieux et très amusant. J’y ai travaillé avec assez d’ardeur pendant deux ans, mais c’est un temps perdu que je regrette. Tu dis un mot bien vrai : « l’amour est une grande comédie et la vie aussi, quand on n’y est pas acteur » ; seulement je n’admets pas que ça fasse rire. Il y a à peu près dix-huit mois, j’ai fait cette expérience sur nature vivante, c’est-à-dire que l’expérience s’est trouvée faite d’elle-même ; c’est moi qui n’ai pas voulu la voir complète. Je fréquentais une maison où il y avait une jeune fille charmante, admirablement belle, d’une beauté toute chrétienne et presque gothique, si je puis dire. Elle avait un esprit naïf, facile à l’émotion ; elle pleurait et riait tour à tour, comme il fait tour à tour pluie et soleil. J’agitais au gré de ma parole tout ce beau cœur où il n’y avait rien que de pur. Je la vois encore couchée sur son oreiller rose et me regardant, quand je lisais, avec ses grands yeux bleus. Un jour, nous étions seuls, assis sur un canapé ; elle me prit la main, me passa ses doigts dans les miens ; je me laissais faire sans penser à rien du tout, car je suis très innocent la plupart du temps, et elle me regarda avec un regard… qui me fait froid encore. La mère entra là-dessus, elle comprit tout et sourit en songeant à la consommation du gendre. Je n’oublierai pas ce sourire ; c’est ce que j’ai vu de plus sublime. Il était composé d’indulgence bénigne et de canaillerie supérieure. Je suis sûr que la pauvre fille s’était laissée aller à un mouvement de tendresse invincible, à une de ces fadeurs de l’âme où il semble que tout ce qu’on a en vous se liquéfie et se dissout, agonie voluptueuse qui serait pleine de délices, si on n’était prêt à éclater en sanglots ou à fondre en larmes. Tu ne peux pas te figurer l’impression de terreur que j’en ai ressentie. Je suis revenu chez moi bouleversé et me reprochant de vivre. Je ne sais pas si je m’étais exagéré les choses, mais moi qui ne l’aimais pas, j’aurais donné ma vie avec plaisir pour racheter ce regard d’amour triste auquel le mien n’avait pas répondu.
Je t’engage à faire le pendant de la Provinciale à Paris, le colon à Paris, comme tu en as le dessein. Quelle atroce invention que celle du bourgeois, n’est-ce pas ? Pourquoi est-il sur la terre, et qu’y fait-il, le misérable ? Pour moi, je ne sais pas à quoi peuvent passer leur temps ici les gens qui ne s’occupent pas d’art. La manière dont ils vivent est un problème. Tu as peut-être raison sur ce que tu me dis que trop lire éteint l’imagination, l’élément individuel, seule chose après tout qui ait quelque valeur. Mais je suis engagé dans un tas de travaux qu’il faut que je finisse, et puis maintenant j’ai toujours peur d’écrire, de manquer mes plans ; de sorte que je recule devant l’exécution. Attends, pour m’envoyer ce que tu veux, que Du Camp soit revenu. À son retour, il viendra ici deux jours. J’attends néanmoins très incessamment la fin de Mantes.
Adieu, il est temps que je parte. À toi, cher amour, celui qui t’aime et t’embrasse sur les seins. Regarde-les et dis : Il rêve votre rondeur et son désir pose sa tête sur vous.
Videos de Gustave Flaubert (132)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Et si l'une des meilleures façons de plonger dans l'oeuvre d'un classique était de contourner momentanément ses romans pour découvrir sa correspondance, c'est-à-dire l'homme derrière la statue, l'homme mis à nu ?
La « Correspondance » de Flaubert, c'est à lire en poche chez Folio.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Et si l'une des meilleures façons de plonger dans l'oeuvre d'un classique était de contourner momentanément ses romans pour découvrir sa correspondance, c'est-à-dire l'homme derrière la statue, l'homme mis à nu ?
La « Correspondance » de Flaubert, c'est à lire en poche chez Folio.
autres livres classés : correspondanceVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gustave Flaubert (142)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Éducation Sentimentale
Fumichon, concernant la propriété, évoque les arguments d'un homme politique dont Flaubert parle en ces terme dans une lettre à George Sand: "Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croûtard plus abject, un plus étroniforme bourgeois! Non! Rien ne peut donner l'idée du vomissement que m'inspire ce vieux melon diplomatique, arrondissant sa bêtise sur le fumier de la Bourgeoisie!". De qui s'agit-il?
Benjamin Constant
Adolphe Thiers
Proudhon
Frédéric Bastiat
Turgot
8 questions
174 lecteurs ont répondu
Thème : L'Education sentimentale de
Gustave FlaubertCréer un quiz sur ce livre174 lecteurs ont répondu