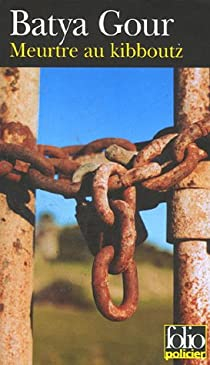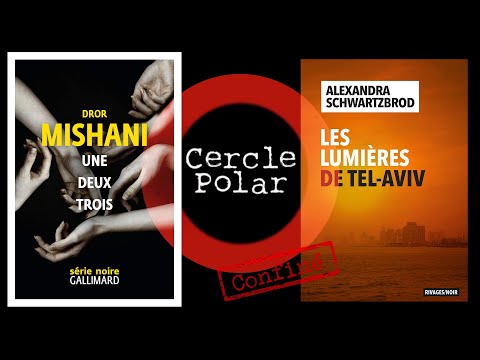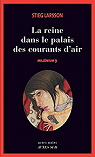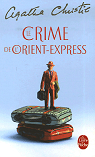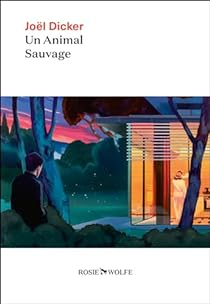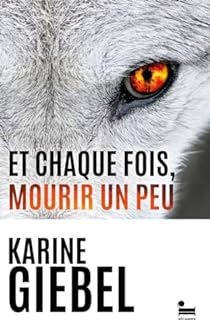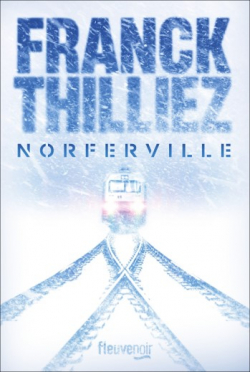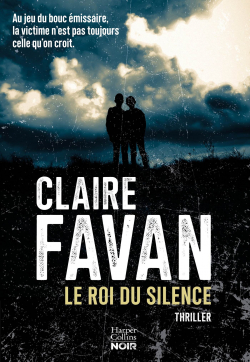Batya GourCommissaire Michael Ohayon tome 3 sur 6
Rosie Pinhas-Delpuech (Traducteur)/5 57 notes
Rosie Pinhas-Delpuech (Traducteur)/5 57 notes
Résumé :
Deux meurtres -à tout le moins deux morts suspectes : voilà une catastrophe, un véritable traumatisme pour le kibboutz tout entier. Car le kibboutz est une famille, une seule grande famille, où toutes les décisions sont prises en commun à main levée, où dès le plus jeune âge les enfants sont séparés chaque soir de leurs parents.
Un monde complexe, aussi, très fermé, par-delà l'ordre impeccable de ses champs, de son centre industriel, de ses bâtiments ... >Voir plus
Un monde complexe, aussi, très fermé, par-delà l'ordre impeccable de ses champs, de son centre industriel, de ses bâtiments ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Meurtre au kibboutzVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (13)
Voir plus
Ajouter une critique
Un meurtre au kibboutz, dans cette grande famille, cela semblait impossible et pourtant…
Un roman où l'intrigue policière prend moins de place que la description de l'environnement particulier du kibboutz. Cela devient presque pédagogique : une explication du fonctionnement, des mécanismes démocratiques et des enjeux sociaux de ces communautés disparates installées dans le désert. On y verra les tensions entre les traditions et la modernité, on discutera par exemple, de l'opportunité de laisser les enfants coucher dans leur famille plutôt que tous ensemble dans un dortoir, ou encore, de la possibilité de construire une maison de retraite pour les vieillards.
Dans ce décor moins familier, le commissaire Ohayon est chargé d'une enquête difficile, car un homme politique est mêlé à l'affaire. le policier y utilise toutefois des méthodes un peu surprenantes vues d'ici, comme enregistrer des témoins à leur insu.
Un polar à lire davantage pour le dépaysement que pour le suspens.
Un roman où l'intrigue policière prend moins de place que la description de l'environnement particulier du kibboutz. Cela devient presque pédagogique : une explication du fonctionnement, des mécanismes démocratiques et des enjeux sociaux de ces communautés disparates installées dans le désert. On y verra les tensions entre les traditions et la modernité, on discutera par exemple, de l'opportunité de laisser les enfants coucher dans leur famille plutôt que tous ensemble dans un dortoir, ou encore, de la possibilité de construire une maison de retraite pour les vieillards.
Dans ce décor moins familier, le commissaire Ohayon est chargé d'une enquête difficile, car un homme politique est mêlé à l'affaire. le policier y utilise toutefois des méthodes un peu surprenantes vues d'ici, comme enregistrer des témoins à leur insu.
Un polar à lire davantage pour le dépaysement que pour le suspens.
C'est au kibboutz que nous emmène cette fois-ci Batya Gour, dans cette troisième enquête du commissaire Michaël Ohayon. le départ est un peu long, pour qui attend le déclenchement de l'enquête avec impatience, ce qui n'arrivera pas avant la page 104 (éditions Fayard). Muté depuis deux mois à l'Unité nationale d'enquêtes sur les crimes graves à titre de commissaire en chef, et chef de l'Équipe spéciale d'investigation, le commissaire Michaël Ohayon doit enquêter sur une affaire délicate, la mort d'une femme qui était secrétaire dans un kibboutz. Ce n'est pas nécessairement l'enquête qui captive dans cet opus, elle est même en fait un peu brouillonne - la faute au commissaire qui a la fâcheuse tendance à faire cavalier seul -, c'est le lieu où elle se produit. Batya Gour donne à voir ce qui se voulait un idéal de vie, dans toute sa complexité. Dépaysant et instructif sur le plan social et historique.
Nous voici plongés dans la vie quotidienne d'un kibboutz. de la cantine aux «chambres», terme qui désigne le logement des kibboutzniki, en passant par le dispensaire ou les entrepôts, nous découvrons l'organisation sociale et les règles de vie de la communauté. L'idéal égalitaire des membres, la générosité des principes et le partage des tâches masquent de plus en plus difficilement les tensions qui résultent des nouveaux enjeux de la société israélienne et qui naissent des contraintes de la modernité. Les objectifs des fondateurs des kibboutzim paraissent dévalorisés dans un monde de plus en plus matérialiste, confronté aux appétits du marché, à la recherche du profit et à l'individualisme croissant des nouvelles générations. Les débats deviennent de plus en plus difficiles entre les pionniers d'une part, combattants de la première heure ou rescapés de la shoah, et les sabras d'autre part, nés en Israël et élevés dans le cocon du kibboutz. Ces derniers sont de plus en plus décidés à faire évoluer des règles de vie qui leur paraissent dépassées dans le monde d'aujourd'hui. Faut-il continuer à élever les enfants à l'écart de leur famille naturelle ? Faut-il installer les vieillards dans des maisons de retraite? Faut-il placer les revenus du kibboutz en Bourse ou développer les équipements collectifs ? Ces questions soulèvent des discussions passionnées dans le kibboutz car elles touchent à l'essence même du système kibboutznique.
Lorsque la secrétaire du kibboutz meurt à la suite d'un empoisonnement criminel, ce petit monde clos menace d'éclater devant la violence du choc engendré par le crime. L'équipe du commissaire Michaël Ohayon chargé de l'enquête, affronte le désarroi et la peur dans un lieu auparavant préservé des maux de la société moderne. Un second meurtre fait encore vaciller davantage le fragile équilibre du kibboutz. le refus du changement, la crainte de renoncer à un mode de vie acquis au prix de sacrifices quotidiens expliqueront cette dérive meurtrière.
L'intérêt du livre de Batya Gour réside dans la description minutieuse d'un univers qui nous est, pour beaucoup, inconnu. La sécheresse du trait restitue un peu de l'austérité de la vie des premiers kibboutzniki. La société israélienne nous apparaît dans sa diversité et ses contradictions et le personnage de Michaël Ohayon, qui manque parfois un peu de relief, possède une retenue et une pudeur touchantes.
Lorsque la secrétaire du kibboutz meurt à la suite d'un empoisonnement criminel, ce petit monde clos menace d'éclater devant la violence du choc engendré par le crime. L'équipe du commissaire Michaël Ohayon chargé de l'enquête, affronte le désarroi et la peur dans un lieu auparavant préservé des maux de la société moderne. Un second meurtre fait encore vaciller davantage le fragile équilibre du kibboutz. le refus du changement, la crainte de renoncer à un mode de vie acquis au prix de sacrifices quotidiens expliqueront cette dérive meurtrière.
L'intérêt du livre de Batya Gour réside dans la description minutieuse d'un univers qui nous est, pour beaucoup, inconnu. La sécheresse du trait restitue un peu de l'austérité de la vie des premiers kibboutzniki. La société israélienne nous apparaît dans sa diversité et ses contradictions et le personnage de Michaël Ohayon, qui manque parfois un peu de relief, possède une retenue et une pudeur touchantes.
D'abord un peu d'éthique sociale avec la présentation d'un kibboutz, ses familles, ses élus et en somme, de cette microsociété qui se comporte comme un véritable état autonome avec des lois et ses comités de décisions partagées, élus par leurs membres. Un milieu très fermé et difficile à comprendre et donc de pénétrer même pour la police surtout lorsqu'il y a mort violente inexplicable.
Un peu long cette mise en train, mais les problèmes abordés par Batya Gour permettent de bien comprendre le fonctionnement du kibboutz et surtout la mentalité complexe de ses kibboutzniks : les anciens les sionistes et ceux qui ont échappé à la Shoah, leurs enfant qui vivent encore du mythe et essaient de le faire perdurer et les jeunes qui aspirent à une vie autrement plus conforme à ce qui se fait à l'extérieur du kibboutz. Des valeurs socialistes, communistes de partage et de coopération autogestionnaire libertaire
C'est très intéressant en soi et ce procédé permet de mettre en place tous les acteurs du drame avant l'arrivée du Hercule Poirot israélien, celui-ci mandaté par toutes sortes de polices d'Israël. le statut du kibboutz, la présence d'un député de la knesset nécessite une grande coordination des polices politiques et criminelle car elles marchent sur des oeufs.
Ici c'est un travail collectif et non un travail solitaire d'un super flic, travail conséquent avec ses rivalités, ses problèmes d'egos des enquêteurs, l'émulation entre services, les contraintes politiques et juridiques. Pourtant Michaël Ohayon, le commissaire, se sent de taille a faire cavalier seul et n'est pas très regardant sur la forme et les procédures, il provoque un petit séisme dans ce monde paisible, bucolique et routinier
Bien difficile de comprendre cette mort d'Osnat une responsable du kibboutz , mort naturelle des suites d'une pneumonie ou de la piqûre des soins, suicide ou meurtre. Personne n'y met du sien! Lorsqu'une mort naturelle précédente d'un « ancien » responsable devient suspecte lors d'une autopsie qui met en évidence la présence un pesticide très mortel l'enquête qui patine prend de l'ampleur.
Bref au pays de Yahvé il y a aussi des assassins car les affaires des hommes sont parfois violentes mais Michaël Ohayon est là pour les traduire devant la justice des hommes
De bons portraits fouillés de personnages qui ont une épaisseur certaine, une atmosphère lourde et poisseuse, une écriture féminine, prenante et assez marquée et somme toute un bon sujet qu'on ne rencontre guère dans les polars et plutôt d'actualité c'est à dire presque un écopolar… enfin pas tout à fait
Un peu long cette mise en train, mais les problèmes abordés par Batya Gour permettent de bien comprendre le fonctionnement du kibboutz et surtout la mentalité complexe de ses kibboutzniks : les anciens les sionistes et ceux qui ont échappé à la Shoah, leurs enfant qui vivent encore du mythe et essaient de le faire perdurer et les jeunes qui aspirent à une vie autrement plus conforme à ce qui se fait à l'extérieur du kibboutz. Des valeurs socialistes, communistes de partage et de coopération autogestionnaire libertaire
C'est très intéressant en soi et ce procédé permet de mettre en place tous les acteurs du drame avant l'arrivée du Hercule Poirot israélien, celui-ci mandaté par toutes sortes de polices d'Israël. le statut du kibboutz, la présence d'un député de la knesset nécessite une grande coordination des polices politiques et criminelle car elles marchent sur des oeufs.
Ici c'est un travail collectif et non un travail solitaire d'un super flic, travail conséquent avec ses rivalités, ses problèmes d'egos des enquêteurs, l'émulation entre services, les contraintes politiques et juridiques. Pourtant Michaël Ohayon, le commissaire, se sent de taille a faire cavalier seul et n'est pas très regardant sur la forme et les procédures, il provoque un petit séisme dans ce monde paisible, bucolique et routinier
Bien difficile de comprendre cette mort d'Osnat une responsable du kibboutz , mort naturelle des suites d'une pneumonie ou de la piqûre des soins, suicide ou meurtre. Personne n'y met du sien! Lorsqu'une mort naturelle précédente d'un « ancien » responsable devient suspecte lors d'une autopsie qui met en évidence la présence un pesticide très mortel l'enquête qui patine prend de l'ampleur.
Bref au pays de Yahvé il y a aussi des assassins car les affaires des hommes sont parfois violentes mais Michaël Ohayon est là pour les traduire devant la justice des hommes
De bons portraits fouillés de personnages qui ont une épaisseur certaine, une atmosphère lourde et poisseuse, une écriture féminine, prenante et assez marquée et somme toute un bon sujet qu'on ne rencontre guère dans les polars et plutôt d'actualité c'est à dire presque un écopolar… enfin pas tout à fait
Continuant ma découverte du monde du polar, grâce au challenge chez Delph, j'ai sélectionné ce titre de Batya Gour, une auteur israélienne, uniquement pour le décor, le cadre original dans lequel se déroule l'enquête criminelle : un kibboutz.
Un peu un mystère pour moi... je sais qu'il est question de vie en communauté et de collectivisme, d'exploitation de la terre, de pionniers du sionisme mais ça reste assez flou pour moi.
Alors ce livre, je l'ai pris comme une excellente occasion de me renseigner sur le sujet tout en explorant le genre policier.
Osnat, la secrétaire d'un kibboutz (rang important) vient de mourir à l'infirmerie dudit kibboutz où elle venait d'être admise quelques heures plutôt pour une soi-disant pneumonie.
L'autopsie révèle très vite qu'elle a été empoisonnée par un insecticide.
Le commissaire Michaël Ohayon, un personnage récurrent de l'auteure, nouvellement promu au sein d'une unité spécialisée dans les crimes graves, est chargé de l'enquête. Il s'avère qu'une personnalité du pays est mêlée à l'affaire : un député qui entretenait une liaison depuis peu avec la défunte.
Vous pourriez penser que je viens de vous résumer les premières pages du livre.
Que nenni !
Le commissaire Ohayon et ses collègues n'entrent en scène qu'au bout de 120 pages, soit à un quart du livre.
Surprenant.
Dès le début, Batya Gour immerge son lecteur dans l'ambiance du kibboutz riche, qui ne vit plus de l'agriculture mais qui fait fortune en fabriquant en exclusivité un produit anti-ride.
Le narrateur est externe et suit les pas de Aharon Meroz, le fameux membre de la Knesset, qui fait son retour au kibboutz juste le temps d'assister à une fête traditionnelle.
Le kibboutz qui l'avait accueilli étant enfant, tout comme Osnat (la morte), avec qui il a été élevé au sein de la famille de Moysh, l'actuel directeur du kibboutz.
Aharon a quitté le kibboutz à 24 ans, pour poursuivre des études de droit, ou par dépit amoureux, ou un peu les deux. Il a réussi à l'extérieur et n'est jamais revenu vivre au kibboutz. Lui qui n'était pas né à l'intérieur n'a pas été gagné par ce sentiment d'appartenance unique qui unit les kibboutznikim entre eux, contrairement à Osnat qui, elle, est restée, s'est y largement investie et a nourri de grands espoirs de changements.
La première centaine de pages est donc entièrement vouée à planter le décor et les personnages.
À ce titre, j'ai apprécié tout ce que j'ai appris sur la gestion d'un kibboutz, les enjeux actuels entre volonté de s'ouvrir à un certain individualisme (prendre ses repas chez soi, le coucher familial) d'un côté et l'envie de respecter le fonctionnement traditionnel de la communauté collectiviste (les repas pris ensemble, les enfants dorment ensemble, en dehors de la famille).
Par contre, pour qui s'attendait à être plongé directement au coeur de l'intrigue, c'est loupé !
Oui, ce polar n'a rien d'hyper captivant au niveau de l'enquête policière, qui n'est somme tout qu'un prétexte à un état des lieux des kibboutzim, oscillant entre traditionalisme et modernité.
critique complète sur mon blog, merci
Lien : http://linecesurinternet.blo..
Un peu un mystère pour moi... je sais qu'il est question de vie en communauté et de collectivisme, d'exploitation de la terre, de pionniers du sionisme mais ça reste assez flou pour moi.
Alors ce livre, je l'ai pris comme une excellente occasion de me renseigner sur le sujet tout en explorant le genre policier.
Osnat, la secrétaire d'un kibboutz (rang important) vient de mourir à l'infirmerie dudit kibboutz où elle venait d'être admise quelques heures plutôt pour une soi-disant pneumonie.
L'autopsie révèle très vite qu'elle a été empoisonnée par un insecticide.
Le commissaire Michaël Ohayon, un personnage récurrent de l'auteure, nouvellement promu au sein d'une unité spécialisée dans les crimes graves, est chargé de l'enquête. Il s'avère qu'une personnalité du pays est mêlée à l'affaire : un député qui entretenait une liaison depuis peu avec la défunte.
Vous pourriez penser que je viens de vous résumer les premières pages du livre.
Que nenni !
Le commissaire Ohayon et ses collègues n'entrent en scène qu'au bout de 120 pages, soit à un quart du livre.
Surprenant.
Dès le début, Batya Gour immerge son lecteur dans l'ambiance du kibboutz riche, qui ne vit plus de l'agriculture mais qui fait fortune en fabriquant en exclusivité un produit anti-ride.
Le narrateur est externe et suit les pas de Aharon Meroz, le fameux membre de la Knesset, qui fait son retour au kibboutz juste le temps d'assister à une fête traditionnelle.
Le kibboutz qui l'avait accueilli étant enfant, tout comme Osnat (la morte), avec qui il a été élevé au sein de la famille de Moysh, l'actuel directeur du kibboutz.
Aharon a quitté le kibboutz à 24 ans, pour poursuivre des études de droit, ou par dépit amoureux, ou un peu les deux. Il a réussi à l'extérieur et n'est jamais revenu vivre au kibboutz. Lui qui n'était pas né à l'intérieur n'a pas été gagné par ce sentiment d'appartenance unique qui unit les kibboutznikim entre eux, contrairement à Osnat qui, elle, est restée, s'est y largement investie et a nourri de grands espoirs de changements.
La première centaine de pages est donc entièrement vouée à planter le décor et les personnages.
À ce titre, j'ai apprécié tout ce que j'ai appris sur la gestion d'un kibboutz, les enjeux actuels entre volonté de s'ouvrir à un certain individualisme (prendre ses repas chez soi, le coucher familial) d'un côté et l'envie de respecter le fonctionnement traditionnel de la communauté collectiviste (les repas pris ensemble, les enfants dorment ensemble, en dehors de la famille).
Par contre, pour qui s'attendait à être plongé directement au coeur de l'intrigue, c'est loupé !
Oui, ce polar n'a rien d'hyper captivant au niveau de l'enquête policière, qui n'est somme tout qu'un prétexte à un état des lieux des kibboutzim, oscillant entre traditionalisme et modernité.
critique complète sur mon blog, merci
Lien : http://linecesurinternet.blo..
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Les gens sont prisonniers de schémas et de comportements dans leurs rapports familiaux. Ils ne sont plus capables de distinguer entre leur moi individuel et leur moi familial, et toute nouvelle approche leur parait impossible. Au kibboutz, c’est la même chose, avec cette différence qu’il s’agit d’une famille de trois cents personnes.
(Fayard, p. 266)
(Fayard, p. 266)
- Il y a un certain nombres de choses que j'ai apprises, et il y a des livres.
- Des livres. Oui, c'est très important les livres, mais ce n'est pas la vie. Les livres ne sont que des livres.
- Je ne suis pas d'accord.
- Des livres. Oui, c'est très important les livres, mais ce n'est pas la vie. Les livres ne sont que des livres.
- Je ne suis pas d'accord.
- Les détournements de fonds, ce n'est pas nouveau dans les kibboutzim. Nous avons déjà clos trois dossiers comme celui-ci parce qu'ils ont préféré étouffer l'affaire. C'est toujours la même histoire, sauf que les gens ouvrent un compte en ville et mettent l'argent à leur nom. C'est ça que je voulais trouver. Et bien c'est ce que nous avons trouvé.
- Oui, mais le compte n'est pas à son nom, il est à celui d'Osnat, répliqua Sarit.
- Oui, mais le compte n'est pas à son nom, il est à celui d'Osnat, répliqua Sarit.
Videos de Batya Gour (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Une Française, Alexandra Schwarzbrod, et un Israélien, Dror Mishani, publient au même moment deux romans qui mettent en scène Israël et en particulier Tel-Aviv. Deux regards et deux styles très différents. D'autant plus marquants que les polars israéliens sont rares. L'occasion de rappeler l'oeuvre d'une pionnière du genre dans ce pays, Batya Gour.
"Les lumières de Tel-Aviv" d'Alexandra Schwartzbrod, éd. Rivages/Noir "Une deux trois" de Dror Mishani, traduit de l'hébreu par Laurence Sandrowicz, éd. Gallimard/Série noire Les deux livres sont disponibles en numérique.
UNE ÉMISSION ANIMÉE PAR Michel Abescat Christine Ferniot
RÉALISATION Pierrick Allain
TÉLÉRAMA - AVRIL 2020
"Les lumières de Tel-Aviv" d'Alexandra Schwartzbrod, éd. Rivages/Noir "Une deux trois" de Dror Mishani, traduit de l'hébreu par Laurence Sandrowicz, éd. Gallimard/Série noire Les deux livres sont disponibles en numérique.
UNE ÉMISSION ANIMÉE PAR Michel Abescat Christine Ferniot
RÉALISATION Pierrick Allain
TÉLÉRAMA - AVRIL 2020
+ Lire la suite
autres livres classés : romans policiers et polarsVoir plus

Millénium, tome 1 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes
Stieg Larsson
813
critiques
202
citations
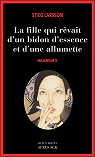
Millénium, tome 2 : La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette
Stieg Larsson
408
critiques
121
citations
Les plus populaires : Polar et thriller
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Batya Gour (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (6 - polars et thrillers )
Roger-Jon Ellory : " **** le silence"
seul
profond
terrible
intense
20 questions
2867 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, thriller
, romans policiers et polarsCréer un quiz sur ce livre2867 lecteurs ont répondu